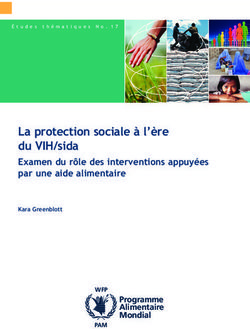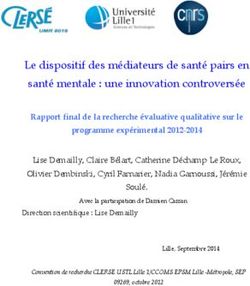ÉTUDE SUR LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS - état des lieux mai 2021 - IOM
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
ÉTUDE SUR LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS
état des lieux
mai 2021
Sous la direction de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM),
en coopération avec le Comité National de Coordination de la Lutte contre
la Traite des personnes et les pratiques assimilées, et le financement de
l’Ambassade des Pays-bas au Mali.
Étude réalisée par Marine Rousselot White et Barnabas GuindoL’Organisation internationale pour les migrations (l’OIM) croit fermement que les migrations ordonnées, s’effectuant dans des
conditions décentes, profitent à la fois aux migrants et à la société tout entière. En tant qu’organisation intergouvernementale,
l’OIM collabore avec ses partenaires de la communauté internationale en vue de résoudre les problèmes pratiques de la
migration, de mieux faire comprendre les questions de migration, d’encourager le développement économique et social grâce
à la migration et de promouvoir le respect effectif de la dignité humaine et le bien-être des migrants.
Cette étude sur la traite des êtres humains au Mali a été réalisée avec le soutien financier de l'Ambassade
des Pays-Bas au Mali.
Les opinions exprimées dans ce document sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les vues et politiques
officielles des Pays-Bas ou de l’OIM. Les désignations utilisées dans ce document n’impliquent aucune expression de la part
des Pays-Bas ou de l’OIM concernant le statut juridique du pays, d’un territoire, d’une ville ou d’une région, ou de leurs
autorités, concernant leurs institutions, frontières ou limites.
Editeur : Organisation internationale pour les migrations
Quartier Badalabougou
Rue Gamal A Nasser, Porte 756
B.P.288
Bamako, Mali
Tél. : +223 20 22 76 97
+223 20 22 76 98
Émail : iombamako@iom.int
Site Web : mali.iom.int
© 2021 Organisation internationale pour les migrations (OIM)
Tous droits réservés. Aucun élément du présent ouvrage ne peut être reproduit, archivé ou transmis par quelque moyen que
ce soit – électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autres sans l’autorisation écrite et préalable de l’éditeur.
© IOM/2016
P2TABLE DES MATIÈRES
TERMINOLOGIES..................................................................................................................................................................5
ACRONYMES ET LISTE DES ABRÉVIATIONS...................................................................................................6
RÉSUMÉ EXÉCUTIF............................................................................................................................................................9
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS.......................................................................................................15
SECTION 1 : CADRE CONCEPTUEL ET PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE........................................................................18
A- HISTORIQUE ET CONTEXTE DU PROJET ............................................................................................................................18
B- OBJECTIFS ATTENDUS DE L'ÉTUDE (TDR)..........................................................................................................19
C- MÉTHODOLOGIE ET LIMITES DE L'ÉTUDE.....................................................................................................19
1. Méthodologie..........................................................................................................................................................19
2. Limites de l'étude ..................................................................................................................................................22
D- DÉFINITION DE LA NOTION DE TRAITE..................................................................................................26
SECTION 2 : CONTEXTE DANS LEQUEL S’INSCRIT LE PHÉNOMÈNE DE LA TRAITE AU MALI......28
A- LE CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE DU MALI ..............................................................................28
B- LA RÉPONSE DE L’ÉTAT MALIEN FACE AU PHÉNOMÈNE DE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS............29
1. Cadre juridique, politique et institutionnel ..............................................................................................29
2. Cadre normatif spécifique à la protection des enfants............................................................................30
C- ACCÈS AUX DROITS ET SERVICES DE PROTECTION......................................................................30
1. Les limites institutionnelles..................................................................................................................................................................30
2. Le rôle de la société civile................................................................................................................................32
SÉCTION 3 : TYPOLOGIE DE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS AU MALI...........................................................34
A- LA TRAITE AUX FINS D’EXPLOITATION SEXUELLE ET PROSTITUTION FORCÉE......................................35
1. Les cas de traite aux fins de prostitution forcée de migrantes anglophones adultes..........................................36
2. La traite aux fins de l'exploitation sexuelle des mineurs...............................................................................39
B- LA TRAITE AUX FINS DE TRAVAIL FORCÉ ..............................................................................................40
1. L'exploitation organisée de la mendicité d'autrui....................................................................................41
2. La servitude domestique : les jeunes filles aide-ménagères.................................................................................44
3. Exploitation des personnes par le travail forcé sur les sites aurifères artisanaux maliens.........................................46
4. Les enfants associés aux groupes armés....................................................................................................49
C- L’EXPLOITATION DES MIGRANTS : ZONE GRISE ENTRE TRAFIC ILLICITE DE MIGRANTS ET TRAITE DES
PERSONNES .....................................................................................................................................................................51
D- LA TRAITE ET L’ESCLAVAGE PAR ASCENDANCE................................................................................55
P3SECTION 4 : SYSTÈMES DE COLLECTE DE DONNÉES EXISTANTS AU MALI ET PROPOSITION
D’INDICATEURS DE LA TRAITE ADAPTÉS AU CONTEXTE MALIEN ..............................................................59
A- LES SYSTÈMES DE COLLECTE DE DONNÉES EXISTANTS..................................................................................59
B- PROPOSITION D’UNE LISTE D’INDICATEURS COMMUNS DE DÉTECTION DES CAS DE TRAITE DES
PERSONNES..........................................................................................................................................................................................................................60
1. Les indicateurs contextuels................................................................................................................................................................61
2. Les indicateurs généraux portant sur les critères de la traite............................................................................................61
3. Les indicateurs spécifiques aux formes d'exploitation.................................................................................................................63
a- Traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle..........................................................................................................63
b- Traite des êtres humains aux fins d’exploitation par le travail forcé......................................................................................63
c- Traite des mineurs.....................................................................................................................................................................64
d- Traite des êtres humains aux fins de domesticité forcée............................................................................................................64
e- Traite des êtres humains aux fins de mendicité forcée............................................................................................................65
ANNEXES ..............................................................................................................................................................................66
SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE..................................................................................................................................................................67
P4TERMINOLOGIES
VICTIME DE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS est le terme juridique officiel établi dans le Protocole de
Palerme. Cependant, au Mali, une personne doit se voir officiellement accorder ce statut de victime de la traite par
l’État. Toutefois, de nombreux acteurs de première ligne rentrent en contact/détectent et assistent une personne
qui a été victime de la traite avant que ce statut ne lui soit accordé. Pour éviter toute confusion entre potentiel,
présumé, identifié de manière informelle et officiellement identifié, nous utilisons le terme « personne victime de la
traite » tout au long du document.
PASSEUR : Dans le cadre du trafic illicite de migrants, le passeur est l’intermédiaire qui, dans le cadre d’un
contrat conclu avec des personnes, assure de façon illicite leur transport à travers une frontière internationalement
reconnue d’un État afin d’obtenir un avantage financier ou un autre avantage matériel.
TRAFIQUANT/EXPLOITANT : Auteur de l’infraction de traite des personnes : personne qui se charge de
recruter, de transporter ou d’héberger une autre personne par un moyen de contrainte physique ou psychologique
aux fins d’exploitation de cette personne. Contrairement à la langue anglaise qui différencie clairement l’auteur de
l’infraction de traite des personnes (trafficker) de l’auteur de l’infraction de trafic illicite de migrants (smuggler), la
langue française utilise parfois, et à tort, le même terme pour décrire ces deux situations. Dans le cadre de cette
étude, nous n’utiliserons que le terme trafiquant pour les cas de traite développés dans ce rapport.
DÉTECTION : La détection se réfère aux observations initiales selon lesquelles une situation de traite peut se
produire. La détection peut être le fait de tout acteur de première ligne.
IDENTIFICATION : L’identification renvoie à un processus de vérification par lequel un cas de trafic est confirmé
ou non. L’identification est faite par des autorités disposant de la force publique.
GROUPES ARMÉS : L’étude se réfère à tous les groupes sous le nom de « groupes armés », c’est-à-dire des
groupes armés non-étatiques. Conformément au principe de neutralité, l’étude évite d’utiliser des termes qui
insinuent des perspectives politiques et qui peuvent exacerber les tensions.
P5ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS
AEJT Association des enfants et jeunes travailleurs
BIT/ILO Bureau International du Travail
CNCLTP Comité National de Coordination de la Lutte contre la Traite des Personnes et les pratiques
assimilées
CNDIFE Centre National de Documentation et d’Information sur les Femmes et l’Enfant
COMADE La Coalition Malienne des Droits de l’Enfant
CPE Convention pour la Protection de l’Enfant
CPS Cellule de planification et stratégie
DNDS Direction Nationale du Développement Social
DNPEF Direction nationale de la promotion de l’enfant et de la famille
FMP Point de suivi des flux migratoires
LUTRENA Programme sous régional de lutte contre la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur
travail en Afrique de l’Ouest et du Centre
MINUSMA Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali
MPFEF Ministère de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la famille
MRM Mécanisme de Surveillance et Rapportage (MRM) co-dirigé par l’UNICEF et la MINUSMA
OIM Organisation internationale pour les migrations
OIT Organisation Internationale du travail
ONG Organisation non gouvernementale
PANATEM Plan National pour l’Élimination du Travail des Enfants 2020-2022
PNUD Programme des Nations unies pour le développement
PRODESS Programme de développement sanitaire et social
RAO Réseau Afrique de l’Ouest de protection de l’enfant
P6RRM Rapid Response Mechanism/Mécanisme de Réponse Rapide humanitaire (MRM)
SIPRE Système d’information sur la protection de l’enfant
SOSTEM Système d’Observation et de Suivi du Travail et de la Traite des Enfants au Mali
UNHCR Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (United Nations High Commissioner
for Refugees).
UNODC Office des Nations unies contre les drogues et le crime (United Nations Office on Drugs
and Crime).
UNFPA Bureau des Nations unies pour la population
UNICEF Fonds des Nations unies pour l’enfance (United Nations of International Children’s
Emergency Fund).
P7RÉSUMÉ EXÉCUTIF
La présente étude, qui s’inscrit dans l’objectif I du Plan d’Action Nationale de Lutte Contre la Traite des Personnes et
les Pratiques Assimilées (2018-2022) a pour objectif principal d’établir un état des lieux portant sur le phénomène
de la traite des êtres humains sur le territoire malien. Cette étude résulte d’une approche qualitative (section 1)
et a permis au travers des entretiens et des groupes de discussion effectués auprès de 136 acteurs répartis sur 8
régions administratives d’identifier de manière précise les causes (section 2) et les caractéristiques des différentes
formes de traite au Mali (section 3). Les résultats obtenus ont permis de faire une proposition d’indicateurs de
la traite qui pourront servir dans un futur proche à renforcer la collecte de données quantitatives – informations
nécessaires pour affiner l’analyse de ce phénomène sur le territoire malien (section 4).
Dans le cadre des recherches, l’étude (section 1) a toutefois permis de mettre en avant deux limites
importantes qu’il convient d’introduire :
1- Actuellement, au Mali, les informations disponibles sur la traite des personnes proviennent essentiellement
d’informations obtenues lors d’entretiens avec les victimes détectées et assistées. Toutefois, au regard de l’ampleur
du phénomène, la détection reste insuffisante et est trop souvent incertaine. En effet, les entretiens ont permis
d’identifier que le phénomène de la traite est mal compris par de nombreux acteurs impliqués directement ou
indirectement dans la lutte contre la traite des personnes. 40 % sont en capacité de définir précisément ce
qu’est la traite des personnes ; 37% peuvent partiellement définir la traite ; 23% ne le peuvent pas. Il
a donc été difficile d’obtenir des données qualitatives fiables sur le phénomène en raison de la compréhension
aléatoire de ce qu’est la traite par un grand nombre d’acteurs rencontrés.
2- L’étude a pu faire ressortir l’existence d’un certain nombre d’outils de collecte de données disposant d’au moins
un indicateur général sur la traite. De manière quasi-systématique, cet indicateur n’est pas informé, et lorsqu’il l’est,
il ne produit que des informations parcellaires mentionnant tout au plus le sexe de la victime, son âge et s’il ou elle
est victime du travail forcé ou de l’exploitation sexuelle. Enfin, les indicateurs utilisés par tous les acteurs diffèrent,
ce qui rend l’analyse des informations agrégées difficiles, voire impossibles. Aucune de ces informations ne nous
permet de vérifier la réalité du crime subi, et encore moins de le comprendre ou d’évaluer l’étendue du phénomène
sur le territoire malien.
Seule l’implication de statisticiens et d’une base de données dédiée à la collecte systématique d’informations portant
sur le phénomène de la traite en fonction de critères clairs permettra d’analyser et dessiner un tableau réaliste du
phénomène de la traite des personnes au Mali.
En tout état de cause et malgré les difficultés rencontrées, l’étude a pu faire ressortir les résultats suivants :
1- En dépit des efforts de l’État malien, on constate encore de nombreux défis au niveau national dans la lutte
contre la traite des personnes (Section 2). Par manque de confiance dans les autorités et institutions,
peu de victimes souhaitent porter plainte. Même dans les cas où les victimes ont la possibilité de signaler leur
situation d’exploitation, elles ne le font pas par crainte de leurs trafiquants, par honte culturelle ou encore parce
que l’exploitation est alors perçue comme un moyen de migrer. Par ailleurs, l’incrimination de traite des
êtres humains reste encore trop peu utilisée et les classements sans suite sont nombreux. L’analyse
des informations collectées démontre que cette difficulté est notamment liée à un manque de connaissance du
phénomène par les services d’enquêteurs (police/gendarmerie). En outre, les procureurs ne retiennent que très
rarement l’infraction de traite des êtres humains lors des renvois devant les tribunaux et qualifient des infractions
connexes qui sont plus simples et moins coûteuses à poursuivre. Enfin, les agents des services techniques de
l’État ont mentionné que les ressources allouées sont insuffisantes pour permettre aux autorités de
faire leur travail de détection.
P92- Les formes de traite le plus souvent signalées (section 3) au Mali sont le travail forcé des enfants dans les
activités domestiques et les sites miniers, l’exploitation de la mendicité des enfants, l’exploitation sexuelle et de
la prostitution forcée des femmes et des jeunes filles, ainsi que l’esclavage par ascendance. Le conflit et la crise
humanitaire qui gangrènent actuellement deux tiers du pays ont par ailleurs généré de nouvelles formes de traite
à savoir l’exploitation des enfants associés aux groupes armés et la traite des migrants. Des entretiens, l’étude a pu
faire ressortir les caractéristiques suivantes :
BAMAKO
ALGÉRIE
S A H A R A
GAO
Borj Mokhtar
KAYES
In Khalil
MAURITANIE Tessalit
KIDAL
Kidal
Ber KOULIKORO
Tombouctou
Goundam Gao
Gossi Ménaka
Ansongo
Douentza MOPTI
Nioro Nara
Mopti Sevaré
Bandiagara NIGER
Kayes Niono
Bankass SÉGOU
Bafoulabé Banamba Djenné
BURKINA
Segou San
kita
Koutiala
BAMAKO SIKASSO
Sikasso
Bougouni
GUINÉE BENIN
TOMBOUCTOU
GHANA
COTE D’IVOIRE
Carrefour migratoire Exploitation sexuelle par la prostitution forcée
Route migratoires et du trafic illégale de migrants = potentiels
cas de traite Exploitation aux fins de mendicité forcée des mineurs
Régions de Ségou; Bamako et Mopti
Pistes
Servitude domestique : Sites aurifères des régions de Kayes; Sikasso
Bamako-Capitale et point de transit, passage et tarfic et Koulikoro
des personnes Exploitations aux fins de travail forcé des migrants sites
aurifères controlés par groupes armés : Massina; Gossi; (Ntili);
Exploitations aux fins de travail forcés des enfants
Gao (N’Take); Kidal
Kadiolo; bougouni; Loulou; Sadiola; Yanfolila; Kangaba;
Kenieba; Misseni; wassoulou; Soloba Enfants associés aux groupes armés détectés dans les régions de kidal; Gao;
Assango et autour de ménaka
Esclavage par ascendence
P10© IOM/2014
P11PROFIL DES ACTE MOYEN BUT ZONES
VICTIMES D’EXPLOITATION
Femmes et jeunes filles Recrutement des victimes par Offre de cadeaux voire Exploitation Les victimes de la
anglophones d’origine des femmes influentes issues des paiement des parents de sexuelle prostitution forcée
nigériane et ghanéenne. mêmes villages. Ces recruteuses la victime pour obtenir par la sont essentiellement
Elles ont entre 19 et organisent et prennent en leur consentement; prostitution exploitées dans les bars
30 ans. L’ambassade charge le coût du transport ; les fausses promesses forcée et les makis sur les
du Nigeria estime qu’il victimes sont ensuite escortées d’emplois lucratifs à sites aurifères (Kenieba
y aurait près de 4000 par des passeurs qui s’occupent l’étranger (tromperie) ; et Sabiola, cercle de
victimes de traite au aussi de falsifier leurs documents abus d’autorité ou de Yelimané, etc.) et dans
Mali. d’identité. Les victimes doivent vulnérabilité ; pression les capitales régionales
rembourser leur dette en étant psychologique avec la du sud/sud ouest du
forcées à la prostitution. (1) La pratique du « juju ». pays – Kayes, Koulikoro,
majorité des victimes détectées Ségou et Sikasso. La
au Mali, sont recrutées dans Brigade des mœurs a pu
leur pays d’origine pour être préciser qu’à Bamako,
exploitées au Mali. (2) Les autres les filles vivent avec
sont recrutées en vue d’être leur exploitante, une
exploitées en Europe. Le Mali « madame » au niveau
n’est donc qu’un pays de transit. des quartiers de l’ACI
2000 et de Sotuba.
Filles mineures 1- Recrutement des enfants Ce sont des mineurs. Exploitation La traite aux fins
maliennes ou venant provenant du même village par Leur consentement sexuelle des d’exploitation sexuelle
de l’étranger (Nigéria, de fausses promesses de travail; n’est pas nécessaire mineures des mineurs est
Burkina Faso, Guinée organisation et prise en charge pour constituer particulièrement
Conakry). Elles ont du transport de la victime sur l’infraction de traite. importante sur les sites
entre 14 et 18 ans. la zone d’exploitation ; dette à Toutefois, les entretiens aurifères des régions
rembourser ; hébergement des font ressortir les éléments de Sikasso, Kayes et
victimes dans des conditions suivants : Koulikoro.
indignes. 1- Fausse promesse
2- Pour les enfants non d’emploi ; abus d’autorité
accompagnés qui sont ou de vulnérabilité.
volontairement arrivés sur les 2- Pour les enfants qui
sites aurifères, le recrutement et sont volontairement
l’exploitation se font sur place arrivés sur les sites
avec l’accueil et l’hébergement aurifères, les exploitants
des mineurs. Ces derniers sont utilisent la violence et
par la suite contraints de se l’abus d’autorité pour
prostituer pour payer les frais soumettre les enfants.
d’hébergement.
Garçons mineurs Les maîtres coraniques Ce sont des mineurs- Mendicité 90% des enfants
maliens venant des obtiennent la confiance des leur consentement n’est forcée; talibés en situation de
zones rurales. Ils parents qui acceptent de leur pas nécessaire pour travail mendicité sont exploités
viennent surtout des donner leurs enfants en vue de constituer l’infraction forcé dans dans le district de
régions de Mopti, leur éducation religieuse. de traite. Toutefois, les les zones Bamako, Ségou et Mopti.
Sikasso, Koulikoro et entretiens font ressortir agricoles À Bamako, les enfants
Ségou ainsi que du les éléments suivants : pour le sont localisés au niveau
Niger, de Guinée et du Abus d’autorité. Les compte des auto-gares, autour
Burkina Faso. Plus de victimes sont menacées du maître de la Grande Mosquée,
la moitié des enfants d’être punies si elles ne coranique. les Halles ou encore
talibés en situation de veulent pas travailler ou dans le grand marché de
mendicité ont entre 7 si elles ne rapportent Bamako.
et 12 ans et 12% ont pas les montants fixés.
entre 13 et 15 ans. Utilisation de la violence
L’étude fait ressortir ou de la torture si elles
qu’il pourrait y avoir ne ramènent pas les
près de 155 000 montants attendus par le
potentielles victimes maître coranique.
de traite aux fins de
la mendicité forcée.
P12Vraies ou fausses Recrutement et déplacement Ce sont des mineures Mendicité 48% des enfants
jumelles mineures des enfants mineurs sur les leur consentement forcée; mendiants sont identifiés
maliennes venant des lieux de l’exploitation par leurs n’est pas nécessaire à Bamako. C’est au
capitales régionales ou parents ou des femmes qui pour constituer niveau des abords ou
de Bamako. Elles ont louent leurs services pour la l’infraction de traite. sur les trottoirs des
entre 7 et 12 ans. Elles journée. L’argent est collecté en Toutefois, les entretiens principaux axes de
viennent de familles tout ou partie par l’exploitant. font ressortir les éléments Bamako que sont placés
pauvres habitant dans suivants : Utilisation les enfants.
les centres urbains de la violence pour Des enfants mendiants
(Bamako ou les contraindre les enfants à sont aussi identifiés
capitales régionales). obtempérer ; l’argent est à Mopti, Sikasso et
capté directement par Ségou. Les entretiens
l’exploitant. font ressortir que cette
forme d’exploitation
n’existe pas dans les
régions du nord.
Jeunes filles âgées de Recrutement par une personne Si ce sont des mineures Servitude Les jeunes filles
9 à 17 ans. D’origine qui vient en général du village. leur consentement domestique aide-ménagères
malienne, ces jeunes Elle organise le voyage et place n’est pas nécessaire sont principalement
filles sont issues la jeune fille dans des familles. pour constituer exploitées au niveau
principalement des Une fois qu’elles sont arrivées l’infraction de traite. des sites aurifères des
milieux ruraux des chez leur employeur, elles sont Si elles sont majeures : régions de Kayes, Sikasso
régions du centre et forcées de travailler dans des fausse promesse de et Koulikoro, ainsi qu’à
du sud du Mali : Mopti conditions très difficiles : elles travail ; tromperie ; abus Bamako et les capitales
(jeunes filles dogons); sont victimes de violences d’autorité parentale. régionales. La pratique
Ségou (San), Sikasso, physiques, abus psychologiques des jeunes filles aide-
Koulikoro et dans et sexuels. Elles ne sont pas ou ménagères n’est pas
une moindre mesure, peu rémunérées et lorsqu’elles présente dans les régions
Kayes. L’étude, au le sont, l’argent est capté en du nord du Mali.
regard des informations tout ou partie par le trafiquant
obtenues, fait ressortir en l’espèce, de faux recruteurs/
qu’il pourrait y avoir grands logeurs.
près de 7 800 jeunes
filles aide-ménagères
qui seraient
potentiellement
victimes de la traite
au Mali.
Enfants provenant du Recrutement et/ou accueil Si ce sont des mineurs Exploitation La région de Kayes,
Mali ainsi que des pays sur les sites aurifères par leur consentement par le travail la plus grande région
frontaliers tels que des membres éloignés de la n’est pas nécessaire forcé sur les aurifère du pays,
la Guinée, le Burkina famille où des employeurs peu pour constituer sites aurifères emploie 42 695 enfants.
Faso, la Côte d’Ivoire scrupuleux font travailler les l’infraction de traite. maliens. La région de Sikasso
et le Sénégal. Ce sont enfants dans des conditions emploie 2 496 enfants.
principalement des difficiles, en contravention avec Quant à la région de
garçons. loi malienne. Les caractéristiques Koulikoro, on estime
des modes opératoires sont qu’il y aurait 562 enfants.
peu précises. Des recherches
supplémentaires devront être
effectuées.
P13Depuis 2012, près de Les acteurs interrogés décrivent Si ce sont des mineurs Enfants L’UNICEF rapporte
900 enfants ont été deux modalités de recrutement : leur consentement associés que les régions les plus
recrutés et utilisés par le recrutement « volontaire » et n’est pas nécessaire aux groupes touchées sont Ménaka
les groupes et forces le recrutement par (et) rétention pour constituer armés. (33%), Gao (28%) et
armées au Mali. Ce forcée. Certains groupes l’infraction de traite. Kidal (21%).
sont majoritairement auraient également eu recours Toutefois, les entretiens
des mineurs maliens, au recrutement transfrontalier. font ressortir les éléments
dont 33% sont Les jeunes sont utilisés pour suivants : utilisation de la
des filles. Ils sont effectuer des rôles de support violence, abus d’autorité
principalement recrutés (travaux domestiques ou travail et administration de
dans les régions de sur les sites aurifères) ou de drogues pour contrôler
Kidal, Gao et Ménaka. combat. les enfants.
La plupart des enfants
sont dans la tranche
d’âge de 13-17 ans.
Certains enfants
recrutés sont d’anciens
talibés.
Migrants maliens Mode opératoire complexe : Le consentement Travail forcé ; Les migrants sont
ou étrangers faisant Si initialement les migrants est très difficile à extorsion; particulièrement
appel à des passeurs font volontairement appel caractériser puisque la enlèvement vulnérables lorsqu’ils
pour migrer. aux services de passeurs plupart des migrants et détention transitent par les zones
Majoritairement âgés pour voyager, ces derniers connaissent, à des degrés forcée. contrôlées par les
entre 21 et 30 ans peuvent facilement abuser divers, la contrainte groupes armés dans
(70%), les migrants de leur pouvoir au cours ou la tromperie au les régions de Gao,
sont principalement du voyage pour contrôler cours de leur périple : Tombouctou, Kidal
originaires du Burkina les migrants et réaliser des Utilisation de la (Tessalit) et Mopti.
Faso (44%), suivi du bénéfices supplémentaires violence ; abus physique Les entretiens ont
Mali (42% et viennent par l’exploitation directe et psychologique ; permis d’identifier plus
de Kayes ; Mopti et ou indirecte de la victime. coercition ; torture précisément les sites
Bamako), du Niger Les passeurs assument un miniers de Gao (N’Taka)
(4%), de la Guinée, de ou plusieurs rôles dans et Tessalit comme étant
la Côte d’Ivoire et du l’exploitation des migrants des zones d’exploitation
Sénégal. Les migrants (transports ; hébergements). où les migrants sont
en direction pour Les passeurs sont souvent de régulièrement détenus
l’Europe sont plus connivence avec des groupes et forcés de travailler.
enclins à être victimes armés pour lesquels ils
de la traite que ceux en travaillent.
partance pour d’autres
pays de la sous-région.
Il y aurait au moins Les personnes qui naissent en Affranchie ou pas, la Esclavage L’esclavage est un
300 000 esclaves esclavage sont exploitées toute victime de la pratique de par phénomène national.
exploités par des leur vie et sont traitées comme l’esclavage par ascendance ascendance D’après l’entretien
maîtres au Mali. Ces un bien par leur propriétaire est confrontée à une avec l’organisation
individus appartiennent qualifié de « maître » (des discrimination et à des TEMEDT, l’esclavage
en général aux couches biens de propriété par leurs persécutions morales et est particulièrement
sociales les plus soi-disant « maîtres »). Les physiques permanentes. pratiqué à Gao
défavorisées. Dans le victimes travaillent sans salaire, (Gossi), Ansango,
nord, ce sont les Bellas s’occupent des animaux, Menaka, Tombouctou
et les Harratins. Dans travaillent dans les champs ou et Douentza. Cette
le sud, ce sont les chez leur maître. pratique a aussi cours
Peuhls du Seno. dans plusieurs villages
des cercles de Kayes,
Diéma, Nioro du Sahel,
Yelimané et Kita.
P14CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
Au-delà de la difficulté à détecter des cas, le manque d’un outil de collecte de données unique disposant
d’indicateurs précis, partagés et utilisés par tous les acteurs entrave l’analyse ordonnée des informations. Dans ces
circonstances, l’analyse et la vérification des informations collectées auprès de dizaines d’acteurs sont très difficiles.
Bien que le CNCLTP compile dans son rapport annuel les informations fournies par chaque membre du comité
sur leurs activités annuelles, elles ne reflètent pas l’ampleur réelle et les caractéristiques du phénomène au Mali.
Au regard des résultats obtenus, des recommandations collectées et des limites identifiées, l’étude a pu faire
ressortir les propositions suivantes :
Recommandations en vue de renforcer la détection et l’identification des victimes :
• Organiser des campagnes de formations à destination des acteurs de première ligne. Centrer les
formations sur les méthodes de détection de potentielles victimes. Les formations doivent cibler l’ensemble des
professionnels susceptibles d’être en contact avec des victimes de la traite des êtres humains (policiers, gendarmes,
magistrats, personnel de la protection de l'enfance, inspecteurs du travail, personnel hospitalier, travailleurs sociaux,
services de police aux frontières, etc.). Il est conseillé de cibler particulièrement tous les acteurs gouvernementaux
et/ou de la société civile qui sont des acteurs de première ligne. Par ailleurs, considérant que peu de victimes
souhaitent porter plainte et ne semblent pas faire confiance aux autorités, il semble pertinent de former les
acteurs de première ligne aux techniques d’écoute et les premiers secours psychologiques.
• Continuer de sensibiliser systématiquement les communautés à travers le lancement de campagnes
d’information sur les risques et les dangers de certaines pratiques culturelles perçues comme des moyens de
socialisation et d’éducation des enfants. Ces campagnes devraient cibler en priorité les parents. Enfin, faire
des campagnes de sensibilisation pour mettre fin à certaines idées reçues telles que la croyance que la traite
est uniquement transnationale et ne cible que les étrangers, ou encore les femmes. Ces sensibilisations ont
pour objet d’impliquer autant que possible les communautés, et le plus tôt possible, dans le processus de
détection et de prévention.
• Mettre en place des systèmes d’alerte ciblés au travers des comités locaux déjà existants. Les acteurs
rencontrés ont par ailleurs mentionné la nécessité de travailler main dans la main avec les acteurs communautaires
clés (chefs de villages ; maires, etc..) qui sont essentiels pour renforcer les mécanismes de détection et de
référencement de potentielles victimes. Ils assurent aussi un meilleur accès aux ONGs qui souhaiteraient mettre
en place des activités de prévention (sensibilisation et information) et de protection (identification; assistance;
référencement) sur les sites aurifères qui sont actuellement très difficiles d’accès.
• Appuyer à la création d’équipes mobiles régionales représentées par des travailleurs sociaux de la
DNDS et de la DNPEF. Ces équipes mobiles pourraient être les points focaux régionaux. Ils auraient pour
mission de coordonner les missions de sensibilisation et de formation ; faire de la détection et assurer la prise
en charge des potentielles victimes identifiées sur leur zone de couverture. Enfin, ils seraient en charge de
collecter et rapporter les informations au CNCLTP; et de faire des enquêtes auprès des populations.
Recommandations en vue de renforcer la collecte d’informations quantitatives et qualitatives :
• L’OIM devrait saisir l’opportunité d’appuyer le CNLTP dans la mise en place et la gestion d’un système de
collecte de données unique portant sur la traite des personnes (informations quantitatives et qualitatives).
Pour ce faire, la création d’un sous-groupe Gestion de l’Information logé au sein du CNCLTP pourrait
assurer ce travail de collecte de données ordonnées et systématiques. Pour éviter la duplication des
efforts et des informations, limiter la dispersion d’informations sensibles ou générer une lassitude de la
collecte d’information auprès des acteurs, la CNCLTP devrait s’appuyer autant que possible sur les outils
de collecte de données déjà existants. Pour ce faire, et à titre d’exemple, utiliser les évaluations sectorielles
et multisectorielles qui collectent déjà des données qui peuvent être utilisées pour éclairer les programmes
de lutte contre la traite (sous cluster VBG ; sous cluster Enfants, etc.). Ces évaluations pourraient inclure
P15des indicateurs sur différentes formes d’exploitation. En outre, il conviendrait de collecter les informations
provenant des acteurs de la répression/poursuite. Développer des fiches de collecte de données partagées
avec tous les acteurs afin d’assurer l’utilisation d’indicateurs précis et alignés (confère section 4 Proposition
d’indicateurs de la traite). Enfin, développer un protocole strict des modalités de partage des données et des
règles de confidentialité.
• Développer un Mécanisme de Référencement National pour l’identification et l’assistance des
victimes de la traite (MRN). Développer et intégrer des procédures opérationnelles standards (SOP) sur
la collecte et la gestion de l’information. Former les acteurs ciblés sur l’utilisation de ce MRN en vue d’assurer
que les cas détectés soient bien rapportés au niveau de l’entité en charge de collecter, compiler et analyser
les informations reçues par les différents acteurs.
• Développer une proposition d’un formulaire commun de détection des vulnérabilités afin de
permettre à tous les acteurs de protection d’utiliser les mêmes indicateurs, ce qui permettrait par ailleurs
de faciliter la compilation et l’analyse des informations obtenues. À titre indicatif, il est suggéré de s'appuyer,
dans la mesure du possible, sur des indicateurs indirects et d'éviter de préférence les questions directes qui
en général ne sont jamais informées.
P16© IOM/2016
P17SECTION 1 : CADRE CONCEPTUEL ET PRÉSENTATION
DE L’ÉTUDE
A- HISTORIQUE ET CONTEXTE DU PROJET
Selon l’UNODC, la traite des êtres humains serait la troisième forme de trafic la plus répandue dans le
monde après le trafic de drogue et le trafic d'armes. C’est l’une des violations les plus graves des droits fondamentaux
et de la dignité humaine. Cette forme de l‘esclavage moderne ne constitue pas seulement une violation des droits
de l‘homme, mais est aussi un problème d‘ordre public qui nécessite la coopération entre tous les intervenants, et
à tous les niveaux, pour être appréhendée. L’engagement en faveur de son éradication est illustré par son inclusion
proéminente dans les cibles des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies et du Pacte
mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (GCM)1.
Au cours des deux dernières décennies, l’Afrique de l’Ouest a été le théâtre d’une mobilisation sans précédent des
États, des agences intergouvernementales, des organisations non gouvernementales et des principaux bailleurs de
fonds contre ce phénomène unanimement dénoncé. Si au Mali la traite des êtres humains est bien reconnue par
les acteurs, ce phénomène reste pourtant mal compris et est peu identifié. Il existe pourtant un corpus législatif
et programmatique adopté pour lutter contre la traite des êtres humains, mais il reste peu efficace : l’identification
des victimes reste insuffisante et la poursuite des exploitants est presque inexistante. Par ailleurs, les informations
quantitatives et qualitatives relatives à la traite en tant que telle sont rares et très éparses, ce qui rend le travail
d’analyse difficile sinon impossible.
Or, pour prévenir et lutter contre la traite des êtres humains, protéger les victimes et garantir la poursuite des
auteurs, il est indispensable que le pays dispose de données et d’informations détaillées qui permettent de connaître
l’étendue réelle du phénomène et d’y répondre de manière efficace.
Pour pallier ce déficit, au travers d’une initiative financée par l’Ambassade des Pays-Bas au Mali, et à la demande
du Comité National de Coordination de la Lutte contre la Traite des Personnes et les pratiques assimilées,
l’Organisation Internationale pour les Migrations a développé une étude sur le phénomène de la traite au Mali.
Cette activité s’inscrit dans le cadre du Plan d’Action Nationale de Lutte Contre la Traite des Personnes et les
Pratiques Assimilées (2018-2022)2
1
L'éradication de la traite des êtres humains est spécifiquement abordée dans les objectifs 5.2, 8.7 et 16.2. Le 10e objectif du GCM appelle
également à des mesures spécifiques pour prévenir et combattre la traite des personnes dans le contexte des migrations internationales.
2
Plan d’Action Nationale de Lutte Contre la Traite des Personnes et les Pratiques Assimilées (2018-2022) – Pilier I, Activité 1.
P18B- OBJECTIFS ATTENDUS DE L’ÉTUDE (TDR)
OBJECTIF GÉNÉRAL : La présente étude a pour objectif principal d’établir un état des lieux portant sur le
phénomène de la traite des êtres humains sur le territoire malien. Elle répond à la volonté d’améliorer les connaissances
de ce phénomène pour mieux le cerner afin de renforcer les réponses qui y sont apportées. Il s’agit donc d’une étude
exploratoire appelant à la mise en place d’un système de collecte de données quantitatives et qualitatives brutes qui
permettront d’analyser dans un futur proche l’ampleur, les caractéristiques, les causes et les conséquences de la traite.
Confère ANNEXE 1 : Termes de référence de l’étude.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :
• Identifier les formes de traite par région ;
• Identifier les profils de victimes de traite et d’individus à risque ;
• Identifier les circuits/itinéraires de la traite, ainsi que les zones d’exploitation ;
• Identifier les profils des trafiquants, les réseaux existants;
• Identifier les acteurs impliqués dans la lutte contre la traite et leurs domaines d’intervention (prévention ;
protection, répression) ; ainsi que les données quantitatives existantes en leur possession ;
• Formuler des indicateurs de la traite adaptés au contexte malien afin de renforcer le système de collecte de
données qualitatives et quantitatives
CIBLES DE L’ÉTUDE : Les principaux utilisateurs sont l’ensemble des parties prenantes : bailleur, partenaires
d’exécution, les autorités et les leaders communautaires, les organisations nationales et internationales, ainsi que les
professionnels des médias.
C- MÉTHODOLOGIE ET LIMITES DE L’ÉTUDE
1. MÉTHODOLOGIE
L’étude résulte d’une approche qualitative. Elle propose donc une analyse de la situation et ne prétend pas
quantifier le phénomène de la traite au Mali. Une méthodologie combinée a été adoptée, en s’appuyant
sur une variété de sources primaires et secondaires. L’étude s’appuie entre autres sur l’analyse des données
quantitatives disponibles dans des rapports, études, bulletins et annuaires statistiques accessibles ainsi que sur
les informations obtenues auprès de 136 acteurs (dont 25 victimes de la traite) lors d’entretiens semi-
structurés et des groupes de discussion. Afin de ne pas se limiter à un groupe d’individus ou à une forme
d’exploitation spécifique, l’étude s’est intéressée aussi bien aux hommes, femmes, et enfants de nationalité
malienne que des étrangers.
Le projet, d’une durée de 5 mois, a été articulé comme suit :
Octobre 2020 : Définition d’un plan de recherche; démarrage de l’étude documentaire ; développement des
outils de recherche; étude du cadre légal malien.
Novembre 2020 : Constitution du Comité de pilotage et validation des outils de collecte de données;
identification des acteurs à rencontrer; démarrage des rencontres avec les acteurs identifiés sur Bamako;
planification des entretiens avec des victimes de la traite.
Décembre 2020 : Planification des visites de terrain et poursuite des entretiens.
Janvier 2021 : 2 semaines de visites de terrain à Kayes et Gao et présentation des résultats provisoires au
Comité de pilotage;
Février 2021 : Rédaction du rapport; formulation des recommandations et des indicateurs de la traite;
restitution des résultats de l’étude à l’OIM.
P19ÉTAPE 1 : Revue documentaire
Les termes de référence de l’étude étant très large, il convenait de pouvoir encadrer le champ de l’étude tant d’un
point de vue thématique que géographique. Il convient toutefois de rappeler que cette étude a pour vocation
de présenter une analyse situationnelle générale du phénomène de la traite sur tout le territoire malien. Les
documents analysés proviennent de structures étatiques, ONGs, organisations des Nations Unies, et des instituts
privés de recherche. L’étude documentaire s’est effectuée tout au long du projet, et a permis dans un premier
temps d’identifier des postulats de base qui ont été explorés et vérifiés/infirmés au cours des recherches. La revue
documentaire a également couvert les textes juridiques pertinents.
Enfin, un certain nombre d’informations quantitatives présentées dans cette étude sont créditées aux acteurs qui
les ont fournies. Les statistiques ont été principalement produites, outre les rapports et études cités ci-dessus, par
le Centre National de Documentation et d’Information sur les Femmes et l’Enfant (CNDIFE), ainsi que les cellules
de Planification et Stratégie (CPS) des ministères suivants : Ministère de la Justice ; Ministère de la Santé et du
Développement Social ; du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile ainsi que du Ministère du Travail et
de la fonction publique.
ÉTAPE 2 : Mise en place d’un Comité de pilotage
Les termes de référence ainsi que la méthodologie de la recherche ont été préalablement présentés au Comité
national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées (CNCLTP). Le Comité
de pilotage nommé par le CNCLTP a pu valider l’approche méthodologique ainsi que les outils de collecte de
données. Ces membres ont activement orienté la consultante dans l’identification des acteurs clés à rencontrer
au cours de l’étude. C’est lors de la première réunion de cadrage qu’il a été décidé que l’étude couvrira les régions
administratives suivantes: le district de Bamako ; Kayes ; Koulikoro ; Sikasso ; Ségou ; Mopti ; Gao ; Tombouctou. Le
manque d’interlocuteurs identifiés dans les régions de Kidal et Ménaka, ainsi que la difficulté à pouvoir se déplacer
pour des raisons de sécurité n’ont pas permis d’explorer et d’obtenir suffisamment d’informations pertinentes sur
le phénomène de la traite dans ces deux dernières régions pour en faire état dans cette étude.
ÉTAPE 3 : Identification des interlocuteurs
C’est un total de 136 acteurs travaillant sur les 8 régions administratives ciblées qui ont pu être contactés.
L’équipe a ainsi pu s’entretenir avec des points focaux de 16 services techniques étatiques (ainsi que leurs représentations
en région) dont des procureurs du Pôle judiciaire spécialisé et des magistrats du siège; 9 leaders communautaires (chefs
religieux ; chefs de quartiers ou de villages ; leaders féminins) ; 26 ONGs nationales et 14 ONGs internationales (ainsi
que leurs représentations en région) ; 8 organisations internationales ; 5 Ambassades ; 2 chercheurs universitaires ; 2
avocats spécialisés et 1 journaliste ; ainsi que 25 victimes de la traite et 2 anciens passeurs de la région de Gao.
Tous les acteurs identifiés jouent concurremment un rôle dans la prévention, la protection des victimes ou
encore la répression de la traite des personnes. Confère ANNEXE 2 : Cartographie des acteurs.
ÉTAPE 4 : Création de guides d‘entretien et de questionnaires
Considérant le caractère clandestin et sensible du phénomène - il a été décidé d’organiser des entretiens individuels
semi-structurés avec les acteurs de lutte contre la traite des personnes au Mali. L’objectif de ces entretiens individuels
était de pouvoir obtenir des informations sur les caractéristiques de la traite au Mali au regard des informations que
les acteurs ont pu obtenir directement auprès des victimes détectées et assistées. Les entretiens ont permis dans
un premier temps de vérifier la compréhension de ce qu’est la traite. Sur la base des entretiens semi-structurés, les
5 points suivants étaient systématiquement abordés :
Obtenir des informations sur la mission/activités de l’organisme interrogé ;
Évaluer le niveau de compréhension de la notion de traite;
Identifier si des bases de données/informations désagrégées portant sur le phénomène de la traite existent;
3
Voir les références et la bibliographie.
P20Vous pouvez aussi lire