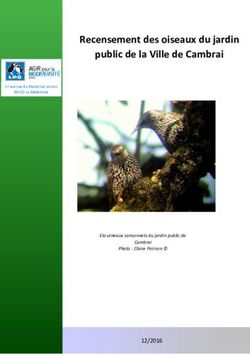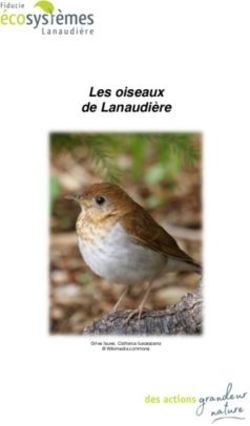Avifaune du campus : suivi de l'occupation des nichoirs - UFR SFA
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Licence Sciences & Technologies, mention Sciences du Vivant 2017/2018
Parcours « Écologie et Biologie des Organismes » (EBO)
Université de Poitiers
U.F.R. Sciences Fondamentales et Appliquées
40 avenue du Recteur Pineau
F-86022 Poitiers Cedex
Avifaune du campus : suivi de l'occupation
des nichoirs
Photo : Stefan-Xp — Travail personnel, C 1
LIBERT Valentin
Sous la direction de : à Hélène PAULHAC, adjointe technique.
à Nicolas BECH, maitre de conférences.
Laboratoire Ecologie et Biologie des Interactions - UMR CNRS 7267
6 Rue Michel Brunet T.S.A 51106
86073 POITIERS CEDEX 9
Du 14/05/2018 au 15/06/2018Remerciements,
Je souhaite exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance envers toutes les
personnes m’ayant permis de réaliser ce stage dans les meilleures conditions possibles :
Tout d’abord je tiens à remercier chaleureusement Hélène PAULHAC pour son
accueil, sa bonne humeur, sa disponibilité et son aide tout au long de ce stage.
Je souhaite également remercier monsieur Nicolas BECH pour m’avoir permis de
réaliser ce stage, ses précieux conseils et de son aide, notamment pour la prise en main de
QGIS.
Je remercie aussi toute l’équipe du projet avifaune de cette année, à savoir Maxime
AUBOURG, Julien AVRIL et Quentin ESNAULT avec qui j’ai passé de très bons moments
lors des séances de recensement malgré la météo parfois capricieuse.
Merci encore à Quentin ESNAULT pour ses photos des nichoirs.
Encore merci à l’équipe de techniciens ainsi qu’à Roland RAIMOND pour avoir
permis l’installation du nichoir et de la caméra.
Un grand merci aussi à toute l’équipe du laboratoire pour son accueil.Table des matières
Environnement professionnel .............................................................................................................1
Contexte scientifique ..........................................................................................................................1
Mission et activités confiées ...............................................................................................................2
1) Site d’étude ...........................................................................................................................3
2) Méthode d’échantillonnage ..................................................................................................3
a) Poursuite du suivi de l’avifaune sur le campus B de Poitiers. ................................................3
b) Suivi de l’occupation des nichoirs ........................................................................................4
3) Résultats................................................................................................................................5
a) Distribution de l’avifaune.....................................................................................................5
b) Occupation des nichoirs.......................................................................................................7
Mon point de vue ...............................................................................................................................8
Bibliographie ......................................................................................................................................9
Annexes ............................................................................................................................................ 10Intitulé / sujet du stage : Avifaune du campus : suivi de l’occupation des nichoirs. Entreprise (nom, adresse, pays) : Laboratoire Écologie et Biologie des Interactions – UMR CNRS 7267 6 rue Michel BRUNET 86073 Poitiers CEDEX 9 Secteur d'activité : Laboratoire Écologie et Biologie des Interactions – UMR CNRS 7267 Maître de stage en entreprise : Hélène PAULHAC Enseignant - Tuteur : Nicolas BECH Diplôme préparé : L3 Écologie et Biologie des Organismes Établissement : Université SFA Poitiers Stage inscrit dans le cursus : Obligatoire
Environnement professionnel
Ce stage est réalisé au sein du laboratoire Écologie et Biologie des Interactions à
Poitiers et plus précisément au sein de l’équipe Écologie Évolution Symbiose, une équipe de
chercheurs dont les recherches portent sur l’étude des interactions entre des crustacés et les
microorganismes qu’ils hébergent. Le principal modèle d’étude de cette équipe correspond à
l’association de crustacés terrestres (isopodes) et de bactéries parasites de la reproduction
du genre Wolbachia. L’ensemble des travaux de l’équipe EES s’inscrivent dans trois
thématiques de recherche :
- L’impact évolutif de la symbiose : ayant pour objectif principal la
compréhension de la féminisation induite par le symbiote.
- Interactions dans l’holobionte : concernant le dialogue moléculaire et la
coévolution entre les différents partenaires au sein de l’holobionte.
- Biodiversité et agrosystèmes : portant sur l’évolution et le fonctionnement de
la biodiversité, notamment dans le contexte d’écosystèmes continentaux anthropisés.
Contexte scientifique
Partout sur la planète, on observe un déclin de la biodiversité dû à plusieurs facteurs
anthropogéniques, parmi lesquels on distingue la réduction des habitats par une
augmentation des surfaces agricoles et urbaines. En effet l’inexorable croissance des
besoins en ressources et en espace de l’Homme s’accompagne de l’augmentation de la
surface des villes et entraîne une diminution et une fragmentation des habitats de la faune et
de la flore. On estime ainsi une disparition de 51% des zones humides depuis 1970 ou
encore le déclin de 42% des espèces animales et végétales au cours de ces dix dernières
années (Markus Fischer et al, 2018.). Cette expansion de la surface des villes s’accompagne
d’une fragmentation de l’habitat correspondant à la transformation d’une surface d’habitat en
une multitude de petites zones isolées les unes des autres formant des réservoirs de
biodiversité (Wilcove et al, 1986). Ce phénomène est donc considéré comme une des
causes majeures de régression de la biodiversité (Cordingley JE et al, 2015.).
Afin d’endiguer le phénomène de fragmentation des paysages, certains projets tel
que celui de la Trame Verte et Bleue ont pour but la création de corridors écologiques
assurant des connexions entre des réservoirs de biodiversité. Ces corridors, restaurant ainsi
une continuité écologique, offrent aux espèces des conditions favorables à leurs
1déplacements et ainsi à l'accomplissement de leurs cycles de vie. Ces corridors écologiques
comprennent les espaces naturels ou semi-naturels ainsi que les formations végétales
linéaires ou ponctuelles. Grâce à une grande surface semi-naturelle et abritant de
nombreuses espèces notamment d’oiseaux (Delage Mathilde, 2016), le campus des
sciences de Poitiers représente un réservoir de biodiversité important au sein de la ville et
s’inscrit donc dans la dynamique de Trame Verte et Bleue.
En milieu urbain et semi-urbain, l’avifaune représente une composante essentielle de
la biodiversité. Les oiseaux se positionnent généralement en haut des chaines trophiques et
sont très sensibles aux variations environnementales susceptibles d’affecter leur habitat
(Faber Anne-Sophie, 2017). Ainsi, face à la détérioration, la réduction et la fragmentation des
habitats, on observe au cours des 30 dernières années une diminution des espèces
spécialistes au profit d’une augmentation du nombre d’espèces généralistes (Annexe 1). Ces
tendances illustrent un phénomène d’homogénéisation de la faune, notamment aviaire ; les
communautés s’uniformisant au profit d’espèces peu spécialisées et peu exigeantes.
Depuis maintenant 5 ans, un projet de recensement de l’avifaune sur le campus B de
Poitiers est mené dans le but d’analyser le peuplement et la répartition d’oiseaux sur le site.
En parallèle, un suivi annuel du taux d’occupation des nichoirs est aussi réalisé. La présente
étude s’inscrit dans la continuité de ce recensement afin d’estimer les changements de
densités et de répartition des oiseaux sur le site d’étude. L’étude a aussi comme objectif de
suivre l’évolution de l’occupation des nichoirs et leur impact sur la reproduction des
populations d’oiseaux au cours du temps.
Mission et activités confiées
Les principales missions qui m’ont été confiées lors de ce stage ont consisté à
poursuivre l’inventaire de l’avifaune sur le campus B de l’université de Poitiers et à suivre
l’évolution du taux d’occupation des nichoirs pour déterminer quelles espèces y nichent. Les
résultats de ces différentes missions ont été reportés sur un SIG (Système d’Information
Géographique) à l’aide du logiciel Qgis afin d’étudier la densité et la répartition de l’avifaune
sur le campus de Poitiers.
21) Site d’étude
Le site d’étude se situe en région Nouvelle Aquitaine dans le département de la Vienne,
au sud-est de la ville de Poitiers et plus précisément au niveau du campus B de l’université
de Poitiers. Cette zone d’étude a une superficie de 37,31 ha ce qui représente moins de 1%
de la surface totale de la ville (Damien Nivelle, 2016). Comme précédemment évoqué, c’est
un milieu semi- urbain dont un peu moins de la moitié de la surface (i.e. 46%) correspond à
une aire non bétonnée (e.g. pelouse, haie, brande). Le reste de la surface est couvert par
des routes, des bâtiments, des parkings ou des chemins (figure 1).
2) Méthode d’échantillonnage
a) Poursuite du suivi de l’avifaune sur le campus B de Poitiers.
Ayant commencé la récolte de données à partir de novembre 2017 jusqu’à mai 2018 j’ai
effectué le recensement de l’avifaune au cours de 15 sorties réalisées en compagnie de
3Julien Avril, Maxime Aubourg et Quentin Esnault. J’ai aussi réalisé jusqu’à la remise de ce
rapport 2 sessions de comptage supplémentaires à raison de 1 par semaine. Ces sessions
se poursuivront jusqu’à la fin du stage. L’échantillonnage se faisait au lever du jour, qui est la
période de la journée où les oiseaux diurnes sont le plus actifs vocalement (Blondel, 1975).
Les comptages se sont faits à vue (à l’aide de jumelles) et à l’ouïe en suivant un transect
préexistant que nous avons dû légèrement modifier compte tenu des travaux réalisés au
niveau du passage entre les bâtiments B7 et le B3. Chaque oiseau identifié, au chant ou à
vue, a été recensé via l’application Android Naturalist. Les données ainsi obtenues ont été
récupérées sur le site Biolovision puis exportées vers le logiciel de cartographie QGIS. Ce
logiciel nous a permis de cartographier la répartition de l’avifaune sur le campus B (figure1).
Sur la base de ces données, une carte de chaleur globale a été réalisée sur l’ensemble du
cortège d’espèces recensées via l’outil ‘carte de chaleur’ implémenté dans le logiciel QGIS.
De plus j’ai également réalisé des cartes de chaleur pour les espèces dont les individus ont
été recensés entre 15 et 300 fois cette année afin d’exclure les espèces observées de
manière exceptionnelle et les espèces abondantes réparties de manière relativement
uniforme sur l’ensemble du site d’étude. Ces cartes de chaleur permettent de représenter sur
une carte les densités de distribution de points, ici les densités d’oiseaux, et permettent donc
de déterminer la répartition spécifique et globale de l’avifaune sur le campus.
b) Suivi de l’occupation des nichoirs
Le suivi de l’occupation des nichoirs suit un protocole prédéfini, il se fait le matin au lever
du jour en observant l’ouverture des nichoirs et les éventuels oiseaux qui y nichent à l’aide
de jumelles ou d’une longue vue. Chacun des 16 nichoirs (un des nichoirs est doté d’une
caméra diffusant en direct il n’est donc pas nécessaire de l’observer aux jumelles) fut
observé durant dix minutes pendant 2 sessions afin de déterminer s’ils étaient occupés ou
non et si oui, par quelle espèce d’oiseau. Il existe 3 types de nichoirs sur le campus, ils
diffèrent principalement en fonction de leurs types d’ouverture, chacun ciblant une espèce en
particulier :
Nichoir à rougequeue Nichoir à grimpereau Nichoir à mésange
4Les résultats ainsi obtenus ont été notés sur une carte en version papier puis analysés
pour mettre en évidence l’impact des nichoirs sur la reproduction des oiseaux sur le campus
et de voir si certains types de nichoirs étaient préférés à d’autres selon les espèces.
3) Résultats et discussion
a) Distribution de l’avifaune
Avant les sessions de recensement effectuées durant le stage, sur les 15 sorties
réalisées entre novembre et mai, 3061 oiseaux ont été recensés, répartis dans 42 espèces
différentes. Lors des 2 sessions réalisées à partir du 14 mai 2018 et jusqu’à la remise de ce
rapport, 274 nouveaux recensements et 4 nouvelles espèces (i.e. linotte mélodieuse,
fauvette à tête noire, grive draine et martinet noir) ont été recensés ce qui fait un total de
3335 oiseaux et 46 espèces (Annexe 2). Toutes ces données ont ensuite été mises en
commun avant d’être utilisées pour la réalisation d’une carte de chaleur nous renseignant sur
la distribution globale de l’avifaune sur le campus (figure 2).
Les densités absolues de chaque espèce ont quant à elles été représentées sur
plusieurs cartes de chaleur afin de mettre en évidence de potentielles affinités des espèces
avec certaines zones du campus (figure 3).
Figure 2 : Carte de densité globale de l’avifaune du campus B de Poitiers
5Figure 3 : Cartes des densités spécifiques sur le campus B de Poitiers
Verdier d’Europe (Chloris chloris) Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) Chardonneret élégant (Carduelis carduelis)
Accenteur mouchet (Prunella modularis) Mésange noire (Periparus ater) Moineau domestique (Passer domesticus)
Mésange charbonnière (Parus major) Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) Roitelet huppé/triple bandeau (Regulus
regulus)(Regulus ignicapilla)
Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) Rougegorge familier (Erithacus rubecula) Pinson des arbres (Fringilla coelebs)
Merle noir (Turdus merula) Pic vert (Picus viridis) Corneille noire (Corvus corone)
6b) Occupation des nichoirs
Suite à l’observation des nichoirs, le taux d’occupation des nichoirs était de 8/17 soit
47%. Sur les 8 nichoirs occupés, 5 l’étaient par des mésanges bleues (Cyanistes caeruleus)
et les 3 autres l’étaient par des mésanges charbonnières (Parus major). De plus, seuls les
nichoirs de type « boîte aux lettres », visant principalement les mésanges, sont occupés, ce
qui est parfaitement en accord avec les résultats obtenus.
L’absence d’oiseaux dans les nichoirs type nichoir à bergeronnette/rougequeue et type
nichoir à grimpereau peut être expliquée par une présence suffisante de sites naturels de
nidification sur le campus ou bien par une mauvaise conception de ces nichoirs. En effet, ces
derniers se sont révélés inefficaces dès leur pose en 2015 alors que ces oiseaux ont, pour
certains, été observés en train de nicher sur le campus.
En ne prenant en compte que les nichoirs à mésanges, qui sont les seuls à être
occupés, l’évolution de l’occupation de ces derniers semble variable au cours du temps
(Annexe 3). En effet, si le taux d’occupation des nichoirs semblait élevé peu après leurs
installations (en 2015 et 2016), celui-ci a brusquement diminué en 2017 (-50% d’occupation)
avant de montrer une tendance à la hausse cette année. Pour ce qui est des espèces
nicheuses, ces dernières restent invariablement des mésanges bleues (Cyanistes caeruleus)
et des mésanges charbonnières (Parus major) qui se partagent les nichoirs de manière
relativement équitable.
On remarque aussi que les nichoirs qui étaient déjà occupés par des oiseaux les
années précédentes ont tendance à le rester cette année aussi (nichoirs 7, 8, 17, 18 et à
l’exception du nichoir 9). Cela pourrait indiquer une préférence de certains nichoirs par les
oiseaux constante au fil des années.
D’une manière générale, du fait de leurs taux d’occupation relativement élevés, les
nichoirs semblent avoir un effet positif sur la reproduction des populations de mésanges du
campus. À l’avenir, la pose de nouveaux nichoirs à mésange, sur des sites à proximité des
nichoirs occupés chaque année, pourrait donc être envisageable afin de favoriser la
reproduction de ces oiseaux.
7Mon point de vue
Les conditions de travail pendant ce stage étaient très agréables, j’avais la possibilité
de solliciter une aide à tout moment si le besoin s’en faisait sentir. Ayant participé au projet
avifaune dans le cadre de l’UE préprofessionnalisation, ce stage se plaçait parfaitement
dans la continuité du travail que j’avais déjà réalisé. Le seul inconvénient fut le fait que le
nombre d’oiseaux observés est parfois bien inférieur à nos attentes rendant le comptage
moins exaltant surtout lors d’une météo capricieuse. Mais cela reste malgré tout dérisoire en
face de tous les aspects positifs du stage.
J’ai été en autonomie une grande partie de ce stage. En effet, les cartes QGIS ainsi
que les sorties de recensement (à l’exception de quelques-unes avec Quentin ESNAULT) et
d’observation des nichoirs ont été réalisées seul. De cette autonomie, découle de grandes
responsabilités car c’est moi qui ai choisi le type de carte à réaliser ainsi que les dates des
sessions de recensement.
Ce stage m’a permis de renforcer mes connaissances en ornithologie mais aussi de
découvrir et d’utiliser le logiciel de cartographie QGIS dont la maîtrise est fréquemment
demandée pour postuler à des stages ou à des emplois. Fort de cette expérience, et
appréciant les recensements de biodiversité sur le terrain, J’ai pour projet professionnel de
devenir ingénieur écologue afin de d’estimer et de freiner l’impact de l’homme sur la
biodiversité. Afin de pouvoir mener à bien ma mission en tant qu’ingénieur écologue, il me
faut acquérir une expérience dans le recensement des espèces ainsi que dans la réalisation
de carte pour estimer la distribution d’espèces sur un site d’étude. Ce stage m’a donc permis
de m’initier à ces deux aspects fondamentaux de ce métier, m’a donné goût au travail en
extérieur et m’a permis de continuer à réaliser ces sessions de comptage de l’avifaune que
j’apprécie tant.
8Bibliographie
Anne Sophie Faber. Analyse de la distribution spatiale des habitats des mésanges bleues (Cyanistes
caeruleus) sur le campus de l’Université de Poitiers. Rapport de stage de master 1, Écologie et
Biologie des Populations. Poitiers, Université de Poitiers, 2017.
Blondel, J. L'analyse des peuplements d'oiseaux, élément d'un diagnostic écologique ; I. La méthode
des échantillonnages fréquentiels progressifs (E.F.P). Terre et Vie. 1975, p533-58.
Cordingley JE et al. Habitat Fragmentation Intensifies Trade-Offs between Biodiversity and Ecosystem
Services in a Heathland Ecosystem in Southern England. PLoS One. 2015.
Damien Nivelle. Suivi de l'avifaune du campus de Poitiers : distribution et densité. Rapport de stage
de master 1, Écologie et Biologie des Populations. Poitiers, Université de Poitiers, 2016.
Évolution des oiseaux communs [en ligne] : http://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/indicateurs-indices/f/1964/1115/evolution-labondance-oiseaux-communs.html
Mathilde Delage. Cartographie du suivi de l'avifaune au sein de la Faculté des Sciences de Poitiers.
Rapport de stage de licence 3, Écologie et Biologie des Organismes. Poitiers, Université de Poitiers,
2016.
Markus Fischer et al. « Summary for policymakers of the regional and subregional assessment of
biodiversity and ecosystem services for Europe and Central Asia ». IPBES. 2018.
Présentation de l’équipe de recherche EES [en ligne] : http://ebi.labo.univ-poitiers.fr/ees/
Wilcove et al. Habitat Fragmentation in the Temperate Zone: A Perspective for Managers.
Conservation Biology. 1986.
9Annexes
Annexe1 :
10Annexe 2 : Tableau récapitulatif des recensements de l’avifaune de campus de Poitiers en 2018.
Éspèce Nombre
Accenteur mouchet 26
Bergeronette grise 13
Cannard colvert 7
Chardonneret élégant 148
Choucas des tours 6
Corbeaux freux 2
Corneille noire 85
Coucou gris 1
Etourneau sansonnet 318
Fauvette à tête noire 2
Faucon crécerelle 15
Geai des chênes 9
Grimpereau des jardins 41
Grive draine 1
Grive musiscienne 1
Grosbec casse-noyau 8
Grue cendrée 2
Hirondelle des fenêtres 2
Hirondelle rustique 9
Linotte mélodieuse 1
Martinet noir 12
Merle noir 233
Mésange à longue queue 13
Mésange bleue 288
Mésange charbonière 263
Mésange noire 30
Mésange huppée 1
Moineau domestique 271
Pic épeiche 1
Pic épeichette 1
Pic vert 29
Pie bavarde 751
Pigeon ramier 348
Pinson des arbres 113
Pinson du nord 1
Roitelet à triple bandeau 21
Roitelet huppé 14
Rougegorge famillier 111
Rougequeue noir 35
Sittelle torchepot 9
Sizerin boréal 5
Sizerin cabaret 1
Tarin des aulnes 6
Tourterelle turque 9
Troglodyte mignon 1
Verdier d'europe 71
Total 3335
11Annexe 3 : Tableau récapitulatif de l’occupation des nichoirs à mésange depuis 2015. (/ : installation
postérieure à la période de reproduction)
Nichoirs 2015 2016 2017 2018
7 Charbonnière Charbonnière Charbonnière Bleue
8 Bleue Charbonnière Pas de traces Bleue
9 Bleue Charbonnière Bleue Pas de traces
10 Charbonnière Bleue Bleue Bleue
11 / Bleue Pas de traces Charbonnière
12 Charbonnière Bleue Pas de traces Pas de traces
13 / Charbonnière Pas de traces Pas de traces
14 Bleue Pas de traces Pas de traces Bleue
15 / Charbonnière Pas de traces Pas de traces
16 / Pas de traces Pas de traces Charbonnière
17 / Bleue Bleue Bleue
18 / Charbonnière Charbonnière Charbonnière
Nichoir caméra / / / Pas de traces
12Vous pouvez aussi lire