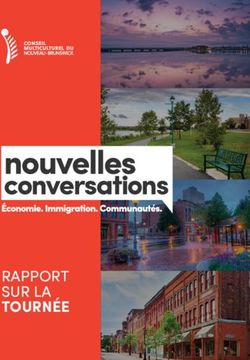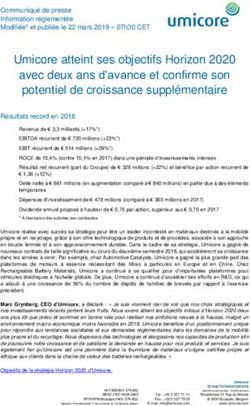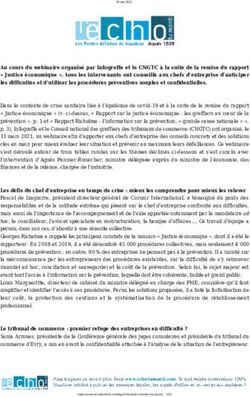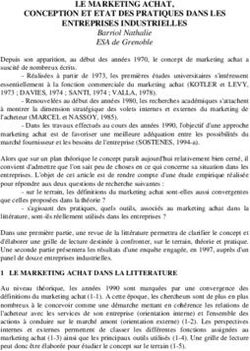LE DEVELOPPEMENT DURABLE : SON CONCEPT - CEP de Florac 1996
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
LE DEVELOPPEMENT
DURABLE :
SON CONCEPT
CEP de Florac - 1996HISTORIQUE
Le concept de développement durable est le dernier né d’un ensemble de démarche de
développement apparu dans les années 70 suite à l’échec du schéma dominant.
Les fondements théoriques de la durabilité ont été établis en 1980 par l’Union
Internationale pour la Conservation de la Nature (U.I.C.N.) puis développés par la
Commission Mondiale sur l’environnement et le développement (CNUED, Commission
Brundtland, Montréal, 1988).
Constatant les effets nocifs du développement qui dégrade les ressources sur lequel il repose,
minant ses bases même, la Commission conclut à l’inséparabilité des questions de
développement économique et celles touchant à l’environnement. Elle définit le concept de
développement durable comme l’ensemble des processus de changement par lesquels
l’exploitation des ressources , l’orientation des investissements et des institutions se
trouvent en harmonie et renforcent le potentiel actuel et futur de satisfaction des besoins
des hommes.
Les résultats de la Commission Mondiale ont suscité l’émergence d’un droit
international de l’environnement : convention de Sofia et d’Helsinki pour la pollution
atmosphérique, directive et convention de Bâle pour les déchets, convention de Montréal
pour le contrôle des CFC et la protection de la couche d’ozone, conventions de Ramsar,
Washington, Bonn et Berne pour la protection de la nature, convention d’Oslo et de Paris
pour la protection du milieu méditérranéen de l’Atlantique Nord-Est, convention de la mer
du Nord sur le déversement et l’incinération des déchets en mer, directives européennes sur
la qualité des eaux, directive « nitrates », directive « habitats »,...
La Conférence Mondiale sur l’environnement et le développement de Rio de
Janeiro consacrera le concept de développement durable : le développement durable est alors
défini comme un mode de développement qui contribue aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs.
La déclaration de Rio donnera naissance à la convention sur la biodiversité et
l’agenda 21, catalogue des recommandations à mettre en oeuvre pour un développement
durable.
Le concept de développement durable est devenu le cadre des actions du programme
des Nations Unies et de l’Europe (juin 1992 : règlement CEE n°2078/92 concernant les
méthodes de production agricole compatibles avec l’environnement ; décembre 1992 :
programme européen intitulé « vers un développement soutenable »).
En France, il est le maître mot de la législation sur l’aménagement et la protection de
la nature:
F circulaire DERF du Ministère de l’Agriculture sur la mise en oeuvre expérimentale
des plans de développement durable de septembre 1992.
CEP de Florac - 1996F décret portant création de la Commission du Développement Durable auprès du
premier ministre en mars (décret n°93-744 du 29 mars 1993 modifié par le décret n°
96- 53 du 23 janvier 1996). La commision est chargée de définir lers orientations d’une
politique de développement durable et de soumettre au gouvernement des
recommandations ayant pour objet de promouvoir ces orientations dans le cadre des
objectifs arrétés à l’occasion de la conférence des Nations Unies sur l’environnement et
le développement.
F loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement :
l’article L 200-1 déclare que les espaces , ressources et milieux naturels, les sites et les
paysages, les espèces animales et végétales, la diversité des équilibres biologiques
auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. Leur
protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont
d’intérêt général et concourrent à l’objectif de développement durable.
F loi du 04 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du
territoire : le schéma national d’aménagement et de développement du territoire fixe
les orientations fondamentales en matière d’aménagement du territoire, d’environnement
et de développement durable (art 2).
CEP de Florac - 1996DEFINITIONS DE LA DURABILITE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
La définition du développement durable est sujet à de nombreuses contreverses :
Pour certains la définition de l’UICN est trop restrictive , l’adjectif « durable » désigne
uniquement la valorisation des ressources biologiques et l’approche protectrice du patrimoine
naturel. La durabilité doit être appréhendée dans sa conception la plus globale possible et se
construit sur la base des dimensions suivantes :
F la durabilité sociale : il s’agit de construire une civilisation de l’être fondée sur un
partage plus équitable et la satisfaction des besoins matériels, fondements du
développement humain.
F la durabilité économique : il faut sortir d’une logique économique fondée sur les
seuls critères de l’entreprise pour évaluer l’efficacité économique en termes globaux et
instaurer un système mondial plus efficace (éviter les dettes, les détériorations de
l’échange,...)
F la durabilité écologique : elle suppose la limitation de la consommation des
ressources non renouvelables, la réduction de la pression des plus riches sur les ressources,
l’amélioration de l’efficacité dans l’utilisation des ressources non renouvelables et
renouvelables.
F la durabilité spatiale : elle implique une meilleure répartition spatiale des activités
humaines et des hommes : limitation de la concentration, décentralisation des
industries, promotion d’une agriculture non destructive des sols et de la biodiversité.
F la durabilité de la diversité culturelle : la gestion intégrée des écosystèmes doit
s’appuyer sur la tradition, les savoirs propres à chaque milieu et chaque contexte
culturel.
D’autres rejettent la notion même de développement durable sur la base de deux
arguments :
1) Un développement durable est antinomique : la notion de développement implique un
accroissement linéaire alors que la durabilité soutend un fonctionnement cyclique.
2) La notion même de développement est typiquement occidentale et a peu de sens dans la
plupart des pays en voie de développement où l’homme vit en harmonie avec la nature et en
respecte les grands cycles.
La liste des définitions qui suit n’est pas exhaustive mais permet d’avoir un bon aperçu de la
variété des définitions du concept de développement durable et de durabilité. Elle peut être
aussi un bon outil pédagogique pour travailler sur les représentations des concepts.
Notons que nous trouvons dans la littérature indifféremment les termes de développement
durable et de développement soutenable ; la notion anglaise de sustainability n’a pas
d’équivalent en français ; les termes approchant « soutenable » ou « durable » veulent avant
tout rendre compte du souci d’équilibre entre l’homme et son environnement.
CEP de Florac - 1996ALLEN (1980): (résumé U.I.C.N).
Le « Développement Durable » est une notion simple à comprendre : nous devrions
utiliser les espèces et les écosystèmes à des niveaux et d’une manière qui leur permettent de se
renouveler indéfiniment, quelque soit l’utilisation que l’on en fait.
L’importance qu’il y a à s’assurer que l’utilisation d’un écosystème ou d’une espèce est
durable varie selon la dépendance des sociétés par rapport aux problèmes de la ressource en
question. Pour la pérennité d’une société, l’utilisation durable de la plupart, sinon de toutes
ses ressources vivantes, est essentielle. Plus l’économie est flexible et diverse, moins on a
besoin d’utiliser certaines ressources durablement, mais, dans le même esprit, moins il est
excusable de ne pas le faire.
Il est essentiel de s’assurer que les hommes protègent l’ensemble des composantes de la
biosphère qui présentent un risque de disparition et ne modifient les autres que dans la mesure
où elles peuvent durer.
Le développement durable : développement qui, approximativement, tend vers la
réalisation durable des besoins humains et l’amélioration de la qualité de la vie.
BARBIER (1987) (Économiste)
Le concept de développement économique durable tel qu’il est appliqué au Tiers-Monde
est directement lié au niveau de vie croissant des classes pauvres, qui peut être mesuré
quantitativement en terme d’accroissement de la part alimentaire, du revenu effectif, des
services d’éducation, de la sécurité sociale, des équipements sanitaires et d’eau potable, etc. Il
n’est qu’indirectement concerné par la croissance économique nationale et globale. En termes
généraux, l’objectif premier est de réduire la pauvreté absolue des pays pauvres, en
fournissant des moyens de subsistance durables et sûrs qui puissent minimiser l’épuisement
des ressources, la dégradation de l’environnement, la rupture culturelle et l’instabilité sociale.
BROWN ET AL (1987) (écologues)
Au sens le plus réduit du terme, la « durabilité globale » signifie la survie des espèces
humaines à travers toutes les régions du monde. Au sens plus large, la définition spécifie que,
virtuellement, tous les humains naissent et vivent jusqu’à l’âge adulte, et que leurs vies ont
une qualité bien supérieure à la simple survie biologique. Finalement, la définition la plus
large de la « durabilité globale » inclue la persistance de toutes les composantes de la
biosphère, y compris celles qui ne comportent pas d’avantages apparents pour l’humanité.
CEP de Florac - 1996BURNESS AND CUMMINGS (1986) (économistes)
La notion de durabilité du Professeur Daily (1986) est extraordinairement vague et mal
définie. Au sens pédagogique, la durabilité implique que tous les processus opèrent seulement
à leur état d’équilibre dans un système renouvelable, ce qui pourrait alors suggérer un retour à
une agriculture préhistorique régulée.
CLARK (1986) (écologue et analyste politique)
L’un des principaux challenges des décennies à venir est d’apprendre comment les
interactions sur le long terme et à une large échelle entre l’environnement et le développement
peuvent être mieux gérées afin d’accroître les perspectives d’une amélioration écologique
durable, pour le bien être de l’humanité.
COOMER (1979)
La « société durable » est une société qui vit dans les limites d’auto-régénération de son
environnement. Cette société n’est pas une société qui n’évolue pas ; c’est plutôt une société
qui reconnaît les limites de la croissance...[et] recherche des modes de développement
alternatifs.
DAILY (économiste)
1. La durabilité, comme la justice, est une valeur impossible à appréhender par des
processus de marché purement individuels. (1986)
2. Par « croissance », j’entends croissance à l’échelle de l’économie. Par
« développement », j’entends l’amélioration qualitative de la structure, de la forme et de la
composition des stocks et flux physiques qui résultent à la fois de la technique et du bon sens.
(1987)
GEORGESCU-ROEGEN (1988) (économiste)
Si vous prenez juste un nombre croissant de malles postales, il s’agit de croissance. Et si
vous passez du transport par malles postales au transport ferroviaire, il s’agit de
développement.
CEP de Florac - 1996GOODLAND ET LEDEC (1987) (écologues)
1. Le développement durable est défini comme un exemple de transformations
économiques sociales et culturelles qui optimise les bienfaits sociaux et économiques
accessibles au moment présent, sans compromettre les bienfaits similaires dans le futur. Un
des objectifs essentiels du développement durable est d’atteindre un niveau acceptable
(toutefois défini) et équitable des répartitions du bien-être économique, qui peut-être perpétué
continuellement pour un grand nombre de générations.
2. Le développement durable implique l’utilisation des ressources naturelles
renouvelables d’une manière qui ne les dégrade ou ne les élimine pas, ou qui ne diminue pas
leur utilisation potentielle par les générations futures. Le développement durable implique de
plus l’utilisation de ressources minérales non renouvelables (épuisables) d’une façon qui ne
compromette pas inutilement leur facilité d’accès par les générations futures. Le
développement durable implique également un épuisement des ressources énergétiques non
renouvelables à une vitesse très réduite afin d’assurer une transition sociale méthodique vers
des sources d’énergie renouvelables...
HOWE (1979) (économiste)
Lignes directrices pour une politique d’utilisation responsable (rationnelle) des
ressources naturelles : les activités devraient être considérées comme étant destinées à
maintenir perpétuellement une base de ressources naturelles effective et constante. Ce concept
a été proposé par Page (1977) et implique non pas une base de ressources inéchangeable, mais
un panel de réserves de ressources, de technologies, et de maîtrise politique, qui maintienne
ou développe les possibilités de production des générations futures.
MARKANDYA ET PEARCE (1988): (économistes)
1. L’idée de base du développement durable est simple à mettre en oeuvre dans le
domaine des ressources naturelles (exceptées les non renouvelables) et de l’environnement :
leur utilisation dans le processus de développement devrait être durable à travers le temps. Si
nous appliquons maintenant cette idée aux ressources, la durabilité devrait signifier qu’un
stock donné de ressources (arbres, qualité de la terre, eau,...) ne doit pas décliner.
2. La durabilité pourrait être définie en terme d’exigence : celle que l’utilisation actuelle
des ressources ne doit pas réduire les revenus bruts dans le futur.
MOREY (1985) (économiste)
La littérature sur la désertification suggère en général que cette dernière nuit à la fois
aux perspectives du producteur et à celles de la société. L’utilisation durable est généralement
posée comme représentant la stratégie optimale.
CEP de Florac - 1996O’RIORDAN (1988) (écologue)
1. L’image de la durabilité risque dans le temps d’être si utilisée qu’elle en devienne
dénuée de sens, probablement comme un terme englobant les conflits idéologiques qui
s’infiltrent dans l’écologisme contemporain.
2. La durabilité est plus un phénomène général (que le développement durable),
embrassant les normes éthiques du domaine de la matière vivante, des droits des générations
futures, et des institutions chargées de s’assurer que de tels droits sont pleinement pris en
compte dans les politiques et les actions entreprises.
PEARCE (économiste)
1. Le critère de durabilité requière que les conditions nécessaires pour un accès
équitable aux ressources de base pour chaque génération soient appliquées. (1987)
2. En termes simples, le développement durable plaide en faveur d’un développement
sujet à un jeu de contraintes selon lesquelles le taux de prélèvement des ressources ne devrait
pas dépasser le taux de régénération naturelle ou artificielle; et l’utilisation de
l’environnement en tant qu’égout se ferait en se basant sur le fait que le taux d’ordures
stockées ne devrait pas excéder le taux d’assimilation (naturelle ou artificielle) des
écosystèmes correspondants...Il y a des problèmes évidents en soi dans le fait d’évoquer des
niveaux de durabilité de ressources périssables, c’est pourquoi les « durabilistes » ont
tendance à réfléchir en terme de jeu de ressources, englobant la substitution entre ressources
renouvelables et périssables. De la même manière, l’hypothèse implicite que la durabilité est
une « bonne chose » est évidente en soit (cela optimise le fait que l’utilisation durable est un
objectif désirable). En ces termes, la durabilité pourrait impliquer l’utilisation de services
environnementaux sur de longues périodes et, en théorie, indéfiniment.
Le concept clé au regard de la dégradation des ressources naturelles dans les pays en
développement est la durabilité. Les changements dans l’exercice de la gestion des ressources
pourraient finalement contribuer à la préservation de la base de ressources renouvelables, et,
en conséquence, au bien-être direct de la population et de l’économie globale future.
PEARCE, BARBIER, et MARKANDYA (1988) (économistes)
Nous considérons le développement comme étant un vecteur d’objectifs sociaux
désirables, et pouvant inclure ces éléments:
-croissance du revenu brut per-capita
-amélioration des acquis nutritionnels et de la santé
-accès à l’éducation
-accès aux ressources
-répartition des revenus plus juste
-croissance des libertés élémentaires
Le développement est alors une situation dans laquelle le vecteur de développement
croît de façon monotone au fil du temps.
Les conditions nécessaires pour le développement durable sont la « stabilité du capital
naturel » et plus strictement, l’exigence que les changements ne soient pas négatifs sur le
stock des ressources naturelles telles que le sol et sa qualité, les eaux souterraines et de surface
CEP de Florac - 1996et leur qualité, la biomasse terrestre, la biomasse aquatique, et la capacité d’assimilation des
déchets par les milieux qui les reçoivent.
PIRAGES (1977) (tirée d’une conférence fondée par l’Institut pour l’Ordre Mondial)
1. La croissance durable signifie une croissance pouvant être supportée par les
environnements physiques et sociaux dans un futur prévisible. La société durable idéale serait
celle au sein de laquelle l’énergie serait tirée du rayonnement solaire et où toutes les énergies
non renouvelables seraient recyclées.
PORRITT (1984) (Directeur des Frères de la Terre du Royaume-Uni)
Toute croissance économique dans le futur devrait être durable: cela revient à dire
qu’elle devrait s’opérer de l’intérieur, et non au delà, des limites finies de la planète.
REPETTO (1985) (économiste, Institut des Ressources Mondiales)
1. Le concept de durabilité tient dans l’idée que les décisions en cours ne devraient pas
altérer les perspectives de maintien ou d’accroissement des niveaux de vie futurs...Ceci
implique que nos systèmes économiques devraient être gérés de manière que l’on puisse vivre
des revenus tirés des ressources, en maintenant ou en accroissant ces dernières. Ce principe est
de plus en plus en adéquation avec la conception idéale du revenu que les comptables
cherchent à déterminer : la plus grosse quantité qui puisse être consommée dans la période
actuelle sans pour autant réduire les perspectives de consommation dans le futur.
2. Cela ne signifie pas que le développement durable demande la préservation du stock
actuel de ressources naturelles ou de n’importe quel « melting-pot » humain particulier et de
n’importe quel bien naturel ou physique. Tel que le développement s’effectue, la composition
de l’actif immobilisé sous-jacent change.
3. Un large consensus poursuit les politiques qui mettent en péril le bien être des futures
générations, qui ne sont représentées dans aucun forum politique ou économique, ce qui est
injuste.
REDCLIFT (1987) (économiste)
Jusqu’à quel point la croissance économique est-elle une mesure appropriée du
développement ?
CEP de Florac - 1996SOLOW (1986) (Prix Nobel d’économie)
Une société qui investit dans un capital reproductible les bénéfices compétitifs tirés de
l’extraction actuelle de ses ressources non renouvelables, appréciera un courant de
consommation constant dans le temps. Ce résultat peut être interprété en terme de stock,
défini et approprié, de capital (incluant la dotation initiale des ressources) se maintenant
intégralement, et la consommation peut être interprétée comme un intérêt envers ce
patrimoine.
TALBOT (1984) (Directeur Général de l’U.I.C.N.)
1. Objectif de la stratégie de conservation mondiale
La conservation a trois objectifs de base:
(1) maintenir les processus écologiques essentiels et les écosystèmes
(2) préserver la diversité génétique
(3) s’assurer que l’utilisation des ressources vivantes, ainsi que les écosystèmes
dans lesquels elles se trouvent, est durable.
TIETENBERG (1984) (économiste)
1. Le critère de durabilité suggère que, au minimum, les générations futures ne vivent
pas plus mal que les générations actuelles.
2. Plutôt que d’éliminer les taux d’escompte [positifs], le critère d’évaluation actuel
devrait être complémenté par d’autres critères, tels que la durabilité. Par exemple, nous
devrions choisir d’en maximiser la valeur actuelle, soumise à la condition que les futures
générations ne soient pas défavorisées.
TOLBA (1987) (Directeur exécutif, Programme Environnemental des Nations Unies)
1. Le développement durable est devenu une profession de foi, un mot d’ordre : souvent
utilisé, rarement expliqué. Ce concept représente-t-il une stratégie ? S’applique-t-il seulement
aux ressources renouvelables ? Que signifie actuellement ce terme ?
Dans un sens large, le concept de développement durable englobe :
(1) L’aide aux pays très pauvres, parce qu’ils sont laissés sans autre option que
de détruire leur environnement.
(2) L’idée de développement autarcique ou autosuffisant, au sein des
contraintes de ressources naturelles.
(3) L’idée de développement « au coût effectif » juxtaposant des critères
économiques différents par rapport à l’approche traditionnelle ; ceci revient à dire que le
développement ne devrait pas dégrader la qualité de l’environnement, ni réduire la
productivité sur le long terme.
(4) La résolution des grandes problématiques de contrôle sanitaire, des
technologies appropriées, de l’autosuffisance alimentaire, de la salubrité de l’eau, et de
logement, pour tous.
(5) La notion de nécessité d’initiatives de la part des populations locales ;
l’existence humaine, en d’autres termes, est la ressource au sein du concept.
CEP de Florac - 1996TONN (1988)
Deux principes de la planification sur cinq ans :
Principe 1: les génération futures ne devraient pas hériter des générations
présentes, des risques inacceptables de mort inhérents aux catastrophes environnementales ou
autres catastrophes, endigables.
Principe 2: les générations futures, aussi bien que les présentes, pourraient
éviter des contraintes, comme des sacrifices faits pour jouir des conditions du principe 1, sur
leurs libertés les plus élémentaires.
TURNER (économiste)
1. La stratégie mondiale de conservation donne une éminence considérable au concept
de durabilité, bien que ses applications implicites et pratiques n’aient pas été présentées sous
une forme détaillée et opérationnelle. (1987)
2. La signification précise de termes tels que « usage durable des ressources »,
« croissance durable », et « développement durable » est jusqu’ici démontrée comme
intangible. (1988)
3. En principe, une politique de croissance durable chercherait à maintenir un taux de
croissance acceptable en revenu réel per-capita sans déprécier le stock national d’actif
immobilisé ou le stock de biens environnementaux naturels.
4. Il s’agit d’un non sens que de parler de l’utilisation durable d’une ressource non
renouvelable (même avec des efforts de recyclage et des niveaux de réutilisation substantiels).
Tout niveau positif d’exploitation conduira en définitive à l’épuisement du stock fini.
5. Par ce mode de développement durable, la conservation devient la base universelle
pour définir un critère à l’aide duquel on puisse juger de l’intérêt d’affectations alternatives
pour les ressources naturelles.
W.C.E.D. (1987) (Rapport de Brundtland)
1. Nous venons de voir qu’une nouvelle voie de développement était requise, qui ferait
perdurer les progrès humains non seulement à certains endroits et pendant quelques années,
mais pour la planète entière et pour le futur éloigné. Ce développement devient un enjeu non
seulement pour les P.V.D., mais aussi pour les pays industrialisés.
2. Le développement durable est un développement qui satisfait les besoins du présent
sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs. Il contient
en soi deux concepts clé:
* le concept des « besoins », en particulier les besoins essentiels du Tiers-
Monde, auxquels les priorités directrices devraient être consacrées.
CEP de Florac - 1996* l’idée de limitations, imposées en fonction de l’état d’organisation sociale et
technologique par rapport à la capacité de l’environnement à satisfaire les besoins présents et
futurs.
3. Même l’étroite notion de durabilité physique suscite un intérêt pour l’équité sociale
entre les générations, un intérêt qui devrait logiquement être étendu à l’équité entre chaque
génération.
4. Les niveaux de vie qui vont au-delà du minimum de base sont durables seulement si
les niveaux de consommation s’intéressent partout à la durabilité à long terme. Encore
beaucoup d’entre nous vivent à l’écart des règles écologiques mondiales, par exemple dans
nos modèles d’utilisation de l’énergie. Les besoins perçus sont socialement et culturellement
déterminés, et le développement durable requiert la promotion de valeurs qui encourageraient
des niveaux de consommation allant de pair avec les bornes du « possible écologique » et
auxquels tous puissent raisonnablement aspirer.
5. La croissance et le développement économiques impliquent manifestement des
changements dans l’écosystème physique. Aucun écosystème, nulle part, ne peut être préservé
intact.
6. La perte [i.e. l’extinction] d’espèces animales et végétales peut grandement limiter les
options des générations futures; aussi le développement durable requiert-t-il la conservation
des espèces animales et végétales.
BANQUE MONDIALE (1987)
1.Le développement durable satisfait les multiples critères de la croissance durable,
l’allégement de la pauvreté, et une gestion environnementale saine.
2. A un large degré, la gestion de l’environnement devrait être conçue comme un moyen
d’atteindre les objectifs les plus larges de la croissance économique durable et de l’allègement
de la pauvreté.
3. Édifier l’intérêt des questions environnementales et développer la capacité à mettre en
pratique des outils sains pour la gestion de l’environnement sont des points avec lesquels nous
devons nous réconcilier, et, là où cela est approprié, faire l’échange entre les objectifs de
croissance et l’allégement de la pauvreté, et une gestion environnementale saine.
RAPPORT BRUNDTLAND (1987)
Le développemenrt durable est une modèle de développement qui permet aux générations
présentes de satisfaire leurs besoins sans compromettre la capacité des générations futures à
satisfaire leurs propres besoins.
CEP de Florac - 1996LE DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LE CADRE DES REVENDICATIONS
ENTRE ECONOMIE ET ENVIRONNEMENT
ALLEN (1980) (U.I.C.N.)
Le développement dépend de la conservation, et cette conservation dépend également
du développement.
La conservation de la biosphère est une nécessité pour la survie et le bien être des
hommes ; l’interdépendance est un inévitable ingrédient de la vie.
BARTELMUS (1986)
Les objectifs principaux du développement et de l’environnement ne sont pas en
conflit mais sont véritablement les mêmes, à savoir l’amélioration de la qualité de vie des
hommes, ou le bien être des générations présentes et futures.
CLARK (1986) (écologue et analyste politique)
A travers la majeure partie de l’histoire, les interactions entre le développement de
l’humanité et l’environnement ont été relativement simples et locales. Mais la complexité et
l’échelle de ces interactions augmentent... Ce qui fut franchement objet d’opposition entre la
préservation écologique et la croissance économique reflète maintenant de complexes
enchevêtrements (témoins la rétroaction entre l’énergie et la production de récoltes, la
déforestation et les changements climatiques, qui apparaît comme flagrante dans l’étude de
l’effet de serre atmosphérique).
TOLBA (1987)
Le développement économique et la qualité environnementale sont interdépendants et,
sur le long terme, se renforcent mutuellement. La gestion rationnelle du stock mondial de
ressources naturelles menacées anticipe sur une perte en qualité de l’environnement et accroît
la croissance économique durable.
W.C.E.D. (1987)
Il est impossible de dissocier les problèmes de développement économique des
problèmes d’environnement ; certaines formes de développement érodent les ressources
environnementales sur lesquelles elles devraient se reposer, et la dégradation de
l’environnement peut miner de l’intérieur le développement économique. La pauvreté est une
cause et un effet majeur des problèmes globaux d’environnement.
CEP de Florac - 1996BANQUE MONDIALE
Promouvoir la croissance, l’allégement de la pauvreté, et protéger l’environnement,
sont des objectifs qui peuvent se juxtaposer sur le long terme. Sur le cours terme, cependant,
ces objectifs ne sont pas toujours compatibles. (1987)
La pauvreté (des peuples et des pays) est ainsi une cause majeure de dégradation
environnementale. Ceci rend essentielle, si les dégradations environnementales ne deviennent
pas complètement ingérables, la conception de politiques orientées vers la croissance
économique avec une insistance toute particulière sur l’accroissement des revenus des
pauvres...Néanmoins, la croissance économique pourrait aussi détruire l’environnement et
épuiser les revenus déjà ténus des pauvres...Ainsi, et malgré le fait que la croissance soit
impérative pour l’allégement de la pauvreté, elle pourrait également affecter défavorablement
les pauvres et l’environnement, si une attention inadéquate était dispensée aux pauvres et à
leurs besoins. (1987)
La croissance économique, l’allégement de la pauvreté, et la gestion saine de
l’environnement sont dans bien des cas des objectifs mutuellement conséquents. (1988)
CEP de Florac - 1996MOTS CLEFS ASSOCIES AU CONCEPT DE DEVELOPPEMENT DURABLE développement : concept récent car le terme n’apparait qu’au 15ème siècle et se répandra surtout au 17ème et 18ème siècle avec la révolution industrielle et le développement des échanges internationaux. On associe actuellement la notion de développement à une dimension économique. Cette association est née dans les années 20 et 30, la Société des Nations l’utilisant par opposition au non développé. L’ONU lancera dans les années 1945 sa théorie du développement : le développement ne peut être assuré que par l’évolution économique ; cette vision soutend une notion de progrès perpétuel et illimité. . développement solidaire : développement soucieux des impacts qu’il peut avoir sur les autres sociétés. développement autocentré : ce concept apparait en opposition au système mondial régi par un ensemble de relations entre le centre (les pays développés) et la périphérie (les pays en voie de développement), le centre exerçant sur la périphérie une influence unilatérale et irréversible impliquant un échange inégal. Les centres du développement ne doivent être conçus que dans les fondements de la société même. développement endogène ou endodéveloppement : il s’agit d’un mode de développement qui s’appuie sur le « noyau positif » des valeurs culturelles héritées du passé ainsi que sur les éléments les plus valables du patrimoine universel. Il implique 2 exigences : - sur le plan de la finalité, il doit être au service de l’homme en vue d’assurer son plein épanouissement - sur le plan de la modalité, il est engendré de l’intérieur et respecte le droit d’un peuple à sa culture. développement communautaire : un développement né de l’ensemble des populations humaines dans le souci d’une parfaite équité. . durabilité faible : elle repose sur le principe de préserver de façon indéfinie la capacité des sociétés humaines à produire et non pas à conserver telle ou telle ressource, encore moins à conserver tous les éléments naturels dans un état inaltéré. Il s'agit non pas de manger son capital (équipements productifs, captital humain, capital naturel) mais de prendre en compte le revenu encore disponible une fois que la dégradation du capital a été compensée par des dépenses de restauration appropriées. Le capital naturel n'est ici pas considéré comme irremplaçable , il n'a de valeur que par les services qu'il rend (ce qui pose le problème de pouvoir mesurer la valeur des capacités naturelles et de pouvoir remplacer les services non renouvelables par des formes renouvelables). CEP de Florac - 1996
objectifs économiques
F croissance
F efficacité
objectifs sociaux objectifs écologiques
F équité F gestion des ressources
F réduction de la naturelles
pauvreté
durabilité forte : elle repose sur le principe que la sauvegarde du capital naturel est une
exigence à part entière, en plus de celle de préserver le capital total : les pertes du capital
naturel doivent être empêchées ou sinon compensées par la réhabilitation d'autres éléments de
ce capital naturel. Il s'agit donc de prendre en compte l'irréversibilité de certains dommages
causés à l'environnement.
objectifs économiques
F croissance
F efficacité
F équité
objectifs sociaux objectifs écologiques
F participation F respect de l'écosystème
F mobilité sociale F capacité de charge
F cohésion sociale F biodiversité
F identité culturelle F problèmes globaux
F développement institutionnel
ethnodéveloppement : comme le développement endogène, il se fonde sur le respect des
habitudes culturelles de la société mais ne s’appuie pas nécessairement sur les potentialités de
CEP de Florac - 1996la société pour assurer sa croissance. Il peut être exogène. Alors qu’il cherche à maintenir les valeurs culturelles, il en sape souvent les fondements qui sont rarement accessibles à l’ethnosociologue. écodéveloppement : développement endogène et dépendant de ses propres forces, soumis à la logique des besoins de la population entière, conscient de sa dimension écologique et recherchant une harmonie entre l’homme et la nature » (Ignacy Sachs) développement viable : il soutend 4 règles : - la définition d’objectifs de très long terme, d’ordre éthique et politique, au sens fort du terme, est un préalable à l’élaboration de toute stratégie de gestion (Weber et Bailly, 1993) - s’agissant de communautés humaines, la sociodiversité est au moins aussi importante que la biodiversité. - Les décisions économiques et sociales devraient être prises sous contrainte de maintien de la viabilité des écosystèmes, et parallèllement les aménagements des milieux devraient être respectueux du maintien de la viabilité des modes de vie. - Nos actions se feront en connivence avec les écosystèmes et leurs variabilités naturelles et non pas en concurrence ; il s’agira plus que de rechercher un optimum mais d’élaborer des stratégies adaptatives aux variabilités naturelles et économiques. Ce concept est proche de celui d’écodéveloppement à la différence que le développement viable ne préjuge pas « d’une logique des besoins de la population entière » qui soutend une notion d’équité intrinsèque à la démarche. Un développement peut être parfaitement viable et non équitable. Raisonner en terme de développement viable c’est s’imposer la règle d’équité qui n’émergerait pas obligatoirement de la démarche choisie. Le développement viable est par contre très différent du développement durable car refuse la notion d’équilibre soutendu par la notion de durabilité. Le développement viable a le souci de gérer une variabilité et des incertitudes inhérents à tout système (écosystème, système socio économique) et recherche à assurer une co-viabilité à long terme des écosystèmes et des modes de vie. développement intégré : notion qui s’oppose au système économique global où le marché est désarticulé et où règne la domination de certains pays sur d’autres. agriculture intégrée : ce concept est né de la notion de lutte intégrée ; elle propose des systèmes d’exploitation qui intègrent l’ensemble des techniques agricoles en privilégiant quand c’est possible les techniques respectueuses de l’environnement tout en maintenant ou accroissant le revenu de l’agriculteur. CEP de Florac - 1996
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ANTOINE S.; BARRERE M. ; VERBRUGGE G., 1994. - La planète terre entre nos mains (conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement de Rio de Janeiro). - Paris, la Documentation française, 442 p. ARNAUD D. ; ILBERT H. ; MONGRUEL R., 1994. - Biodiversité le fruit convoité. L’accès aux ressources génétiques végétales : un enjeu de développement. - Paris : FPH/Solagral, - (coll.dossier pour un débat, n°28). BARBUT M. ; KARSENTY A., 1994. - Stratégie pour une gestion des forêts tropicales dans un but d’exploitation durable. - Paris : UICN, Comité français, octobre 1994 BROWN M. ; WYCKOFF-BAIRD B., 1994. - Projets Intégrés de Conservation de la Nature et de Développement. - Biodiversity Support Program. CHAUVET M. ; OLIVIER L., 1993.- La Biodiversité : enjeu planétaire.- Paris : Ed. Sang de la terre CONFERENCE DES NATIONS UNIES POUR L’ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMEN, 1992. - Convention sur la Diversité Biologique DE MONTGOLFIER J. ; NATALI J.M., 1987. - Le patrimoine du futur : des outils pour une gestion patrimoniale. -Paris: Economica.- 248 p. EDWARDS S., 1994. - Utilisation durable des espèces. - Bulletin de l’UICN, n°2, Gland (suisse). -p.15, 1994 FAUCHEUX S. ; FROGER G., 1994. - Le revenu national soutenable est -il un indicateur de soutenabilité?. - Revue française d’économie, n°9, 1994 FAUCHEUX S. ; FROGER G. ; MUNDA G., 1994.- Des outils d’aide à la décision pour la multidimensionnalité systémique : une aplication au développement durable.- revue internationale de systémique n°15 FAUCHEUX S. ; FROGER G. ; NOEL J.F.,1993. - Quelle hypothèse de rationalité pour le développement soutenable ?. - Economie appliquée 46(4), 1993 GIRARDIN P., 1993. - Agriculture intégrée : au-delà des mythes...un défi. - Cahiers Agricultures, 2(2), pp 141-143, 1993. GODARD O., 1995. - Le développement durable : paysage intellectuel.- Nature,Sciences, Sociétés vol.2, n°4. - p.309-322, 1995. GODARD O., 1991. - Environnement soutenable et développement durable : le modèle néoclassique en question. -Séminaire du CNRS, Environnement et développement durable, Univ. de Paris I, avril 1991 CEP de Florac - 1996
GUILLE-ESCURET G., 1989. - Les sociétés et leurs natures. - Paris : Armand Colin. - 175 p. HENRY C., 1990. - Efficacité économique et impératifs éthiques : l’environnement en copropriété. - Revue économique, n°41. HUYNH CAO T ; LE THANH ; ROLAND C. et al, 1984. - Stratégies du développement endogène. - Paris UNESCO KLEITZ G.,1994. - Frontières des aires protégées en zone tropicale humide : quels projets de développement et de gestion des ressources naturelles? - GRET, Equipe agriculture. LEVÊQUE F., 1992. - Erosion de la diversité génétique et gestion mondiale des ressources vivantes. - Problèmes Economiques, n°2.278. p. 8-16 LEVÊQUE F. ; GLACHANT M., 1992 - Diversité génétique : la gestion mondiale des ressources vivantes. - La Recherche n°23. - p.114-123 LUCAS B., 1994. - Pour que la conservation soit durable! - Bulletin de l’UICN, n°2, Gland (Suisse). - p14. MERMET L., 1992. - Stratégies pour la gestion de l’environnement. - Paris : L’Harmattan.- 205p. OLLAGNON H., 1989. - Une approche patrimoniale de la qualité du milieu naturel. - In Mathieu N. et Jollivet M. (ed.) : Du rural à l’environnement, la question de la nature aujourd’hui.- Paris : A.R.F. : L’Harmattan. PASSET R., 1992. - De la connaissance à une maitrise de l’environnement : les approches économiques de l’environnement. - Problèmes Economiques n°2.278. - p.1-7 PRIEUR M., DOUMBE BILLE , 1994. - Droit de l'environnement et développement durable. - PULIM. -352p. SACHS I., 1993. - Ecodéveloppement. - Paris : Syros : Alternatives Economiques. SOLAGRAL, 1995. - La nature et le marché. - Courrier de la planète, n°30, septembre- octobre 1995 WEBER J. ; REVERET J.P., 1993. - La gestion des relations sociétés-natures : mode d’appropriation et processus de décision. - Le Monde Diplomatique, Octobre 1993. WEBER J. ; BAILLY D., 1993. - Prévoir, c’est gouverner. - Natures, Sciences, Sociétés, n° 1, Janvier 1993. WRI/UICN/PNUE, - 1994- La stratégie mondiale de la biodiversité. - Bureau de ressources génétiques, Comité français UICN CEP de Florac - 1996
Vous pouvez aussi lire