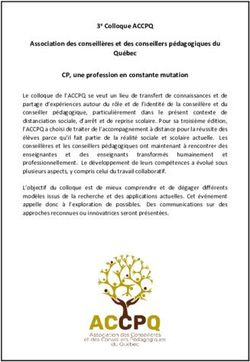Résumé et présentation des " ateliers ", des " consultations en vue de la création d'un groupe de recherches " et des " communications libres " ...
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Colloque du RRENAB 2021
« Identité et narrativité dans les littératures juives et chrétiennes
anciennes »
Du 3 au 5 juin 2021, ce colloque a lieu sous la forme d’un webinaire
Résumé et présentation des « ateliers », des
« consultations en vue de la création d’un groupe de
recherches » et des « communications libres »RRENAB 2021 Résumé des ateliers, consultations et des communications 2 Ateliers du jeudi 3 juin 15 h. 30 à 17 h. 00 Atelier 1 : «Les récits de conversion dans les Actes des apôtres : écriture, lecture et relecture» Organisation : Steeve Bélanger, Université Catholique de Louvain Engendrant une transformation marquée chez un individu, la conversion, qu’elle soit religieuse, philosophique ou idéologique, se manifeste généralement par l’adhésion à une nouvelle communauté, impliquant notamment l’adoption de nouvelles règles de vie, et une redéfinition identitaire du converti. Ce dernier l’expérimente souvent comme une refiguration temporelle de son identité pouvant conduire à une rupture soudaine par rapport à son passé proche ou lointain, à une manière nouvelle d’habiter le présent et de lui donner sens ainsi qu’à des possibles inédits ouverts vers l’avenir. Si plusieurs textes bibliques comportent de tels récits de conversion, c’est probablement dans le second volet du diptyque lucanien qu’ils sont les plus fréquents : entre autres, celui de Corneille et de sa famille (Ac 10) et ceux de Paul (Ac 9,1-30; Ac 22,1-22; Ac 26,2-23). Si ce type de récit a fait l’objet de nombreuses études, celles-ci se sont surtout intéressées aux stratégies narratives qu’ils construisent dans l’ensemble du récit, souvent sans rendre compte de leur réception par le lecteur et de sa coopération dans l’acte de lecture. Lors de cet atelier interdisciplinaire, nous ferons dialoguer narratologie classique et narratologie cognitive pour réfléchir d’abord aux fonctions des récits de transformation de l’identité des personnages puis à la manière dont ces récits ont été lus et interprétés par les commentateurs antiques des Actes des apôtres. Finalement, nous nous demanderons comment ces lectures plurielles ouvrent au(x) lecteur(s), anciens comme actuels, diverses possibilités d’identité narrative. Atelier 2 : «Identité textile : la contribution du vêtement à l’analyse des personnages» Organisation Anne Létourneau, Université de Montréal ; Corinne Lanoir, Institut protestant de Paris ; Ellen De Doncker, Université Catholique de Louvain Cet atelier propose d’explorer le motif narratif du vêtement et son rôle dans la mise en intrigue de différents personnages bibliques. À la suite des travaux pionniers de Jones et Stallybrass (2000) et de Frenk (2012) en études anglaises, il s’agit d’analyser l’effet des objets « textualisés », en particulier les vêtements, sur la caractérisation biblique. En effet, les gestes du dé/vêtir et les autres manipulations d’objets textiles contribuent à l’édification de l’identité narrative du personnage, à sa présentation de soi. Portés à même le corps, ces habits contribuent par ailleurs à la circulation d’affects narratifs des personnages aux lectrices et lecteurs. Dans le cadre de cet atelier, nous nous pencherons sur deux péricopes bibliques : Le butin imaginé de la mère de Sisera et de ses princesses (Jg 5,28-30) et le viol de Tamar, parée d’une tunique princière (2 S 13). Nous chercherons ainsi à jeter les bases d’une narratologie biblique sensible aux objets et à leur impact sur la caractérisation.
RRENAB 2021 Résumé des ateliers, consultations et des communications 3 Consultation en vue de la création d’un groupe de recherches : « Histoire de la réception ». Régis Burnet, Université catholique de Louvain Depuis que Gadamer a commencé à formaliser le concept de Wirkungsgeschichte1, beaucoup de travaux ont été consacrés dans les sciences bibliques aux questions de « réception » ou d’« histoire de la réception », mais force est de constater que chacun partit en ordre dispersé. Quoi de commun en effet entre l’Evangelisch-Katholischen Kommentars zum Neuen Testament, publié chez Benzinger2 ou le commentaire de Matthieu d’Ulrich Luz3 qui distinguent encore soigneusement l’exégèse historico-critique de l’usage postérieur qu’on a pu faire du texte, et la série des New Blackwell Bible Commentaries ou de la série Through the Centuries qui ne sont consacrées qu’à l’histoire des lectures du texte ? Faut-il, à l’image des Suppléments aux Cahiers Évangile, de la collection « Graphè » (publiée par les presses de l’Université d’Artois) ou du monumental dictionnaire de La Bible dans les littératures du Monde dirigé par Sylvie Parizet4, prendre en considération toutes les réceptions possibles, de la patristique à la chanson populaire, en passant par l’art, la musique, la littérature de tous les continents? Doit-on au contraire comme dans la collection «Études d’histoire de l’exégèse» (éditions du Cerf) se focaliser uniquement sur l’histoire des lectures théologiques d’Hippolyte de Rome à Dom Calmet en passant par Raban Maur et Jean Calvin ? Assez souvent, ces diverses entreprises hésitent entre l’histoire culturelle et l’illustration d’une exégèse traditionnelle par le détour de l’histoire des appropriations. Ce faisant, n’est-on pas en train de s’éloigner du projet gadamérien qui faisait de la Wirkungsgeschichte la clef de voûte du processus d’interprétation? En d’autres termes: comment faire pour que l’histoire de la réception serve effectivement à lire aujourd’hui le texte biblique ? Nos études, qu’elles se revendiquent de la méthode historico-critique, de la méthode narrative ou de toute autre méthode d’interprétation, font- elles même partie de l’histoire de la réception ? Dans ce groupe, nous essaierons donc de préciser la méthodologie de l’histoire de la réception, en prenant soin, comme on a commencé à le faire lors du RRENAB 2016 à Metz, de penser les articulations entre les questions de réception et les méthodes narrative et historico-critique. 1. H.G. GADAMER, Wahrheit und Method, Tübingen, Mohr Siebeck, defg, he éd. deij. 2. J. GNILKA, « Methodik und Hermeneutik. Gedanken zur Situation der Exegese », in J. GNILKA (éd.), Neues Testament und Kirche. Für Rudolf Schnackenburg, Freiburg im B., Herder, deih, p. hjm-hij ; K. LEHMANN, « Der hermeneutische Horizont der historisch-kritischen Exegese », in J. SCHREINER (éd.), Einführung in die Methoden der biblischen Exegese, Würzburg, Echter-Verlag, deid, p. hg-mg ; A. STOCK, « Überlegungen zur Methode eines Theologischen Kommentars », EKK Vorarbeiten Heft T, Zürich, Benziger, deit, p. ij-ef. Sur l’entreprise, voir également T. SCHMELLER, « Écrire aujourd’hui un commentaire (sur t Co) », Revue des sciences religieuses mg, tggf, p. thu- tjt. 3. U. LUZ, Das Evangelium nach Matthäus. Mt W-X (EKK d.d), Düsseldorf – Zürich – Neukirchen-Vluyn, Benziger – Neukirchener Verl., demj ; U. LUZ, Das Evangelium nach Matthäus. Mt Y-WX (EKK d.t), ibid., deeg ; U. LUZ, Das Evangelium nach Matthäus. Mt WY-Z[ (EKK d.u), ibid. deei ; U. LUZ, Das Evangelium nach Matthäus. Mt Z\-ZY (EKKd.h), ibid., tggt. Voir M. W. ELLIOTT, « Effective-History and the Hermeneutics of Ulrich Luz », Journal for the Study of the New Testament uu, tgdg, p. dfd-diu, mais aussi, pour une réflexion sur la Wirkungsgeschichte en lien avec sa propre pratique de recherche et d’enseignement, U. Luz, Matthew in History. Interpretation, Influence and Effects, Philadelphia, Fortress, demj. 4. S. PARIZET, La Bible dans les littératures du monde, Paris, Cerf, tgdf.
RRENAB 2021 Résumé des ateliers, consultations et des communications 4
Communications libres du jeudi 17.30-19.00 (2 groupes
parallèles)
Communications groupe 1. Présidence Elena di Pede
17.30-18.00 «Y-a-t-il de l’ironie dans le livre d’Habaquq ?»
Catherine Boutet, Université de Lorraine
Si « l’intention ironique relève au moins autant du lecteur-interprète que de l’auteur-ironiste » , il 1
est légitime de s’interroger sur la validité de l’interprétation de l’ironie dans une démarche
scientifique d’exégèse : « l’ironie est-elle une catégorie si malléable et si dépendante du lecteur
qu’elle échappe à tout usage méthodologique rigoureux et critique ? »2 . Et si jamais « toute l’ironie
se perd quand il faut l’expliquer »3 , le défi est de taille. Il demeure d’actualité un peu plus de dix
ans après le symposium du RRENAB : « L’ironie dans le récit biblique » (Faculté protestante de
Montpellier, 2009). Le Livre d’Habaquq est le champ choisi pour l’exploration de la tension
qu’engendre la notion d’ironie entre méthodologie et subjectivité. Sa datation4 entérine la distance
entre le lecteur contemporain et le ou les auteurs du texte sans rien y ajouter car elle est constitutive
du rapport des uns et des autres dans l’acte de lecture synchronique. Le thème central de ce livre
prophétique, le mal dans l’histoire des nations, tout comme son style littéraire dialogal devront être
situés au regard de l’enjeu évoqué plus haut.
1 D. LUCIANI, « L’ironie vétéro-testamentaire. De Good à Sharp », EThl 85 (2009), p. 405.
2 Ibid., « L’ironie vétéro-testamentaire », p. 397.
3 J.-L. SKA, « “ Nos pères nous ont raconté ”. Introduction à l’analyse des récits de l’Ancien Testament », CEv 155
(2011), p. 57.
4 L’écriture de ce texte se situe vraisemblablement entre 612 et 597 avant J.-C., pendant l’expansion babylonienne.
18.00-18.30 «Enquête sur les supposés grécismes de Qohélet»
Alain Machia Machia, Université Laval
L’originalité de la langue et du vocabulaire de Qohélet est l’un des rares traits autour desquels le
consensus est quasiment absolu dans l’aréopage des exégètes en ce qui est de ce livre tant
énigmatique qui n’a pas encore épuisé d’interroger. F. Piotti1 avait déjà fait le constat que dans les
livres de l’Ancien Testament en hébreu, l’Ecclésiaste est l’un de ceux dont le texte a été le mieux
conservé, ce qui en a facilité l’étude à partir du Texte Massorétique. De ces investigations, il en est
ressorti que l’hébreu de Qohélet est tellement particulier qu’on s’est demandé s’il est vraiment
original ou s’il est tout simplement la version hébraïque d’un supposé original araméen2 . En
effet, Delsmann avait identi>ié un total de 27 hapax legomena dans le seul livre de Qohélet dans le
3
cadre de l’ensemble de la littérature vétérotestamentaire, avec 26 mots ou combinaisons de mots
comme ( ׁשמלכQo 10,16.17) et ( וׂשריךQo 10,16.17). On recense aussi un nombre assez important
de mots terminés en –ōn et –ūt, des concepts abstraits, quasiment absents de la littérature biblique
antérieure, mais souvent présents dans les textes post-rabbiniques et mishniques 4 . Johann Gottfried
Eichhorn5 avait pour cela émis l’idée selon laquelle l’auteur du Qohélet se serait servi de concepts
étrangers pour forger son vocabulaire propre. John Henry van der Palm6 identifia, en 1784, ces
supposées sources étrangères comme provenant des vestiges littéraires grecs. Où en sont les
recherches sur la question et que devrait-on en retenir ?RRENAB 2021 Résumé des ateliers, consultations et des communications 5 1 F. PIOTTI, La lingua, 185 2 J. VILCHEZ, Eclesiastés o Qohelet, Pamplona, Editorial Verbo Divino, 1994, 72. 3 A. BONORA, Guía espiritual del An8guo Testamento: El libro de Qohélet, Barcelona, Herder, 1994, 14. 4 J. VILCHEZ, Eclesiastés o Qohelet, Pamplona, Editorial Verbo Divino, 1994, 74-75. 5 J. G. EICHHORN, Allgemeine Bibliothek der biblischen Literatur, 10 vols., Leipzig, 1787-1801 ; IDEM, Einleitung in das Alte Testament, 5 vols., Leipzig, 1780-1783... 6 J. H. VAN DER PALM, Ecclesiastes philologice et cri8ce illustratus, p. 20-23 18.30-19.00 «Identités en mutation dans les Homélies pseudo-clémentines. Le cas de la conversion de Clément et de sa famille» Philippe Therrien, Université de Lausanne/Université Laval Dans les Homélies du Pseudo-Clément, le lecteur suit l’apôtre Pierre alors qu’il attire à lui une foule de personnages, qui bénéficient de ses enseignements et de ses miracles. L’activité missionnaire de Pierre déclenche ainsi des conversions et de profondes transformations identitaires, révélant les enjeux théologiques sous-jacents à la trame romanesque. En effet, de païens à chrétiens, trois personnages – le narrateur Clément, sa mère Mattidie et son père Faustus – sont tour à tour convertis par Pierre, mais chacun selon des modalités bien distinctes. Cette communication propose donc d’examiner les spécificités de la mise en intrigue de ces trois récits de conversion : comment sont-ils construits, comment s’intègrent-ils au cadre narratif général et que peut-on en conclure sur le fonctionnement des Homélies? Cette contribution pourra en outre offrir des considérations sur l’identité du ou des rédacteurs des Homélies, sur la visée de l’œuvre dans son milieu de composition et sur les procédés employés pour s’attirer les faveurs d’un certain lectorat. Communications groupe 2. Présidence : Geert van Oyen 17.30-18.00 «Juda et Tamar : Gn 38, une histoire d’identité» Thérèse-dan Wang, Institut Catholique de Paris Ce que nous intitulons habituellement et sans doute un peu rapidement, « L’histoire de Joseph » que nous trouvons en Gn 37,2–50,26, apparaît comme une intrigue unifiée, relatant ce qui s’est passé entre Joseph et ses frères. Or, dans le cours du récit, nous butons sur Gn 38 qui semble sans rapport avec le reste, voire hors-sujet. Nous voudrions souligner quelques aspects assez surprenants de cette histoire de Juda et de Tamar, étrangement incrustée dans l’histoire de Joseph. Une crise se noue au moment où Juda renvoie Tamar à la maison de son père pour protéger la vie de son dernier fils Shélah ; et l’histoire se termine par la naissance de jumeaux, sans que rien ne soit dit sur la relation finale entre Tamar et Shélah. Le rédacteur de Gn 38, nous montre comment la descendance d’une étrangère se trouve intégrée au sein du peuple d’Israël. Grâce à Tamar, Juda reçoit deux jumeaux dont l’un est l’ancêtre de David. Alors que Juda et ses fils (Er et Onân) sont présentés sous des aspects critiquables, ce qui est dit de Tamar, une étrangère, est plutôt élogieux. Juda, l’ancêtre des judéens, doit reconnaitre qu’elle est plus juste que lui (v.26) ; et que c’est elle, l’étrangère, qui lui révèle sa propre identité. En outre, le récit comporte une subversion. En Gn 38, le mariage mixte est possible, ce qui n’est pas dans le cas dans cycle d’Abraham, d’Isaac et de Jacob (cf. Gn 24,3-4 ; Gn 26,34-25 ; Gn 28,1) ; l’histoire de
RRENAB 2021 Résumé des ateliers, consultations et des communications 6
Juda et de Tamar exprime donc un changement complet de perspective. L’essentiel pour le rédacteur
de Gn 38 n’est pas la question Nord-Sud , mais la véritable identité de Juda, et le retournement de
1
sa position vis-à-vis des étrangers. En résumé, l’histoire de Juda et Tamar telle qu’elle est décrite en
Gn 38 est peu théologique et peu conceptuelle dans son vocabulaire, mais contribue néanmoins à
forger une identité : l’ouverture aux autres nations.
1 Gn 38 est souvent mis en parallèle avec Gn 39 à propos de l’opposition Nord-Sud.
18.00-18.30 «Comment l’épisode de la reine de Saba (1 R 10,1-13) contribue-t-il à
l’élaboration d’un portrait de Salomon différencié selon TM et selon LXX ?»
Emanuelle Pastore, Institut Catholique de Paris
La finalité de notre recherche en thèse est de déterminer quelle est la fonction littéraire, socio-
historique et théologique de la péricope de 1 R 10,1-13 dans l’ensemble du cycle de Salomon (1 R
1-11). Un aspect de notre travail porte sur certaines différences entre le TM et la LXX qui
s’expliquent difficilement par de simples effets de traduction ou par des erreurs de copiste. Il est
possible qu’elles contribuent à l’élaboration d’un portrait différencié de Salomon. Les différences
d’une version à l’autre jouent sur deux niveaux : sur celui du type de sagesse dont Salomon fait
preuve et sur celui du rapport à la femme étrangère.
18.30-19.00 «La nécromancienne d’Eïn-Dor, une préfiguration des croyantes en la
résurrection?»
Christel Koehler, Centre Sèvres
De l’avis de nombreux chercheurs, la première formulation explicite de la foi en la résurrection des
corps dans le corpus biblique est dans le chapitre 7 du Deuxième livre des Maccabées.
Cette croyance s’enracine néanmoins profondément dans les Ecritures et s’est construite au fil des
siècles dans la théologie d’Israël. Nous posons deux hypothèses : d’une part, cette croyance était en
germe dans l’espérance d’Israël antérieure à la période maccabéenne. D’autre part, la femme en fait
une expérience inscrite dans l’expérience du corps, c’est une foi existentielle.
Une lignée de figures féminines qui font cette expérience jalonne l’émergence de cette doctrine. La
nécromancienne d’Eïn-Dor en fait partie. Cet épisode de 1 S 28 est déjà une préfiguration de la foi
en la résurrection à travers le statut de Samuel, le rôle de la femme et le soin qu’elle prend du
corps."RRENAB 2021 Résumé des ateliers, consultations et des communications 7 Ateliers et consultation du vendredi 4 juin 15 h. 30 à 17 h. 00 Atelier 3 : « La figure du Fils de l’homme en Luc-Actes dans la progression du macro récit. » Organisation : Nathalie Martin-Derore, Institut Catholique de Paris ; Marie-Pia Ribéreau-Gayon, Institut Catholique de Paris ; Sylvie de Vulpillières, Facultés Jésuites de Paris-Centre Sèvres Nous nous attacherons à la figure du « Fils de l’homme » en Luc-Actes afin de voir comment elle s’inscrit dans une chaîne de référence qui se densifie au fur et à mesure du macro-récit et contribue à le faire avancer. C’est à la lumière de cet enrichissement progressif du sens et de la transformation narrative qui en découle que nous vous proposerons de mettre en rapport le titre de Fils de l’homme avec les autres titres identitaires pour construire le personnage de Jésus. Nous vous inviterons également à poursuivre la recherche sur cette appellation Fils de l’homme dans le diptyque Luc-Actes. Bibliographie - Catherine SCHNEDECKER, Nom propre et chaîne de référence, Paris, Klincksieck, 1992. - Michel CHAROLLES et Catherine SCHNEDECKER, « Coréférence et identité. Le problème des référents évolutifs », Langages n°112,1993, p. 106-126. - Camille FOCANT « Du Fils de l’homme assis (Lc 22,69) au Fils de l’homme debout (Ac 7,56), Enjeux théologique et littéraire d’un changement sémantique », J. VERHEYDEN (ed.), The Unity of Luke-Acts, Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, (CXII), University Press, Peeters, Leuven, 1999, p. 563-576. - Jacques BUCHHOLD, « Jésus ou l’énigme du Fils de l’homme, Enquête sur les synoptiques », ThEv vol. 1, n°2, 2002, p.21-46. - Jacques BUCHHOLD « Jésus ou l’énigme du Fils de l’homme, Enquête sur les synoptiques », ThEv vol. 1, n° 3, 2002, p.3-24. - Clare. K. ROTHSCHILD, Luke-Acts and the Rhetoric of History (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 2. Reihe 175), Tübingen 2004. - Julie GLIKMAN, Céline GUILLOT-BARBANCE et Vanessa OBRY, « Les chaînes de référence dans un corpus de textes narratifs médiévaux : traits généraux et facteurs de variation » Langages n°195, 2014/3, p. 43-60. Atelier 4 : « Quand l’identité croyante adopte le récit : le cas de l’évangile selon Jean » Organisation : Simon Butticaz, Université de Lausanne ; Linda Sibuet Rakotovao ; Jean Zumstein, Université de Zurich. « Dans le cadre d’un atelier-texte consacré au quatrième évangile, nous souhaitons explorer diverses modalités à l’œuvre dans la construction narrative de l’identité et les effets de sens qui en découlent. Pour ce faire, nous approfondirons trois paramètres du récit – l’espace en Jn 5 et 6 ; le geste et le rite en Jn 13 et les personnages en Jn 21 – habités de deux questions directrices : (1) comment analyser ces composantes d’un récit, à l’aide de quels outils et théories précisément, afin d’en saisir les enjeux identitaires ? (2) En quoi ces catégories analytiquesdéployées sur le récit johannique favorisent-elles une lecture renouvelée et/ou complémentaire des passages considérés ? »
RRENAB 2021 Résumé des ateliers, consultations et des communications 8 Consultation en vue de la création d’un groupe de recherches : «Herméneutique biblique et études animales» Organisation Jacques Descreux, Université Catholique de Lyon ; Sébastien Doane, Université Laval ; Anne Létourneau, Université de Montréal ; Catherine Vialle, Université Catholique de Lille. Lire les récits bibliques à partir de la perspective de la place de l’animal permet de jeter un regard renouvelé sur les textes bibliques. Ce groupe de recherche propose d’explorer les dynamiques relationnelles entre les animaux, les humains, la terre, l’ensemble de la création et Dieu dans les textes bibliques. Partir de la question de la place de l’animal permettra d’ouvrir l’étude de la Bible aux enjeux écologiques importants dans le monde actuel, dans leurs dimensions sociales, éthiques, philosophiques et théologiques. Si dans le cadre du RRENAB, cette thématique s’enracine d’abord dans l’étude de la caractérisation des animaux dans les récits bibliques, elle veut s’ouvrir à l’interdisciplinarité par des avenues telles que : - L’herméneutique écocritique - La théologie, la philosophie et le posthumanisme - Les études des monstres et du bestiaire fantastique - La sotériologie - Les études animales - La zoo-archéologie - L’éthique Nous envisageons l’écriture d’un collectif et éventuellement l’animation d’un symposium/colloque du RRENAB à partir de cette thématique. Des réflexions théoriques ainsi que des analyses de passages spécifiques permettront de jeter les bases pour un champ d’études encore relativement peu développé. Bibliographie BERKOWITZ, Beth A., Animals and Animality in the Babylonian Talmud, Cambridge, University Press, 2018. BODSON, Liliane, « Les animaux dans l’antiquité : un gisement fécond pour l’histoire des connaissances naturalistes et des contextes culturels », dans L’animal dans les civilisations orientales (Acta Orientalia Belgica XIV), Bruxelles – Louvain-la-Neuve – Leuven, 2001, p. 1-27. DUCHÊNE, J., J.-P. BEAUFAYS, L. RAVEZ, Entre l’homme et l’animal : une nouvelle alliance, Presses Universitaires de Namur, Namur, 2002. FORTI, Tova, ‘Live a Lone Bird on a Roof’: Animal Imagery and the Structure of Psalms, University Park, Eisenbrauns, 2018. FORTI, Tova, Animal Imagery in the Book of Proverbs, Leiden, Brill, 2008. GENEST, Olivette, « La Bible relue par les animaux », dans Théologiques 10/1 (2002), p. 131-177. HETZEL, Aurélia, Bestiaire de la Bible hébraïque et chrétienne (Découvrir autrement), Paris, Le Monde de la Bible / Bayard, 2019. HYLAND, J. R., God’s Covenant with Animal’s. A Biblical Basis for the Humane Treatment of All Creatures, New York, Lantern Books, 2000. KEEL, Othmar et Thomas STAUBLI (dir.), Les animaux du 6e jour (Musée Bible et Orient), Fribourg, Editions universitaires, 2003. KOOSED (dir.), Jennifer L., The Bible and Posthumanism. Atlanta, Society of Biblical Literature, 2014. LÉMONON, Jean-Pierre, « Saint Paul aux prises avec les viandes sacrifiées aux idoles, les idolothytes », dans Communio 43/5 (2018), p. 63-72. LIMET, Henri, « Le bestiaire des proverbes sumériens », dans L’animal dans les civilisations orientales (Acta Orientalia Belgica XIV), Bruxelles – Louvain-la-Neuve – Leuven, 2001, p. 29-52. LINZEY, Andrew, Animal Theology, Urbana, Chicago and Springfield, University of Illinois Press, 1995. LUCIANI, D., Les animaux dans la Bible (CE 183), Paris, Cerf, 2017. MICHON, Anne-Laetitia, « La Bible et le statut des animaux au cœur du projet créateur », dans Contact 231 (2010), p. 231-255. MURRAY, R., The Cosmic Covenant. Biblical Thèmes of Justice, Peace and the Integrity of
RRENAB 2021 Résumé des ateliers, consultations et des communications 9 the Création (coll. Heythrop Monographs, 7), Londres, Sheed & Ward, 1992. STROMMEN, Hannah M., Biblical Animality after Jacques Derrida, Atlanta, SBL Press, 2018. STONE, Ken, Reading the Hebrew Bible with Animal Studies, Stanford, Stanford University Press, 2017. STRAWN, Brent, What is Stronger Than a Lion ? Leonine Image and Metaphor in the Hebrew Bible and the Ancient Near East, Fribourg, Academic Press & Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2005.
RRENAB 2021 Résumé des ateliers, consultations et des communications 10 Communications libres du samedi 14.00-15.30 (3 groupes parallèles) Communications groupe 3 : Présidence : Céline Rohmer 14.00-14.30 «La caractérisation du Ressuscité en Lc 24 : quelles modalités pour quelle(s) identité(s) ?» Romaric Ouattara, Université Catholique de Louvain La première impression qui se dégage à la lecture de Lc 24, laisse penser que l’identité du Ressuscité est fournie d’emblée en Lc 24, 3.13.36. C’est pourtant elle qui suscite la tension narrative dans les trois épisodes consécutifs : elle fait problème. Tout au long du récit, un jeu de voilement/dévoilement est ménagé pour rendre opaque l’identification du Ressuscité aussi bien pour les personnages intradiégétiques, que pour les lecteurs/rices. La présente communication propose de l’appréhender à partir d’une analyse qui prend en compte les effets du texte sur le lecteur, comme facteurs de caractérisation. De fait, l’intrigue de révélation de la séquence narrative dont il est question, se dénoue au fur et à mesure que l’on prête attention à la manifestation progressive du Ressuscité à l’ensemble des différents groupes de personnages mis en scène (les femmes, les compagnons d’Emmaüs, les Onze et ceux qui étaient avec eux). L’impact de ladite manifestation, perceptible seulement par le lecteur/rice, rend compte d’une transformation, voire d’une force libératrice liée à la présence ou à l’agir du protagoniste. La finesse du narrateur se découvre ici, dans une stratégie qui met en perspective la radicalité d’une transformation des personnages, pour faire ressortir avec plus d’éclat, la figure de celui qui est le vecteur de cette transformation (L. Madala, 2010). Le stratagème n’est-il pas un indice, invitant à reconsidérer avec plus de profondeur l’identité du Ressuscité en Lc 24 ? 14.30-15.00 « D’une déchirure à l’autre. Émergence et morcèlement des identités du texte et du lecteur dans et par Marc. » Antoine Paris, Université Sorbonne / Université de Montréal Dans une perspective phénoménologique, Georges Poulet décrit la lecture comme un moment où le texte devient « aux dépens du lecteur (...) un esprit conscient de lui-même » [Georges Poulet, « Criticism and the experience of interiority », in Reader-Response Criticism. From Formalism to Post-Structuralism (Jane P. Tompkins, dir.), Baltimore, The John Hopkins University Press, p. 41- 19, p. 47.]. Nous proposons de prolonger cette intuition en l’appliquant à la lecture de l’Évangile selon Marc. En Marc 1, 1-3, il se produit un phénomène similaire à l’émergence de la conscience, telle que la décrit le psychanalyste Michel de M’Uzan : « le soi-même archaïque doit (...) émerger d’une entité syncrétique confuse » [Michel de M’Uzan, Aux confins de l’identité, Paris, Gallimard, 2005, p. 20.]. La voix du narrateur émerge d’un magma de voix (le texte commence par une citation biblique qui présente le discours d’un personnage, qui cite lui-même la « voix de quelqu’un qui crie dans le désert ») et le texte émerge d’un magma de références à d’autres textes (Genèse, Isaïe, Malachie,
RRENAB 2021 Résumé des ateliers, consultations et des communications 11 Exode). Au contraire, en Marc 15, 29 - 16, 8, le texte fait disparaître tout ce qu’il avait construit comme repères et retourne ainsi à l’état d’« entité syncrétique confuse ». Le personnage principal disparaît, y compris comme humain ramené à la vie, puisque Jésus ressuscité n’apparaît jamais dans le récit. Surtout, les derniers mots de l’Évangile pourraient faire douter de l’existence même du texte [Si les femmes qui sont les seuls témoins de l’apparition au tombeau « ne dirent rien à personne car elles avaient peur » (Marc 16, 8), il est impossible que l’Évangile qui raconte cette apparition existe. ] . Si l’émergence de la conscience du texte coïncide avec un morcèlement de la conscience du lecteur, le morcèlement final de Marc permettrait l’émergence d’une conscience et donc d’une identité nouvelle du lecteur, par la confrontation avec la conscience du texte [Le texte, comme conscience autre, serait alors l’équivalent de ce que Michel de M’Uzan nomme le « jumeau paraphrénique » : un double permettant à une conscience d’émerger (Michel de M’Uzan, op. cit., p. 21).] . Il ne serait alors pas anodin que l’Évangile selon Marc soit construit entre les cieux « déchirés » du baptême (Marc 1) et le rideau du temple qui « se déchire » au moment de la mort de Jésus (Marc 15) : tandis que le texte va de l’émergence à la déchirure, le lecteur va de de la déchirure à une émergence nouvelle. 15.00-15.30 Les « questions » sur l’identité de Jésus dans l’évangile de Marc et la formulation σὺ εἶ (« tu es ... ») Geert Van Oyen. Université Catholique de Louvain On le sait, au centre de l’évangile de Marc se trouve la question fondamentale de Jésus : « Qui dites- vous que je suis ? » (8,29). Le protagoniste situe ainsi lui-même le problème de son identité de manière directe au cœur de l’intrigue du récit. Dans cette communication nous analysons comment le jeu de « questions et réponses » entre Jésus, la voix céleste, les disciples et les adversaires crée une tension permanente pour les lecteurs autour de cette identité. Non seulement ils veulent savoir comment les personnages réagissent, mais ils sont aussi défiés eux-mêmes à se prononcer sur l’identité. La formule σὺ εἶ (« tu es ... »), utilisé cinq fois dans l’évangile pour identifier Jésus, prend une place primordiale dans cette stratégie narrative. Il introduit cinq perspectives différentes sur Jésus dans cinq contextes différents. La voix céleste (1,11), les démons (3,11) et Pierre (8,29) se prononcent par des phrases affirmatives ; le grand-prêtre (14,61) et Pilate s’expriment par des questions. Mais comment réagit Jésus ? Et les lecteurs, ont-ils assez d’information pour pouvoir formuler leurs réponses ? Communications groupe 4 : Présidence Régis Burnet 14.00-14.30 «Lecture liturgique du récit de Jonas» Biasgiu Virgitti, Univerità Gregoriana Le renouveau biblique postconciliaire a permis de redécouvrir la richesse des récits bibliques à travers un nouveau Lectionnaire, destiné à raconter l’Histoire du salut. Malheureusement, peu d’études ont montré l’originalité narrative de cette nouvelle composition mise à disposition de nos
RRENAB 2021 Résumé des ateliers, consultations et des communications 12 communautés chrétiennes. L’analyse narrative ne peut-elle pas contribuer à une nouvelle approche des récits bibliques en lecture continue ou semi-continue dans la liturgie. Le récit de Jonas, lu dans son intégralité et en lectio continua dans la liturgie latine, représente un échantillon significatif de la lecture narrative en contexte liturgique. Nous présenterons le formulaire biblique et liturgique de la Feria IV, Hebdomada I in Quadragesima, et sa lecture chorale du récit de la conversion des Ninivites (Jon 3,1-10), avec le Miserere et l’évangile du signe de Jonas, qui évoque la conversion des Ninivites à la prédication de Jonas (Lc 11,29-32), pour en montrer la plus-value. 14.30-15.00 « "Ninive était une ville divinement grande, [une ville] de trois jours de marche" Une note sur la taille des villes et des armées dans l’Antiquité » Axel Bühler, Université de Genève. L’utilisation des nombres dans la Bible est un domaine d’investigation peu exploité. En prenant l’exemple du livre de Jonas qui contient de nombreuses hyperboles et souvent des nombres usuels (3, 40, 120’000), cette note cherche à montrer l’intérêt d’une cohérence quantitative des données numériques bibliques pour d’une part dégager au mieux les absurdités d’une compréhension littérale des nombres dans la Bible et d’autre part pour mener à une meilleure compréhension historique des sociétés antiques.
Vous pouvez aussi lire