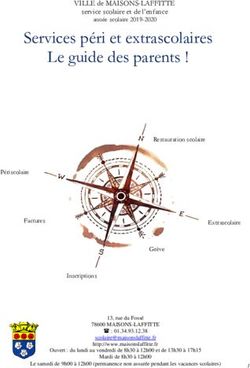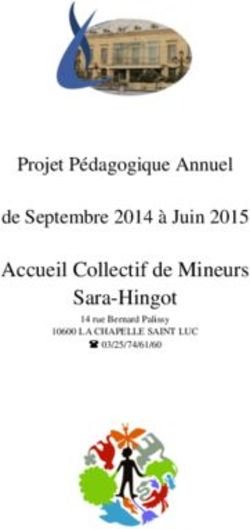Termes de référence : diagnostic socio-anthropologique - Mauritanie - Coordination ...
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Termes de référence : diagnostic socio-anthropologique - Mauritanie
Type d’évaluation : diagnostic socio-anthropologique
Période et durée : juin – août 2019 (3 mois)
Programme SAFIRE (Sécurité Alimentaire, Formation, Insertion, Résilience, Emploi)
Intervention de l’Union Européenne en Mauritanie, pour la période 2019 -2022, sous financement
Fonds Fiduciaire d’Urgence pour l’Afrique.
Localisation de la
Mauritanie – Région du Gorgol – Moughata’a de Kaédi (basé à Kaédi ville)
consultance
Durée du
48 mois (mars 2019 à mars 2023)
programme
1. Contexte
1.1 La sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le contexte du Gorgol
La malnutrition aigüe demeure un problème majeur de santé publique en Mauritanie, en dépit des
progrès réalisés ces dernières années par sa prise en charge via le gouvernement et ses partenaires.
La malnutrition reste la cause sous-jacente de plus de 50% de la mortalité infantile.
La saisonnalité de l'évolution de la malnutrition aigüe reste forte dans la région du Gorgol, avec des
pics importants en période de soudure (Mai - septembre) et une accalmie en période post-récolte. En
période de soudure, l'insécurité alimentaire et la malnutrition aiguë se conjuguent installant les
enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes et allaitantes dans une situation de vulnérabilité
extrême. La saison des pluies, puis la période de soudure sont des périodes à fort risque de diarrhée,
de paludisme et d'infections respiratoires pour les enfants de moins de 5 ans, qui les exposent à un
risque accru de malnutrition. Les enfants âgés de 6-23 mois sont particulièrement affectés par la
malnutrition aiguë. La prévalence importante de la diarrhée constitue un facteur aggravant sérieux.
L’enquête SMART réalisée en 2018 a révélé que la prévalence de la malnutrition aiguë globale (MAG)
au niveau national est de 11,6% avec un taux de cas sévères dépassant le seuil d’urgence nutritionnel
de 2% (2.3%). 07 Wilayas sont en situation critique avec une prévalence de la malnutrition aiguë
globale supérieure à >15 et/ou une prévalence de cas sévères supérieure à 2%. Il s’agit des wilayas
de Hodh El Chargui, Hodh El Gharbi, Assaba, Gorgol, Brakna, Guidimakha, Tagant.
Certains facteurs culturels, socio-économiques et environnementaux limitent certains
comportements alimentaires bénéfiques tels que l'alimentation du nourrisson et jeune enfant,
provoquant une aggravation du risque de malnutrition dans les communautés. Les enquêtes
montrent que les femmes doivent travailler aux champs pendant les périodes de récoltes et
1consacrent moins de temps au suivi de l'alimentation des jeunes enfants. Elles assument
d'importantes responsabilités dans toutes les tâches agricoles, notamment, le semis, le désherbage,
la récolte et participent activement au transport, stockage et à la conservation des récoltes.
Ces pratiques socio-culturelles privilégient de même l'utilisation et la consommation d'eaux de
surface plutôt que d'eaux issues de forages. Or l'eau de surface est une source de nombreuses
maladies hydriques. Les conditions en eau, hygiène et assainissement sont donc un facteur potentiel
d'aggravation des risques de malnutrition. Le paludisme, les infections respiratoires aigües et la
diarrhée constituent un cercle vicieux autour de la malnutrition aigüe et contribuent à accroître la
morbidité et la mortalité dues à la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans.
Les femmes enceintes et allaitantes ont des besoins accrus en calories et en nutriments de par leur
statut physiologique. Elles sont donc d'autant plus vulnérables face à l'insécurité alimentaire qui sévit
dans le Gorgol. Cette situation de malnutrition chez les femmes enceintes et allaitantes peut aussi
impacter le statut nutritionnel de l'enfant et entraîner une malnutrition.
Au-delà du risque lié au développement de l'enfant, la malnutrition des FEFA impacte également le
reste de la famille, de par le rôle de piliers que jouent les femmes pour la survie de la famille et des
enfants en particulier. Il est donc nécessaire d'apporter une attention particulière au bien-être des
enfants de 0 à 59 mois, mais également des femmes enceintes et allaitantes.
L’enquête de suivi de la sécurité alimentaire (FSMS) réalisée en août 2017 montre que 28% des
ménages mauritaniens sont en insécurité alimentaire, soit 1 076 000 personnes, dont 5,7% soit 218
000 personnes en insécurité alimentaire sévère.
L’analyse de l’évolution des taux d’insécurité alimentaire en période de soudure en Mauritanie met
en évidence son caractère structurel en raison de la récurrence des chocs de sécheresse et
d’inondation et de la pauvreté chronique. Les taux d’insécurité alimentaire restent structurellement
élevés, autour de 26 % en situation normale ou année normale, pouvant atteindre jusqu’à 32 % en
année de crise comme 2012, mais avec une forte variation de la sévérité de l’insécurité alimentaire
(ratio insécurité alimentaire sévère / modérée plus élevé) et de son impact sur le statut nutritionnel
des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes et allaitantes.
Evolution de l'insécurité alimentaire
mesurée par le FCS (données FSMS)
40%
32%
28%
30% 26% 27%
22% 24%
21%
18% 19% 19% 18%
20% 17%
10%
0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Soudure Post récolte
La dernière enquête de suivi de la sécurité alimentaire (FSMS) conduite en août 2017 donne un point
de référence avec une prévalence globale à 27,8% :
Insécurité % de ménages Nombre de personnes
FSMS août 2017
alimentaire affectés affectées
Sévère 5,7% 218 000
Prévalence d’insécurité
Modérée 22,1% 858 000
alimentaire
Globale 27,8% 1 076 000
2En année dite normale, grâce à la production agro-pastorale, une plus grande partie des ménages -
même parmi les plus vulnérables - est généralement en mesure de trouver les ressources leur
permettant de satisfaire leurs besoins alimentaires et nutritionnels, conduisant à la baisse du taux
d’insécurité alimentaire en période post-récolte (comme relevé dans les FSMS réalisés en
décembre/janvier des années précédentes). Malheureusement, compte tenu de la situation agro-
pastorale 2017/2018, les ménages les plus vulnérables qui ne disposent pas d’autres sources de
revenus, sont exposés à un risque de détérioration des conditions alimentaires.
1.2 La Croix-Rouge française en Mauritanie
Depuis 2001, la CRf et le CRm collaborent en République Islamique de la Mauritanie à travers la mise
en œuvre de projets dans les domaines du VIH/SIDA, la santé maternelle et néonatale, la sécurité
alimentaire et économique, la prévention contre la maladie à virus Ebola et la prise en charge de la
malnutrition aigüe. En 2016, la CRf en partenariat avec le CRm a poursuivi la réalisation de trois
projets:
un projet de prévention et de réponse contre la maladie à virus Ebola dans les Wilayas frontalières
du Sénégal et du Mali financé par la Délégation de l'Union Européenne(DUE) ;
un projet de santé maternelle et infantile dans la Wilaya du Gorgol financé par l'Agence Française de
Développement (AFD) ;
un projet d'appui à la prise en charge des patients vivant avec le VIH/SIDA. Ce projet est entré dans
sa phase de passation effective des prestations de la CRf à l'hôpital national de Nouakchott.
La CRf et le CRm poursuivent les actions engagées depuis 2007 avec le soutien de la DG ECHO dans la
lutte contre la malnutrition dans la région du Gorgol. L'action entreprise a permis jusqu' ici une
extension progressive pour couvrir l'ensemble des structures sanitaires dans la wilaya. La prise en
charge de la malnutrition aigüe est donc effective dans la région du Gorgol couplée aux activités
communautaires suivantes :
Sensibilisations ANJE dans les centres de santé
PB-Mère
Groupe de soutien ANJE
Cinéma débat communautaire
Visites à domicile
1.3 Le programme SAFIRE
SAFIRE regroupe trois (3) consortia dont les leads sont OXFAM, GRET, et CRf. Le consortium leadé par
la CRf et son partenaire le Croissant Rouge mauritanien, est composé d’ONG internationales (Terres
des Hommes Italie et le GRDR) et nationale (Ecodev) et travaillera dans trois wilayas (Guidimakha,
Gorgol et Nouakchott-Sud). Avec le Brakna, ces wilayas affichent les scores les plus forts du pays en
termes de taux pauvreté (Guidimakha, 49% ; Gorgol, 40%) et de chômage, en particulier des jeunes
et des femmes, d’insécurité alimentaire et de malnutrition aiguë sévère (Guidimakha, Gorgol). Au
sein de ces trois régions, la CRF aux côtés du Croissant Rouge interviendra au Gorgol dans la
Moughata’a de Kaédi (49 152 habitants). Le GRDR interviendra dans le Wilaya de GUIDIMAKHA et à
Nouakchott, Terres des Hommes à Nouakchott et Ecodev dans le Gorgol et à Nouakchott.
Globalement, SAFIRE cherche à impacter positivement la stabilité nationale et la cohésion sociale en
contribuant activement à l’augmentation de la résilience à l’insécurité alimentaire, aux multiformes
de vulnérabilité affectant les groupes et communautés pauvres et ou exposant directement, d’autres
groupes moins pauvres, aux effets des crises et des CC.
3Trois résultats sont attendus de la mise en œuvre du programme SAFIRE mais les activités CRf/CRM
sont principalement concentrées dans le second résultat.
Résultat 1 : l'insertion socioprofessionnelle durable est augmentée à travers le soutien à la
formation professionnelle et l'accompagnement à l'emploi
Indicateurs Pourcentage des bénéficiaires insérés
Pourcentages des personnes ayant validé la formation
Nombre de personnes qui ont eu accès à un emploi durable et décent grâce au projet
SAFIRE (désagrégé par sexe et catégorie d’âge et zone urbaine/rurale
Nombre d'emplois créés
R1A1 : Sélection et orientation des bénéficiaires
R1A2 : Définition de projets professionnels
R1A3 : formations techniques des porteurs de projets
R1A4 : Accompagnement des porteurs de projets
Résultat 2 : La résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle est renforcée à travers une
meilleure prise en compte de l'environnement et une augmentation de la production AP
Indicateurs Taux d'augmentation des productions impactant la résilience à l'insécurité alimentaire
et nutritionnelle y compris par une valorisation des complémentarités "rural-urbain
Augmentation du pourcentage de bénéficiaires AP vulnérables soutenus ayant
augmenté leur production (désagrégé par sexe du chef de ménage),
Augmentation du pourcentage des groupements ASP qui pratiquent des techniques
respectueuses de l'environnement,
Augmentation du pourcentage de bénéficiaires qui ont de bonnes pratiques
nutritionnelles (désagrégé par sexe du chef de ménage)
R2A1 : Renforcement Renforcement sur le plan organisation
des groupements d'AP Aide à la formalisation en structure associative
Renforcement des compétences techniques
Soutien à l'entrepreneuriat agropastoral
Appuis aux activités agropastorales (CDM, jardins hydroponiques et autres
R2A2 : Appui aux
coopératives féminines)
productions AP
Appui à l'insertion des jeunes et des femmes dans les entreprise AP soutenues
Accès aux financements
Site test et jardins hydroponiques
R2A3 : Renforcement Etude socio-anthropologiques
des capacités Elaboration d'outils de sensibilisation (ateliers culinaires et groupes ANJE)
nutritionnelles des Ateliers culinaires/groupes ANJE, actions de sensibilisation et d'éducation
communautés alimentaire
Résultat 3 : les complémentarités économiques et sociales entre territoires urbains et ruraux, les
opportunités liées aux dynamiques migratoires sont promues
Nombre de personnes ayant utilisé les cadres d'information urbain-rural pour accéder
Indicateurs à un emploi
Nombre de projets/actions qui renforcent le développement économique financé par
la diaspora dans les zones cibles
R3A1 : appuis aux initiatives Co construction d'espaces de solidarités rural-urbain, festival
agri culturelles "convergence citoyenne"
R3A2 : Soutien au Mise en relation des porteurs de Projets avec la diaspora
développement des liens entre
porteurs de projets et diaspora
4Plus spécifiquement la CRF/CRM prévoit les approches/activités suivantes :
La conduite d’une étude socio anthropologique dans le wilaya de Gorgol ;
Mise en place de 10 clubs de mères et accompagnement à la formalisation en tant que
structure associative et reconnaissance officielle par l’autorité compétente ;
Identification et mise en place d’activités génératrices de revenus par les clubs des mères,
dont 4 dans l’agropastoralisme ;
Renforcement des capacités des femmes dans la gestion technique et financière de leur
AGR ;
Mise en place d’ateliers culinaires et sessions d’échanges et de soutien à l’Alimentation du
Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE) au sein des CdM et à travers la communauté
Les approches communautaires sur lesquelles nous allons travailler sont les suivantes :
a. Mise en place de 10 clubs des mères
Les CdM assurent 4 fonctions :
- Fonction préventive: diminuer les tensions intercommunautaires en renforçant les activités
d’épargne et de crédit et les liens au sein du groupe par un regain d’activités productives qui
en font le ciment de la cohésion sociale du groupe.
- Fonction reconstructrice : les clubs des mères peuvent mettre en place des Caisses
communes incluant une caisse de solidarité (prêts aux membres) et une caisse de résilience
(cotisations mensuelles générées par les activités économiques collectives).
- Fonction de promotion des bonnes pratiques : en fonction du dynamisme et de la volonté
des membres clubs des mères, des activités de communication en nutrition pourront être
réalisées au sein de leur groupe et/ou auprès de leur communauté (sessions d’échanges et
de soutien à l’ANJE, ateliers culinaires, etc.).
Les membres des clubs des mères seront également formés sur le dépistage de la
malnutrition et le référencement des cas rencontrés au CS/PS en lien avec l’intervention
actuelle sur la zone (ECHO). Des activités complémentaires pourraient évoluer sur la base des
recommandations du diagnostic.
- Fonction productive : l’introduction d’un élément fédérateur au sein du club qui s’articule
autour d’initiatives productives collectives organisées par les femmes, dans l’intention de
générer des revenus pour augmenter les moyens des clubs et améliorer le niveau socio-
économique des ménages est important.
b. Mise en place d’ateliers culinaires et sessions d’échanges et de soutien à l’Alimentation du
Nourrisson et du Jeune Enfant dans la communauté.
Les clubs des mères pourront animer des ateliers culinaires et/ou sessions d’échange sur l’ANJE et les
pratiques alimentaires au sein de leur propre groupe (CdM) et au sein de leur communauté (groupe
communautaire évolutifs ANJE) en fonction de leur intérêt et motivation. Dans le cas contraire, des
groupes de soutien ANJE pourraient être créés dans la communauté par la communauté (sera défini
en fonction du diagnostic). Les ateliers culinaires seront basés sur les recettes existantes, les recettes
consommées, les aliments locaux accessibles et disponibles suivant la saisonnalité, les
représentations et perceptions des groupes d’aliments ainsi que les obstacles identifiés (un accent
sera mis sur les bouillies améliorées localement). Les ateliers culinaires ne visent pas à apprendre aux
participantes la préparation culinaire mais sert à une réflexion informée pour améliorer les recettes
existantes par catégorie d’aliment ainsi que les combinaisons possibles pour impacter positivement
la qualité nutritionnelle des repas en tenant compte de la question de goût.
5Cette intervention a pour objectif d’accroitre les connaissances sur la malnutrition, renforcer les
capacités nutritionnelles des communautés et améliorer la nutrition des groupes et ménages
vulnérables en milieu agropastoral (nutrition, diversification alimentaire, bonnes pratiques).
c. Elaboration d’outils de communication adaptés au contexte socioculturel en fonction des
résultats du diagnostic. Les membres des clubs des mères et les groupes de soutien ANJE recevront
un kit d’outils et seront formées à leur manipulation et à la mise en œuvre des activités définies
comme les ateliers culinaires et les sessions d’échanges sur l’Alimentation du Nourrisson et du Jeune
Enfant (ANJE). En Mauritanie, les acteurs ont déjà pu travailler sur des activités de démonstration
culinaire et des séances de causerie, l’approche proposée ici se base sur les résultats du diagnostic
socio-anthropologique afin de prendre en compte les barrières spécifiques identifiées, tout en
s’intégrant dans une approche participative.
Les résultats attendus sont les suivants :
- 10 clubs des mères (200 femmes) mettent en œuvre des projets collectifs. Les activités
techniques/productives seront menées de façon collective pour être fédérateur de la
cohésion sociale du groupe et renforcer le volet social. Ces activités collectives permettront
de générer des revenus qui pourront alors être réinvesties au niveau individuel selon la
volonté et les initiatives personnelles des membres du CdM. Les 2 types d’activités sont
possibles : collective et individuelle.
- Les clubs des mères accompagnées valorisent les pratiques favorables à une bonne nutrition
(organisation d’ateliers culinaires, sessions d’échanges et de soutien ANJE, dépistage de la
malnutrition et référencement des cas malnutris).
- 80% des membres des clubs des mères adoptent des comportements nutritionnels positifs
au sein de leur ménage.
- 10 clubs des mères des mères réalisent des ateliers culinaires et des sessions d’échange et de
soutien ANJE au sein de leur groupe et dans la communauté
2. Le diagnostic
2.1 Objectifs et attentes du diagnostic
- Analyse des représentations socio-économiques (place du genre, fonctionnement et gestion
économique) et des dynamiques locales collectives et individuelle existantes avant de mettre
en place les Clubs des Mères dans le contexte de la Mauritanie. En lien avec un diagnostic sur
les secteurs porteurs en cours de réalisation.
o Analyse des tendances (collectives et individuelles) dans le cadre d’une activité
génératrice de revenus ; Contraintes pour les femmes à faire partie des groupements.
Faire ressortir une analyse des principales réussites / Principaux échecs dans le domaine.
o Diagnostic des activités économiques autour desquelles les femmes sont organisées ;
activités que les femmes peuvent conduire mais très peu pratiquées et rentables.
o Diagnostic des activités économiques interdites aux femmes dans la zone - faire ressortir
les barrières en lien avec ces activités.
o Analyse des appréhensions vis-à-vis des groupements mixtes dans la zone.
- Diagnostic des représentations, pratiques, usages préexistants et mécanismes d’adaptation
(choix, mise en œuvre) liées à la sécurité alimentaire et la nutrition par l’équipe projet afin de
définir et mettre en place les activités communautaires.
6- Analyse des intérêts, des logiques et des stratégies des acteurs locaux par rapport au
dispositif projet pour assurer une mise en œuvre et un suivi adéquat (activités CRF/CRM,
région du Gorgol – Moughata’a de Kaédi). A ce titre, l’anthropologie du développement a
notamment démontré que le champ local relevait plus d’une arène politique, dans laquelle
les acteurs s’affrontent, que d’une communauté consensuelle, toute tournée vers la
satisfaction durable de ses besoins.
Utilisation des leviers d’action pour le changement des comportements des pratiques favorables à
une bonne nutrition (y compris ANJE). Ainsi, ce diagnostic contribuera à une meilleure adaptation du
projet aux réalités locales et à une meilleure compréhension des enjeux locaux par la production
d’une connaissance socio anthropologique à destination de l’équipe projet. Ce diagnostic sera basé
sur une méthodologie mettant en avant la participation active des communautés, en particulier les
coopératives féminines et clubs des mères qui seront mis en place. L’équipe projet sera impliquée
tout au long du diagnostic afin d’assurer l’appropriation des résultats. Le prestataire réalisera la
phase de diagnostic et assurera un accompagnement jusqu’à la mise en œuvre des activités afin
d’assurer la prise en compte des résultats dans l’action.
2.2 Couverture géographique
Région du Gorgol – Moughata’a de Kaédi
2.3 Déroulement
Revue bibliographique (travail qui pourra se faire à distance)
Briefings avant départ en Mauritanie (à distance) :
approche Clubs des Mères Croix-Rouge : Gema ARRANZ - Déléguée de Moyens d’Existence
Région Afrique (Livelihoods Resource Centre / IFRC Africa Region, Dakar Office) et Nathalie
WIRT – référente technique Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence Siège ;
nutrition à base communautaire (Croix-Rouge française) : Anne-Sophie DESMARIS – référente
technique régionale Afrique de l’Ouest et du Centre ;
Objectif de l’étude et contexte : Barnabe NOMBRE (coordinateur du projet) et Soazic DUPUY
(chef de délégation)
Mission Mauritanie :
rencontres : autorités locales, équipe projet ECHO CRF/CRM, GRET (acteur intervenant dans
la région du Gorgol). Le programme SAFIRE sera mis en lien, dans un souci de synergie, avec
le programme d’appui à la prise en charge de la malnutrition, conduit par CRF/CRM dans la
région avec ECHO. Une attention particulière sera également apportée aux passerelles avec
le consortium GRET qui appuie la production de farines améliorées au Gorgol. Un modèle
précis d’articulation et coordination sera à définir avec l’équipe projet ;
recrutement des traducteurs ;
formation des équipes ;
collecte et analyse des données qualitatives ;
restitutions communautaires ;
atelier du diagnostic à l’action avec les équipes et acteurs impliqués ;
système de remontée des informations continue avec la communauté (équipe) ;
rédaction des documents et supports (une partie du travail pourrait se faire à distance).
72.4 Résultats attendus
Rédiger un document d’étude socio anthropologique synthétique sur :
- les représentations socio-économiques existantes (place du genre, fonctionnement et
gestion économique). Une note synthétique d’approfondissement du diagnostic
socioéconomique de la zone d’action devra également être rédigée ;
- les dynamiques locales collectives et individuelles ;
- les représentations – pratiques, usages et mécanismes d’adaptation, préexistants liées à la
sécurité alimentaire et la nutrition ;
- les intérêts, logiques et stratégies des acteurs locaux par rapport au dispositif projet,
- les leviers d’action pour le changement des comportements des pratiques favorables à une
bonne nutrition (y compris ANJE) ;
- Des fiches techniques pratiques d’orientation seront ensuite élaborées pour que l’équipe
puisse facilement les utiliser lors de la mise en place des activités.
Elaborer des recommandations opérationnelles pour adapter ou faire évoluer les activités de
sensibilisation et les pratiques culinaires dans une perspective de renforcement des capacités
nutritionnelles des communautés rurales et semi urbaines.
Etablir une revue bibliographique de l’existant.
Réaliser des restitutions communautaires post diagnostic.
Appuyer l’équipe dans l’élaboration des outils de communication nécessaires aux clubs des
mères et groupes communautaires adaptés au contexte socioculturel en fonction des résultats
obtenus.
Appuyer la mise en place d’un système de remontée des informations continue avec la
communauté et former l’équipe (consultation communautaire).
2.5 Moyens humains et techniques
Moyens Conditions
Moyens de Les coûts relatifs à la communication seront à la charge du prestataire
communication
Moyens de Le projet pourra mettre à disposition du prestataire un véhicule. Cependant, ce véhicule
transport étant aussi utilisé par l’équipe projet, son utilisation nécessitera une planification
rigoureuse des besoins de la part du prestataire et une coordination avec le service
logistique du projet. Selon le coût proposé par le prestataire, la CRF pourra dégager un
montant pour la location d’un véhicule dédié à l’équipe pour l’étude.
Ressources L’équipe projet CRF est composée de la manière suivante : 1 coordinateur consortium – 1
humaines chef de projet – 1 assistant chef de projet – 1 chargé de mission CRM – 10 volontaires
CRM (1 par club des mères) – 1 chargé de suivi évaluation PMER.
Les ressources humaines nécessaires pour le recueil des données seront définies par le
prestataire. Cependant, l’équipe projet pourra être mobilisée pour :
faciliter l’accès aux localités et les rencontres avec les autorités locales,
préparer la logistique des missions (réservation hébergement, etc.),
participer au déroulement du diagnostic afin de s’approprier les résultats et
mettre en œuvre les activités
L’équipe projet ne pourra pas être mobilisée pour la traduction des entretiens (le cas
échéant).
Moyens Le prestataire pourra utiliser un bureau dans les locaux de l’équipe projet situés à Kaédi.
bureautiques Il pourra bénéficier des équipements bureautiques, à savoir : une photocopieuse, une
imprimante pour les petites impressions quotidiennes. En revanche, pour d’importantes
quantités, les impressions devront être planifiées en avance.
Hébergement Les coûts relatifs à la nourriture seront à la charge du prestataire.
82.6 Bibliographie / Documents mis à disposition
- Etude link-NCA 2016/2017 (disponible en accès libre à l’adresse suivante :
http://linknca.org/etude/region_de_matam_et_region_de_gorgol_zone_transfrontaliere_du_walo.h
tm
- Brochure + descriptif de l’approche Club des mères 2017 (Croix-Rouge française)
- Rapport Enquête SQUEAC/SLEAC
- Fiche activité : groupe de soutien à l’ANJE
- Carte et données démographique de la zone d’intervention
3. Profils et compétences requises
3.1 Profils
Capacités à travailler sur le terrain ;
Capacités d’écoute et d’observation ;
Capacités à respecter les délais ;
Diplomate et patient ;
Très bon esprit analytique et de synthèse ;
Bonnes capacités rédactionnelles ;
Maîtrise des outils informatiques Word, Excel etc.
3.2 Compétences et connaissances requises
Expérience d’enquêtes de terrain sociologiques et/ou anthropologiques qualitatives ;
Maîtrise des outils d’enquête tels que l’entretien ouvert ou le récit de vie ;
Connaissance des problématiques liées aux usages et représentations en Mauritanie ;
Très bonne maîtrise du français écrit et parlé ;
Connaissance des outils et/ou expérience d’analyse des acteurs : jeux d’acteurs et enjeux,
organisation sociale des communautés, identification de leviers d’actions pour le
changement de comportement.
4. Composition du dossier de candidature
- Le CV du ou des consultants ;
- Une note méthodologique détaillée ;
- Un budget détaillé.
La note méthodologique comprendra au minimum les parties suivantes :
Compréhension de la demande ;
Méthodologie de diagnostic proposée ;
Consistance de l’enquête ;
Etapes de réalisation ;
Moyens mobilisés ;
Organisation pratique ;
Chronogramme prévisionnel détaillé de réalisation.
95. Soumission du dossier de candidature
Les dossiers de candidature devront être déposés dans une enveloppe scellée. L’enveloppe devra
comporter la mention suivante :
Projet SAFIRE – Réalisation d’un diagnostic socio anthropologique – Croix-Rouge française.
Une copie informatique de l’ensemble des documents soumis sera envoyée par e-mail.
5.1 Lieu de dépôt des candidatures
Les dossiers de candidature sont à déposer à la Délégation de la Croix-Rouge française en Mauritanie
à Nouakchott, ou bien envoyés directement par email à l’adresse « recru-mauritanie.frc@croix-
rouge.fr » indiquant dans le titre du message « Réponse TDR/CRF/MAURITANIE/SAFIRE/Socio-
anthropo » (attention : un logiciel anti spam vous renverra un message après votre envoi, en vous
demandant de rentrer un code. Ce n’est qu’une fois cette démarche effectuée que l’e-mail
parviendra au destinataire).
5.2 Date limite indicative de réception des candidatures
Le 31 Mai, à 16 heures (heure Mauritanie).
6. Modalités de sélection
Une commission ad hoc sera chargée de l’évaluation des dossiers de candidatures reçus. Après
ouverture et analyse des offres, la commission pourra demander des précisions aux soumissionnaires
quant à leur offre. Une fois les éventuelles précisions données, la commission procédera à la
sélection du ou des soumissionnaires selon les critères de sélection définis.
Le marché sera attribué à l’offre jugée techniquement la mieux exprimée, c’est à dire techniquement
la meilleure (qualité de la note méthodologique et expériences du/des prestataires) et
financièrement réaliste.
10Vous pouvez aussi lire