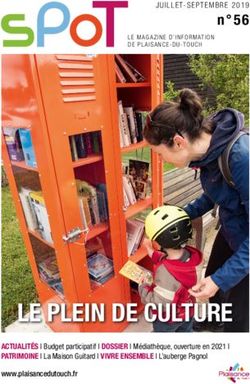ASTÉROÏDES L'EXPLORATION SPATIALE DES - Hiver - Printemps 2022 - volume 33 , numéro
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Une publication de la Société d’astronomie du Planétarium de Montréal • SAPM Hiver - Printemps 2022 — volume 33 , numéro 1
L’EXPLORATION SPATIALE DES
ASTÉROÏDESSommaire
3 Mot du président
4 Équipe de production
5 Espace des membres
7 Événements astronomiques
Crédit : NASA
12 Sur le web Page couverture : La sonde LUCY explorant un astéroïde troyen.
Accueil des
Pour y voir clair nouveaux membres
13
La différence entre un astéroïde La pandémie continue à affecter
et une comète nos abonnements ; toutefois, l’offre
du Passeport Multi-musées d’Espace
16 À la Une pour la vie nous a apporté un nombre
L’exploration spatiale des astéroïdes impressionnant de nouveaux membres.
La Société d’astronomie du Planétarium
Histoire
20 de Montréal (SAPM) est heureuse
La météorite du cap York d’accueillir 261 nouveaux membres
depuis août 2021. La provenance
de ces nouveaux membres est assez
Biographie
23 diversifiée : Montréal, Saint-Sixte,
Carolyn S. Shoemaker, une passionnée Brossard, Longueuil, Laval, Verdun,
du ciel étoilé Granby, Saint-Hubert, Sainte-Catherine,
LaSalle, Saint-Philippe, Repentigny,
Beloeil, Chambly, Beauharnois, Elgin,
Jeune astronome
25 Saint-Laurent, Saint-Jean-sur-Richelieu,
À la recherche des cailloux spatiaux Saint-Eustache, Franklin, Papineauville,
Pointe-Claire, Mascouche, Mercier,
Beaconsfield, Sainte-Mélanie et
Saint-Lambert.
28 Le Petit Planétaire
Merci à tous ceux qui sont
29 Une constellation et ses trésors restés fidèles à la SAPM
en ces temps difficiles !
32 Ciel profond
N’hésitez pas à consulter notre
35 Variations sur un même thème site web et nos réseaux sociaux
(Facebook et Twitter) pour obtenir
plus d’informations sur l’actualité
astronomique, nos ateliers
ainsi que nos activités.
Bienvenue à la SAPM !
L’icône SAPM contient des liens.
N’hésitez pas à cliquer dessus
pour découvrir plus d’informations.
Les textes n’engagent que leurs auteurs.
Hyperespace • Hiver - Printemps 2022 2Mot du président
Observations et formations
OBSERVATION DU CIEL L’HIVER conseil d’administration auxquels vous confierez la
L’hiver, puisqu’il il fait froid, il n’est pas commode gestion de la Société.
d’observer les beautés du ciel. Cependant, il y a On y remet aussi le prix annuel de la SAPM, le prix
beaucoup d’avantages à l’observation hivernale. La Michel-Nicole, pour souligner l’implication remar
noirceur arrive plus tôt et les nuits sont plus quable d’un de nos membres. Finalement, cette
longues. Il y a aussi de magnifiques constellations assemblée vous permet de communiquer vos
telles qu’Orion qui regorgent d’objets intéressants commentaires et suggestions au nouveau conseil élu.
comme la grande nébuleuse d’Orion Messier 42, la
nébuleuse de la tête de Cheval, de la Flamme et Nous vous y attendrons en grand nombre!
l’amas des Pléiades (Messier 45).
CONFÉRENCES DE LA SAPM
Il faut toutefois prendre des précautions pour bien (saison hiver-printemps)
se protéger de la froidure. Il faut s’habiller en couches,
Le conseil d’administration de la SAPM a décidé
soit la méthode de la « pelure d’oignon ». L’air entre
d’essayer une nouvelle formule pour les conférences
vos différentes pièces de vêtements servira d’isolant.
de la saison, c’est-à-dire qu’il n’y aura qu’une seule
Il vous faut de bonnes bottes et des semelles épaisses
conférence par mois. Cependant, aux mois d’avril
pour isoler le froid provenant du sol. Un thermos
et mai, si la température le permet, il y aura une
contenant une boisson chaude est toujours très
soirée d’observation de la Lune au Planétarium. En
réconfortant. Les chauffe-mains ou chauffe-pieds cas de mauvais temps, il y aura une nouvelle activité,
sont toujours très utiles. « Le salon du livre ». Plus de détails à venir en avril.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SAPM Pour toutes informations au sujet de nos activités,
Vous êtes cordialement invités à participer à l’assem je vous invite à consulter la rubrique Espace des
blée générale des membres de la SAPM qui aura lieu membres – Activités à venir à la page 5.
le vendredi 25 mars 2022 à 19 h 30. Nous vous infor
merons quelques semaines avant la tenue de cette Bonne fin d’hiver et bon printemps 2022 !
rencontre sur les modalités de cette importante soirée.
Cette rencontre constitue le moment privilégié où Alain Vézina
nous faisons le bilan du fonctionnement de la SAPM Président
et où nous procédons à l’élection des officiers du Société d’astronomie du Planétarium de Montréal
Sommaire Hyperespace • Hiver - Printemps 2022 3Équipe de production
Nouvelle capitaine
à bord de l’Hyperespace
Après trois ans aux commandes de l’Hyperespace, ma mission se
termine avec la parution de l’édition hiver-printemps 2022. Dorénavant,
c’est Margaux Szuter qui sera votre capitaine. Elle saura, j’en suis
certaine, vous transporter avec passion vers de nouveaux horizons.
J’aimerais remercier tous les membres de l’équipage (les auteurs, Équipe de production
les réviseurs et les astrophotographes) qui ont fait de ce voyage une
incroyable aventure.
Rédactrice en chef
Quand j’ai joint l’équipe à l’été 2019, j’arrivais avec beaucoup d’enthou Isabelle Léveillée
siasme et un petit vertige.
Assistante à la rédaction
Je peux conclure en utilisant les mêmes mots dans un autre contexte, en Johanne Prud’homme
disant que l’enthousiasme de tous les collaborateurs m’a marquée (et va
me manquer) et que le vertige est encore plus grand, car maintenant je Réviseure
réalise l’immensité que représente cette quête de percer les secrets de Geneviève Girard
l’univers.
Réviseur scientifique
Bonne lecture ! et recherchiste
Jean-François Guay
Isabelle Léveillée
Rédactrice en chef Conception visuelle
Kanoca infographie
Pour joindre la rédaction :
Isabelle Léveillée
isabelle.hyperespace@sapm.qc.ca
Mission SAPM et
conseil d’administration
Pour joindre la SAPM
Sommaire Hyperespace • Hiver - Printemps 2022 4Espace des membres
Conférences et activité spéciales
février avril
« Voir » de la matière La vie sur Vénus
non lumineuse (Conférence)
(Conférence) par Frédérique Baron
Vendredi 22 avril 2022
Partie 2 - Des galaxies à la matière sombre
par Olivier Hernandez
Vendredi 18 février 2022
Soirée d’observation de la Lune
OU Salon du livre
(Activité spéciale)
mars Vendredi 8 avril 2022
L'astronomie aux jumelles
(Conférence) mai
par Philippe Graveline
Vendredi 11 mars 2022 La théorie du Big Bang
(Conférence)
Assemblée générale par Richard Piché
des membres de la SAPM Vendredi 27 mai 2022
Vendredi 25 mars 2022 à 19 h 30
Soirée d’observation de la Lune
OU Salon du livre
(Activité spéciale)
Vendredi 13 mai 2022
Crédit photo : Greg Rakozy
Sommaire Hyperespace – Hiver - Printemps 2022 5Espace des membres
Les suggestions de lecture d’Isabelle Harvey
Initiation à la cosmologie
par Marc Lachièze-Rey, 2013
À la croisée de l'astrophysique et de la physique des particules, la cosmologie offre une
connaissance de plus en plus riche de l'Univers et de son origine. Ce livre élabore des
raisonnements physiques et mathématiques qui permettent de concevoir des modèles
d'Univers (infini, fini, courbe, etc.). Cette édition est une actualisation rendue nécessaire, car
la cosmologie est un domaine où les découvertes et les interprétations sur les processus
d'organisation de l'Univers foisonnent. Un nouveau chapitre sur la cosmologie quantique a
également été ajouté. (Code : F0245)
Astronomica
par Fred Watson, 2012
Les étoiles et les planètes fascinent les hommes depuis la nuit des temps. Au fil des siècles, les
observateurs ont rassemblé une multitude de données sur l'Univers. Cette quête incessante
nous a conduits à approfondir nos connaissances sur le Système solaire et poussés, au-delà
des limites de notre galaxie, à la découverte d'autres mondes. Astronomica propose au lecteur
une plongée passionnante à la découverte de l'Univers et des objets célestes peuplant les
profondeurs du ciel nocturne. (Code : F0236)
Histoire visuelle des sondes spatiales :
50 ans d’exploration de Luna 1 à New Horizons
par Philippe Séguéla, 2009
Ce livre veut rendre hommage au génie inventif derrière ces exploits. Depuis 1959, l'année
où la sonde soviétique Luna 1 a été la première à se libérer de l'attraction terrestre, le
lecteur pourra constater l'évolution croissante qui mène aux engins spatiaux du XXIe siècle,
de véritables explorateurs autonomes équipés de puissants moyens d'investigation et de
communication. Qui aurait cru possible de toucher une comète, de capturer du vent solaire
ou de se poser sur une lune de Saturne ? (Code : F0123)
Les comètes et les astéroïdes
par Philippe de La Cotardière et Anny-Chantal Levasseur-Regourd, 1997
Frôlées par des sondes spatiales, elles se sont révélées être de proches cousines des discrets
astéroïdes qui se croisent par milliers dans le Système solaire : une comète "usée" par des
passages répétés au voisinage du Soleil peut se changer en astéroïde, et il suffit d'une
pichenette cosmique pour qu'un astéroïde devienne une comète. Cet ouvrage donne de
ces « petites planètes » une synthèse des découvertes les plus récentes, enrichie par une
approche historique remontant aux sources de la fascination populaire pour les comètes.
(Code : F0058)
Les codes indiquent la Les
référence
codes indiquent
du livre à la bibliothèque
référence du du
livre
Planétarium
à la bibliothèque
de Montréal
du Planétarium de Montréal.
Pour découvrir d’autres suggestions d’Isabelle,
suivez ce lien vers la bibliothèque de la SAPM.
Sommaire Hyperespace • Hiver - Printemps 2022 6Événements astronomiques par Marc Jobin
Enfin ! Une éclipse totale de Lune !
La première éclipse totale de Lune visible du Québec impressionnante, plus ou moins sombre selon la
en plus de trois ans a lieu dans la nuit du 15 au quantité de particules et autres aérosols en
16 mai. Le phénomène sera observable en entier suspension dans la stratosphère.
depuis l’est de l’Amérique du Nord. La Lune se lève
L’apogée de l’éclipse totale a lieu à minuit 11. À
durant l’éclipse dans l’ouest du continent.
ce moment, on retrouve la Lune à 23 degrés de
La Lune entre graduellement dans la pénombre de hauteur vers le sud-sud-est, dans la constellation
la Terre à compter de 21h32, mais il faut attendre de la Balance. Après la totalité, la Lune émerge
une bonne demi-heure pour qu’on commence à graduellement du cône d’ombre de la Terre ; on
distinguer un léger assombrissement de la partie assiste à nouveau à la séquence de phases partielles,
gauche de son disque. Cette impression que jusqu’à 1h55. L’éclipse par la pénombre, moins
« quelque chose » est en train de se produire se spectaculaire, se poursuit jusqu’à 2h51. La Lune
confirme quelques minutes avant le début des quitte alors complètement l’ombre de la Terre et
phases partielles à 22h27. Pendant l’heure qui suit, c’est la fin de l’éclipse.
on verra le profil circulaire de l’ombre de la Terre
Une autre éclipse totale de Lune aura lieu l’automne
avancer progressivement sur la surface de notre
prochain. Le 8 novembre, au petit matin, les astro
satellite. L’éclipse est totale entre 23h29 et 0h54 ;
nomes du Québec pourront assister à la première
éclairée seulement par un filet de lumière rougie
moitié du phénomène, qui sera interrompu par le
par son passage à travers l’atmosphère terrestre, la
coucher de la Lune… et le jour qui se lève !
Lune prend alors cette fameuse teinte orangée si
La Lune passe dans l’ombre de la Terre dans
la nuit du 15 au 16 mai. Le nord est en haut ;
OMBR E
P ÉN
selon l’heure de la nuit et l’endroit où
on se trouve, l’ensemble de la figure
doit pivoter vers la gauche ou
la droite pour correspondre
à l’orientation de la Lune
dans le ciel.
OMBRE
d’après des données de F. Espenak/NASA GSFC; images de la Lune : NASA SVS
0h11
Crédits diagramme : Marc Jobin/Planétarium Rio Tinto Alcan,
21h32
22h28
23h29
0h54
1h55
2h51
Sommaire Hyperespace • Hiver - Printemps 2022 7Événements astronomiques
QUATRE BELLES OCCULTATIONS
La Lune se déplace continuellement par rapport aux lointaines étoiles d’arrière-plan. À l’occasion, elle passe
devant certaines d’entre elles, produisant une sorte de « mini-éclipse » qu’on appelle une occultation. À cause
de leur distance littéralement astronomique, les étoiles nous apparaissent comme des points non résolus (sauf
rares exceptions) ; leur disparition ou réapparition au bord de la Lune se produit en un clin d’œil. C’est un
phénomène absolument fascinant à observer et facile d’accès pour de petits instruments dans le cas d’étoiles
relativement brillantes. En voici quelques-unes, observables depuis le sud du Québec, qui vaudront le coup
d’œil au cours des prochains mois.
Le 16 mars en début de soirée, la Lune gibbeuse croissante (éclairée
à 94 %) occulte Êta Leonis (magnitude +3,5), l’étoile immédiatement
au-dessus de Régulus dans l’astérisme de la Faucille (ou tête du
Lion). À Montréal, la disparition a lieu à 19h 57min 4s au bord
sombre de la Lune, qui se trouve alors à 38° de hauteur en
direction est-sud-est ; l’étoile réapparaît à 21h 4min 20s
derrière le bord éclairé de notre satellite (hauteur 48°).
Soulignons qu’Êta Leonis est une étoile double rapprochée ;
la composante B, de 8e magnitude, est séparée de seulement
0,1" de l’étoile principale.
Occultation Êta Leonis.
Crédits diagramme : Marc Jobin/Planétarium Rio Tinto Alcan ;
image de la Lune : NASA SVS
Deux jours plus tard, dans la nuit du 18 au 19 mars, la Lune gibbeuse
décroissante (éclairée à 99 %, donc presque pleine) occulte Porrima
ou Gamma Virginis (magnitude +2,8), une superbe étoile double
dont les composantes A et B, de magnitude semblable (+3,5) et
séparées de 3,2 secondes d’arc, sont faciles à voir même dans
un petit télescope. Les deux disparaissent et réapparaissent
distinctement à quelques instants l’une de l’autre. Absolument
fascinant ! (Techniquement, Porrima est une étoile multiple,
mais les autres composantes du système sont très faibles.) À
Montréal, la disparition a lieu à 0h 44min 9s derrière le bord
éclairé de la Lune, à 41° de hauteur au sud-sud-est ; l’étoile
réapparaît à 1h 47min 12s au bord sombre de notre satellite
(hauteur 43° au sud).
Occultation Gamma Virginis.
Crédits diagramme : Marc Jobin/Planétarium Rio Tinto Alcan ;
image de la Lune : NASA SVS
Sommaire Hyperespace • Hiver - Printemps 2022 8Événements astronomiques
Dans la nuit du 18 au 19 avril, la Lune gibbeuse décroissante
(éclairée à 92 %) occulte Dschubba ou Delta Scorpii (magnitude
+2,3), une des étoiles qui dessine la tête du Scorpion. À Montréal,
Dschubba disparaît à 2h 12min 51s derrière le bord éclairé de
la Lune, à 21° de hauteur au sud-sud-est ; l’étoile réapparaît
à 3h 7min 55s au bord sombre de notre satellite, à 22° de
hauteur au sud.
Occultation Delta Scorpii – avril 2022.
Crédits diagramme : Marc Jobin/Planétarium Rio Tinto Alcan ;
image de la Lune : NASA SVS
Enfin, la Lune gibbeuse croissante (éclairée à 97 %) occulte à nouveau
Dschubba le soir du 12 juin. À Montréal, l’étoile disparaît à 22h
15min 25s derrière le bord sombre de la Lune (à 21° de hauteur au
sud-sud-est) ; elle réapparaît à 23h 11min 22s au bord sombre
de notre satellite (hauteur 22° au sud).
Occultation Delta Scorpii – juin 2022
Crédits diagramme : Marc Jobin/Planétarium Rio Tinto Alcan ;
image de la Lune : NASA SVS
Attention : les heures mentionnées (heure avancée
de l’Est) sont approximatives et peuvent diverger de
plusieurs secondes selon votre position géographique
exacte. Il faut avoir l’œil à l’oculaire au moins une
minute avant pour ne pas rater le phénomène !
Sommaire Hyperespace • Hiver - Printemps 2022 9Événements astronomiques
PLUIES DE MÉTÉORES : réaliste, on doit donc s’attendre à ce que les
ASSISTERA-T-ON À UN SURSAUT météores des Tau Herculides soient visuellement
faibles. Autre inconnue, et elle est importante :
DES TAU HERCULIDES ?
l’intensité que pourrait atteindre la pluie, en nombre
La seconde moitié de l’hiver et le printemps sont de météores à l’heure. En tout, ce sursaut ne dure
pauvres en pluies de météores du calibre des que quelques minutes.
Perséides ou des Géminides. Comptant déjà parmi
les plus faibles des pluies annuelles régulières, En dépit de leur nom, le radiant des Tau Herculides
les Lyrides (maximum autour du 22 avril) sont de se trouve en fait… dans la partie ouest du
surcroît affectées par la Lune gibbeuse décroissante Bouvier, près des Chiens de Chasse (a.d. 14h, déc.
cette année. Les Êta Aquarides, quant à elles, +28°). Pour le sud du Québec, il se trouve à une
peuvent s’épanouir en 2022 dans un ciel sans cinquantaine de degrés de hauteur au moment de la
Lune, mais elles ne sont visibles qu’entre 3 heures rencontre la plus rapprochée. La Lune est nouvelle
du matin et l’aube ; leur pic d’activité s’étale sur et ne gêne pas les observations. Dans l’ensemble,
plusieurs jours, avec un maximum attendu le 6 mai. les conditions sont favorables pour l’observation
Parions que vous n’avez jamais entendu parler de ce phénomène. Soyez donc au rendez-vous,
des Tau Herculides. Cette pluie normalement très et gardez l’œil ouvert ; il pourrait tout de même y
faible est associée à la comète 73P/Schwassmann- avoir des surprises !
Wachmann 3 (SW3), qui s’est fragmentée en 1995.
Ce sont les particules libérées à cette époque que la
Terre croise le 31 mai vers 1h05 (+/– 10 min), selon DOSSIER « ASTÉROÏDES » : À LA
différents modèles numériques. Mais la vitesse
de rencontre entre les poussières et la Terre est RECHERCHE DE CÉRÈS ET VESTA
exceptionnellement lente : « seulement » 16 km/s Dans l’esprit de ce numéro de l’Hyperespace, nous
(58 000 km/h), ce qui est le double des satellites en vous proposons de partir à la chasse aux deux
orbite basse, mais tout de même considérablement astéroïdes les plus brillants. Nul besoin de gros
moins rapide qu’une Perséide typique à 60 km/s télescopes ; Cérès et Vesta sont à portée de jumelles
ou même qu’une Géminide à 36 km/s. De manière dans un ciel modérément sombre.
Crédit : m wrona - Unsplash
Sommaire Hyperespace • Hiver - Printemps 2022 10Événements astronomiques
La première carte illustre la trajec- +40°
toire de Cérès parmi les étoiles du
Taureau depuis le 1er octobre 2021
jusqu’au 1er mai 2022 ; Cérès était
à l’opposition le 26 novembre et
brillait alors à magnitude +7,2 ; son
éclat décroît graduellement jusqu’à +30°
magnitude +9,0 à la fin d’avril. On
remarque la proximité des amas
des Pléiades et des Hyades, avec 1er
l’étoile Aldébaran à l’avant-plan. CÉRÈS avril 1er
mars
+20° 1er
Crédit carte : Marc Jobin/Planétarium Rio Tinto Alcan
fév
1er
nov 1er
1er janv
1er déc
oct
+10°
0°
6h 4h
5h
La seconde carte montre la trajec-
toire de Vesta dans les constellations
du Capricorne et du Verseau, entre
0° le 1er mai et le 31 décembre 2022 ;
sa boucle rétrograde apparaît clai-
rement. Au cours de cette période,
la magnitude de Vesta fluctue gra-
duellement entre +6,0 (au moment
de son opposition le 22 août) et
–10° 1er
1er +8,5 en fin d’année. Saturne effectue
juil
juin 1er également sa boucle rétrograde dans
mai la même région. L’étoile brillante dans
1er VESTA SATURNE
le Poisson Austral est Fomalhaut.
Crédit carte : Marc Jobin/Planétarium Rio Tinto Alcan
déc
1 er
1er
août nov Les étoiles les plus faibles représen-
–20° tées sur les cartes sont de magni-
1er tude +9,0. Les symboles (+) sur la
sept 1er
oct trajectoire de chaque astéroïde indi
quent sa position le 1er, le 11 et le 21
de chaque mois.
–30°
23h 22h 21h
Sommaire Hyperespace • Hiver - Printemps 2022 11Sur le web par Patrick Horlaville
C’est parti pour James Webb ! Une étape d’évolution d’amas de galaxies
Le télescope spatial James Webb est assurément l’un de ceux qui manquante finalement trouvée
se sont fait le plus attendre. Alors qu’en 1997 on prévoyait un L’évolution des amas de galaxies est prédite par un modèle qui
lancement en 2007 pour un budget de 0,5 milliard de dollars USD, jusqu’alors était incomplet. En effet, le modèle prévoyait un stade
le télescope a finalement coûté près de 10 milliards de dollars et initial, un stade intermédiaire ainsi qu’un stade final, bien que
décollé le 25 décembre 2021 ! n’avaient été observés que les stades initiaux et finaux. Avec
notamment l’aide des télescopes Chandra et VLA (Very Large
Array), cette étape intermédiaire vient enfin d’être observée.
Source : Radio-Canada Source : Ça Se Passe Là-Haut
Crédits image : X-ray: NASA/CXC/CfA/M.Markevitch et al.;
Optical: NASA/STScI; Magellan/U.Arizona/D.Clowe et al.;
Crédit photo : NASA/Desiree Stover
Lensing Map: NASA/STScI; ESO WFI
Crédits image : ESO/L. Calçada
Crédits image : Pasetto et al., Sophia Dagnello, NRAO/AUI/NSF
La découverte d’une nouvelle exoplanète remet Un jet de trou noir en forme de double hélice
en question nos modèles La galaxie M87, qui avait fourni la fameuse image du trou noir
La masse combinée des deux étoiles binaires au centre du système en avril 2019, ne s’arrête pas d’approvisionner la communauté
b Centauri est de six à 10 fois la masse du Soleil. Or, il est prévu scientifique d’images surprenantes alors qu’une équipe d’astro
que pour de telles masses solaires, les émissions UV et rayons X nomes vient de modeler le jet de son trou noir en forme de double
entravent le processus de formation de planète… et pourtant, une hélice !
planète vient d’être découverte orbitant ces binaires !
Source : Astronomy Source : Space.com
Sommaire Hyperespace • Hiver - Printemps 2022 12Pour y voir clair
La différence entre
un astéroïde et une comète
Bernard Marcheterre
Professeur de physique au Cégep de l’Assomption depuis le début des années 80, il a participé à l’adaptation de différentes
collections de manuels de physique au Collégial et travaille activement, chez Pearson-ERPI, à ce que seront les manuels
de science de demain.
Notre Système solaire n’a pas toujours existé. de taille appréciable. Finalement, (3) comme le nuage
Comme tout ce que l’Univers contient, incluant tournait faiblement avant de s’effondrer, tout ce
l’Univers lui-même, notre Système solaire est né il y qu’il contient s’est mis à tourner plus vite, et dans
a quelque 4,6 milliards d’années. Comment ? Bonne le même sens, à cause de l’effondrement. En termes
question ! savants, on invoque la « conservation du moment
Un nuage, un immense nuage dont la taille se cinétique ». Il suffit de dire que ça ressemble à ce
mesure en années-lumière, contenant beaucoup qui se passe quand une patineuse tourne sur elle-
d’hydrogène, un peu moins d’hélium et une bonne même en ramenant ses bras vers elle : elle tourne
quantité de poussières rocheuses ou glacées surgit de plus en plus vite.
tranquillement de la mort d’une étoile de 3e ou 4e
génération. L’effondrement de ce nuage, à cause La plus grande partie de ce que contenait le nuage
de la gravité, a eu plusieurs conséquences : (1) le originel s’est retrouvée dans le Soleil, la pièce
soleil est apparu au centre, une immense boule maîtresse, et une fraction importante de ce qui
d’hydrogène qui s’est « allumée », (2) les planètes se restait, dans les planètes. Or, et c’est là que nous
sont formées par « accrétion », le mot savant pour revenons au sujet de l’article, il restait encore de la
décrire l’accumulation de petits morceaux en objets matière…
FIGURE 1 - Ceinture d’astéroïdes.
Crédits image : Wikipedia commons
Famille Hilda
Troyens
Vénus
Mars Mercure
Soleil Terre
Jupiter
Grecs
Sommaire Hyperespace • Hiver - Printemps 2022 13Pour y voir clair
Les astéroïdes et les comètes sont ce que les planètes vous relisez l’article, vous verrez qu’on y parle des
n’ont pas « ramassé ». Autrement dit, ce sont aussi « points de Lagrange ». Les astéroïdes du groupe
des objets qui se sont formés par accrétion des des Troyens et des Grecs sont justement en deux de
poussières initiales, mais qui n’ont pas subi une ces points (L4, L5), mais de l’orbite de Jupiter !
collision avec l’une des huit planètes officielles du
Système solaire. Ce sont des objets plus petits que L’absence de glace sur les astéroïdes dépend de
les planètes, qui se retrouvent là où le risque d’une leur position dans le Système solaire : comme ils
collision future avec l’une d’elles est faible, sans sont proches du Soleil (toutes proportions gardées)
toutefois être nulle. les éléments volatils comme l’eau, l’ammoniac et
le méthane ont depuis longtemps disparu de leur
Les astéroïdes sont des objets rocheux, dont surface.
l’orbite est à l’intérieur de celle de Jupiter. Comme
on le voit à la FIGURE 1, une grande quantité de À ce jour, on a répertorié plus de 30 millions
ces astéroïdes se trouve dans ce que l’on appelle d’astéroïdes, la plus vaste majorité faisant moins
la « ceinture d’astéroïdes ». Mais, il n’y en a pas que de 100 m et l’un d’eux, Cérès, faisant 939 km
là. On en retrouve aussi sur l’orbite de Jupiter, dans de diamètre. La FIGURE 2 nous montre Cérès en
deux régions bien définies (voir la figure 1). Par comparaison avec la Lune, 3575 km, et Vesta, qui
un drôle de hasard, ces deux régions ont déjà fait en fait 525 km. On notera que Cérès est plutôt
l’objet d’un article où il était question du télescope sphérique, ce qui n’est pas le cas de Vesta. C’est
Web et surtout de sa position par rapport à la normal! Pour qu’un corps céleste prenne une forme
Terre (Hyperespace, automne 2020, page 14). Si sphérique, il doit être suffisamment grand.
FIGURE 2 - Cérès en comparaison avec la Lune et Vesta.
Crédits image : Gregory H. Revera - NASA/JPL-Caltech/UCAL/MPS/DLR/IDA
Sommaire Hyperespace • Hiver - Printemps 2022 14Pour y voir clair
Les comètes, contrairement aux astéroïdes, con 30 UA à 50 UA. Les instabilités gravitationnelles que
tiennent de la « glace ». Par ce terme, on désigne vit cette région feraient en sorte que les comètes
les éléments volatils comme l’eau, l’ammoniac ou s’en détachent et se dirigent vers le centre.
le méthane, sous forme solide. Les comètes ont
des orbites beaucoup plus excentriques que les Plus loin, bien plus loin, on pense qu’il existe un
astéroïdes, ce qui les amène à proximité du Soleil et autre centre d’accumulation d’objets pouvant
devenir des comètes. On le nomme « nuage d’Oort »
provoque l’apparition de cette aura, que l’on nomme
en l’honneur de celui qui l’a théorisé. Ce nuage
« coma » et de ces queues si caractéristiques. Ces
s’étendrait entre 2000 et 50000 UA. C’est loin,
phénomènes sont la conséquence directe de l’effet
très loin… mais il faut savoir que la sonde spatiale
du Soleil sur la glace, qui se réchauffe.
Voyager I vient d’y entrer !
On dénombre quelques milliers de comètes, dont
Bref, les mêmes instabilités gravitationnelles feraient
le passage autour du Soleil est plus ou moins en sorte que des objets se détachent du nuage
remarqué. L’une d’elles, nommée affectueusement d’Oort et filent vers le centre. Ces comètes ont
« 67P/Churyumov–Gerasimenko » nous est mieux des périodes de révolution beaucoup plus longues.
connue depuis que la mission Rosetta de l’Agence Elles passent et repartent et on ne risque pas de
spatiale européenne l’a visitée à l’automne 2014. La les revoir.
photo de la FIGURE 3 est issue de cette mission.
Ainsi donc, si on devait répondre à la question que
Bien que l’orbite des comètes les rapproche du Soleil, pose le titre, la différence entre les astéroïdes et les
on pense qu’elles sont issues, initialement, de deux comètes tient au fait que les premières ont chauffé
autres fractions de la matière initiale qui ne s’est pas et ne sont plus que roches, alors que les secondes
effondrée sur les planètes. Les comètes dont l’orbite contiennent de la glace, qu’elles réchauffent en
est de courte durée proviendraient de la ceinture de approchant du Soleil. Dans les deux cas, ce sont
Kuiper, un vaste amas de débris, se situant au-delà des vestiges qui n’ont pas eu la chance de rejoindre
de Neptune et s’étendant sur une région allant de une planète.
FIGURE 3 - Comètes 67P/Churyumov–Gerasimenko.
Crédits image : ESA/Rosetta/NAVCAM
Sommaire Hyperespace • Hiver - Printemps 2022 15À la Une
L’exploration spatiale
des astéroïdes :
entre science et commerce
André Grandchamps
Astronome au Planétarium Rio Tinto Alcan, André a étudié en astrophysique
à l’Université de Montréal à la fin des années 1980. Il s'est joint à l'équipe du
Planétarium Rio Tinto Alcan en 1992. Il a développé une expertise sur les
météorites à la suite de la chute de l'une d'elles à Saint-Robert en 1994. Il est
maintenant conservateur de la collection de météorites du Planétarium.
Pendant longtemps, les astéroïdes ont été considérés comme de vulgaires cailloux
qui dérivaient dans l’espace. Même au début de l’ère spatiale, ces objets
n’étaient pas considérés comme une cible intéressante pour de futures missions
d’exploration. Aujourd’hui, autant les scientifiques que de nombreuses
entreprises privées envisagent d’explorer ou d’exploiter ces cailloux célestes.
VOIR LES ASTÉROÏDES DE PLUS PRÈS
C’est dans les années 1990 que les scientifiques ont commencé
à réaliser l’importance d’étudier les astéroïdes. Ces corps
peuvent nous aider à comprendre comment les planètes
du Système solaire se sont formées et comment la vie
a pu apparaître sur Terre.
La première sonde spatiale à survoler un astéroïde
a été Galileo, alors qu’en 1991 elle survole
l’astéroïde (951) Gaspra, dévoilant un corps aux
formes variées, de petits cratères et de grandes
surfaces planes.
Deux ans plus tard, Galileo étonne les astronomes
en transmettant des images de l’astéroïde (243)
Ida. On voit alors un corps criblé de cratères de
toutes tailles. En tenant compte de sa taille
modeste (54 km de long), Ida est le corps céleste
le plus marqué par les cratères d’impact de tout
le Système solaire. Mais surtout, on découvre pour
la première fois une lune, Dactyle, gravitant autour
d’un astéroïde. Les deux corps auraient été créés lors
d’une collision il y a deux milliards d’années. Les astro L’astéroïde (243) Ida
nomes doivent alors revoir leurs modèles de formation et sa lune Dactile.
de ces petits corps. Crédits image : NASA
ON SE POSE SUR UN ASTÉROÏDE
La sonde NEAR Shoemaker est la première à se mettre en orbite autour d’un
astéroïde et à l’étudier en détail. Sa cible est (433) Éros, le premier astéroïde
découvert dont l’orbite croise celle de la Terre, qu’on appelle un géocroiseur.
À la fin de la mission, la sonde s’est même posée sur la surface de l’astéroïde.
NEAR Shoemaker a permis de mieux comprendre la composition des astéroïdes
et leur évolution.
Sommaire Hyperespace • Hiver - Printemps 2022 16À la Une La mission Dawn a elle aussi été très riche en enseignement alors que la sonde a visité (4) Vesta et la planète naine Cérès. Les saisissantes images de Vesta ont montré que l’astéroïde a échappé de peu à la destruction après d’importantes collisions il y a près de deux milliards d’années. D’une taille de 553 km x 557 km x 446 km, on trouve à la surface de Vesta deux immenses cratères de 503 et 395 km ! Ces collisions ont donné naissance à toute une famille d’astéroïdes circulant maintenant dans la ceinture principale située entre Mars et Jupiter et aux météorites de types HED (pour Howardite, Eucrite et Diogénite). RETOUR D’ÉCHANTILLONS D’ASTÉROÏDES Deux missions récentes avaient pour but d’explorer de petits géocroiseurs pour mieux définir leur composition et de rapporter des échantillons sur Terre. La sonde japonaise Hayabusa 2 a réussi, à la fin de l’année 2020, à rapporter plus de cinq grammes du sol de l’astéroïde (162173) Ryugu. C’est un immense succès par rapport à la réussite en demi-teinte de sa prédécesseur Hayabusa 1 qui, après de nombreux problèmes lors de son périple spatial, n’avait rapporté que quelque milligramme de l’astéroïde (25143) Itokawa en 2010. La NASA, ne voulant pas être en reste, a lancé la mission OSIRIS-REx vers l’astéroïde (101955) Bénou en 2016. La collecte d’échantillons semble avoir été fructueuse et on attend plus de 60 g lors du retour de la capsule en septembre 2023. Ces deux missions ont découvert des corps très sombres, dont la surface est un amoncellement de roches liées par la faible gravité de l’astéroïde. Ce sont des corps primitifs ayant peu évolué depuis les débuts du Système solaire, composé en partie de matière organique. L’étude des échantillons devrait nous renseigner sur la matière ayant formé les planètes et pourrait aussi nous éclairer sur les processus d’apparition de la vie sur Terre. EXPLORER LES ASTÉROÏDES TROYENS La quête de la matière primitive du Système solaire est le but de la mission Lucy lancée par la NASA en octobre 2021. Lucy ira étudier six astéroïdes troyens de la planète Jupiter ainsi qu’un septième de la ceinture principale qui sera survolé en cours de route. Ces astéroïdes gravitent devant et derrière la planète géante aux points de Lagrange L4 et L5. On estime que ces corps proviennent des régions externes du Système solaire et qu’ils auraient très peu évolué. Selon les modèles de formation des planètes, Jupiter après sa formation, se serait déplacée vers les régions internes du Système solaire pour ensuite rebrousser chemin vers sa position actuelle. Les astéroïdes troyens auraient migré vers les régions internes et se seraient mis en orbite aux points de Lagrange de Jupiter lors des mouvements de la planète géante. En étudiant ces astéroïdes, les astronomes espèrent en apprendre plus sur la matière qui abondait dans les premiers temps du Système solaire. Gros plan de la surface de l’astéroïde (101955) Bénou pris par la sonde Osiris-Rex. Crédits image : NASA Sommaire Hyperespace • Hiver - Printemps 2022 17
À la Une ÉTUDIER LES RESTES D’UNE PROTOPLANÈTE La NASA doit lancer en 2022 la sonde Psyché vers l’astéroïde du même nom. Ce petit corps céleste a la particularité d’être composé d’une grande quantité de fer, soit près de 60 % selon certaines estimations. C’est donc une chance unique d’étudier, pour la première fois, un corps qui pourrait être le noyau d’un ancien astéroïde dans lequel la différentiation aurait concentré les métaux lourds au centre de l’astre. Une collision a-t-elle influencé l’évolution de cet astre ? Les astronomes veulent aussi comprendre comment les noyaux métalliques des gros astéroïdes se forment et quels sont les alliages qui se créent et dans quelles conditions. L’EXPLOITATION COMMERCIALE DES ASTÉROÏDES Il n’y a pas que les scientifiques qui s’intéressent aux astéroïdes. Conscients du potentiel de ressources minérales que renferment ces corps célestes, plusieurs industriels montrent maintenant un intérêt pour les exploiter. On trouve trois grandes familles d’astéroïdes. Les plus abondants sont de type C, pour carbonés. Ces astéroïdes sont faits de matière primitive et sont riches en eau. Ils constituent donc des réservoirs d’eau pour de futures bases spatiales orbitales sur Mars ou sur la Lune. Cette eau pourrait aussi servir de combustible pour des vaisseaux spatiaux. Les astéroïdes de type S contiennent peu de matériaux hydratés, mais sont constitués principalement d’olivine, de pyroxène, de silicate de fer et de magnésium. Mais les astéroïdes les plus intéressants pour l’industrie privée sont sans nul doute ceux de type M. On y trouve une grande quantité de métaux, dont le fer, le nickel, mais aussi des métaux plus rares, comme le platine et le cobalt. LES DIFFICULTÉS DE L’EXPLOITATION DES ASTÉROÏDES Avant de lancer un vaisseau spatial vers un astéroïde, il sera nécessaire d’avoir une meilleure connaissance des caractéristiques des différents types d’astéroïdes. Il faudra aussi dresser un catalogue plus complet de ces corps avec leurs caractéristiques physiques et orbitales. La rentabilité d’une mission d’exploitation ne dépendra pas seulement de la quantité de matériaux composant l’astéroïde, mais aussi de la difficulté de s’y rendre et de rapporter les minéraux sur Terre. Les géocroiseurs qui passent fréquemment près de l’orbite terrestre sont pour le moment les cibles les plus intéressantes. Ce sont cependant des corps de petite taille avec une faible gravité. Si cela facilite les déplacements vers ces astres, en contrepartie, l’extraction des matériaux composant l’astéroïde devient un défi important. Les forages pourraient changer l’orbite de l’astéroïde et causer des maux de tête pour revenir ensuite sur Terre. Certains proposent de capturer les petits astéroïdes dans d’immenses ballons où il serait alors plus facile de contrôler les processus d’extraction. On pourrait même les amener près de la Terre ou de la Lune pour diminuer les coûts d’exploitation. Sommaire Hyperespace • Hiver - Printemps 2022 18
À la Une
EST-CE LÉGAL D’EXPLOITER citoyens américains d’extraire, posséder, transporter,
LES ASTÉROÏDES ? utiliser et vendre des ressources issues des astéroïdes.
Toutefois, plusieurs s’interrogent sur la légalité de Le Luxembourg a adopté en 2017 une législation
l’exploitation des astéroïdes. Après tout, le traité favorisant l’exploitation des ressources spatiales,
de l’espace de 1967 stipule que « L'espace extra- qui s’applique aussi aux entreprises étrangères
atmosphérique, y compris la Lune et les autres domiciliées au pays. Depuis, plus d’une dizaine
corps célestes, ne peut faire l'objet d'appropriation d’entreprises se sont installées au Luxembourg.
nationale par proclamation de souveraineté, ni
par voie d'utilisation ou d'occupation, ni par aucun Malgré ces législations, de nombreuses zones d’incer
autre moyen ». titude subsistent concernant l’exploitation des corps
célestes par des entreprises privées. Il sera nécessaire
Mais ce traité ne concerne que les nations, rien n’est de clarifier le plus rapidement possible ces zones
dit au sujet des entreprises privées qui voudraient d’incertitude pour éviter un « Far West » spatial.
exploiter les astéroïdes. Pour certains, cela s’appa
rente à la pêche dans les océans. Bien que l’océan Même si certains s’opposent à exploiter les corps
n’appartienne à personne, il est permis à des célestes, pour plusieurs, cela semble inévitable dans
entreprises d’y exploiter le poisson à des fins un avenir plus ou moins lointain. Car, si nous
commerciales. commençons à véritablement prendre conscience
que notre planète possède des ressources qui sont
De plus, en 2015, le président américain Barak Obama limitées, les astéroïdes représentent une alternative
a signé le « Space Act », dans lequel il permet à des incontournable.
Illustration imagée de
l’exploitation d’un astéroïde
qu’avait la NASA en 1977.
Crédits image : NASA
Sommaire Hyperespace • Hiver - Printemps 2022 19Histoire
La météorite du cap York
Pierre Lacombe
Astrophysicien, ex-directeur du Planétarium de Montréal ayant un grand
intérêt pour l’histoire de l’astronomie et des météorites. Ses travaux de
recherche l’ont amené à réaliser des observations à l’aide des plus grands
télescopes du monde.
C’est dans le cadre de l’expédition de l’Amirauté britannique pour découvrir le passage du Nord-Ouest vers
l’Asie en 1818 que l’on découvre que les Inuits de la mer de Baffin utilisent des lances (défenses de narval)
munies de pointes de fer. Les discussions tenues lors des échanges de « cadeaux » entre le capitaine John Ross
(1777-1856), commandant de l’expédition, et les Inuits démontrent alors que le fer provient de pierres d’une
montagne située près de la côte dans la région de cap York.
Edward Sabine (1788-1883).
Malheureusement, et au grand désespoir de l’astronome de l’expédition, Edward Sabine
Crédits image : Wikipedia commons
(1788-1883), le capitaine refuse d’explorer la région, les conditions météorologiques et les
glaces rendant alors les déplacements dangereux.
Au retour à Londres, il est démontré que le fer des couteaux
contient du nickel en bonne quantité et que l’origine de
celui-ci est fort probablement météoritique. De nombreux
explorateurs tenteront sans succès de trouver les météorites
du cap York, source de fer pour les Inuits.
Lance inuit avec une pointe
de fer météoritique reçue
par John Ross en 1818.
Crédit : Photographie Pierre Lacombe/British Museum
Première rencontre avec les Inuits lors de l’expédition de John Ross en 1818.
Crédit : John Ross, 1819, « Voyage of Discovery… », illustration Sacheuse/Domaine public
Robert E. Peary (1856-1920), ingénieur civil nombreuses occasions entre 1886 et 1897 pour
de la marine américaine, a un rêve : celui se familiariser et apprendre les techniques
d’être le premier explorateur à atteindre de survie adaptées aux déplacements dans
le pôle Nord. Conscient des difficultés de les régions polaires. Il adopte l’habillement
se déplacer en mer et sur terre dans ces local, apprend à construire des igloos et
contrées dominées par la glace et la neige, devient maître dans la gestion du mode de
il décide de s’entraîner auprès des meilleurs, transport local : le traîneau à chiens.
les Inuits. Il séjourne donc au Groenland à de Robert E. Peary (1856-1920).
Crédits image : Wikipedia commons
Sommaire Hyperespace • Hiver - Printemps 2022 20Histoire
Au cours de ses expéditions, Peary développe
même une technique pour améliorer grandement
ses chances de succès en installant des caches de
survie (nourriture et matériel) le long du parcours
et en utilisant des équipes de soutien qui ouvrent le
chemin pour l’équipe principale. C’est lors d’un
séjour à son camp de base au Groenland en 1894
que Peary décide de rechercher les météorites du
cap York.
Le premier fragment, d’une masse d’environ
trois tonnes et appelé « Woman », est retrouvé dans
la neige le matin du 27 mai 1894. Malheureusement,
les glaces ne permettent pas au bateau de
s’approcher suffisamment de la côte pour
« ramasser » la météorite lors du voyage de retour. Probablement la première photographie du fragment
de météorite « Ahnighito » in situ.
Mieux préparé, Peary retourne au Groenland à
Crédit : American Museum of Natural History (AMNH)
l’été 1895 et réussit non seulement à transporter le (on trouve cette image dans le Guide pour les enseignants sur le Arthur Ross Hall
fragment « Woman » à bord du bateau, mais aussi of Meteorites)
un autre fragment, plus petit, d’une masse d’environ
Il revient donc à l’été 1896 à cap York dans le but de
400 kg, appelé « Dog ». Il est intéressant de noter
rapporter cette lourde et immense météorite. Son
que c’est en déplaçant les météorites sur des glaces
équipe réussit à la dégager du sol, à la traîner et à la
flottantes que celles-ci furent transportées près du
faire rouler jusqu’à un promontoire près du bateau.
bateau pour y être hissées.
De l’équipement brisé et inadéquat et le danger
C’est aussi lors de cette expédition que Peary provoqué par le mouvement des glaces forcent
localise le troisième et plus gros fragment, cependant Peary à abandonner temporairement
« Ahnighito » ou « Tent », d’une masse d’environ le projet. Pas du tout découragé, Peary retourne
31 tonnes ! encore une fois au Groenland à l’été 1897.
Transport sur un bloc de glace du fragment
« Woman » de la météorite du cap York.
Crédit : Darmouth College/fig. 23 dans H. Pedersen, « Cape York
meteorite… »/original de la photographie disparue
Sommaire Hyperespace • Hiver - Printemps 2022 21Histoire
Cette fois, les conditions sont idéales. Malgré tout,
le déplacement de la météorite « Ahnignito » du
promontoire au bateau n’est pas de tout repos. La
masse élevée de la météorite, les marées et les
courants affectant sans cesse le mouvement du navire
et du pont qui maintient celui-ci à la côte créent un
stress énorme sur l’équipage. On réussit finalement
à placer la météorite à bord du navire, un succès
incroyable !
Peary revient à New York avec sa visiteuse céleste
le 30 septembre 1897 (il y a donc 125 ans cette
année). Devant plus de 30 000 personnes, la météorite
« Ahnighito » est déposée sur le quai de débar
quement de la marine américaine. Elle y demeurera
jusqu’en octobre 1904, où elle sera transférée par Déplacement sur un pont de fortune du fragment de météorite
bateau et chevaux jusqu’au American Museum of « Ahnighito » du promontoire au bateau.
Natural History (AMNH) de New York. Crédit : American Museum of Natural History (AMNH)
(On trouve cette image dans le Guide pour les enseignants sur le Arthur Ross Hall
of Meteorites)
Les trois fragments de la météorite du cap York
(« Ahnighito », « Woman » et « Dog ») sont présentés au Pour terminer et pour la petite histoire, mentionnons
public d’abord dans ce musée et ensuite au « Hayden que Robert E. Peary a réalisé son rêve d’être le
Planetarium » lors de son inauguration en 1935. En premier explorateur à atteindre le pôle Nord le
1981, elles seront déplacées et mises en valeur 6 avril 1909. Toutefois, et ce même aujourd’hui,
dans le nouvel espace d’exposition du musée dédié son exploit demeure toujours controversé et suscite
aux météorites, le Arthur Ross Hall of Meteorites. de nombreux débats.
Le fragment « Ahnighito » de la météorite du cap York dans
la salle d’exposition des météorites du American Museum
of Natural History.
Crédit : American Museum of Natural History (AMNH)
Sommaire Hyperespace • Hiver - Printemps 2022 22Vous pouvez aussi lire