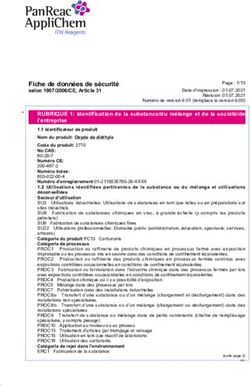Café images 10 avril 2021 Nathalie Tirot - Un jardin d'agronomie tropicale à Paris - Un jardin d ...
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Café images 10 avril 2021
Nathalie Tirot
-
Un jardin d’agronomie
tropicale à Paris
Il y a mille et une manières de
découvrir le Jardin d’agronomie
tropicale et d’y revenir...
Nathalie Tirot, Porte sacrée chinoise provenant de l’exposition
coloniale organisée au Grand-Palais à Paris en 1906 @ Nathalie Tirot
Une fois passé, avenue de la Belle-Gabrielle, le portail de style haussmannien, le promeneur
hésite. Franchir le seuil du jardin par la porte chinoise de teck rouge ; obliquer à droite vers
les fragments arrangés en arc de cercle du monument « A la gloire de l’expansion coloniale »
réalisé par Jean-Baptiste Belloc en 1913 ; tourner à gauche vers le monument « Au souvenir
des soldats de Madagascar » d’Albert Ernest Sanchez et André Le Roy, inauguré en 1925.
En quelques pas éclate toute la complexité insolite du jardin situé à l’est du Bois de
Vincennes, lieu d’enseignement et de recherche, parc où s’entremêlent plantations anciennes
et vestiges conquis par la végétation sauvage ou restaurés, aménagements végétaux discrets,
monuments commémoratifs ; un espace subtil et singulier livré à des imaginaires où l’histoire
et la mémoire entrent constamment en débat.
De ces particularités, où l’étrange se mêle au familier, Nathalie Tirot a fait image, un
questionnement tout autant esthétique qu’historique et archéologique, ethnologique même
tant se mêlent et dialoguent dans ses photographies, accrochées en contexte, le regard
proche et le regard éloigné.
Envoûtée, Nathalie Tirot a parcouru le jardin, plusieurs années, à l’écoute des bifurcations de
l’histoire et de la succession des saisons. Elle en a interrogé les signes et les indices, creusé
la mémoire à la bibliothèque du CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche
agronomique pour le développement) et au Musée intercommunal de Nogent-sur-Marne.
Il y a le livre, en cinquante photographies et quatre chapitres : « Serres et écoles d’agronomie
», « L’Exposition coloniale », « La guerre », « Un lieu voué à la recherche et à l’enseignement
». Il y a l’exposition dans les allées du jardin en quinze photographies. Imprimées en 120 x 80
cm sur Dibond, les images sont clouées sur des panneaux de bois, implantés près de leur lieu
de prise de vue.
Dans la surface photographique de chacune est incrustée, fondue en transparences,
une carte postale ancienne, une trace d’histoire du jardin. Subtiles correspondances,
la photographie est dans le lieu, elle s’y absorbe et, en même temps, elle le met àdistance, comme une pénétration au-delà du regard immédiat, un jeu de mémoires en strates. Le dialogue temporel d’un siècle et plus entre la photographie couleur et la carte postale en noir et blanc ouvre la « désolation douce » (Thomas B. Reverdy, Sylvain Venayre, Jardin des colonies, 2017) du jardin, comme espace de représentation, à l’imaginaire du visiteur, déstabilisant quelque peu ses certitudes politiques ou entraînant ses ambigüités dans un jeu complexe d’échelles. À l’entrée du jardin, la « porte chinoise » en teck rouge, telle qu’elle a survécu des dégradations diverses et de la tempête Lothar de 1999. En contrechamp du pas et du regard du visiteur qui vient de franchir la grille d’entrée, la photographie, cadrée vers le sud-est une fin d’après-midi de printemps, met en abyme les perspectives de la porte et ses mutations symboliques. Sertie dans l’aplat photographique, la carte postale de l’exposition coloniale parisienne de 1906 décale les significations et les contextes. Sous la verrière du Grand Palais, l’arche centrale de la « Porte sacrée » de la rue d’Extrême-Orient encadre la « Grande pagode chinoise ». Remontée avec la « Porte chinoise » dans le jardin pour l’Exposition coloniale de 1907, sous l’appellation « Tour chinoise » ou « Tour d’Annam » et disparue depuis, elle dominait le « campement touareg » et un café permettant « aux visiteurs de se rafraîchir avant de visiter l’Exposition des Beaux-Arts » (La Dépêche coloniale illustrée, 15 juillet 1907, p. 164). Dans les superpositions de ses prises de vue et des cartes postales anciennes provenant de la collection du Musée de Nogent et des archives du CIRAD, Nathalie Tirot crée ainsi un jeu de miroirs tentant de capter l’âme du jardin, d’en donner à voir la vie ancienne et actuelle, à entendre les sons passés et présents derrière le silence assoupi des vestiges et des plantations séculaires. Par les glissements sémantiques et iconiques que ses images révèlent, la photographe dévoile l’ambigüité du jardin, les hésitations politiques et l’entretien de son oubli qui ont présidé à son lent dépérissement ; elle fait percevoir la restauration douce et lente menée par la ville de Paris depuis la réouverture au public du jardin sous l’égide de René Dumont « Agronome de la faim […] considéré comme le père de l’écologie politique en France » (plaque commémorative inaugurée en 2004 dans le jardin). Elle en donne à entendre les débats, les enjeux et les engagements qui animent, et déchirent parfois, le monde scientifique comme ceux de la politique et des arts du spectacle, depuis le décret du 28 janvier 1899 qui crée le « Jardin d’essais colonial ». Car le jardin est d’abord et surtout une institution de recherche. Au moment où sa direction est confiée à l’agronome Jean Dybowski, la Troisième République, dans une rivalité avec le Royaume-Uni, réfléchit à la prospérité agricole des colonies - et, en retour, de la métropole - par l’étude des pratiques indigènes, la recherche agronomique et l’acclimatation. Le « Jardin d’essais colonial » a alors « pour objet de fournir aux jardins d’essais des possessions françaises les produits culturaux dont ils pourraient avoir besoin ainsi que de réunir tous les renseignements les intéressant. » (Journal Officiel de la République française, n°30, 31 janvier 1899, p. 759). La participation aux expositions coloniales est alors d’évidence pour montrer les collections et valoriser les recherches auprès du grand public. Dans un monde francophone où les remises en cause de la colonisation ne font pas la une des journaux, les expositions apportent une visibilité publique et des opportunités de communication. À côté de la grande serre et du bâtiment des laboratoires construits en 1899, de la maison des jardiniers, des bâtiments des collection et des intrants, de l’orangerie…, de l’École nationale supérieure d’agriculture coloniale créée en 1902, les expositions apportent aussi, à moindre coût, par le transfert et le remontage des pavillons et des serres, les bâtiments nécessaires aux laboratoires, aux essais, à la production des semences et des plants, à la conservation et la présentation des collections. Plusieurs photomontages de Nathalie Tirot, jouant quelquefois de déplacements, en construisent le récit.
Enchâssées dans le pavillon du Maroc en ruines, envahi par la végétation, les tags et l’art
de rue, les images noir et blanc ouvrent au visiteur le laboratoire de botanique et le bureau
d’un professeur en 1909. Édifié pour l’exposition de 1907, le pavillon du Maroc accueillait le
laboratoire de chimie de L’IRAT (Institut de Recherches Agronomiques Tropicales).
Sur le paysage enneigé du
délabrement actuel des serres,
les serres Hamelle et Menier,
photographiées vers 1920,
provenaient de l’exposition
universelle de 1900, l’une abritait
la culture des caféiers, l’autre
celle des cacaoyers et des
vanilliers, puis à partir de 1907
celle des cocotiers. Les deux ont
été détruites à la fin des années
1950.
Devant les bâtiments en ruine
ou restaurés, les photomontages
de Nathalie Tirot invitent
ainsi autant à l’imaginaire de
l’exposition coloniale de 1907
qu’à la réflexion sur ses ruines et
aux débats de sciences sociales
et politiques, voire philosophiques Nathalie Tirot, Laboratoire de botanique @ Nathalie Tirot
qu’elles suscitent.
Les restes du pavillon du Congo, détruit par un incendie en 2004, sont aujourd’hui enserrés
par Le Comble, une œuvre de l’artiste Johann Le Guillerm en résidence au jardin :
« Attraction est un monde en soi, une planète sans lieu, qui dessine un paysage
singulier aux frontières infinies. » Johann Le Guillerm.
Hérité de l‘Exposition coloniale de Marseille en 1906, la factorerie voisinait avec les cases
à « l’authenticité très étudiée » d’un « des cinq villages habités par des indigènes provenant
authentiquement de leurs colonies respectives » (La Dépêche Coloniale illustrée 15 Juillet
1907, pp. 162-163). Nathalie Tirot associe ainsi les ruines avec une carte postale représentant
les « Types de la Côte occidentale d’Afrique ».
Aujourd’hui la porte du pavillon de la Réunion, souvenir de l’Exposition universelle du
Trocadéro de 1900, ouvre sur le vide intérieur que Nathalie Tirot photographie dans une vue
traversante dans laquelle elle insère la carte postale du « Kiosque en bois du pays », lieu de
dégustation du rhum, puis poste de secours et enfin lieu de stockage pour les collections en
1912.
La photographie du pavillon de la Tunisie, prise sous la mince couche neigeuse de l’hiver
2019, le situe avant la restauration qui vient de se terminer et l’appel à proposition pour
exploitation comme espace de restauration et d’animation de La Cité du développement
durable. La carte postale de la « jolie construction mauresque toute blanche au milieu de la
verdure [...] du style arabe le plus pur » (La Dépêche Coloniale illustrée,15 Juillet 1907, p. 170)
où « les Tunisiens […] offrent le «caoua» sous les palmiers aux alentours d’un Dar-el-bey en
miniature » (p. 162) et la photographie qui la reçoit invitent alors, par l’observation des détails,
crénelage du toit en terrasse, décors muraux, à s’interroger sur la forme, la fonction et le sens
historique des restaurations.Avec ces cartes postales incrustées qui présentent en pose les « types » ethniques, Nathalie Tirot ouvre bien d’autres questions, elle pose en images critiques une traversée des débats séculaires sur la mise en scène de l’altérité et de l’émotion exotique, confinant parfois au voyeurisme racial, dans les expositions ethnographiques qui mettent en spectacle « la domestication du sauvage ». En conviant le visiteur à traverser le miroir de l’image, elle donne à penser les enjeux que représente l’entretien des pavillons, aujourd’hui classés à l’inventaire des monuments historiques. Aves les deux photographies des attractions organisées par le Journal des Voyages, les éléphants de l’Inde et les Touaregs du Sahara, elle interpelle, aujourd’hui et dans le passé, la vocation récréative de l’exposition : les « éléphants sauvages » de l’Inde qui « donnaient, sous la conduite de leurs cornacs, […], une bien curieuse leçon de choses, en se pliant à tous les services que l’on est en droit d’attendre de leur intelligence et de leur force » (Eugène Charabot et G. Collot, Revue coloniale, janvier 1909, p. 55 ; Auguste Terrier, Journal des Voyages, 2 juin 1907) ; les Touareg du Sahara dont Auguste Terrier rappelle la difficile « pacification » par les armes françaises et précise à « tous les passionnés de l’ethnographie [que] ces populations qui demain ne seront plus ou seront autres [font] revivre pour quelques mois, près de nous, un coin du pays de la peur, de la soif et du silence. » (Journal des Voyages, 19 mai 1907) Légèrement en avant de la stèle qu’elle reproduit, la photographie de Nathalie Tirot intrigue. Au carrefour de deux allées, à proximité du stûpa en béton qui attire l’œil, la stèle se démarque peu, perdue dans une végétation à demi sauvage. L’inscription « HOPITAL DU JARDIN COLONIAL / MOSQUEE / 1915 - 1919 » qui entoure la gravure de la façade nord de la mosquée est peu lisible. La photographie de Nathalie Tirot, de format carré, cadrée au plus près de la plaque de marbre, lui a redonné sa visibilité. À une échelle légèrement inférieure, la carte postale superposée, représentant deux groupes de soldats, en dédouble la façade. La légende est bilingue, français et arabe. Avec cette photographie et quelques autres, Nathalie Tirot introduit deux autres histoires du jardin, celle de la mobilisation des services civils pendant la Première Guerre mondiale et celle, toujours, vivante du lieu de mémoire. En 1914, les pavillons de l’exposition de 1907 sont transformés pour accueillir un hôpital militaire auxiliaire de chirurgie, affecté à la fin de l’année aux soldats coloniaux. Émile Prudhomme, le nouveau directeur du jardin, met à la disposition du Ministère de la Guerre, le personnel non mobilisé. La prise en charge des blessés et des convalescents est organisée selon les origines et le statut, soldats ou sous-officiers. Inaugurée en 1916, la mosquée, œuvre en bois de M. Péni, décorée par Pierre-Antoine Cluzeau, a quelque chose de l’exemplarité, tout comme l’édition bilingue, déjà évoquée, des cartes postales par le Jardin. Comme en témoignent les divers échanges ministériels, le projet est autant humanitaire que de communication en temps de guerre. Si le ministère de la guerre établit un certain nombre de règles pour assurer aux troupes coloniales le respect des rites et prescriptions religieuses pour les sépultures et dans les hôpitaux militaires, la construction de la mosquée est aussi une réponse à la propagande allemande sur l’érection d’une mosquée dans le camp de prisonniers de Zossen-Wünsdorf. L’hôpital ferme ses portes le 1er mai 1919, la mosquée est détruite au moment de la construction de la mosquée de Paris. Le pavillon « d’Indo-Chine », construit par M. Lapeyrère pour l’exposition de 1907 et réhabilité en 2011, qui abritait, avec des collections de plantes alimentaires, des produits de l’art et de l’artisanat asiatique, accueille entre 1914 et 1918 le personnel de l’hôpital, les convalescents et la lingerie. Sur la carte postale de la Bibliothèque historique du CIRAD, qui se cadre parfaitement sur le bâtiment actuel et la serre du Dahomey, ne serait-ce la déchéance actuelle de cette dernière ou la taille de certains végétaux, un groupe de convalescents prend la pose.
Avec la photographie implantée devant le pavillon de la Guyane, le photomontage de Nathalie Tirot percute les temps et les géographies de l’empire colonial français, faisant résonner jusqu’à aujourd’hui les débats autant sur l’exploitation et les troupes coloniales que la recherche pour l’amélioration des fruits tropicaux. Érigé lui aussi en 1907, le pavillon exposait une collection de bois précieux et des maquettes sur l’extraction de l’or. Pendant la guerre, il accueille, pour leur convalescence, les sous-officiers des troupes coloniales blessés, avant d’être converti en laboratoire de génétique, puis en division de l’amélioration des plantes. La superposition de la carte postale, sur laquelle posent un groupe de soldats et les soignants au-dessus de la légende bilingue, a fait disparaitre la dédicace actuellement encore visible du pavillon à Joseph-Alfred Massibot, spécialiste de l’expérimentation agricole, tandis que, sous le nom du pavillon « Guyane » s’impose, comme un linteau, la plaque de la « Compagnie des chemins de fer Bône-Guelma », raccourci géographique qui n’est pas sans rappeler l’énumération de « L’empire colonial » dans le Manuel de cours moyen d’Histoire de France d’Ernest Lavisse, édition 1916. Comme pour la plaque commémorative de la mosquée, avec les photographies de la « Remise de décorations aux blessés des troupes coloniales durant la première guerre mondiale », du stûpa et de la « Maison des notables de Cochinchine », le puzzle temporel de Nathalie Tirot s’inverse, se complexifie dans une dimension mémorielle. Après la Première guerre mondiale, le parc est devenu un lieu du souvenir. Les cérémonies commémoratives s’y poursuivent aujourd’hui. Les monuments se multiplient : ensemble indochinois et monument aux Indochinois chrétiens, phnom dédié aux Cambodgiens et Laotiens, obélisque dédié aux soldats coloniaux, monument au soldat malgache, monument aux soldats noirs. Dans son image cadrée sur la pelouse entre l’obélisque et le monument aux soldats noirs, Nathalie Tirot a implanté la photographie de la cérémonie du 13 novembre 1916 prise par un photographe de l’agence Rol. En fond, masquant à peine les serres aujourd’hui en désuétude, le kiosque de musique de l’Exposition Nationale d’Agriculture Coloniale de 1905 construit à partir des totems du Dahomey et disparu dans les années 1960. Le ministre des colonies, Gaston Doumergue, remet des décorations aux blessés coloniaux. La photographie ancienne s’insère parfaitement entre les deux monuments. A l’ombre d’un chêne, l’obélisque, édifié en 1920 présente sur ses faces le nom des pays dont les populations ont été enrôlées dans la guerre sous les appellations « France d’Asie, France d’Océanie, France d’Afrique et France d’Amérique ». Le monument aux soldats noirs, sans date d’érection, a été réalisé par Auguste Biaggi. Un bas-relief représente, dans un paysage de ruines, une jeune femme, pieds nus, habillée d’un drapé, qui se tient devant une tombe symbolisée par un casque de poilu reposant sur un pieu. Devant le phnom, « à la silhouette élancée, œuvre du sculpteur [Émile] Auberlet qui s’est inspiré des plus beaux monuments khmer de ce genre [qui rappelle] le souvenir des Cambodgiens et Laotiens morts pour la France » (Henri Gourdon, L’écho annamite, 19 janvier 1927), réalisé en 1926, Nathalie Tirot a placé la carte postale d’un groupe de Laotiens posant sur les marches de la « Maison cochinchinoise » pendant l’exposition de 1907. Avec la « Maison des notables de Cochinchine », réalisée pour l’Exposition coloniale de Marseille en 1906, Nathalie Tirot ajoute de nouvelles pièces à son puzzle historico-mémoriel. Construit et sculpté dans la province de Thudaumot sous la direction de l’architecte Lê-Quan- Quan, le dinh ou maison commune où se réunissent les notables du village de Phu-Cuong est transporté et installé dans le jardin pour l’exposition de 1907. Avec les aménagements des années 1920, notamment le portique réalisé sur les plans de Charles Lichtenfelder qui lui sert
d’écrin, le dinh devient le temple du Souvenir indochinois. La carte postale représente la visite
commémorative de l’Empereur d’Annam Khai-Dinh et de son fils Bao-Dai en juin 1922. Détruit
en avril 1984 par un incendie, le temple est reconstruit en 1990-1992 dans un format réduit
par Michel Dillange. Face au temps actuel, la photographie de Nathalie Tirot introduit ainsi un
fantôme du bâtiment et de ses changements de fonction.
L’exposition de Nathalie Tirot est une invitation à laisser vagabonder le regard et l’imaginaire
et, s’accrochant à une correspondance, à la subtilité d’une superposition, à risquer une pensée
toute en nuances d’un passé complexe qui engage, sous les vestiges assoupis, les tensions
de notre société.
Jean-Marie Baldner - Gens d’images - Écrits - 20 avril 2021
Les informations qui soutiennent ce texte sont tirées, entre autres, de :
- Nathalie Tirot, Un jardin d’agronomie tropicale à Paris, Photo#graphie, 2021.
- Isabelle Levêque, Dominique Pinon, Michel Griffon, Le Jardin d’agronomie tropicale. De
l’agriculture coloniale au développement durable, Actes Sud / CIRAD, 2005.
- Thomas B. Reverdy, Sylvain Venayre, Jardin des colonies, Flammarion, 2017.
- des sites du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le
développement (www.cirad.fr/), du Musée intercommunal de Nogent-sur-Marne (https://
museenogentsurmarne.net/), du site de la Ville de Paris « 14-18 Monuments aux morts
de la Grande Guerre » (http://memorial14-18.paris.fr/) consultés entre le 12 et le 16 avril
2021.
- Des journaux, magazines et revues contemporaines de la création du jardin et des
expositions de 1905 et 1907, disponibles sur Gallica, notamment : L’Agronomie coloniale,
La Revue coloniale, La Dépêche Coloniale illustrée, le Journal des Voyages, L’illustration,
L’Écho annamite.Vous pouvez aussi lire