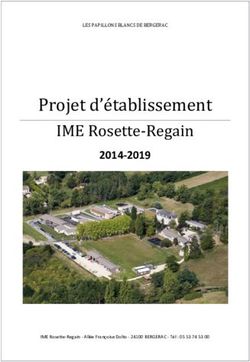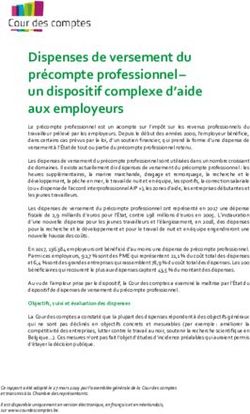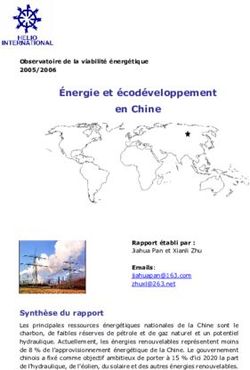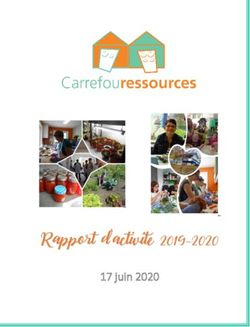CENTRE HOSPITALIER DU MANS CENTRE HOSPITALIER DU MANS
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
CENTRE HOSPITALIER DU MANS
(Département de
CENTRE HOSPITALIER DUlaMANS
Sarthe)
(Département 72)
Exercices 2011 et suivants
Le présent document a été délibéré par la chambre le
.
Le présent document qui a fait l’objet d’une contradiction avec les destinataires, a été délibéré
par la chambre le 13 décembre 2017
25, rue Paul Bellamy B.P. 14119 - 44041 Nantes Cedex 01 www.ccomptes.frCENTRE HOSPITALIER DU MANS
TABLE DES MATIÈRES
SYNTHÈSE ............................................................................................................................... 3
RECOMMANDATIONS ........................................................................................................... 5
1 PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT ET DE SON ENVIRONNEMENT ............. 7
1.1 Présentation du centre hospitalier du Mans (CHM) ....................................................... 7
1.2 Le centre hospitalier du Mans et son environnement ..................................................... 7
1.2.1 Le groupement hospitalier de territoire (GHT) de la Sarthe ............................................. 8
1.2.2 Le projet stratégique 2013-2018 du CHM ...................................................................... 10
1.2.3 La certification de la haute autorité de santé (HAS) ....................................................... 10
2 L’ACTIVITÉ, L’ATTRACTIVITÉ ET LA PERFORMANCE DU CHM ......................... 12
2.1 L’attractivité du CHM................................................................................................... 12
2.1.1 L’activité ......................................................................................................................... 12
2.1.2 La performance du CHM ................................................................................................ 14
3 FIABILITÉ DES COMPTES ET ANALYSE FINANCIERE ............................................ 14
3.1 La gestion budgétaire et la fiabilité des comptes .......................................................... 14
3.1.1 La qualité des prévisions budgétaires ............................................................................. 15
3.1.2 L’inventaire..................................................................................................................... 15
3.1.3 L’amortissement des immobilisations ............................................................................ 16
3.1.4 Le rattachement des charges et des produits ................................................................... 16
3.1.5 Les provisions ................................................................................................................. 17
3.2 La situation financière................................................................................................... 20
3.2.1 Le précédent contrat de retour à l’équilibre financier (CREF) ....................................... 20
3.2.2 Présentation des budgets ................................................................................................. 20
3.2.3 Le compte de résultat consolidé...................................................................................... 20
3.2.4 Le budget principal ......................................................................................................... 21
3.2.5 Le financement des investissements de l’établissement ................................................. 27
3.2.6 Le taux de vétusté des équipements ................................................................................ 27
3.2.7 Le taux de renouvellement des équipements .................................................................. 27
3.2.8 L’endettement ................................................................................................................. 28
3.2.9 Les résultats patrimoniaux : le bilan fonctionnel de l’établissement .............................. 30
3.2.10 Les structures de prise en charge des personnes âgées ................................................... 30
4 PROSPECTIVE ................................................................................................................... 32
4.1 La construction du compte de résultat principal 2017 .................................................. 33
5 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ................................................................... 35
5.1 L’évolution des effectifs non médicaux ........................................................................ 35
5.1.1 La répartition des effectifs .............................................................................................. 36
5.1.2 Le recrutement de contractuels ....................................................................................... 37
5.1.3 Le temps de travail du personnel non médical................................................................ 39
5.1.4 L’absentéisme du personnel non médical ....................................................................... 40
5.2 Les effectifs médicaux .................................................................................................. 41
5.2.1 Évolution des effectifs .................................................................................................... 41
5.2.2 L’activité libérale au sein du CHM................................................................................. 42
5.2.3 Respect des délais pour les rendez-vous, des tarifs et de l'affichage .............................. 44
1RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
5.2.4 La permanence des soins ................................................................................................ 45
6 LA PERFORMANCE ET LA RÉGULARITE DE L’ACHAT PUBLIC ........................... 46
6.1 L’organisation de la fonction achat............................................................................... 46
6.2 La politique et les stratégies d’achat ............................................................................. 47
6.2.1 L’engagement dans le programme PHARE .................................................................... 47
6.2.2 La mutualisation des achats ............................................................................................ 49
6.3 La régularité du processus d’achat ................................................................................ 49
ANNEXES ............................................................................................................................... 50
2CENTRE HOSPITALIER DU MANS
SYNTHÈSE
Le centre hospitalier du Mans (CHM) compte 1 693 lits et places. Avec près de
4 500 professionnels, dont 450 médecins, le CHM est à la fois un établissement de proximité et
de référence. Il répond aux besoins de la population du Mans Métropole, mais aussi de la Sarthe
et des départements limitrophes tels que l'Orne et la Mayenne, et il dessert un bassin de
population de 565 000 habitants.
L’établissement est l’hôpital support du groupement hospitalier de territoire (GHT) de
la Sarthe, constitué par un arrêté de la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS)
des Pays de la Loire en date du 7 septembre 2016.
Le précédent rapport d’observations définitives de la chambre avait conclu à une
situation financière préoccupante, avec une amélioration en 2009 reposant sur une aide
substantielle de la tutelle. Par ailleurs, la chambre faisait le constat d’une sincérité des comptes
sérieusement affectée par la persistance des reports de charges de personnel.
La chambre estimait que cette situation financière tendue obérait la relance à court terme
des investissements.
Sur la fiabilité des comptes
Dans le cadre de la certification de ses comptes obtenue sans réserve, le CHM a
considérablement amélioré la fiabilité de ses comptes. L’établissement a notamment assaini sa
politique de provisionnements et d’amortissements, globalement conforme à celle préconisée
par l’instruction comptable M21.
Sur la situation financière
Sur toute la période examinée par la chambre, la situation financière reste favorable. Le
résultat consolidé est constamment excédentaire et en progression pour atteindre plus de 6 M€
en 2016. Cette situation résulte d’une progression des charges moindre que celle des produits
(14,28 % vs 16,23 %), et est largement imputable au budget général.
Globalement, les charges de personnel du budget principal augmentent de 15,50 % sur
la période sous revue, soit une variation moyenne annuelle de près de + 3 % avec des évolutions
plus marquées entre 2011 et 2012 et entre 2013 et 2014.
Par ailleurs, si le taux de marge brute se dégrade en fin de période, il reste à un niveau
convenable au regard des établissements de même catégorie.
Dans le même temps, la capacité d’autofinancement (CAF) importante permet de
couvrir largement le remboursement de l’annuité de la dette de l’établissement, même si elle
marque une diminution sensible entre 2011 et 2016 et ce en dépit d’un résultat en progression.
Pour financer ses investissements, le CHM n’a pas emprunté sur la période.
Entre 2011 et 2016, le CHM a procédé à un apport sur fonds de roulement de plus de
68 M€. Dans le même temps, le taux de vétusté des équipements a amorcé à partir de 2013 une
diminution, résultant de la hausse des investissements consacrés aux équipements et du
nettoyage de l’actif réalisé dans le cadre de la certification des comptes. Par ailleurs, le taux de
renouvellement des équipements s’est accru passant de 2,15 % en 2011 à 6,61 % en 2016. Ce
taux équivaut à un renouvellement de l’actif en un peu plus de 15 ans.
3RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
L’endettement a également baissé de 37,16 % entre 2011 et 2016. De la même manière,
les charges financières ont diminué de 28,68 % sur la même période. La durée apparente de la
dette, après avoir diminué de 2011 à 2013, augmente en 2015 et 2016, en raison de la baisse de
la capacité d’autofinancement brute observée pour ces deux années. En 2015, la durée apparente
de la dette s’élevait à 2,77 années pour le CHM. Le ratio d’indépendance financière s’est
également réduit sur la période, passant de 55,68 % en 2011 à 28,42 % en 2016.
Il demeure que, même en intégrant des mesures organisationnelles devant conduire,
selon l’établissement à des gains de productivité, les projections de dépenses, réalisées par
l’établissement dans le cadre de son programme global de financement pluriannuel (PGFP) à
l’horizon 2025, apparaissent optimistes pour ce qui concerne l’évolution des dépenses de
personnel et les dépenses médicales, au regard de ce qui a été constaté depuis 2011.
Sur la gestion des ressources humaines
L’analyse de la gestion des ressources humaines a mis en évidence une durée du temps
travail dérogatoire avec notamment l’attribution, sans base réglementaire, d’un jour de congé
au titre de l’ancienneté.
Par ailleurs, la chambre a pu constater que certains praticiens ayant une activité libérale
au sein de l’établissement ne respectaient pas la réglementation qui régit cette activité et
n’assuraient pas la parité entre leur activité privée et publique, au détriment de cette dernière.
Sur la commande publique
Enfin, la chambre considère que la fonction achat est perfectible au sein de
l’établissement, et plus précisément la tenue des dossiers de marchés.
Conclusion
Depuis le dernier contrôle de la chambre, la situation financière du CHM s’est
considérablement améliorée. Dans le cadre de la certification de ses comptes l’établissement a
également assaini ses politiques de provisionnements et d’amortissements.
Il demeure, que certains domaines de la gestion interne et notamment l’organisation de
la commande publique sont perfectibles. Ce constat vaut également pour la gestion des affaires
médicales et, dans une moindre mesure, pour la gestion des ressources humaines.
Enfin, la haute autorité de santé (HAS) a mis en évidence, lors de ses visites de
certification, des lacunes importantes dans la gestion de la qualité et des risques, des droits des
patients et dans la tenue du dossier patient.
4CENTRE HOSPITALIER DU MANS
RECOMMANDATIONS
Recommandation n° 1 : Améliorer la rédaction des contrats de travail en détaillant tous les
éléments de la rémunération.
Recommandation n° 2 : Supprimer le jour de congé au titre de l’ancienneté et ne pas utiliser
le jour de congé de fractionnement au titre de de la journée solidarité.
Recommandation n° 3 : Inciter les praticiens concernés à respecter la réglementation
concernant l’activité libérale au sein de l’établissement.
Recommandation n° 4 : Produire des tableaux de service prévisionnels pour la permanence
des soins.
Recommandation n° 5 : Rédiger un règlement intérieur de la commande publique.
Recommandation n° 6 : Améliorer la tenue des dossiers marchés.
5RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
INTRODUCTION
Le contrôle des comptes et de la gestion du centre hospitalier du Mans (CHM), depuis
2011, a été inscrit au programme de la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire en
2016. La notification de l’ouverture du contrôle a été effectuée le 24 août 2016 à
M. Xavier Bossard, directeur en poste et aux anciens ordonnateurs Mmes Lesage et Vo-Dinh
et M. Laffont.
L’entretien de fin de contrôle a été réalisé le 18 mai 2017 avec M. Bossard, le
30 mai 2017 avec M. Laffont, le 31 mai 2017 avec Mme Lesage et le 19 juin 2017 avec
Mme Vo-Dinh.
La chambre a délibéré ses observations provisoires le 29 juin 2017.
Le rapport d’observations provisoires a été notifié par lettre du 4 août 2017 à
l’ordonnateur en fonction, M. BOSSARD, et aux anciens ordonnateurs Mmes Lesage et
Vo-Dinh et à M. Laffont.
Par ailleurs des extraits du rapport ont été adressés aux personnes suivantes :
M. Jean-Emmanuel BINET ;
Dr BENETON-BENHARD Nathalie ;
Dr DOGNON Leila ;
Dr DOVE Jacques Stéphan ;
Dr JULIEN Emmanuel ;
Dr GHYAMPHY Karim ;
Le Président de la commission d’activité libérale ;
L’ancien président de la commission d’activité libérale.
Les réponses suivantes sont parvenues à la chambre :
de M. BOSSARD, enregistrée à la chambre, le 9 octobre 2017 ;
du Dr DOGNON Leila, enregistrée à la chambre, le 27 septembre 2017 ;
du Dr DOVE Jacques Stéphan, enregistrée à la chambre, le 5 octobre 2017 ;
du Dr JULIEN Emmanuel, enregistrée à la chambre, le 16 août 2017 ;
du Dr GHYAMPHY Karim, enregistrée à la chambre, le 9 octobre 2017.
Le contrôle des comptes et de la gestion du CHM a porté sur les suites du précédent
contrôle, l’activité et la performance, les coopérations dans le cadre du groupement hospitalier
de territoire (GHT), la fiabilité des comptes et la situation financière rétrospective depuis 2011
et prospective sur la base de l’état prévisionnel des dépenses et des recettes 2017 et du plan
global de financement pluriannuel couvrant la période jusqu’en 2025.
6CENTRE HOSPITALIER DU MANS
1 PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT ET DE SON
ENVIRONNEMENT
1.1 Présentation du centre hospitalier du Mans (CHM)
Avec près de 4 500 agents, dont 450 médecins, le CHM est à la fois un établissement de
proximité et de référence. Il répond aux besoins de la population du Mans Métropole, mais aussi
de la Sarthe et des départements limitrophes tels que l'Orne et la Mayenne, et il dessert un bassin
de 565 000 habitants.
Le CHM compte 1 693 lits et places, répartis sur deux sites. Le site principal du Mans
compte 1 254 lits et places.
Le centre de gériatrie Charles Drouet situé à Allonnes offre 439 lits. Le CHM est
également le siège du SAMU centre 15 et dispose d’un service mobile d’urgence et de
mobilisation (SMUR).
L’établissement dispose d'un plateau technique conséquent avec notamment :
• six salles de radiologie dont une à la maison d'arrêt ;
• quatre salles d’écho-doppler ;
• un IRM + deux hors site ;
• deux scanners ;
• un TEP-Scan ;
• six appareils de radiographie mobile ;
• 23 salles d'opération réparties en trois blocs opératoires.
1.2 Le centre hospitalier du Mans et son environnement
La communauté hospitalière de territoire (CHT) de la Sarthe a été constituée le
23 octobre 2013 autour du CHM, et à l’initiative de ce dernier.
Durant sa brève existence, la CHT a permis de lancer des discussions sur des filières de
prise en charge qui ont été reprises dans le cadre du projet médical partagé du groupement
hospitalier de territoire (GHT) arrêté par l’agence régionale de santé (ARS) le 6 septembre
dernier. Ces filières sont les suivantes :
- prise en charge des Urgences et SMUR ;
- addictologie ;
- urologie ;
- prise en charge des personnes âgées ;
- pédiatrie ;
- neurologie et prise en charge des accidents vasculaires cérébraux (AVC) ;
- santé mentale ;
- cardiologie.
7RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
1.2.1 Le groupement hospitalier de territoire (GHT) de la Sarthe
Le GHT de la Sarthe a été définitivement constitué par un arrêté de la directrice générale
de l’ARS des Pays de la Loire en date du 7 septembre 2016. Cette décision fait suite à la
signature par neuf des dix établissements publics de santé du département de la convention
constitutive qui avait été élaborée par ces derniers, conformément au dispositif législatif et
réglementaire entre février et juin 2016. Seul l’établissement public de santé mentale (EPSM)
de la Sarthe a refusé de signer cette convention et a entamé des recours contre les décisions de
la directrice générale de l’ARS des Pays de la Loire.
Le CHM a été désigné établissement support par délibération des conseils de
surveillance des établissements membres. Les établissements adhérents sont les suivants :
- le CHM et le pôle santé Sarthe et Loir qui présentent une offre complète en médecine,
chirurgie et obstétrique (MCO) ;
- le centre hospitalier de La Ferté-Bernard qui possède un pôle de médecine, un pôle de
chirurgie et un service de soins de suite et réadaptation (SSR) ;
- le centre hospitalier de Saint-Calais et le centre hospitalier de Château-du-Loir qui
présentent une offre de médecine et un service de SSR ;
- l’EPSM de la Sarthe qui a une activité de psychiatrie ;
- le centre hospitalier du Lude qui possède un service de SSR et d’unité de soins de
longue durée (USLD) ;
- le centre hospitalier de Bonnétable, le centre hospitalier des
Tilleuls-Sillé-le-Guillaume et celui de Beaumont-sur-Sarthe qui possèdent des établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et une activité de SSR et USLD.
Le CHU de référence pour les établissements membres du GHT de la Sarthe est le CHU
d’Angers, avec lequel le GHT s’apprête à passer une convention d’association conformément
au décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de territoire.
La mise en œuvre d’un GHT repose sur la rédaction d’un projet médical partagé, prévu
par les articles L. 6132-2 et R. 6132-3 du code de la santé publique. Ce projet vise à définir la
stratégie médicale du groupement permettant de garantir aux patients du territoire une offre de
proximité de qualité, graduée et sécurisée.
En ce qui concerne le projet médical du GHT, il part du constat que le département de
la Sarthe fait face à une importante pénurie médicale avec une densité de médecins généralistes
inférieure à la moyenne nationale (99 vs 131)1.
Par ailleurs, à l’instar de nombreux départements, la démographie médicale décline sur
la dernière décennie. Ainsi selon le conseil national de l’ordre des médecins, les effectifs en
médecine générale (activité libérale ou mixte) ont diminué de presque 20 % entre 2007 et 2016
dans le département de la Sarthe.
1
Atlas de la démographie médicale en France situation au 1 er janvier 2016 – Conseil national de l’ordre
des médecins.
8CENTRE HOSPITALIER DU MANS
Afin de pérenniser l’offre de soins et compte tenu de ces éléments, l’augmentation de
l’attractivité médicale apparait comme un enjeu clé du GHT de la Sarthe.
Le renforcement de la collaboration entre les différents sites du GHT est également
largement développé dans le cadre du projet médical avec notamment :
- le développement de consultations avancées et des temps partagés ;
- le partage des pratiques médicales et l’harmonisation des pratiques ;
- le développement d’une complémentarité entre l’offre de soins de chaque centre
hospitalier, par des prises en charge inter-établissements et une rationalisation des procédures
de prises en charge (adressage, gradation et conditions de prises charge définies selon la gravité
et la compétence des établissements, …) ;
- la définition d’une permanence des soins par spécialité.
Le projet médical se décline également par filières avec pour chacune d’elles une
description des objectifs et enjeux de la filière : état des lieux et « chiffres clés », capacités en
lits, activité, temps médical disponible, et permanence des soins.
Une fiche descriptive de la filière et de la stratégie envisagée est ensuite proposée.
S’agissant de la filière santé mentale, le projet médical du GHT déplore que : « Du fait
de l’absence de participation de l’établissement public de santé mentale (EPSM) aux réflexions
sur le projet médical partagé du territoire, le travail sur ces filières n’a pas pu avoir lieu. Il s’agit
d’un grave manque du projet, déploré par tous les établissements membres qui sont aux prises
avec des difficultés de prise en charge des patients atteints de ce type de pathologie ».
En effet, l’offre de santé mentale du département est structurée autour d’un acteur
principal : l’EPSM de la Sarthe.
Conformément aux articles L. 6132-3-l et R. 6132-15 et 16 du code de la santé publique,
l'établissement support assure également pour le compte des établissements membres du
groupement les fonctions et activités suivantes :
- la fonction achats ;
- la stratégie, l'optimisation et la gestion du système d'information ;
- la gestion d'un département de l'information médicale ;
- la coordination des instituts et des écoles de formation paramédicale du groupement et
des plans de formation continue et de développement professionnel continu des personnels des
établissements membres du groupement.
Enfin, conformément aux articles L. 6132-3-3 et R. 6132-19 du code de la santé
publique, les établissements membres du groupement organisent en commun les activités de
biologie médicale, d'imagerie, de pharmacie.
9RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
1.2.2 Le projet stratégique 2013-2018 du CHM
Le CHM a élaboré un projet stratégique s’articulant autour de 10 axes principaux :
- être un établissement accessible, attractif pour les patients et valoriser l’offre
hospitalière ;
- renforcer la dynamique d’ouverture, d’écoute mutuelle et de coopération avec les
partenaires ;
- faire évoluer l’offre du CHM dans certains secteurs clés ;
- simplifier et optimiser le parcours de soin du patient, développer des alternatives à
l’hospitalisation conventionnelle, contribuer au maintien ou au retour à domicile ;
- améliorer la pertinence des prescriptions, la qualité des soins et le bien-être des
patients ;
- développer l’innovation et les activités universitaires d’enseignement et de recherche ;
- recruter, fidéliser et développer les compétences ;
- améliorer l’environnement et la qualité de vie au travail ;
- améliorer l’efficience qualitative et économique ;
- promouvoir la santé publique et le développement durable.
Ces objectifs généraux ont fait l’objet d’une déclinaison dans la cadre d’un projet
médical, spécialité par spécialité, en prenant en compte le projet régional de santé (PRS) centré
sur le patient et la prise en charge de proximité et le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
(CPOM).
1.2.3 La certification de la haute autorité de santé (HAS)
La démarche de certification mise en œuvre par la haute autorité de santé a pour objet
d'évaluer la qualité et la sécurité des soins dispensés et l'ensemble des prestations délivrées par
les établissements de santé. L’organisation interne et la satisfaction des patients sont
particulièrement analysées. La démarche de certification est une procédure obligatoire qui
intervient tous les quatre ans.
Dans sa décision en date du 25 novembre 2015, l’HAS a prononcé un sursis à statuer en
raison de réserves portant sur la gestion de la prise en charge médicamenteuse et celle du patient
en endoscopie.
Par ailleurs des obligations d’amélioration relatives à la qualité et à la gestion des
risques, aux droits des patients et à la tenue du dossier du patient ont été prononcées.
10CENTRE HOSPITALIER DU MANS
Enfin, des recommandations d’amélioration ont été signifiées à l’établissement sur les
points suivants :
- le parcours du patient ;
- la prise en charge du patient au bloc opératoire ;
- la prise en charge du patient en médecine nucléaire ;
- la prise en charge du patient en imagerie interventionnelle.
Selon la procédure prévue, l'établissement a fait l'objet d'une visite de suivi sur
l'ensemble de ses réserves dans un délai de six mois.
Dans cette perspective, il appartenait à l'établissement de transmettre à la HAS un
compte qualité supplémentaire dans les deux mois précédant la visite, indiquant les actions
correctives conduites sur les réserves et sur la ou les obligations d’amélioration définies dans
le rapport. C’est au terme de l’analyse de ce compte qualité, que l’HAS établit le programme
de la visite de suivi.
L’établissement a produit un plan d’actions et leur état d’avancement, à destination de
l’HAS.
In fine, l’établissement a été certifié en février 2017, avec une obligation2 d'amélioration
portant sur la gestion de la qualité et des risques, des droits des patients et de leur dossier. Par
ailleurs, l’HAS a prescrit un certain nombre de recommandations d’amélioration relatives à :
la prise en charge médicamenteuse du patient ;
la prise en charge du patient en endoscopie ;
celle du suivi du parcours du patient ;
la prise en charge du patient au bloc opératoire ;
la prise en charge du patient en médecine nucléaire ;
la prise en charge du patient en imagerie interventionnelle.
2
Pour les rendre plus explicites et favoriser leur lisibilité, l’HAS a revu les intitulés des avis sur ces
thématiques au regard des niveaux de certification et du sens qu’ils emportent pour les professionnels mais aussi
les usagers.
Il en existera trois types :
- les recommandations d’amélioration, qui sont des préconisations formulées à l’établissement de
progresser dans certains domaines : elles peuvent être suivies ;
- les obligations d’amélioration, qui sont des prescriptions formulées à l’attention de l’établissement
pour atteindre l’exigence que constitue le Manuel : elles doivent être suivies ;
- les réserves, qui constituent une défaillance importante du système de management de la qualité
et/ou traduisent le constat d’une problématique grave de sécurité des soins empêchant, en l’état, la
certification de l’établissement.
11RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
2 L’ACTIVITÉ, L’ATTRACTIVITÉ ET LA PERFORMANCE DU
CHM
2.1 L’attractivité du CHM
L’établissement dispose d’une zone s’attractivité d’environ 400 000 habitants.
Ses parts de marchés en font le principal offreur de soins MCO sur cette zone avec
néanmoins une concurrence des établissements privés en chirurgie (37,6 % vs 50 % pour
l’ensemble des cliniques) en 2015 (cf. annexe 1 – tableaux n° 1, 2 et 3).
Cette concurrence est également très marquée pour ce qui concerne la chirurgie
ambulatoire, avec l’établissement qui capte 31,5 % des séjours en 2015 contre plus de 60 %
pour les cliniques (cf. annexe 1 – tableaux n° 1, 2 et 3).
2.1.1 L’activité
En 2015 le CHM a réalisé 94 925 séjours en MCO dont 47 594 séjours de plus de
24 heures (+ 1 % par rapport à 2014) (cf. annexe 2 – tableau n° 4).
L’établissement a également réalisé 336 772 consultations (+ 9 % par rapport à 2014).
Le nombre de naissances s’est élevé à 3 862.
Par ailleurs, la plateforme de régulation du SAMU centre 15 a reçu 363 584 appels
entrants soit 996 appels par jour en moyenne, pour 3 091 sorties du SMUR.
Les urgences ont enregistré 90 728 passages (55 291 adultes, 29 480 enfants et 5 957
urgences gynécologiques) soit 249 par jour en moyenne dont 31 % ont mené à une
hospitalisation (cf. annexe 2 – tableau n° 8).
2.1.1.1 Evolution de l’activité MCO
Globalement l’activité progresse de près de 10 % sur la période sous revue (cf. annexe
2 – tableau n° 5). La valorisation T2A augmente dans des proportions légèrement inférieures
(8,4 %) (cf. annexe 2 – tableau n° 6).
Ce constat est toutefois à nuancer avec une baisse des séjours d’obstétrique entre 2011
et 2016 (-1,35 %) n’influençant pas, cependant, les recettes générées (+2,17 %).
Il demeure que la progression d’activité enregistrée entre 2011 et 2015 par
l’établissement est supérieure à ce qui est constaté pour les CHU de Nantes et Angers
(respectivement + 8 et + 8,4 %), pour les cinq plus gros établissements publics de la région
(+ 8,75 %) et en moyenne nationale (+ 9,30 %).
12CENTRE HOSPITALIER DU MANS
2.1.1.1.1 Evolution du nombre de consultations externes
Le nombre de consultations externes est également en forte progression, de 25 % (cf.
annexe 2 – tableau n° 7), sur la période de contrôle.
2.1.1.2 Evolution de l’activité SSR
L’activité du SSR reste stable entre 2011 et 2015 (cf. annexe 2 – tableau n° 9).
2.1.1.3 La chirurgie ambulatoire
En 2015, le taux de recours à la chirurgie ambulatoire atteignait 43,6 % au CHM.
L’instruction DGOS du 28 septembre 2015 relative aux objectifs et orientations
stratégiques du programme national de développement de la chirurgie ambulatoire pour la
période 2015/2020 a instauré un objectif visant à atteindre un taux global national de chirurgie
ambulatoire de 66,2 % à horizon 2020 (ancien taux 50 % à 2016).
Afin de moduler la rusticité de ce taux qui ne peut, à lui seul, permettre l’interprétation
de la performance de chirurgie ambulatoire d’un établissement de santé, l’ANAP, l’ATIH et 15
experts nationaux en chirurgie ambulatoire ont construit un « indicateur de performance
chirurgie ambulatoire ».
Cet indicateur composite, est établi à partir de trois données :
- le volume de chirurgie ambulatoire ;
- un indice d’organisation ambulatoire ;
- la capacité d’innover en ambulatoire est une troisième donnée à relever.
Ces trois composantes (volume ambulatoire, indice d’organisation, volume ambulatoire
innovant) constituent des clés de lecture pour l’interprétation du taux global de chirurgie
ambulatoire.
Selon ses promoteurs, l’indicateur de performance de la chirurgie ambulatoire permet
d’obtenir une photographie précise du niveau de maturité de l’organisation ambulatoire d’un
établissement de santé et de sa performance ambulatoire à un temps T permettant d’en suivre
l’évolution diachronique et une comparaison avec les autres établissements de santé sur des
bases objectives.
Le ratio obtenu par le CHM se situe dans la fourchette haute des établissements, tant au
niveau national que régional (cf. annexe 2 – tableau n° 10).
Au total, sur la période sous revue, le CH du Mans enregistre une activité soutenue tant
en hospitalisation qu’en consultation externe. De la même manière, ses ratios de chirurgie
ambulatoire positionnent favorablement le CH du Mans au regard des établissements de même
catégorie.
13RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
2.1.2 La performance du CHM
Parmi les indicateurs de performance couramment utilisés, l’IP-DMS compare la durée
moyenne de séjour (DMS) de l'établissement à celle standardisée de son casemix3 auquel on
applique les DMS de référence de chaque groupement homogène de malades (GHM). Il reflète
ainsi la performance de l'organisation médicale de l'établissement.
En médecine et obstétrique, les DMS enregistrées au CHM sont plus élevées que ce qui
est observé au niveau national (IP-DMS > 1) (cf. annexe 2 - tableau n° 11). Cette tendance
s’inverse pour la chirurgie dont l’IP-DMS est inférieure à 1 à partir de 2013. Par ailleurs, la
productivité du personnel médical est supérieure à ce qui est observé au niveau régional ou pour
les établissements de même catégorie. Cette situation explique en partie la performance globale
de l’établissement et les indicateurs financiers favorables qui seront développés infra. Cette
remarque vaut également pour le personnel administratif. En revanche, la productivité du
personnel non médical se situe dans la moyenne des établissements de même catégorie.
3 FIABILITÉ DES COMPTES ET ANALYSE FINANCIERE
3.1 La gestion budgétaire et la fiabilité des comptes
La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires a instauré, par son article 17, l’obligation de certification
des comptes des établissements publics de santé par un commissaire aux comptes ou par la Cour
des comptes. La date d'entrée en vigueur de cette disposition était effective à compter du
premier exercice commençant quatre ans après la publication de la loi précitée, soit l’exercice
2014.
La démarche vise à donner à l’utilisateur de l’information financière une assurance
quant à sa sincérité, à son image fidèle et à sa prudence. Les premiers intéressés sont les
bailleurs de fonds de l’hôpital, financeurs publics et privés, et les établissements de crédit.
Le CHM a fait partie de la première vague des établissements soumis à la certification.
Par suite, en 2014, les comptes 2014 du CHM ont été certifiés sans réserve et sans observation.
Dans le cadre de son instruction, la chambre a porté une attention particulière à la
fiabilité des comptes du CHM. Comme rappelé supra, le précédent contrôle avait formulé à ce
titre un certain nombre d’observations. La chambre s’est donc attachée à examiner les suites
qui leurs ont été données.
Dans cette perspective, la politique des amortissements et des provisions a fait l’objet
d’une attention particulière, dont les développements sont présentés supra. Par ailleurs, la
politique de rattachement des charges et des produits a également été examinée.
3
Anglicisme désignant l’éventail des cas traités, décrit par le classement en GHM des séjours réalisés
dans les unités de soins de courte durée.
14CENTRE HOSPITALIER DU MANS
3.1.1 La qualité des prévisions budgétaires
Les prévisions budgétaires sont globalement bonnes pour la période sous revue. Ainsi,
le taux d’exécution varie entre 100 et 109 % pour les charges et entre 100 et 107 % pour les
produits.
On observe néanmoins de grandes disparités au sein des différents titres. Ainsi, le taux
d’exécution des dépenses du titre 4 (charges d’amortissement et de provisions) est très
nettement supérieur à 100 % sur la période.
Cette situation est très largement imputable à la sous-estimation des provisions
(ex : + 5,9 M€ en 2015) et dans une moindre mesure aux charges exceptionnelles (y compris la
valeur des actifs cédés).
3.1.2 L’inventaire
Le CHM s’est engagé dans une démarche de fiabilisation de son actif immobilisé depuis
2012. Dans ce cadre, un important « toilettage » de l’actif a été réalisé pour les exercices 2012
à 2015.
Par ailleurs, depuis 2015, un inventaire comptable est envoyé et corrigé des sorties par
chaque service (blanchisserie, restauration, hôtellerie, jardin, garage,) et les fiches de
fiabilisation du dossier de clôture sont appliquées, afin de pérenniser la fiabilité de l’actif.
Depuis début 2017, l’ensemble des biens de ces services est directement intégré dans le
logiciel de gestion de maintenance (GMAO) de l’établissement afin que chaque gestionnaire
ou référent en tienne l’inventaire courant, devenant ainsi l’outil de base sur lequel s’appuiera
l’inventaire de l’actif.
Le CHM a produit une liste des immobilisations arrêtée au 31 décembre 2015.
Le rapprochement entre le tableau d’immobilisations au 31 décembre 2015 transmis par
le CHM d’une part, la balance du compte financier et l’état de l’actif d’autre part, laisse
apparaître des écarts sur le compte 2031 (cf. annexe 3 – tableau n° 12).
Ces écarts trouvent leur origine dans la mise à jour des frais d’études pour travaux par
le comptable. Le CH du MANS attribue l'écart constaté sur le compte 2031 à l'impossibilité
actuelle d'une comptabilisation des « en-cours » dans le logiciel d'immobilisation GEF IMMO.
Ces derniers étant, selon l’établissement, répertorié dans un tableur. Le CH du MANS s’est
engagé, à compter de 2017, à intégrer les « en-cours » dans une fiche globale sous le logiciel
GEF IMMO, afin qu'ils apparaissent dans le récapitulatif de l'actif GEF, évitant ainsi tout écart.
Par ailleurs, au vu de l’inventaire des immobilisations, il ne paraît pas non plus assuré
que l’établissement ait bien veillé à sortir de son actif l’ensemble des biens totalement amortis
dont il n’a plus l’usage. À titre indicatif, au 31 décembre 2015, l’ensemble des progiciels et
licences logicielles immobilisés depuis plus de 15 ans (dont on peut douter qu’ils soient
réellement encore employés) représentait plus de 600 000 €, les véhicules et mobiliers
immobilisés depuis plus de 20 ans représentaient respectivement 143 000 € et 55 000 €. Le CH
du Mans s’est engagé à porter une attention particulière, lors des prochaines opérations de
clôture, au maintien à l'actif de mobiliers de plus de 20 ans.
15RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
3.1.3 L’amortissement des immobilisations
Par décision du 7 janvier 2013, la direction des affaires financières de l’établissement a
retenu la méthode de l’amortissement linéaire avec un prorata temporis à compter de la mise en
service du bien.
S’agissant des durées d’amortissement, celles retenues par le CHM sont globalement
conformes au barème indicatif donné par l’instruction budgétaire et comptable M21. On peut
toutefois noter que le CHM immobilise sur cinq ans les progiciels alors que la M21 préconise
une durée d’amortissement comprise entre deux et trois ans pour tous les logiciels.
Les durées d’amortissement figurent également en annexe du compte financier sur la
période sous revue comme le prévoit l’instruction budgétaire et comptable M21, à l’exception
de l’année 2011.
Si l’établissement a arrêté les durées d’amortissements applicables par décision du
7 janvier 2013, il apparaît toutefois qu’il ne la respecte pas pleinement dans la mesure où, pour
des biens amortis à compter de 2013, il peut être constaté que des logiciels (VB 166 000 €)
imputés au compte 20511 ne sont pas amortis sur trois ans (deux ou cinq ans selon les cas),
d’autres logiciels (VB 23 000 €) imputés au compte 20512 ou 20514 sont amortis sur deux ans
(au lieu des cinq décidés), des matériels de bureau et informatique (VB 857 000 €) imputés aux
comptes 218311 ou 283211 ou 283122 sont amortis sur des durées différentes des cinq ans
décidés (un, trois, quatre ou 10 ans selon les cas), enfin, des matériels informatiques
bureautiques (VB 10 000 €) sont amortis sur cinq ans au lieu des trois décidés.
Le CH du MANS s’est engagé à porter une attention particulière aux durées
d'amortissement pouvant ressortir comme atypiques, du fait d'erreurs de saisie.
3.1.4 Le rattachement des charges et des produits
3.1.4.1 Le rattachement des intérêts courus non échus (ICNE) à payer
Le CHM a pratiqué le rattachement des ICNE à payer pour la période 2011-2015 et
applique correctement le dispositif budgétaire et comptable prévu par la M21.
A partir de 2013, le CHM a créé le compte 66112 « Intérêts courus non échus »,
permettant d’identifier clairement la variation des ICNE dans la balance des comptes.
3.1.4.2 Le rattachement des charges
Une attention particulière a été portée lors du contrôle au compte 4281 « Prime de
service à payer ».
Le CHM utilise bien les comptes de rattachement des frais de personnel à l’exercice
concerné. La prime de service, versée en janvier, est bien comptabilisée au compte 4281
« personnel-charges à payer ».
Les charges sur exercices antérieurs diminuent de près de 43 % sur la période. Cette
évolution globale est différente selon les budgets : - 44 % sur le budget H et + 21 % sur les
budget EHPAD et USLD. Eu égard au volume du budget du CHM, ces écarts en valeur absolue
n’apparaissent pas significatifs.
16CENTRE HOSPITALIER DU MANS
Le taux de charges reportées diminue nettement sur la période contrôlée (de 1,89 % à
0,11 %). Le taux est inférieur à la cible de 0,2 % à partir de 2013, alors qu’il était supérieur à la
cible en 2011 (1,89 %) et 2012 (0,9 %).
3.1.4.3 Le rattachement des produits
Pour la période 2011-2016, le CHM a procédé au rattachement de ses produits sur le
budget principal et sur les budgets annexes. Le volume global de rattachement des produits a
peu évolué sur la période, sa progression étant de 1,4 % en variation annuelle.
Par ailleurs, si le CHM procède globalement au rattachement de ses produits, on observe
néanmoins que certains produits ne font pas du tout l’objet de rattachement comme les produits
de l’État. D’autres ne font l’objet de rattachement qu’en fin de période comme les produits du
personnel à partir de 2014 ou les produits des organismes sociaux à compter de 2016.
Enfin, le volume global des produits rattachés a progressé de 25 % entre 2011 et 2015,
essentiellement en raison de la hausse du montant des produits à recevoir des redevables
(+ 4 M€).
Au final, la chambre a pu constater que le CH du Mans procédait convenablement
au rattachement des charges et des produits à l’exercice concerné sur la période du
contrôle.
3.1.5 Les provisions
Les provisions ont connu une évolution erratique entre 2011 et 2016, mais ont retrouvé,
en fin de période, un niveau similaire à celui de 2011 (35,24 M€ en 2011 et 33,25 M€ en 2016).
Lors de la signature du contrat de retour à l’équilibre financier (CREF), le bilan du CHM
traduisait notamment des investissements très importants, financés exclusivement par des
emprunts très lourds (faiblesse des amortissements dans le haut de bilan), des résultats
déficitaires accumulés et des provisions extrêmement faibles, incapables de compenser les
déficits.
En outre, le dernier rapport de la chambre avait pointé un important sous
provisionnement de l’établissement : cela signifie que l’établissement ne s’était absolument pas
couvert pour faire face à des charges à venir et connues, notamment les comptes épargne-temps
des personnels, la dépréciation des immobilisations et surtout les risques financiers. Au total,
les provisions du CHM atteignaient seulement 7 M€ en 2008. Or, ces provisions cumulées
atteignaient au 31 décembre 2016 : 33,25 M€. Parmi ces provisions, la moitié correspondait à
des provisions réglementées ; l’autre moitié renvoyait soit à des budgets annexes, soit, fait
nouveau depuis 2011, à une mise en réserve pour l’investissement futur.
Lors de la procédure de certification, l’objet et les modalités d’utilisation de chaque
compte de provision ont été redéfinis par le CHM. La phase préparatoire à la certification des
17RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
comptes (2012-2014) a constitué pour le CHM, à l’instar des autres EPS, une opportunité pour
mettre en adéquation le solde de provisions avec le besoin de provisionnement au regard des
textes. Le CHM a ainsi corrigé un à un ses différents comptes de provisions, directement au
bilan.
La principale conséquence de ce changement de pratique pour les provisions est un
allègement des comptes de provisions au bilan, équilibré par un renforcement des fonds propres
de l’établissement.
L’objectif du CHM étant désormais de limiter les provisions aux strictes exigences de
la certification des comptes hospitaliers.
Ainsi, entre 2011 et 2015, les provisions réglementées ont diminué de 1,17 M€. Depuis
2015, un seul compte de provision réglementée est ouvert dans les comptes du CHM : il s’agit
de la provision pour renouvellement des immobilisations, dotée à hauteur de 3,43 M€ au
31 décembre 2016.
Par ailleurs, en 2011, 7,05 M€ de provisions réglementées pour renouvellement des
immobilisations ont été constituées, dont 6 M€ pour le renouvellement des immobilisations
présentant un caractère de « réserves » dans le cadre de la mise en œuvre du futur projet
d’établissement et 1,05 M€ pour le renouvellement des immobilisations présentant un caractère
de « réserves » dans le cadre d’un projet de construction d’un bâtiment pour personnes âgées.
Dans le cadre de la certification, ces provisions ont fait l’objet d’un toilettage et, en l’absence
de notifications, 7,05 M€ ont été transférés au bilan sur les comptes de report à nouveau
(compte 119), compensant alors d’autant le déficit cumulé.
En 2013, 2,2 M€ ont été provisionnés au titre du fonds d’intervention régional (FIR)
pour « l’accompagnement du projet d’investissement » au titre du schéma directeur immobilier.
La notification de l’ARS, en date du 31 décembre 2013, a été fournie pendant l’instruction. A
la date du contrôle, cette provision n’a pas fait l’objet de reprise. Elle a été maintenue par
l’établissement dans le cadre de l’opération baptisée ARC, actuellement à la validation de
l’ARS.
Enfin, aucune dotation n’a été constituée en 2015 et 2016.
Par ailleurs, les provisions au titre du compte épargne temps (CET) (compte 143 puis
compte 153), font l’objet d’une actualisation chaque année en janvier.
Au 31 décembre 2016, le compte de provisions pour CET s’élevait à 11,51 M€. Au total,
le CHM a provisionné, sur la période de contrôle, les sommes nécessaires pour couvrir le coût
des charges afférentes aux jours épargnés.
Le CHM est son « propre assureur » en matière d’assurance chômage, c’est-à-dire qu’il
se substitue à Pôle Emploi pour indemniser les personnels dont les contrats se sont terminés et
qui ouvrent ainsi droit à indemnisation. Les règles applicables sont conformes à la convention
d’assurance chômage en vigueur.
Une provision relative à ce risque a été comptabilisée pour la première fois dans les
comptes du CHM en 2014. Ce risque a été évalué à la clôture de l’exercice 2014, pour 386
personnes indemnisables, à un coût total de 2,49 M€ tous budgets confondus.
S’agissant des autres provisions, le CH du Mans a mis en place un plan de
provisionnement pour la couverture des sommes dues à la CNRACL dans le cadre des
18Vous pouvez aussi lire