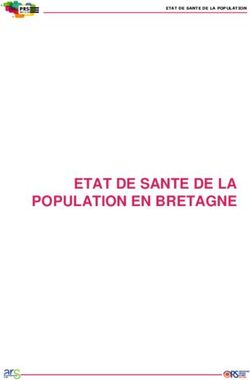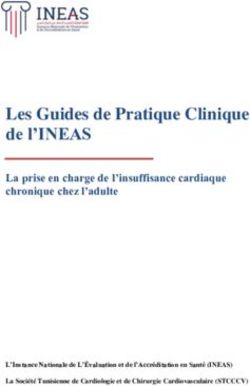Creative commons : Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 2.0 France (CC BY-NC-ND 2.0) ...
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
http://portaildoc.univ-lyon1.fr
Creative commons : Paternité - Pas d’Utilisation Commerciale -
Pas de Modification 2.0 France (CC BY-NC-ND 2.0)
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr
WILLOT
(CC BY-NC-ND 2.0)
UFR
de
MEDECINE
LYON
EST
2017
-‐
N°381
HYPOTHYROÏDIE
FRUSTE
ET
VIEILLISSEMENT
:
CONFRONTATION
D’UN
SEUIL
DE
TSH
ADAPTÉ
À
L’ÂGE
SUR
LES
SIGNES
CLINIQUES.
THESE
D’EXERCICE
EN
MEDECINE
Présentée
à
l’Université́
Claude
Bernard
Lyon
1
Et
soutenue
publiquement
le
17
novembre
2017
En
vue
d’obtenir
le
titre
de
Docteur
en
Médecine
Par
Louise
WILLOT
épouse
DHERS
née
le
20
Juin
1989
à
Roubaix
(59100)
1
WILLOT
(CC BY-NC-ND 2.0)
3
WILLOT
(CC BY-NC-ND 2.0)
4
WILLOT
(CC BY-NC-ND 2.0)
5
WILLOT
(CC BY-NC-ND 2.0)
6
WILLOT
(CC BY-NC-ND 2.0)
7
WILLOT
(CC BY-NC-ND 2.0)Serment
d’Hippocrate
Je
promets
et
je
jure
d'être
fidèle
aux
lois
de
l’honneur
et
de
la
probité
dans
l'exercice
de
la
Médecine.
Je
respecterai
toutes
les
personnes,
leur
autonomie
et
leur
volonté́ ,
sans
discrimination.
J'interviendrai
pour
les
protéger
si
elles
sont
vulnérables
ou
menacées
dans
leur
intégrité
ou
leur
dignité.
Même
sous
la
contrainte,
je
ne
ferai
pas
usage
de
mes
connaissances
contre
les
lois
de
l'humanité.
J'informerai
les
patients
des
décisions
envisagées,
de
leurs
raisons
et
de
leurs
conséquences.
Je
ne
tromperai
jamais
leur
confiance.
Je
donnerai
mes
soins
à
l'indigent
et
je
n'exigerai
pas
un
salaire
au
dessus
de
mon
travail.
Admis
dans
l'intimité
des
personnes,
je
tairai
les
secrets
qui
me
seront
confiés
et
ma
conduite
ne
servira
pas
à
corrompre
les
mœurs.
Je
ferai
tout
pour
soulager
les
souffrances.
Je
ne
prolongerai
pas
abusivement
la
vie
ni
ne
provoquerai
délibérément
la
mort.
Je
préserverai
l'indépendance
nécessaire
et
je
n'entreprendrai
rien
qui
dépasse
mes
compétences.
Je
perfectionnerai
mes
connaissances
pour
assurer
au
mieux
ma
mission.
Que
les
hommes
m'accordent
leur
estime
si
je
suis
fidèle
à
mes
promesses.
Que
je
sois
couvert
d'opprobre
et
méprisé
si
j'y
manque.
8
WILLOT
(CC BY-NC-ND 2.0)Remerciements
À
Monsieur
le
Professeur
Marc
Bonnefoy
:
Merci
de
m’avoir
fait
l’honneur
de
présider
ce
jury,
et
surtout
de
m’avoir
confié
ce
travail.
Veuillez
trouver
ici
l’expression
de
ma
profonde
et
respectueuse
reconnaissance
pour
votre
aide
et
votre
confiance.
Merci
également
de
me
permettre
d’exercer
la
gériatrie
dans
votre
service
très
prochainement.
À
Madame
le
Professeur
Françoise
Borson-‐Chazot
:
Je
vous
remercie
pour
l’intérêt
que
vous
avez
immédiatement
porté
au
sujet.
Vous
me
faites
l’honneur
de
juger
mon
travail.
Veuillez
recevoir
l’expression
de
ma
respectueuse
gratitude.
À
Monsieur
le
Professeur
Philippe
Vanhems
:
Merci
d’avoir
accepté
de
juger
ce
travail,
veuillez
trouver
ici
l’expression
de
mes
sincères
remerciements
et
de
mon
profond
respect.
Au
Docteur
Antoine
Vignoles
:
Merci
de
m’avoir
accompagnée
pendant
la
réalisation
de
ce
travail.
Merci
d’avoir
cru
en
moi,
de
m’avoir
redonner
confiance,
de
m’avoir
fait
avancer
et
merci
pour
tes
conseils
et
pour
tes
pensées
toujours
positives.
Je
te
remercie
également
pour
le
temps
que
tu
m’as
accordé,
c’était
très
agréable
de
travailler
avec
toi.
À
Mesdames
le
Professeur
Catherine
Ronin
et
Sandrine
Donadio-‐Andrei
:
Je
vous
remercie
pour
vos
conseils
et
remarques
qui
ont
permis
à
ce
travail
de
prendre
cette
orientation.
Merci
pour
votre
aide
et
votre
disponibilité,
ainsi
que
de
vous
être
déplacées
sur
Lyon
si
régulièrement.
Veuillez
recevoir
toute
ma
gratitude.
À
Madame
le
Docteur
Muriel
Rabilloud
:
Je
vous
vous
remercie
d’avoir
participé
à
cette
thèse
en
m’aidant
dans
la
réalisation
des
tests
statistiques.
Veuillez
recevoir
toute
ma
gratitude.
9
WILLOT
(CC BY-NC-ND 2.0)À
tous
mes
collègues
:
Que
j’ai
rencontré
lors
de
mes
études
médicales
à
Lille
ou
à
Lyon
:
merci
de
m’avoir
fait
découvrir
la
médecine
et
de
m’avoir
passionnée
pour
la
gériatrie.
Un
grand
merci
à
Clémence,
Florence,
Marine,
Mahdi
et
Sophie,
j’ai
adoré
travailler
avec
vous
en
tant
qu’interne,
et
vous
recroiser
à
chaque
fois
que
je
passais
à
Lyon
Sud
pour
ma
thèse.
Votre
soutien
et
vos
encouragements
ont
été
précieux.
À
mes
parents
:
Que
j’aime
tant
et
qui
m’ont
permis
de
faire
les
études
que
j’aime.
Merci
pour
tout,
pour
votre
amour,
votre
éducation,
vos
conseils,
votre
soutien,
votre
présence.
C’est
grâce
à
vous
que
je
suis
là
aujourd’hui
et
je
ne
vous
remercierez
jamais
assez.
À
ma
sœur
Jeanne
et
à
mes
frères
Clément
et
Antoine
:
Grandir
avec
vous
était
génial,
vous
me
manquez
beaucoup
à
Lyon.
Merci
d’avoir
fait
la
route
jusqu’ici
pour
m’écouter,
même
si
je
sais
que
Jeanne
tu
feras
semblant
d’avoir
tout
compris.
À
ma
belle-‐famille
:
Merci
d’être
venu
de
loin
pour
m’encourager,
merci
pour
votre
présence
et
votre
soutien.
À
mes
amis
et
surtout
mes
copines
de
Lille
qui
me
manquent
tant
à
Lyon
:
Merci
d’être
des
si
bons
amis
et
de
me
procurer
du
bonheur
dans
ma
vie.
Et
surtout
à
Henri
:
Mon
mari,
l’homme
de
ma
vie,
merci
pour
tout,
pour
ta
présence,
ta
patience,
ta
confiance
en
moi,
ton
amour.
Merci
d’avoir
accepté
de
travailler
ton
swing
tous
les
weekends
pour
que
je
puisse
travailler
tranquillement.
Vivre
avec
toi
est
un
réel
bonheur.
10
WILLOT
(CC BY-NC-ND 2.0)Table
des
matières
Serment
d’Hippocrate
........................................................................................................................
8
Remerciements
...................................................................................................................................
9
Liste
des
abréviations
......................................................................................................................
13
Introduction
......................................................................................................................................
14
1.
Définition
de
l’hypothyroïdie
fruste
...................................................................................................
14
2.
Pathologies
thyroïdiennes
:
fréquence
..............................................................................................
15
3.
Physiopathologie
de
la
thyroïde
..........................................................................................................
16
4.
Prévalence
de
l’hypothyroïdie
fruste
.................................................................................................
17
4.1.
Prévalence
dans
la
population
générale
et
selon
le
sexe
.............................................................
17
4.2.
Prévalence
selon
l’origine
ethnique
......................................................................................................
18
4.3.
Prévalence
selon
l’apport
en
iode
..........................................................................................................
19
4.4.
Prévalence
selon
l’âge
.................................................................................................................................
19
5.
Valeurs
de
référence
de
la
TSH
............................................................................................................
20
6.
Limite
supérieure
de
la
TSH
chez
la
personne
âgée
.........................................................................
21
7.
Signes
cliniques
dans
l’hypothyroïdie
fruste
.....................................................................................
23
8.
Traitement
de
l’hypothyroïdie
fruste
.................................................................................................
26
9.
Objectifs
..................................................................................................................................................
26
Matériel
et
méthode
.......................................................................................................................
28
1.
Patients
....................................................................................................................................................
28
2.
Mesures
cliniques
et
biologiques
........................................................................................................
30
3.
Tests
statistiques
...................................................................................................................................
31
Résultats
............................................................................................................................................
33
1.
Population
de
référence
.......................................................................................................................
33
2.
Moyenne,
médiane,
2,5ème
et
97,5ème
percentile
de
la
TSH
dans
la
population
de
référence
..
33
3.
Répartition
de
la
population
étudiée.
................................................................................................
35
4.
Etude
des
signes
cliniques
....................................................................................................................
36
4.1.
Signes
cliniques
dans
la
population
étudiée
totale
.........................................................................
36
4.2.
Signes
cliniques
dans
la
population
étudiée
féminine.
.................................................................
38
4.3.
Signes
cliniques
dans
la
population
étudiée
masculine.
..............................................................
40
4.4.
Courbe
ROC
et
odds
ratio
...........................................................................................................................
41
5.
Paramètres
biologiques
........................................................................................................................
43
Discussion
..........................................................................................................................................
45
1.
Interprétation
des
résultats
................................................................................................................
45
1.1.
La
TSH
augmente
avec
l’âge.
....................................................................................................................
45
1.2.
Prévalence
de
l’hypothyroïdie
fruste
et
utilisation
de
bornes
de
référence
liées
à
l’âge.
........................................................................................................................................................................................
47
1.3.
Signes
cliniques
..............................................................................................................................................
48
1.4.
Paramètres
biologiques.
.............................................................................................................................
51
2.
Vieillissement
et
signes
cliniques
........................................................................................................
53
3.
Retentissements
de
l’hypothyroïdie
fruste
:
risque
cardiovasculaire
et
risque
neuropsychologique.
.................................................................................................................................
55
4.
Prise
en
charge
de
l’hypothyroïdie
fruste
chez
la
personne
âgée.
................................................
57
4.1.
Dépistage
..........................................................................................................................................................
57
4.2.
Traitement
:
indication,
limites
et
risques
.........................................................................................
59
5.
Biais
et
limites
........................................................................................................................................
61
11
WILLOT
(CC BY-NC-ND 2.0)Conclusions
.......................................................................................................................................
63
Bibliographie
.....................................................................................................................................
65
Annexes
.............................................................................................................................................
75
Annexe
1
:
Axe
thyréotrope
dans
le
vieillissement
....................................................................
75
Annexe
2
:
97,5ème
de
la
TSH
(mUI/L)
selon
l’âge
dans
des
populations
de
référence
selon
la
littérature.
.................................................................................................................................
76
Annexe
3
:
Algorithme
décisionnel
de
l’
HAS
concernant
l’hypothyroïdie
fruste.
............
77
Annexe
4
:
Questionnaire
de
recrutement
des
patients.
...........................................................
78
Annexe
5
:
Odds
Ratio
pour
chacun
des
signes
cliniques
de
l’hypothyroïdie
fruste.
.......
80
12
WILLOT
(CC BY-NC-ND 2.0)Liste
des
abréviations
AUROC
:
«
Area
Under
the
Receiver
Operating
Characteristic
curve
»
:
Aire
sous
la
courbe
des
caractéristiques
de
fonctionnement
du
récepteur
FN
:
Faux
Négatifs
FP
:
Faux
Positifs
HAS
:
Haute
Autorité
de
Santé
HF
:
Hypothyroïdie
Fruste
IC
:
intervalle
de
Confiance
IMC
:
Indice
de
Masse
Corporelle
INSEE
:
Institut
National
de
la
Statistique
et
des
Études
Économiques
NACB
:
«
National
Academy
of
Clinical
Biochemistry»
ROC
:
«
Receiver
Operating
Characteristic
»
:
Caractéristiques
de
fonctionnement
du
récepteur
Se
:
Sensibilité
Sp
:
Spécificité
T3
:
Tri-‐iodothyronine
T3L
:
Tri-‐iodothyronine
T4
:
Thyroxine
T4L
:
Thyroxine
libre
TPO
:
Thyroperoxydase
TRH
:
«
Thyrotropin-‐Releasing
Hormone
»
:
Thyréoliberine
TSH
:
«
Thyroid
Stimulating
Hormone
»
:
Thyrotropine
VN
:
Vrais
Négatifs
VP
:
Vrais
Positifs
13
WILLOT
(CC BY-NC-ND 2.0)Introduction
L’hypothyroïdie
fruste
est
une
pathologie
fréquemment
rencontrée
en
médecine,
aussi
bien
en
pratique
hospitalière
qu’en
pratique
libérale.
Sa
prévalence
dans
la
population
générale
varie
entre
1%
et
10%
selon
les
auteurs,
mais
jusqu’à
20%
chez
les
femmes
âgées
de
plus
de
60
ans.
La
moyenne
des
prévalences
se
trouve
aux
alentours
des
7%.
Ces
chiffres
doivent
apostropher
le
médecin
généraliste,
car
sur
15
patients,
au
moins
un
patient
souffre
d’hypothyroïdie
fruste.
Chez
les
femmes
âgées,
1
patiente
sur
5
est
concernée
par
cette
pathologie.
Le
médecin
généraliste
est
donc
au
premier
plan
dans
la
prise
en
charge
de
cette
pathologie,
dont
les
signes
cliniques
sont
souvent
aspécifiques
chez
des
patients
peu
symptomatiques.
La
fréquence
de
cette
pathologie
entraine
de
nombreuses
prescriptions
biologiques
et
thérapeutiques.
Dans
la
littérature,
de
nombreux
articles
donnent
des
avis
divergents
sur
la
définition,
l’épidémiologie,
le
diagnostic,
le
dépistage
et
la
prise
en
charge
de
l’hypothyroïdie
fruste.
Plus
récemment
les
études
s’intéressent
à
l’hypothyroïdie
fruste
de
la
personne
âgée,
qui
apportent
elles
aussi
leurs
lots
de
controverses.
Un
des
sujets
les
plus
récurrents
est
que
les
limites
de
la
TSH,
servant
au
diagnostic
de
l’hypothyroïdie
fruste
ne
seraient
pas
adaptées
chez
la
personne
âgée.
Il
conviendrait
alors
de
redéfinir
la
limite
supérieure
de
la
TSH.
1.
Définition
de
l’hypothyroïdie
fruste
L’hypothyroïdie
fruste
est
aussi
connue
sous
les
noms
d’hypothyroïdie
occulte,
asymptomatique,
modérée,
compensée,
infraclinique
ou
subclinique.
Sa
définition
est
uniquement
biologique,
il
s’agit
d’une
augmentation
isolée
de
la
TSH
(Thyroid
Stimulating
Hormone),
c’est
à
dire
sans
augmentation
des
hormones
périphériques,
la
thyroxine
libre
(T4L)
étant
normale.
L’hormone
T3L
n’entre
pas
dans
la
définition.
En
France
la
limite
supérieure
de
l’intervalle
de
référence
de
la
TSH
est
fixée
à
4mUI/L,
ainsi
le
diagnostic
d’hypothyroïdie
fruste
est
retenu
dès
lors
que
la
valeur
de
la
TSH
est
supérieure
à
4mUI/L,
avec
une
concentration
de
T4L
normale
(1).
14
WILLOT
(CC BY-NC-ND 2.0)Les
causes
d’hypothyroïdie
fruste
sont
les
même
que
celles
des
hypothyroïdies
avérées
périphériques.
Les
étiologies
les
plus
fréquentes
sont
:
le
déficit
endémique
en
iode,
la
thyroïdite
auto-‐immune
chronique,
les
thyroïdectomies,
les
radiothérapies
à
l’iode,
les
médicaments
comme
l’amiodarone,
le
post-‐partum
ou
plus
rarement
les
maladies
infiltrantes
de
la
thyroïde.
2.
Pathologies
thyroïdiennes
:
fréquence
Les
pathologies
thyroïdiennes
sont
souvent
évoquées
lors
des
consultations
en
médecine
générale
devant
des
signes
cliniques
souvent
peu
spécifiques
:
asthénie,
prise
de
poids,
troubles
du
sommeil.
Elles
se
repartissent
en
hypothyroïdies
ou
hyperthyroïdies
avec
des
formes
frustes
et
avérées
pour
chacune
d’elle.
Dans
une
méta-‐analyse
de
2014,
la
prévalence
européenne
des
dysthyroïdies
dans
une
population
générale
est
de
3,82%
(2).
La
répartition
de
ces
dysthyroïdies
est
indiquée
dans
le
tableau
1.
Pathologie
thyroïdienne
Prévalence
Hypothyroïdie
fruste
3,8%
Hypothyroïdie
avérée
0,37%
Hyperthyroïdie
fruste
2,91%
Hyperthyroïdie
avérée
0,68%
Tableau
1
:
Répartition
en
pourcentage
des
dysthyroïdies
dans
la
population
européenne
selon
une
méta-‐analyse
de
2014.
Dans
l’étude
PAQUID,
concernant
les
dysthyroïdies
dans
une
population
de
plus
de
60
ans,
suivie
en
ambulatoire,
le
pourcentage
d’hypothyroïdie
fruste
est
de
4,2%,
contre
1,8%
d’hypothyroïdies
avérées
et
0,5%
d’hyperthyroïdies
(3).
Dans
une
population
âgée
de
plus
de
60
ans
et
en
milieu
hospitalier
nous
observons
que
cette
répartition
suit
les
mêmes
proportions.
La
fréquence
de
l’hypothyroïdie
fruste
est
plus
élevée
que
les
autres
dysthyroïdies
avec
5,6%
de
patients
atteints
(4).
15
WILLOT
(CC BY-NC-ND 2.0)Ainsi
nous
voyons
que
l’hypothyroïdie
fruste
est
la
plus
fréquente
des
dysthyroïdies,
dans
une
population
générale
comme
dans
une
population
âgée,
en
milieu
hospitalier
ou
en
ambulatoire.
3.
Physiopathologie
de
la
thyroïde
Pour
rappel,
l’axe
thyrotropique
est
organisé
de
la
manière
suivante
:
au
niveau
du
cerveau,
les
noyaux
paraventriculaires,
situés
près
du
3ème
ventricule
du
cerveau,
sécrètent
de
la
TRH
(hormone
de
libération
de
la
TSH).
La
TRH
est
responsable
de
la
sécrétion
et
de
la
libération
de
la
TSH
au
niveau
de
la
glande
hypophysaire
dans
la
tige
pituitaire.
A
son
tour
la
TSH,
agit
au
niveau
des
cellules
épithéliales
de
la
glande
thyroïde,
située
dans
le
cou,
et
favorise
la
synthèse
et
la
libération
des
hormones
périphériques
T4L
et
T3L.
Les
hormones
thyroïdiennes
périphériques
agissent
directement
sur
le
cerveau,
les
systèmes
digestif,
cardiovasculaire,
osseux,
les
fonctions
hépatique
et
biliaire.
Elles
régulent
le
système
de
température
corporelle
mais
aussi
le
métabolisme
stéroïdien,
glucosique,
lipidique,
du
cholestérol,
des
protéines.
Elles
aident
au
développement
et
à
la
régulation
des
cellules
de
l’ensemble
de
l’organisme,
agissant
sur
la
croissance
et
la
puberté.
Elles
participent
également
à
la
production
d’énergie.
Pour
résumer,
la
fonction
thyroïdienne
est
de
réguler
le
métabolisme
basal
c’est
à
dire
la
vitesse
par
laquelle
s’effectuent
les
différentes
transformations
biochimiques
de
l’ensemble
de
notre
organisme.
Physiologiquement
des
changements
se
produisent
dans
l’axe
thyroïdien
chez
les
personnes
âgées
en
bonne
santé,
au
niveau
du
cerveau,
de
la
glande
pituitaire
de
l’hypophyse,
de
la
glande
thyroïde,
du
foie
et
des
muscles.
Bien
que
tous
ces
changements
ne
soient
pas
toujours
correctement
identifiés,
nous
savons
par
exemple
qu’au
niveau
de
la
thyroïde
:
une
fibrose
s’installe
associée
à
un
infiltrat
cellulaire
lymphomonocytaire
et
une
atrophie
folliculaire
(5).
Il
a
également
été
proposé
que
la
plus
grande
prévalence
des
anomalies
thyroïdiennes
et
des
dysfonctionnements
associés
au
vieillissement
résulte
des
dommages
causés
aux
cellules
thyroïdiennes
par
le
stress
oxydatif,
en
raison
de
l'exposition
continue
aux
espèces
réactives
d'oxygène
(peroxyde
d'hydrogène)
nécessaires
à
la
production
d'hormones
thyroïdiennes
(6,7).
16
WILLOT
(CC BY-NC-ND 2.0)
Ces
modifications
de
la
structure
et
donc
du
bon
fonctionnement
de
ces
organes
entrainent
des
changements
au
niveau
hormonal
:
TRH,
TSH,
T4
et
T3
(8).
(Annexe
1).
Ici
nous
nous
intéressons
aux
modifications
de
la
TSH.
Dans
le
passé,
les
études
concernant
l’évolution
de
la
TSH
avec
l’âge
divergeaient
à
ce
sujet.
Certaines
études
montraient
soit
une
diminution
du
taux
de
TSH,
soit
un
taux
constant
de
TSH,
soit
une
augmentation
du
taux
de
TSH
(9–12).
Cependant
dans
la
majorité
de
ces
essais
les
patients
âgées
malades
n’étaient
pas
exclus.
Il
est
alors
probable
que
ces
différences
de
résultats
soient
en
lien
avec
des
perturbations
du
systèmes
immunitaires,
les
pathologies
auto-‐immunes
étant
plus
fréquentes
chez
les
personnes
âgées.
Il
existe
un
consensus
plus
récent,
qui
atteste
que,
dans
l’ensemble,
les
taux
de
TSH
ont
une
prédisposition
à
augmenter
avec
l’âge.
Dans
une
étude
publiée
en
2012,
il
est
démontré
que
dans
une
population
de
657
participants
âgés
d’en
moyenne
85ans,
en
13
ans
(de
1992
à
2005),
le
taux
de
TSH
augmente
de
13%.
En
excluant
les
participants
atteints
d’une
pathologie
quelconque,
la
TSH
augmente
également
de
12%(13).
Cette
augmentation
du
taux
de
TSH,
est
valable
également
pour
les
âges
extrêmes
de
la
vie,
dans
l’étude
de
Atzmon
et
al,
un
groupe
d’ashkénazes
(âge
médian
72
ans)
est
comparé
à
des
centenaires
ashkénazes
(âge
médian
98
ans),
le
taux
médian
de
TSH
est
alors
de
1,55
mUI/L
et
1,97mUI/L
respectivement
(14).
Il
est
donc
reconnu
que
la
concentration
de
TSH
augmente
avec
l’âge.
Cependant
il
n’a
toujours
pas
été
défini
clairement
s’il
s’agit
d’une
réponse
adaptative
normale
associée
au
vieillissement
ou
s’il
s’agit
d’une
augmentation
anormale
réelle
de
la
fonction
thyroïdienne
(6).
4.
Prévalence
de
l’hypothyroïdie
fruste
4.1.
Prévalence
dans
la
population
générale
et
selon
le
sexe
Les
chiffres
de
la
prévalence
de
l’hypothyroïdie
fruste
en
France,
correspondent
aux
chiffres
de
l’étude
SUVIMAX
(15).
Cette
étude
est
réalisée
en
1995,
soit
il
y
a
plus
de
17
WILLOT
(CC BY-NC-ND 2.0)20
ans,
à
partir
d’une
population
âgée
de
45
à
65
ans.
3584
femmes
et
3584
hommes
étaient
inclus.
Bien
que
la
parité
soit
respectée,
la
tranche
d’âge
choisie
ne
semble
pas
être
représentative
de
la
population
française,
car
elle
exclue
les
personnes
jeunes
et
âgées.
La
limite
haute
retenue
pour
la
TSH
est
de
5,54mUI/L.
La
prévalence
de
l’hypothyroïdie
fruste
est
alors
de
3,3%
chez
la
femme
et
de
1,9%
chez
l’homme.
Cependant
dans
cette
même
population,
pour
seuil
haut
de
TSH
à
4mUI/L,
la
prévalence
de
l’hypothyroïdie
fruste
passe
de
11%
et
de
4%
chez
les
femmes
et
chez
les
hommes
respectivement.
Au
Royaume-‐Uni,
en
1974
à
Whickham,
sur
un
échantillon
de
2779
adultes,
représentatif
de
la
population
du
comté,
la
prévalence
dans
la
population
générale
âgée
de
plus
de
18
ans
et
pour
une
limite
haute
de
TSH
à
6mUI/L
est
de
5%
mais
respectivement
7,5%
et
2,8%
chez
les
femmes
et
chez
les
hommes
(16).
Dans
l’état
du
Colorado,
cette
prévalence
en
1995,
était
de
9%
dans
une
population
générale
âgée
de
plus
de
18ans,
composée
de
25862
volontaires
et
pour
une
TSH
limite
haute
de
5,1
mUI/L
(17).
Toujours
aux
Etats-‐Unis,
une
grande
étude
NHANES
III,
réalisée
dans
tout
le
pays
et
menée
de
1988
à
1994,
chez
17353
sujets,
estimait
la
prévalence
à
4,3%
pour
un
seuil
haut
de
TSH
à
4,5
mUI/L,
avec
respectivement
5,8%
et
3,4%
chez
les
femmes
et
chez
les
hommes
(18).
Nous
remarquons
alors
que
la
prévalence
varie
d’abord
avec
le
seuil
de
TSH
choisi,
en
effet
si
pour
une
même
population
le
seuil
de
TSH
est
abaissé
la
prévalence
augmente.
Nous
observons
aussi
que
la
prévalence
est
toujours
plus
élevée
chez
les
femmes
que
chez
les
hommes.
Cette
différence
entre
genres
n’est
pas
clairement
définie,
cela
dépendrait
peut
être
des
antécédents
thyroïdiens
et
de
la
pathologie
thyroïdienne
sous
jacente,
ou
encore
de
la
présence
d’anticorps,
plus
fréquents
chez
la
femme.
4.2.
Prévalence
selon
l’origine
ethnique
L’origine
ethnique
est
aussi
un
facteur
de
variation
de
la
prévalence.
Dans
l’étude
NHANES
III,
la
prévalence
de
l’hypothyroïdie
fruste
est
de
4,3%
dans
la
population
totale,
mais
en
classant
les
sujets
par
leur
origine
celle-‐ci
diffère
(18).
Chez
les
américains
blancs
non
hispanique
la
prévalence
est
de
4,8%,
chez
les
américains
noirs
18
WILLOT
(CC BY-NC-ND 2.0)Vous pouvez aussi lire