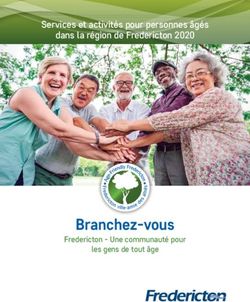Guide sur les Indicateurs de qualité dans l'Alphabétisation et l'Education des Adultes - ISESCO
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Guide sur les Indicateurs
de qualité dans
l’Alphabétisation
et l’Education des Adultes
Aly Abdoulaye NIANG
Organisation islamique pour l’Eduation, les Sciences et la Culture -ISESCO-
1438 H - 2017Dépôt légal : 2017MO1812 ISBN : 978-9981-26-635-3 Photocomposition, montage et impression : ISESCO Rabat - Royaume du Maroc
S ommaire
PREFACE ................................................................................................................................. 7
SIGLES ET ACRONYMES ................................................................................................. 11
INTRODUCTION .............................................................................................................. 13
PREMIER CHAPITRE : Clarification conceptuelle des indicateurs en alphabé-
tisation et éducation des adultes ......................................... 15
DEUXIEME CHAPITRE : Évaluation de la qualité dans l’alphabétisation et
l’éducation des adultes ..................................................... 21
2.1 Mesure de la qualité dans l’alphabétisation et l’éducation des adultes : pourquoi ? .. 23
2. 2 Mesure de la qualité dans l’alphabétisation et l’éducation des adultes : par qui ? ........ 24
2. 3 Aperçu de quelques politiques de qualité dans l’alphabétisation et l’éducation des
adultes ...............................................................................................................................
25
TROISIEME CHAPITRE : Elaboration des indicateurs de qualité dans l’alphabé-
tisation et l’éducation des adultes ........................................ 29
3. 1 Indicateurs de qualité pour l’évaluation des politiques et programmes dans
l’alphabétisation et l’éducation des adultes ............................................................ 31
3. 2 Indicateurs de qualité pour le pilotage et la maîtrise des processus ................. 38
3. 3 Dimensions d’un processus ou d’un dispositif de formation ................................ 55
3. 4 Indicateurs de qualité pour l’évaluation des compétences et des impacts
d’une formation en alphabétisation et éducation des adultes .......................... 59
QUATRIEME CHAPITRE : Paramètres d’évaluation dans l’alphabétisation et
l’éducation des adultes ................................................. 73
4. 1 Paramètres d’appréciation des compétences des apprenants ............................. 75
4. 2 Paramètres d’appréciation des ressources matérielles (RM) ............................... 76
-5-4. 3 Paramètres d’appréciation des ressources financières (RF) ............................... 81
CINQUIEME CHAPITRE : Management de la qualité dans l’alphabétisation et
l’éducation des adultes ................................................. 85
BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................. 97
LISTE DES TABLEAUX ................................................................................................... 103
-6-Préface
Le “ Guide sur les indicateurs de qualité dans l’alphabétisation et l’éducation
des adultes ” s’inscrit dans la politique de l’Organisation islamique pour
l’Education, les Sciences et la Culture (ISESCO) en matière d’amélioration
de la qualité de l’éducation dans les Etats membres.
A ce titre, il se situe dans le cadre de la dynamique des efforts déjà déployés par
l’Organisation en vue d’améliorer la qualité et la pertinence de l’enseignement
supérieur, à travers le « Guide pour l’évaluation et l’amélioration de la qualité des
universités du Monde islamique » assorti des indicateurs-clés de performance.
En fait, la qualité dans l’éducation est un paramètre essentiel pour assurer
l’épanouissement, l’autonomisation ainsi que le développement durable
des sociétés. Elle suit une certaine dynamique et permet d’améliorer les
rendements interne et externe du système éducatif.
Ceci étant, une importance particulière doit être accordée à l’aspect qualité de
l’éducation, attirant par ailleurs les apprenants dans les centres d’enseignement/
apprentissage et les y maintenant. Dans un monde aujourd’hui en pleine
mutation, les pays qui ont atteint un développement socioéconomique fulgurant
sont ceux qui ont intégré la qualité au cœur de leur système éducatif.
Dans ce sens, considérant l’alphabétisation et l’éducation des adultes comme
une des clés de voûte du développement socioéconomique du Monde
islamique, à travers ce guide, l’Organisation vise à cerner les dimensions
essentielles de la qualité dans ce sous-secteur de l’éducation tant sur les
plans politique, matériel, financier que pédagogique. En fait, force est de
reconnaître que ces faisceaux d’éléments concourent à l’atteinte de la qualité.
Aussi est-il indispensable de les cerner pour insuffler une nouvelle dynamique
aux pratiques en cours.
En effet, durant des décennies, le sous-secteur de l’alphabétisation et de
l’éducation des adultes a souffert d’un manque criard d’indicateurs variés
et pertinents permettant d’évaluer la qualité des programmes et d’assurer
une certaine visibilité aux multiples actions menées. Ainsi, il était difficile
d’appréhender l’impact considérable de cette modalité d’éducation sur
l’amélioration des conditions de vie des communautés. Une telle situation a
d’ailleurs longtemps plaidé en défaveur du sous-secteur de l’alphabétisation et
-7-de l’éducation non formelle auprès des partenaires techniques et financiers.
Partant, il s’est avéré nécessaire d’y mettre au point des indicateurs de
qualité permettant de cerner le processus et les différentes actions menées.
Ainsi, les Etats et les Organisations internationales ont fourni des efforts pour
élaborer ces indicateurs en vue de cerner le fonctionnement et l’impact de
l’alphabétisation et l’éducation des adultes.
Dans ce sillage, à travers le présent guide, l’ISESCO voudrait mettre à
la disposition des formateurs, des acteurs locaux, des prestataires de
formation, des évaluateurs ainsi que des partenaires au développement, un
ouvrage de référence qui met en évidence les instruments indispensables
dont ils doivent disposer comme intrants et comment s’en servir pour
améliorer l’enseignement/apprentissage ainsi que le management dans
l’alphabétisation et l’éducation des adultes.
Après une explication des concepts-clés dans le sous-secteur de l’alpha-
bétisation et de l’éducation des adultes, le guide présente l’importance de la
mesure de la qualité dans ce sous-secteur, ainsi que les acteurs responsables
de cette mesure puis les politiques de qualité dans le domaine. Un accent
particulier est mis sur les indicateurs de qualité pour l’évaluation des politiques
et programmes, le pilotage et la maîtrise des processus, les dimensions d’un
dispositif de formation, l’évaluation des compétences et des impacts d’une
formation. Ces différents indicateurs d’une extrême importance constituent la
“clé de voûte” dont doit disposer tout acteur intervenant dans l’alphabétisation et
l’éducation des adultes et soucieux de la qualité du processus d’enseignement/
apprentissage. Le guide examine aussi les paramètres d’appréciation des
compétences des apprenants, ceux d’appréciation des ressources matérielles
et ressources financières. Le guide présente en dernier lieu le management de la
qualité dans l’alphabétisation et l’éducation des adultes, en précisant les qualités
souhaitables du formateur, les compétences managériales des acteurs du sous-
secteur puis quelques points clés des normes ISO de qualité de la formation.
La présente publication se veut donc un instrument de renforcement de l’action
de l’ISESCO pour la promotion d’une alphabétisation et d’une éducation
des adultes de qualité. Elle se situe dans le sillage de « La nouvelle vision
de l’ISESCO en matière d’alphabétisation » et intéresse sans distinction
aucune, tous les intervenants opérant dans ce domaine et vise à améliorer
leurs actions et à rehausser l’efficacité et l’efficience du sous-secteur.
Cependant, dans la pratique, il convient aux utilisateurs du présent guide de
tenir compte du contexte local par rapport à certaines spécificités culturelles,
sociales et économiques.
-8-Puisse le Tout-Puissant couronner de succès nos actions visant à faire
rayonner l’alphabétisation et l’éducation des adultes à travers des programmes
de qualité.
Dr Abdulaziz Othman Altwaijri
Directeur général de
l’Organisation islamique pour l’Education,
les Sciences et la Culture
(ISESCO)
-9-S igles et Acronymes
ADEA Association pour le Développement de l’Education en Afrique
AEA Alphabétisation et Education des Adultes
AGR Activités Génératrices de Revenus
APC Approche par Compétences
BFEM Brevet de Fin d’Etudes Moyennes
BREDA Bureau Régional de l’Education en Afrique/ Bureau de l’UNESCO à Dakar
CAC Centre d’Apprentissage Communautaire
CEBNF Centre d’Éducation de Base Non Formelle
CFCEP Centre de Formation Continue et d’Education Permanente
CNRE Centre National de Ressources Educationnelles
CONFEMEN Conférence des Ministres de l’Éducation des Etats et gouvernements de
la Francophonie
CONFINTEA Conférence Internationale sur l’Education des Adultes
CTF Centre d’enseignement Technique Féminin
DEF Diplôme de fin d’Etudes Fondamentales
EFA Education For All (Education Pour Tous)
ECB École Communautaire de Base
ENF Éducation Non Formelle
EPT Education Pour Tous
EQPT Education de Qualité Pour Tous
GAR Gestion axée sur les résultats
GIE Groupement d’Intérêt Economique
GIQ-AEA Guide sur les Indicateurs de Qualité dans l’Alphabétisation et l’Education
des Adultes
GRIFED Groupe de Recherche Interdisciplinaire en Formation des Enseignants et
en Didactique
ISESCO Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization (Organisation
islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture)
IIPE Institut International de Planification de l’Education
ISO International Standard Organisation
LAMP Literacy Assessment and Monitoring Programme (Programme d’évaluation
et de suivi de l’alphabétisation)
LEM Laboratoire d’Enseignement Multimédia de l’Université de Liège
- 11 -LLECE Latin American Laboratory for Assessment of the Quality of Education
(Réseau des systèmes éducatifs nationaux des pays d’Amérique latine et
des Caraïbes)
OCB Organisation Communautaire de Base
OCDE Organisation de Coopération et de Développement Economique
ODD Objectifs de Développement Durable
OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement
ONG Organisation Non Gouvernementale
PASEC Programme d’Analyse des Systèmes Educatifs de la CONFEMEN
PDDEB Plan Décennal de Développement de l’Éducation de Base au Burkina Faso
PDEF Programme Décennal de l’Éducation et de la Formation (du Sénégal)
PIAAC Programme for the International Assessment of Adult Competencies (Pro-
gramme pour l’Evaluation Internationale des Compétences des Adultes)
PME Petite et Moyenne Entreprise
PRODEC Programme Décennal de Développement de l’Éducation (du Mali)
PTF Partenaires Techniques et Financiers
RA Recherche-action
RAMAA Recherche-Action sur la Mesure des Apprentissages des bénéficiaires
des programmes d’Alphabétisation
RF Ressources Financières
RM Ressources Matérielles
SACMEQ Southern and Eastern Africa Consortium for Monitoring Educational Qua-
lity
SIM/ENF Système d’Information pour le Management de l’Education Non Formelle
UIL UNESCO Institute for Lifelong Learning (Institut de l’UNESCO pour l’ap-
prentissage tout au long de la vie)
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organi-
sation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture)
UPT Université Pour Tous
VAE Validation des Acquis de l’Expérience
- 12 -I ntroduction
Le Guide sur les Indicateurs de Qualité dans l’Alphabétisation et l’Education
des Adultes,GIQ-AEA en acronyme, est une contribution de l’Organisation
islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ISESCO) à la quête
croissante de la qualité dans les systèmes éducatifs des Etats membres. Il est
conçu spécifiquement pour l’alphabétisation et l’éducation des adultes (AEA).
Le développement durable auquel aspirent les communautés du monde
islamique dépend en grande partie de ce sous-secteur dont les politiques
et programmes ne peuvent être efficaces et efficients sans l’existence
d’indicateurs de qualité permettant de jauger la valeur des actions entreprises.
C’est dans ce sens que le GIQ-AEA vient élargir la gamme d’instruments de
qualité que l’ISESCO met à la disposition des Etats membres.
En fait, le monde aspire à plus de paix, de démocratie et de développement
durable. Il a besoin d’une transformation positive profonde et le passage
obligé pour y parvenir demeure l’éducation de qualité, en particulier celle des
jeunes et des adultes.
En produisant ces indicateurs de qualité, l’ISESCO entend participer au
“renforcement des capacités éducatives des États membres”. Tout comme le
Guide pour l’évaluation et l’amélioration de la qualité dans les universités du
Monde islamique assorti des indicateurs clés de performance, le GIQ-AEA
est un outil de référence à la disposition des éducateurs et formateurs en
alphabétisation et éducation des adultes. Il devra contribuer à l’amélioration
de l’impact des projets et programmes d’alphabétisation et d’éducation des
adultes sur les plans socioéconomique et culturel, dans une perspective
inclusive, tenant compte des populations vulnérables et marginalisées,
conformément à l’esprit de l’Alliance mondiale pour l’alphabétisation dans le
cadre de l’apprentissage tout au long de la vie.
Le GIQ-AEA est un instrument de suivi-évaluation, un outil de référence pour
la quête de qualité. Il a pour but d’orienter le choix des utilisateurs sur ce
qu’est la qualité dans les programmes d’AEA.
Dans le GIQ-AEA, l’accent est mis sur comment repérer les intrants de qualité
dans les contenus des programmes et les activités de développement qui les
accompagnent et comment s’en servir pour améliorer les apprentissages. Le
guide donne des indications pour mieux concevoir, mettre en œuvre, suivre et
- 13 -évaluer les actions d’alphabétisation et d’éducation des adultes, avec l’unique
préoccupation d’impacter positivement sur les bénéficiaires.
Au-delà des évaluateurs, les indicateurs sont destinés à l’ensemble des
intervenants dans la chaîne de formation des programmes d’AEA, qu’ils soient
décideurs politiques, acteurs locaux, formateurs (universitaires, techniciens des
ministères et services déconcentrés), prestataires de formation, partenaires
au développement.
Le guide comporte cinq chapitres qui se complètent et se focalisent tous sur
le facteur qualité de l’AEA. Le premier clarifie certains concepts en usage dans
le sous-secteur. Le deuxième présente l’évaluation de la qualité dans l’AEA.
Ce deuxième chapitre met l’accent sur les aspects suivants : qui fait quoi en
termes d’évaluation ? Pourquoi ? Pour qui ? Quelles sont les pratiques en
cours dans plusieurs pays ? Dans le troisième, des types d’indicateurs de
qualité ainsi que la manière de les utiliser sont spécifiés. Le quatrième chapitre
traite des paramètres d’évaluation dans l’AEA et enfin dans le dernier chapitre,
le management de la qualité y est analysé.
Le GIQ-AEA peut être utilisé de façon itérative en effectuant des va-et-vient
entre les chapitres, un processus qui n’exclut pas le recours à d’autres outils
ou manuels complémentaires.
- 14 -Premier Chapitre :
Clarification conceptuelle
des Indicateurs en Alphabétisation
et Education des AdultesPour une meilleure compréhension et une meilleure exploitation du contenu
du guide, il s’avère nécessaire de définir les concepts dont l’usage y est
récurrent. L’alphabétisation et l’éducation des adultes (AEA), bien que
relevant du domaine de l’éducation dans beaucoup de pays, plus précisément
de l’éducation non formelle (ENF), ne bénéficient pas souvent du même
traitement que les autres secteurs, surtout dans son volet évaluation. Les
termes qui y sont utilisés méritent d’être contextualisés afin de correspondre
exactement aux représentations que les usagers sont supposés en avoir.
Pour une meilleure appropriation du contenu du guide, les termes usuels ci-
après font l’objet de définitions et/ou d’explicitations suivantes :
Acquis des apprentissages : tout ce qu’un apprenant sait, comprend et est
en mesure de faire à l’issue d’un processus d’apprentissage.
Alphabétisme fonctionnel : capacité d’un individu à lire et à écrire pour
exécuter les activités de la vie courante et réaliser les tâches liées à un emploi.
Certification des apprentissages : c’est le processus par lequel les résultats
d’une évaluation des apprentissages sont sanctionnés par la délivrance
d’attestations ou de certificats dûment établis par une autorité compétente.
Cohérence : c’est l’adéquation entre les objectifs d’une intervention, les
ressources allouées et les activités prévues pour atteindre des effets (cohérence
interne). L’adéquation peut porter sur la construction de l’intervention elle-
même ou d’autres interventions visant les mêmes effets (cohérence externe).
Compétence : la compétence indique un niveau satisfaisant de ressources
(connaissances, aptitudes et attitudes) et la capacité à les mobiliser en
combinatoires pour la réalisation d’actions ou activités dans des situations
différentes.
Conformité : appréciation permettant de vérifier le niveau de respect de
la bonne réalisation d’un produit attendu, d’une activité planifiée ou d’une
pratique professionnelle requise.
Critère : c’est un ou des éléments d’appréciation qu’on détermine pour savoir
si un résultat attendu est atteint ou pas. C’est la base du jugement évaluatif,
un angle de vue adopté par des acteurs pour apprécier une intervention.
Effet : c’est un changement observé, attendu ou non, consécutif à une
intervention directe ou indirecte sur le milieu, attribuable à une action portant
- 17 -sur une acquisition de connaissances, une amélioration des compétences,
une modification de comportement, etc. L’effet est identifiable à court ou
moyen terme.
Efficacité : appréciation de la réalisation des objectifs d’une intervention en
comparant les résultats obtenus (effets) imputables à cette intervention aux
résultats attendus.
Efficience : rapport entre les ressources mises en œuvre et les effets d’une
intervention. Ce critère est étroitement lié à l’efficacité. Une intervention est
efficiente quand elle est efficace et est à moindre coût.
Évaluation : au sens général du terme, l’évaluation est un ensemble d’activités
permettant de mesurer le degré d’atteinte d’un résultat ou de porter un
jugement de valeur sur un être, un objet ou une activité.
Évaluation certificative : c’est une évaluation qui débouche sur une décision
d’acceptation ou de refus d’un niveau de compétence donné, ou sur la
délivrance d’une attestation ou d’un certificat.
Faire-faire : le faire-faire est une option qui consiste à partager les rôles
et les responsabilités de l’éducation entre les États et leurs partenaires,
particulièrement dans le sous-secteur de l’éducation non formelle où le partage
se fait avec la société civile, les organisations professionnelles et patronales
(les chambres de métiers, de commerce, d’industrie et d’artisanat), le secteur
privé et le secteur dit informel à travers les organisations de femmes, de
jeunes, etc. Dans cette répartition de rôles et de responsabilités, l’État a un
rôle d’orientation, de planification, de pilotage, de concertation, la société
civile est responsable de la livraison des programmes aux communautés selon
un système de contractualisation et le privé (les partenaires techniques et
l’informel) apportent leurs appuis financiers et matériels pour plus de qualité
dans la professionnalisation, plus d’autonomisation dans la production de
biens et de richesses susceptibles de faire reculer l’analphabétisme.
Impact : c’est le dernier maillon de la chaîne des résultats, l’impact est
constitué de l’ensemble des effets, à long terme, exclusivement attribuables
à une action de développement sur les bénéficiaires finaux. Il concerne les
changements observés dans leur bien-être.
Indicateur : c’est une donnée quantitative ou descriptive (individuelle ou
composite) qui, confrontée à un critère, informe sur l’état et/ou l’effet d’une
action, d’un évènement ou d’une évolution.
- 18 -Intrant : c’est une ressource utilisée pour réaliser une action ou une activité
en vue d’atteindre des objectifs préalablement établis. Cette ressource peut
être matérielle, humaine et financière. Elle peut être également un processus
(planification, méthodes, approches, stratégies, style d’enseignement…)
ou un ensemble de stimuli (motivation, développement de l’environnement
lettré…). L’intrant est un facteur de qualité. Dans le domaine de l’éducation,
les intrants peuvent être pédagogiques (programmes d’enseignements,
matériels) ou didactiques (formation des formateurs et autres acteurs, etc.).
Opérateur : c’est le prestataire de formation. Dans ce guide, nous emploierons
indifféremment les deux termes pour ce même acteur. Il peut être une
organisation non gouvernementale (ONG), une association, un groupement
d’intérêt économique (GIE), une fédération, etc. avec une existence juridique
et une expérience en conduite de programmes d’éducation non formelle. Dans
les programmes d’AEA qui ont opté pour le faire-faire, l’État contractualise
avec les opérateurs pour la mise en œuvre de sa politique de formation.
Paramètre : c’est un élément d’appréciation sur lequel on s’appuie pour
juger certains faits. Il rentre en compte dans la résolution d’un problème, la
description d’un phénomène, etc.
Qualité de l’éducation : c’est l’ensemble des éléments qui permettent
d’apprécier positivement un système éducatif. La qualité de l’éducation est
par définition ce qui rend les études agréables, mais également ce qui permet
d’obtenir de bons résultats.
Référentiel : c’est un système de repérage qui permet de situer un évènement
dans l’espace et dans le temps ou un inventaire d’actes ou de compétences
nécessaires à l’exercice d’une activité.
- 19 -Deuxième Chapitre :
Évaluation de la Qualité dans
l’Alphabétisation et l’Éducation
des AdultesL’évaluation de la qualité est l’un des principaux défis à relever dans les systèmes
éducatifs, particulièrement dans le sous-secteur de l’AEA. Dans l’éducation
formelle, des évaluations standardisées et comparées sont réalisées et largement
diffusées. Des programmes sont mis en place à cet effet pour apprécier la
performance des systèmes éducatifs des pays membres à travers les résultats
des élèves surtout pendant le cycle du primaire. C’est le cas du Southern and
Eastern Africa Consortium for Monitoring Educational Quality (SACMEQ), du
Programme d’Analyse des Systèmes Educatifs de la CONFEMEN (PASEC),
du réseau des systèmes éducatifs nationaux des pays d’Amérique latine et des
Caraïbes appelé Latin American Laboratory for Assessment of the Quality of
Education (LLECE), pour ne citer que ces exemples.
Il en va autrement pour l’AEA souvent traité en parent pauvre dans ces
programmes. Les évaluations qui sont faites dans ce sous-secteur sont en
grande partie des “clones” de ce qui se fait dans le formel.
2.1 Mesure de la qualité dans l’alphabétisation et
l’éducation des adultes : pourquoi ?
Mesurer la qualité dans l’éducation, c’est comparer des résultats d’un processus
de formation à des référents initialement identifiés. La mesure de la qualité concerne
les apprenants, les communautés (à travers les collectivités locales), les politiques
(les États et leurs démembrements) et les partenaires au développement. On peut
bien se poser la question sur l’utilité de mesurer la qualité de la formation pour des
cibles aussi diverses que celles de ce sous-secteur.
Pourtant la mesure de la qualité trouve ici toute sa pertinence en ce sens qu’elle
rend compte du niveau de satisfaction dans la conduite d’un programme et
permet à chaque acteur de se situer par rapport à l’action de formation.
Dans l’AEA, les apprenants des programmes de formation sont des enfants
et jeunes non scolarisés ou déscolarisés, parfois à besoins spécifiques et
des adultes en quête de compétences pour un changement leur permettant
de s’autonomiser et de se développer durablement.
La mesure de la qualité permet de sélectionner par exemple dans le contexte de
passerelles où les apprenants enfants du non formel doivent intégrer le formel au
vu de leurs âges, ou tout simplement de valider la formation professionnalisante
des jeunes déscolarisés dont l’âge ne leur permet pas de réintégrer le système
- 23 -formel. Chez les adultes, elle permet de valider les compétences acquises des
apprentissages dans un parcours de professionnalisation.
Chez les enfants et jeunes non scolarisés ou déscolarisés tout comme chez les
adultes, la mesure de la qualité constitue une ressource pour la motivation et un
outil d’aide dans l’apprentissage tout au long de la vie, dans la prise de conscience
des performances pour s’en servir, dans le repérage des risques susceptibles
d’interférer négativement dans le processus de professionnalisation.
Dans les pays où la décentralisation est de mise et l’éducation une
compétence décentralisée, la mesure de la qualité est un moyen pour
les collectivités locales, d’analyser les dysfonctionnements des projets,
l’évolution des métiers et des emplois, les évolutions culturelles… par rapport
à des situations concrètes ou à des référentiels. Les collectivités peuvent
s’en servir dans l’identification de la demande en AEA pour l’élaboration de
leurs politiques de développement local.
Les États s’en servent pour évaluer leurs systèmes, les structures d’accueil,
les dispositifs, afin de mieux formuler leurs politiques et stratégies pour
atteindre leurs objectifs en matière d’alphabétisme et plus généralement en
termes de développement humain durable. Les formateurs tout comme les
chargés du suivi, évaluent pour connaître les progrès et les performances
des apprenants et le niveau d’atteinte des objectifs fixés.
Aux partenaires techniques et financiers (PTF) et à la société civile (ONG,
associations, sociétés de développement…), la mesure de la qualité permet
d’avoir des repères sur le niveau d’atteinte des objectifs de développement
auxquels les Etats ont souscrit. Ils y trouvent un moyen efficace pour analyser
et apprécier le niveau de transformation sociale suite à la mise en œuvre de
programmes de formation, et un moyen pour apprécier le niveau de respect
des engagements des acteurs.
2.2 Mesure de la qualité dans l’alphabétisation et
l’éducation des adultes : par qui ?
La plupart des États assuraient tout le processus d’évaluation à travers leurs
services d’éducation (alphabétisation et éducation non formelle) qui concevaient,
exécutaient et évaluaient les programmes de formation. Avec l’avènement de la
stratégie du « faire-faire » à partir des années 1990-2000, en général, il y a eu
une redistribution des rôles et responsabilités. Dans un premier temps, le type
de formation utilisé était l’alphabétisation de base centrée sur les connaissances
- 24 -instrumentales des cibles. Cette pratique a évolué en alphabétisation
fonctionnelle avec des offres éducatives basées sur les activités professionnelles
et les objectifs poursuivis par les apprenants. Actuellement, avec les mutations
socioéconomiques, la demande éducative exige plus d’apprentissages
professionnalisants avec plus de formations « sur mesure ».
La mise en œuvre des programmes de formation fait alors intervenir plusieurs
acteurs dans la détermination des spécifications (définition des politiques,
objectifs, organisation, progression, évaluation). L’élaboration de cahiers de
charges spécifiques à ceux qui programment et conduisent les formations est
devenue une exigence.
Les États mettent en place des cadres normatifs (lois et textes réglementaires)
et des dispositifs de formation dans lesquels ils se réservent la définition des
politiques, le suivi évaluation et laissent aux opérateurs la mise en œuvre des
actions de formation sur le terrain.
Les dispositifs comprennent une partie administrative composée des services
centraux et déconcentrés de l’État et une partie décentralisée qui comprend
les collectivités locales correspondantes.
Du service central au centre d’alphabétisation, à chaque étape, il y a une
entité désignée responsable de l’évaluation. Les services centraux mettent
en place des structures (Directions, Services, Divisions, Bureaux, …) qui
définissent les standards ; les services déconcentrés organisent, coordonnent,
supervisent les opérations et produisent des rapports ; le formateur local fait
des évaluations formatives et sommatives.
Les problèmes d’évaluation ne peuvent être résolus correctement que s’ils sont
traités dès la conception des actions de formation. Il faut donc associer les
différents acteurs à tous les niveaux du processus, ce qui n’est toujours pas le cas
pour les collectivités locales. Dans les évaluations des acquis des bénéficiaires,
elles sont présentes en tant que cibles mais rarement en tant qu’initiatrices
ou parties prenantes de l’action. Il faut alors repenser leur implication dans le
dispositif de manière à ce que l’initiative d’évaluer puisse émaner d’elles-mêmes.
2.3 Aperçu de quelques politiques de qualité dans
l’alphabétisation et l’éducation des adultes
Les années 2000 ont coïncidé un peu partout dans le monde et particuliè-
rement en Afrique, avec des réformes des systèmes nationaux d’éducation et
- 25 -de formation. La plupart de ces réformes sont toujours en cours et concernent,
en plus de la stratégie du « faire-faire », l’Approche par Compétences (APC)
le plus souvent en situation de bilinguisme, la gestion axée sur les résultats
(GAR) puis l’élaboration et la mise en œuvre des curricula. C’est le cas,
entre autres, du Plan Décennal de Développement de l’Éducation de Base
(PDDEB) au Burkina Faso, du Programme Décennal de Développement de
l’Éducation (PRODEC) au Mali, du Programme Décennal de l’Éducation et
de la Formation (PDEF) au Sénégal…
L’évolution des pratiques témoigne du souci permanent que les pays ont de mettre
de la qualité dans l’AEA. Les acteurs explorent en permanence des voies pour
accéder au développement endogène durable par la mise en place de politiques
de qualité. Des programmes éducatifs qui font une large place à des approches
transformatrices et émancipatrices sont proposés à l’image des Centres
d’Apprentissage Communautaires (CAC) -Ganokendra- au Bangladesh, et des
Universités pour tous (UPT) ou Universités populaires du Maroc.
Dans la plupart des programmes, les concepteurs ont basé leurs travaux sur
trois facteurs : l’accès, la qualité et la gestion.
A ce titre, des curricula tenant compte du genre, de la croissance inclusive, du
multiculturalisme, de l’intégration… sont disponibles ou en cours d’élaboration.
De même, des sommets de haut niveau sont organisés pour promouvoir la qualité
du sous-secteur, au nombre desquels on peut mentionner les Conférences
statutaires des Ministres de l’Education des Etats membres de l’ISESCO, les
Conférences internationales sur l’Education des Adultes (CONFINTEA), les
Triennales de l’Association pour le Développement de l’Education en Afrique
(ADEA), les Forums mondiaux de l’UNESCO sur l’Education, etc.
En outre, des documents de référence de qualité sont produits dans
les langues d’enseignement (officielles et nationales) : documents de
programmes, référentiels, guides, manuels, etc. Toutefois, ces documents ne
sont pas toujours produits en quantité suffisante et largement diffusés.
Certains pays se sont unis pour mettre en place un Système de Management
de l’Education Non Formelle (SIM-ENF) en vue de disposer pour le secteur
de l’éducation non formelle d’un système d’information pour la mesure, le
suivi et l’évaluation de l’apprentissage. Par ailleurs, la RAMAA (Recherche-
action sur la mesure des apprentissages des bénéficiaires des programmes
d’alphabétisation) lancée à l’initiative de l’Institut de l’UNESCO pour
l’apprentissage tout au long de la vie (UIL), et pilotée en partenariat avec le
Bureau de l’UNESCO Abuja, le Bureau de l’UNESCO Dakar et les ministères
- 26 -de l’éducation des pays participants, et l’accompagnement de la Coopération
Suisse, répond au besoin vital de l’éducation non formelle de disposer d’un
système de qualité de mesure, de suivi et d’évaluation, qui renseigne sur
les niveaux d’alphabétisme réellement acquis par les apprenants, et met en
évidence les difficultés rencontrées et les stratégies efficaces.
Dans sa première phase (2011-2014), la RAMAA a associé cinq pays, à
savoir le Burkina-Faso, le Mali, le Maroc, le Niger et le Sénégal. Actuellement,
elle est à sa deuxième phase avec sept autres pays qui se sont joints aux
cinq premiers. Il s’agit du Bénin, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, de la
République Centrafricaine (RCA), de la République démocratique du Congo
(RDC), du Tchad et du Togo.
Il faut noter que la RAMAA s’inspire de diverses bonnes pratiques identifiées
dans des enquêtes internationales sur la mesure de l’alphabétisme des
jeunes et des adultes hors systèmes scolaires, notamment le Programme
d’évaluation et de suivi de l’alphabétisation (LAMP) de l’Institut de l’UNESCO
de statistique, le Programme pour l’évaluation internationale des compétences
des adultes (PIAAC) de l’Organisation de coopération et de développement
économique (OCDE), etc.
Les leçons tirées des différentes expériences font souvent état d’insuffisances
dans l’harmonisation des pratiques et la standardisation des outils, d’où la
nécessité de renforcer les initiatives visant à redynamiser les mesures de
qualité dans ce sous-secteur de l’éducation.
- 27 -Troisième Chapitre :
Élaboration des Indicateurs de
qualité dans l’Alphabétisation et
l’Éducation des AdultesLes systèmes éducatifs formels disposent d’indicateurs, même si dans
les pays en voie de développement, leur fiabilité est souvent sujette à des
débats. L’élaboration des indicateurs de qualité dans l’éducation exige deux
préalables : la mise en place de systèmes d’information fiables, exploitables
et exhaustifs et de plans de développement de l’éducation.
S’agissant des systèmes d’information, rares sont les Etats membres qui
en disposent pour l’éducation non formelle. S’ils en disposent, ce sont des
systèmes qui ne renseignent pas efficacement sur le sous-secteur. L’absence
de ces systèmes d’information se traduit par un manque notoire de données
statistiques fiables dans l’alphabétisation et l’éducation des adultes pourtant
indispensables dans toute démarche efficace d’évaluation.
Le plan de développement de l’éducation s’alimente des informations
disponibles dans le système. Ces informations doivent être plus étoffées et
mieux ciblées au niveau de l’éducation de base, notamment de l’alphabétisation
et l’éducation des adultes. En fait, des informations pertinentes permettant
de déterminer avec précision les besoins de la société et du marché du
travail conditionnent la qualité des apprentissages et les curricula doivent
tenir compte rigoureusement de leur interaction.
3.1 Indicateurs de qualité pour l’évaluation des politiques
et programmes dans l’alphabétisation et l’éducation
des adultes
Le cycle de vie habituel des programmes d’alphabétisation et d’éducation
des adultes va de l’identification des besoins à l’évaluation en passant par
les étapes intermédiaires de la planification et de la mise en œuvre. Pour
évaluer la qualité des politiques et programmes, les indicateurs généralement
utilisés par les acteurs sont de quatre types: des indicateurs de contexte, des
indicateurs de réalisation, des indicateurs de performance et des indicateurs
d’impact.
3.1.1 Indicateurs de contexte
Les indicateurs de contexte qualifient les situations socioéconomiques,
politiques ou environnementales (sanitaires, culturelles, professionnelles…)
dans lesquelles l’action intervient. Ils s’élaborent en termes de données
- 31 -chiffrées qui donnent l’image de l’état initial du programme et les tendances
globales que les décideurs souhaitent imprimer aux actions à l’issue
de l’intervention. Ils informent sur des variations pouvant découler de la
conjoncture et qui pourraient affecter les résultats escomptés, sans être
directement liées aux mesures déjà prises. Par exemple, une catastrophe
naturelle non prévue dans les risques peut affecter les résultats d’un
programme d’alphabétisation fonctionnelle avec des activités génératrices
de revenus.
3.1.2 Indicateurs de réalisation
Les indicateurs de réalisation décrivent ce qui est fait à la fin de la mise
en œuvre de programmes d’alphabétisation et d’éducation des adultes. Ces
indicateurs renseignent sur ce qu’on a fait des ressources consommées. Ils
sont formulés en données physiques pour tout ce qui peut être dénombré,
observé, décrit ou en unités monétaires, s’il s’agit de montants mobilisés
pour la réalisation d’une action.
3.1.3 Indicateurs de performance
Les indicateurs de performance renseignent sur l’atteinte des objectifs d’un
programme plus précisément sur les compétences acquises, l’évolution
des comportements ou le niveau des prestations des bénéficiaires. Dans
le cadre des programmes d’alphabétisation et d’éducation des adultes, ces
indicateurs rendent compte des effets directs et immédiats qu’un programme
a produits sur les bénéficiaires. Ils peuvent renseigner par exemple, sur le
nombre d’apprenants pouvant être considérés comme alphabétisés, c’est-à-
dire ayant atteint le profil attendu ou de sortie.
Du point de vue de l’UNESCO, est fonctionnellement alphabétisée
toute personne capable d’exercer toutes les activités pour lesquelles
l’alphabétisation est nécessaire dans l’intérêt du bon fonctionnement de son
groupe et de sa communauté et aussi pour lui permettre de continuer à lire,
écrire et calculer en vue de son propre développement et de celui de la
communauté. Dans le contexte de l’Alliance mondiale pour l’alphabétisation
dans le cadre de l’apprentissage tout au long de la vie, le champ de cette
définition a été élargi en y incluant les libertés humaines, en particulier
celles des populations vulnérables et marginalisées. En fait, le profil du
néo-alphabète est établi souvent par l’attribution de notes conformément à
une grille d’évaluation ou l’allocation de taux aux différentes compétences,
pour déterminer les seuils de réussite dans les disciplines instrumentales
- 32 -(langue et communication, mathématiques) et les thèmes transversaux ou
compétences de vie courante, selon le cas.
Les acteurs utilisent des grilles accompagnées d’autres outils pour évaluer
les compétences des apprenants. À titre d’exemples, le Mali applique la grille
suivante :
Tableau 1 : Grille d’évaluation des compétences en alphabétisation du Mali
COMPÉTENCES ACQUISES NIVEAUX
§ Savent lire, écrivent lisiblement, font les 4 opérations 1
§ Savent lire, écrivent lisiblement, font l’addition et la soustraction 2
§ Savent lire, écrivent lisiblement, maîtrisent la numération 3
§ Savent lire, écrivent lisiblement, ne maîtrisent pas la numération 4
§ Savent lire, n’écrivent pas lisiblement, font les 4 opérations 5
§ Savent lire, n’écrivent pas lisiblement, font l’addition et la soustraction 6
§ Savent lire, n’écrivent pas lisiblement, maîtrisent la numération 7
§ Savent lire, n’écrivent pas lisiblement, ne maîtrisent pas la numération 8
§ Ne savent pas encore lire, font les 4 opérations 9
§ Ne savent pas encore lire, font l’addition et la soustraction 10
§ Ne savent pas encore lire, maîtrisent la numération 11
§ Ne savent pas encore lire, ne maîtrisent pas la numération 12
Les auditeurs alphabétisés sont ceux dont les performances ont atteint les
trois premiers niveaux.
Le Niger dispose d’une grille de six niveaux organisée en trois groupes, à
l’inverse de celui du Mali, et l’indicateur de l’alphabétisé correspond aux deux
derniers.
- 33 -Tableau 2 : Grille d’évaluation des compétences en alphabétisation du Niger
COMPÉTENCES ACQUISES NIVEAUX
Groupe 1 : constitué de personnes analphabètes qui ne savent ni lire, ni écrire et ne comptent
par écrit que quelques lettres et chiffres. Il comprend les niveaux suivants : débutant, 1 et 2 de
l’échelle d’alphabétisation
§ Ne savent pas encore lire, ne maîtrisent pas la numération 0
§ Ne savent pas encore lire, maîtrisent la numération 1
§ Ne savent pas encore lire, font l’addition et la soustraction 2
Groupe 2: comprend des semi-alphabétisés capables de déchiffrer des phrases simples
(sans nécessairement en comprendre le sens) et d’écrire (ou plutôt de recopier) un texte
simple et faire des opérations mathématiques simples, d’utiliser les connaissances acquises à
des fins culturelles ou socioéconomiques. Ce groupe comprend les niveaux 3 et 4 de l’échelle
d’alphabétisation
§ Savent lire, écrivent lisiblement, ne maîtrisent pas la numération 3
§ Savent lire, écrivent lisiblement, maîtrisent la numération 4
Groupe 3: comprend des personnes qui ont un niveau de connaissance correspondant à une
scolarité de quatre ou cinq (5) ans d’études primaires considérées comme alphabétisées au
sens UNESCO du terme. Il comprend les niveaux 5 et 6 de l’échelle d’alphabétisation
§ Savent lire, écrivent lisiblement, font l’addition et la soustraction 5
§ Savent lire, écrivent lisiblement, font les 4 opérations 6
Le Sénégal est dans la même logique. Les indicateurs de performance y sont
déterminés par des grilles et des tests de niveaux, à la différence que ce pays
alloue les pourcentages suivants aux compétences pour déterminer le profil
de l’alphabétisé :
Tableau 3 : Grille d’évaluation des compétences en alphabétisation du Sénégal
Pourcentage Pourcentage
Types de compétences Domaine
du domaine total
Compétences instrumentales Langue et communication 50%
Mathématiques, sciences 80%
lecture, écriture et calcul 30%
et technologie
Compétences de vie courante Sciences humaines, arts
ou thèmes transversaux et développement de la 20% 20%
(fonctionnels) personne
Taux de réussite attendu Ensemble des domaines 75%
- 34 -Au Maroc, en alphabétisation, les compétences disciplinaires font référence
aux compétences de base qui englobent la compétence linguistique “ com-
muniquer en langue arabe ”, la compétence de résolution des problèmes
mathématiques “ utiliser le langage et les outils mathématiques ”, celle
relative à “ l’utilisation de la démarche et des modes d’explication de l’histoire
et de la géographie ” ainsi que la capacité “ d’exploiter des technologies de
l’information et de la communication ”.
Dans ce cadre, les indicateurs de performance relatifs à la compétence de
lecture sont présentés de la façon suivante :
- 35 -Tableau 4 : Grille d’évaluation des compétences de lecture au Maroc
Compétence disciplinaire : communiquer en langue arabe
LIRE EN LANGUE ARABE
Eléments de la Indicateurs Exemples d’activités
compétence
Maîtriser les · identifie les lettres et les - Exercice de comparaison
processus sons d’une phrase écrite et orale
élémentaires de · identifie les accents (hourouf - Exercice d’analyse de
lecture almad, alfatha, addamma, la disposition de textes
assoukoun, etc.) (paragraphes, titres, encadrés)
· associe sons et graphies ou de l’adresse sur une
enveloppe
· repère l’espace graphique
- Exercice de repérage de mots
· distingue les différentes courants
graphies des lettres de
l’alphabet (au début, au - Exercice sur les sigles, logos,
milieu ou à la fin du mot) pictogrammes (interdit de
fumer, interdit d’entrer, de jeter
· mémorise des formes des ordures, danger, etc.)
· reconnaît des mots usuels
· discrimine
· élargit le champ visuel
Construire du sens · choisit le mot exact - Activités d’association
correspondant à une image d’images et de mots
· choisit le sens exact entre - Mots de la même famille,
deux mots champs lexicaux
· choisit des informations - Activité d’entraînement
appropriées à l’acquisition de mots :
· identifie nature, fonction et comment les retrouver, les
sens de documents simples associer et les réutiliser en
du quotidien contexte
· élabore et vérifie des - Analyse de documents liés à
hypothèses l’identité, au logement (carte
d’identité, facture, etc.)
· reconnaît le sens d’énoncés
courts - Exercice sur le choix entre
trois solutions de légendes
données, à partir d’une image
LIRE EN LANGUE ARABE
Eléments de la Indicateurs Exemples d’activités
compétence
Structurer la lecture · s’approprie des modèles de - Exercice sur le sens donné
construction des phrases et à un texte choisi parmi trois
des textes solutions
· reconnaît le sens d’un texte
simple
- 36 -Vous pouvez aussi lire