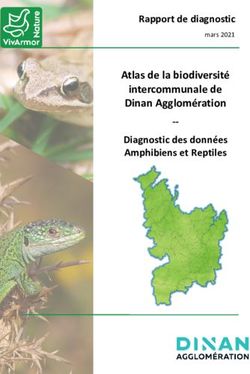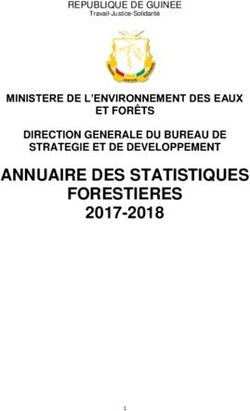Multiplication et valorisation horticole des plantes de forêt sèche indigènes à la Nouvelle-Calédonie - Rapport n 02/2011
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Multiplication et
valorisation horticole des
plantes de forêt sèche
indigènes à la Nouvelle-
Calédonie
Rapport n° 02/2011MULTIPLICATION ET VALORISATION HORTICOLE
DES PLANTES DE FORET SECHE INDIGENES A LA
NOUVELLE-CALEDONIE
Rapport de recherche
Hélène Udo sous l’encadrement de Gildas Gâteblé
Station de Recherche Agronomique de Saint Louis, Mont Dore
Février 2011
Convention IAC/PCFS de collaboration 2010 pour la protection, la restauration et la valorisation
des forêts sèches en Nouvelle-Calédonie n°19/2010/CP
Origine du financement :
Gouvernement de la Nouvelle-CalédonieSOMMAIRE
PARTIE 1 : CONTEXTE DE L’ETUDE ............................................................................................................................... 1
PARTIE 2 : PRESENTATION DES ESPECES ..................................................................................................................... 4
PRESENTATION GENERALE ................................................................................................................................................... 4
CERBERA MANGHAS VAR . MANGHAS .................................................................................................................................... 5
CLEIDION VERTICILLATUM ................................................................................................................................................... 7
E USTREPHUS LATIFOLIUS..................................................................................................................................................... 8
MELODINUS SCANDENS ...................................................................................................................................................... 9
OCHROSIA INVENTORUM .................................................................................................................................................. 10
PAVETTA OPULINA ........................................................................................................................................................... 12
PHYLLANTHUS SPP . .......................................................................................................................................................... 13
PITTOSPORUM SPP . .......................................................................................................................................................... 15
PREMNA SERRATIFOLIA ..................................................................................................................................................... 17
PSEUDERANTHEMUM VARIABILE ........................................................................................................................................ 18
PSYDRAX ODORATA .......................................................................................................................................................... 19
RHYSSOPTERIS TIMORIENSIS VAR TIMORIENSIS ..................................................................................................................... 20
VITEX TRIFOLIA VAR . TRIFOLIA ........................................................................................................................................... 21
PARTIE 3 : PROTOCOLE ET RESULTATS .......................................................................................................................22
LE MACRO-BOUTURAGE .................................................................................................................................................... 22
LE SEMIS ......................................................................................................................................................................... 24
LIEUX DE COLLECTE .......................................................................................................................................................... 24
RÉSULTATS DE MULTIPLICATION......................................................................................................................................... 26
Cerbera manghas .................................................................................................................................................... 26
Cleidion verticillatum ............................................................................................................................................... 28
Eustrephus latifolius ................................................................................................................................................ 29
Melodinus scandens ................................................................................................................................................ 30
Ochrosia inventorum ............................................................................................................................................... 31
Pavetta opulina ....................................................................................................................................................... 32
Phyllanthus conjugatus var. maaensis .................................................................................................................... 33Phyllanthus deplanchei ........................................................................................................................................... 34
Pittosporum cherrieri .............................................................................................................................................. 36
Pittosporum pancheri .............................................................................................................................................. 37
Premna serratifolia.................................................................................................................................................. 38
Pseuderanthemum variabile ................................................................................................................................... 39
Psydrax odorata ...................................................................................................................................................... 42
Rhyssopteris timoriensis var. timoriensis ................................................................................................................ 43
Vitex trifolia var. trifolia .......................................................................................................................................... 44
CONCLUSION .............................................................................................................................................................46
BIBLIOGRAPHIE..........................................................................................................................................................48
Liste des illustrations
Photos :
PHOTO 1 : CERBERA MANGHAS VAR. MANGHAS, PIED-MERE ............................................................................................................ 5
PHOTO 2 : CERBERA MANGHAS VAR. MANGHAS, FRUITS ET FEUILLES .................................................................................................. 6
PHOTO 3 : CLEIDION VERTICILLATUM, RAMEAUX NOIRS ................................................................................................................... 7
PHOTO 4 : CLEIDION VERTICILLATUM, DETAILS DES FEUILLES ............................................................................................................. 7
PHOTO 5 : EUSTREPHUS LATIFOLIUS, PORT GÉNÉRAL ....................................................................................................................... 8
PHOTO 6 : EUSTREPHUS LATIFOLIUS, DETAILS DES FRUITS ................................................................................................................. 8
PHOTO 7 : MELODINUS SCANDENS, DETAIL DES FLEURS ................................................................................................................... 9
PHOTO 8 : MELODINUS SCANDENS, PIED-MÈRE ............................................................................................................................. 9
PHOTO 9 : OCHROSIA INVENTORUM, PIED-MÈRE ......................................................................................................................... 10
PHOTO 10 : OCHROSIA INVENTORUM, DETAIL DES FRUITS .............................................................................................................. 11
PHOTO 11 : PAVETTA OPULINA, PIED-MÈRE ................................................................................................................................ 12
PHOTO 12 : PAVETTA OPULINA, DETAIL DE LA FLORAISON .............................................................................................................. 12
PHOTO 13 : PHYLLANTHUS CONJUGATUS VAR. MAAENSIS .............................................................................................................. 13
PHOTO 14 : PHYLLANTHUS DEPLANCHEI UTILISE EN AMENAGEMENT PAYSAGER .................................................................................. 14
PHOTO 15 : PITTOSPORUM CHERRIERI, FLORAISON....................................................................................................................... 15
PHOTO 16 : PITTOSPORUM PANCHERI, FLORAISON ....................................................................................................................... 16
PHOTO 17 : PREMNA SERRATIFOLIA, PIED-MÈRE .......................................................................................................................... 17
PHOTO 18 : PREMNA SERRATIFOLIA, DETAIL DE LA FLORAISON ........................................................................................................ 17
PHOTO 19 : PSEUDERANTHEMUM VARIABILE, DETAIL DE LA FLORAISON ............................................................................................ 18
PHOTO 20 : PSYDRAX ODORATA, PIED-MÈRE ............................................................................................................................... 19
PHOTO 21 : PSYDRAX ODORATA, DETAIL DE LA FLORAISON............................................................................................................. 19
PHOTO 22 : RHYSSOPTERIS TIMORIENSIS VAR. TIMORIENSIS, INDIVIDU SUR LA ROUTE DU FORT TEREKA................................................... 20
PHOTO 23 : VITEX TRIFOLIA VAR. TRIFOLIA, DETAIL DE LA FLORAISON ............................................................................................... 21
PHOTO 24 : PLAQUES, CELLULES ET SUBSTRAT UTILISE POUR LE MACRO-BOUTURAGE .......................................................................... 22
PHOTO 25 : CERBERA MANGHAS VAR. MANGHAS, BOUTURE RACINÉE .............................................................................................. 26
PHOTO 26 : EVOLUTION DES BOUTURES DE CERBERA MANGHAS, D'OCTOBRE A DECEMBRE .................................................................. 27
PHOTO 27 : EVOLUTION DES BOUTURES DE CLEIDION VERTICILLATUM, D'AOUT A DECEMBRE ................................................................ 28PHOTO 28 : EVOLUTION DES BOUTURES (A ET B) ET DES SEMIS (C ET D) D'EUSTREPHUS LATIFOLIUS, D'AOUT A DECEMBRE .......................... 29 PHOTO 29 : EVOLUTION DES BOUTURES D'OCHROSIA INVENTORUM, D'AOUT A DECEMBRE .................................................................. 31 PHOTO 31 : EVOLUTION DES BOUTURES DE PAVETTA OPULINA, D'OCTOBRE A DECEMBRE .................................................................... 32 PHOTO 30 : PAVETTA OPULINA, RESULTATS DE BOUTURAGE AVEC AIB 1% (A G.) ET CLONEX® (A D.) ..................................................... 32 PHOTO 32 : EVOLUTION DES BOUTURES DE PHYLLANTHUS CONJUGATUS VAR. MAAENSIS, D'OCTOBRE A NOVEMBRE ................................. 33 PHOTO 33 : BOUTURES RACINEES DE PHYLLANTHUS DEPLANCHEI AVEC L'HORMONE AIB 1% ............................................................... 35 PHOTO 34 : EVOLUTION DES BOUTURES DE PHYLLANTHUS DEPLANCHEI, D'OCTOBRE A DECEMBRE ......................................................... 35 PHOTO 35 : BOUTURES DE PITTOSPORUM CHERRIERI QUATRE MOIS APRES LE PREMIER REMPOTAGE ...................................................... 36 PHOTO 36 : EVOLUTION DES BOUTURES DE PREMNA SERRATIFOLIA, D'OCTOBRE A DECEMBRE .............................................................. 38 PHOTO 37 : PSEUDERANTHEMUM VARIABILE, BOUTURE RACINEE .................................................................................................... 39 PHOTO 38 : PSEUDERANTHEMUM VARIABILE, CROISSANCE EN POT .................................................................................................. 40 PHOTO 39 : PSEUDERANTHEMUM VARIABILE, APPARITION DE PLANTULES ......................................................................................... 40 PHOTO 40 : EVOLUTION DE PSEUDERANTHEMUM VARIABILE DANS LE PATIO, D'OCTOBRE A DECEMBRE................................................... 41 PHOTO 41 : EVOLUTION DES BOUTURES DE RHYSSOPTERIS TIMORIENSIS VAR. TIMORIENSIS, SOUS OMBRIERE, D'OCTOBRE A DECEMBRE ........ 43 PHOTO 42 : EVOLUTION DES BOUTURES DE VITEX TRIFOLIA VAR. TRIFOLIA SOUS OMBRIERE, DE JUIN A DECEMBRE .................................... 44 PHOTO 43 : EVOLUTION DES BOUTURES DE VITEX TRIFOLIA VAR. TRIFOLIA EN PLEINE TERRE, D'OCTOBRE A DECEMBRE ............................... 45 PHOTO 44 : VITEX TRIFOLIA VAR. TRIFOLIA, PRESENCE D'EXCROISSANCE............................................................................................ 45 Tableaux : TABLEAU 1 : LISTE DES ESPECES ETUDIEES EN 2010 ........................................................................................................................ 4 TABLEAU 2 : HORMONES DE BOUTURAGE ................................................................................................................................... 23 TABLEAU 3 : COORDONNEES GEOGRAPHIQUES DES INDIVIDUS COLLECTES ......................................................................................... 25 TABLEAU 4 : TABLEAU BILAN .................................................................................................................................................... 47 Figures : FIGURE 1 : LOCALISATION DE LA FORET SECHE EN NOUVELLE-CALEDONIE (PFS) ................................................................................... 1 FIGURE 2 : PHASES DU TRAVAIL .................................................................................................................................................. 3 FIGURE 3 : DIFFERENTS TYPES DE BOUTURES (A. TARDIVEL) ........................................................................................................... 23 FIGURE 4 : SCHEMA DU BOUTURAGE DE PHYLLANTHUS DEPLANCHEI (A. TARDIVEL) ............................................................................ 34
Partie 1 : Contexte de l’étude
L’histoire géologique de la Nouvelle-Calédonie a induit un développement original de sa faune et de sa
flore. La diversité biologique néo-calédonienne est élevée, et en ce qui concerne la flore, plus de 3620
plantes vasculaires y sont indigènes, avec un taux d’endémisme supérieur à 74% (Jaffré et al, 2001). La
Nouvelle-Calédonie se retrouve ainsi parmi les 25 hotspots mondiaux de biodiversité (Myers et al, 2000).
De son côté, le WWF a mis un place un programme nommé Global 200 qui regroupe 238 des écosystèmes
les plus précieux et importants de la planète, et méritant particulièrement d’être protégés. Sur ces 238
écosystèmes, quatre sont présents sur le territoire. La forêt sèche est l’un d’entre eux (Olson et al., 2008).
Conservation Internationale est une ONG présente en Nouvelle-Calédonie depuis 1996, et depuis 2004 elle
est membre du Programme Forêt Sèche. Elle classe la Nouvelle-Calédonie comme une zone prioritaire
(Seligmann et al., 2007). Cette ONG a établi en début d’année la liste des dix hotpsots de forêt les plus
menacés de la planète et les forêts calédoniennes arrivent en seconde place (Conservation internationale).
L’écosystème forêt sèche, ou forêt sclérophylle, est définie par plusieurs critères : il s’agit d’une formation
forestière qui se développe dans un climat sec, où les précipitations ne dépassent pas 1100mm par an.
Situées sur la côte Ouest de la Nouvelle-Calédonie, ces forêts s’étendent du littoral jusqu’à 300 ou 400
mètres d’altitude. Elles sont soumises aux alizées, et la saison sèche peut durer six mois. Elles se
développent souvent sur roches sédimentaires, plus rarement sur des roches basaltiques (Jaffré et al.,
2003). Le nombre d’espèces présentes en forêt sèche est de 438 espèces, 253 genres et 93 familles. Le taux
d’endémisme est de 57%, c’est-à-dire que 252 espèces sur les 438 sont endémiques à la Nouvelle-
Calédonie, dont une soixantaine endémique à cette formation sclérophylle (Jaffré et al., 2001). Les forêts
sèches recouvraient originellement 4500 km² de la Grande-Terre, le long de la côte Ouest. Actuellement,
elles ne sont présentes que sur 50 km², soit environ 1% de la surface initiale (Bouchet et al., 1995).
Figure 1 : Localisation de la forêt sèche en Nouvelle-Calédonie (PFS)
1La vision classique du jardin tropical a énormément évolué au cours de ces dernières années. Il y a encore
une quinzaine d’années, on retrouvait classiquement bougainvilliers et autres hibiscus, espèces pourtant
introduites en Nouvelle-Calédonie (Anonyme, 2010a). Pourtant le territoire regorge de plantes au grand
potentiel ornemental. La valorisation des plantes endémiques, ou tout du moins indigènes, a été un virage
important dans la filière, tournant dynamisé par les actions menées par la station de Recherche
Agronomique de St Louis de l’Institut Agronomique Néo-Calédonien (Anonyme, 2010b). En parallèle, la
sensibilisation au grand public s’est accrue ces dernières années, avec par exemple le thème de la foire de
Bourail 2010 « l’horticulture et ses acteurs », le thème du Marché Nature de Noël 2010 du Parc Zoologique
et Forestier « Plantes endémiques », et de nombreux articles parus dans La Calédonie Agricole ou encore
Les Nouvelles, ainsi que les actions de communication du programme forêt sèche et les actions des services
de développement (DDR et DDEE). En 2008, la Nouvelle-Calédonie a accueilli le 5ème CIPAM (Colloque
international sur les plantes aromatiques et médicinales des régions d’outre-mer), dont un des thèmes
principaux était la valorisation des ressources biologiques ayant un potentiel en horticulture ornementale
(APPAM-NC, 2010).
La valorisation économique de la biodiversité calédonienne en horticulture ornementale reste pourtant
faible (Gâteblé, 2009), bien que plusieurs auteurs aient soulignés les atouts floristiques de espèces néo-
calédoniennes (Naudin, 1866, Guillaumin, 1921, Godard et al., 1978, Petinot, 1991, Dussy, 1996, Dawson,
1997, Gâteblé, 2008). En effet, la plupart des études effectuées ont porté sur les autres applications des
plantes, à savoir les plantes aromatiques et les plantes médicinales.
La prise de conscience de la fragilité de l’écosystème forêt sclérophylle, couplée à la volonté de valoriser les
plantes endémiques dans l’horticulture ornementale, a conduit à l’association du Programme Forêt Sèche
(PFS) et de l’Institut Agronomique Néo-Calédonien (IAC). Une première étude a eu lieu en 2004. Des
travaux de multiplication végétative ont été effectués sur seize espèces. Cette étude s’est faite en plusieurs
temps, avec tout d’abord une identification et une caractérisation phénotypique infraspécifique de chaque
espèce, via des relevés d’information à l’herbier de l’IRD et des sorties sur le terrain, ce qui a conduit à une
sélection des plantes et notamment à l’identification de l’individu « plus ». Le transfert de technologie
constitue la dernière étape du processus de valorisation, mais il faut au préalable conduire des essais afin
d’identifier le meilleur protocole de multiplication, qui varie d’une espèce à l’autre (Pastor, 2005). Les
travaux débutés en 2004 ont permis la mise en place d’itinéraires techniques de multiplication et de culture
pour six espèces, et le résultat final se présente sous forme de fiches techniques (Turbina inopinata - 2005,
Canavalia favieri- 2005, Pittosporum coccineum- 2006, Oxera sulfurea- 2006, Oxera pulchella ssp.
grandiflora- 2006 et Acropogon jaffrei- 2008). Ces fiches techniques, éditées en format papier et
téléchargeables sur internet, sont distribuées aux acteurs de la filière horticole. Lors d’une journée
d’information (le 6 novembre 2009, Pouembout) l’ensemble de la filière (aménageurs, pépiniéristes,
donneurs d’ordre,…) ont émis le souhait de voir se développer la palette végétale des plantes ornementales
de forêt sèche. Dans le but de répondre à cette demande et d’élargir la gamme de plantes disponibles, une
nouvelle étude a débuté en 2010 : des travaux de multiplication végétative et sexuée ont été conduits sur
d’autres espèces potentiellement ornementales. Dans cette nouvelle étude, plusieurs étapes se distinguent
(graphique n°1). La première est l’identification des espèces prioritaires. Cette mission s’appuie sur une
recherche bibliographique couplée aux connaissances des acteurs de la filière.
La sélection des espèces prioritaires se fait sur :
- L’intérêt ornemental de la plante (floraison, fructification, port, etc.) ;
2- Les connaissances déjà partiellement acquises sur la multiplication de l’espèce (ou d’une espèce du
même genre) ;
- L’utilisation connue en culture ornementale de cette espèce (ou d’une espèce du même genre) en
d’autres lieux du monde (par exemple en Australie).
La deuxième phase est la mise en place de protocole de bouturage, et le suivi de l’enracinement, pour
chacune des espèces. Cette étape peut durer plus ou moins longtemps selon les espèces et les modalités
testées. Lorsque les boutures sont enracinées, elles sont rempotées et commence alors la troisième phase
de l’étude, c’est-à-dire le suivi de culture. Les plantes suivent un chemin progressif, elles sont au début
rempotées en petit godet dans un substrat allégé, et placées en conditions quasiment équivalentes à celles
de la période de bouturage. Lorsque les racines se sont suffisamment développées, les plantes sont
rempotées en pot de 2L ou 3L, dans le substrat classique utilisé à l’IAC, composé de tourbe et pumice. Elles
sont alors installées sous ombrière, avec un arrosage réduit. Lorsque le comportement sous ombrière
correspond aux attentes, des essais de plantation en jardin sont réalisés, au sein même de la station de
Saint-Louis. C’est la quatrième phase, qui consiste donc à observer l’évolution des plantes en pleine terre.
Les phases 3 et 4 permettent aussi d’étudier la phénologie de la floraison et de la fructification, la vitesse
de croissance, ainsi que les maladies et ravageurs éventuels. L’ultime étape, qui ne se réalise généralement
que quelques mois, voire années, après le début des essais, est la rédaction et la distribution de la fiche
technique et des plantes mères. Celle-ci permettra aux professionnels d’avoir un appui pour la
multiplication de chacune des espèces, ceci dans le but de la produire et de la commercialiser.
Phase 3 : Evaluation Phase 4 : Evaluation Phase 5 :
Phase 1 : Choix des Phase 2 : essais de Rédaction
de la croissance en de la plante en jardin
espèces prioritaires multiplication d'une fiche
pépinière d'essai
technique
•bibliographie •essais de bouturage •floraison & •croissance en •production de
•communications •essai de fructification pleine terre pieds mères pour
personnelles germination •vitesse de •floraison & distribution aux
croissance fructification pépinéristes
•suivi
d'enracinement •maladies, ravageurs •adaptabilité •Production de
•taille plantes par les
privés
•utilisation (massif,
individu isolé, etc.) •commercialisation
Figure 2 : Phases du travail
3Partie 2 : Présentation des espèces
PRESENTATION GENERALE
En 2010, l’étude de multiplication a porté sur quinze espèces, réunies en huit familles (Tableau n°1).
Tableau 1 : Liste des espèces étudiées en 2010
Famille Espèce
Acanthaceae Pseuderanthemum variabile
Apocynaceae Cerbera manghas var. manghas
Rubiaceae
Melodinus scandens
Ochrosia inventorum
Asparagaceae Eustrephus latifolius
Euphorbiaceae Cleidion verticillatum
Lamiaceae Premna serratifolia
Vitex trifolia var. trifolia
Malpighiaceae Rhyssopteris timoriensis var. timoriensis
Phyllanthaceae Phyllanthus conjugatus ssp. maaensis
Phyllanthus deplanchei
Pittosporaceae Pittosporum cherrieri
Pittosporum pancheri
Rubiaceae Pavetta opulina
Psydrax odorata
4CERBERA MANGHAS VAR. MANGHAS
Présentation
Le genre Cerbera est présent en Asie et en
Océanie. Des fibres abondantes permettent à ses
fruits de flotter sans perdre leur faculté
germinative, ce qui a participé à sa répartition sur
les rives de l’Océan Indien et du Pacifique.
L’homme a aussi joué un rôle dans son expansion
puisque l’amande très toxique de Cerbera
manghas a servi de poison ordalique. Deux
variétés sont présentes en Nouvelle-Calédonie,
Cerbera manghas var. manghas et Cerbera
manghas var. acutisperma. La seconde variété qui
est endémique et présente uniquement en forêt
sèche, à Pouembout, est à rechercher et fera
l’objet de prospections en 2011. Cerbera manghas
var. manghas mesurant entre 5 et 15 mètres a un
port en boule qui n’est pas sans rappeler celui du
manguier (Boiteau, 1981). La ressemblance se
poursuit au niveau du feuillage et des fruits, c’est
pourquoi l’espèce Cerbera manghas var. manghas
est couramment appelé « faux manguier ». En
Nouvelle-Calédonie, Cerbera manghas var.
manghas est présente sur le littoral, ainsi qu’en
forêts sèche et humide (Jaffré et al., 2001). C’est
une espèce résistante à croissance rapide. Les
Photo 1 : Cerbera manghas var. manghas, pied-mère
fleurs sont grandes, mesurant de 3 à 4 cm et sont
regroupées en inflorescences terminales. Elles
dégagent une odeur suave, et présentent plusieurs coloris (blanches avec des nuances rosâtres, le cœur de
la fleur pouvant varier du jaune au rose violacé). La floraison a été observée tout au long de l’année,
excepté les mois de février, avril et mai. La fructification a lieu entre décembre et février. Les fruits sont
rouges à maturité. En ce qui concerne leur toxicité, deux cas se présentent. Premièrement il existe des cas
d’empoisonnements humains directement causés par l’ingestion de fruits de Cerbera (Iyer et al., 1975, Wee
et al., 1988, Gaillard et al., 2004), et deuxièmement des intoxication alimentaire causé par la consommation
de crabe des cocotiers, Birgus latro, eux-mêmes consommateurs de fruits du Cerbera (Maillaud et al.,
2010).
5Utilisation
L’espèce Cerbera manghas var. manghas est déjà utilisée en
aménagement paysager, notamment à Nouméa (Anse Vata,
Promenade Pierre Vernier, etc.) et elle a été plantée en
formation dense sur la parcelle n°2 du Parc Zoologique et
Forestier. L’origine, locale ou non, des Cerbera déjà utilisés en
aménagement nous est inconnue. En individu isolé,
l’architecture naturelle en boule est plaisante, en revanche, en
plantation dense, le port devient plus élancé et moins
attractif. Cette espèce est d’ores et déjà présente à la vente
dans certaines pépinières (Gâteblé, 2008). En Australie,
Cerbera manghas est très utilisé comme arbre de rue, on le
retrouve notamment à Cairns et au Jardin Botanique de
Townsville. Il est recommandé en ornemental pour son
feuillage et ses fruits, d’autant plus qu’il supporte très bien les
embruns salés, et s’adapte à divers types de sols (Wrigley et
Fagg, 2007). Il a aussi été introduit à Hawaï comme plante
ornementale (NTBG, 2010).
Photo 2 : Cerbera manghas var.
manghas, fruits et feuilles
6CLEIDION VERTICILLATUM
Présentation
Le genre Cleidion est présent dans la région indo-
pacifique (Asie, Malaisie, Australie, îles Salomon,
Vanuatu, Fidji). En Nouvelle-Calédonie, le genre
compte 12 espèces endémiques. Cleidion
verticillatum est un arbrisseau pouvant atteindre 2
mètres. Les feuilles sont pseudo-verticillées, chaque
touffe étant séparée de sa voisine par un entre-
nœud plus ou moins long. Les feuilles sont obovées,
à faces glabres, peu tâchées. La plante peut être
dioïque ou monoïque. Les fruits mesurent 4
millimètres (Mc Pherson, 1987). Cette espèce est
présente en forêt, humide et sèche (Jaffré et al., Photo 3 : Cleidion verticillatum, rameaux noirs
2001). La période de floraison n’est pas bien définie.
Utilisation
Aucune espèce du genre Cleidion ne semble déjà
être utilisée en culture ornementale. Cleidion
verticillatum a été sélectionné pour cette étude car
des individus potentiellement intéressants ont été
observés en forêt. En effet, les rameaux varient
selon les individus, certains pouvant être très
sombres, voir quasiment noirs. Cette couleur,
couplée au feuillage vert et léger, rend cette espèce
très attrayante. En fonction de ses caractéristiques
et de sa croissance, il sera possible de déterminer le Photo 4 : Cleidion verticillatum, détails des feuilles
meilleur type d’utilisation possible pour cette
espèce.
7EUSTREPHUS LATIFOLIUS
Présentation
Eustrephus latifolius, aussi appelée Wombat berry, est
l’unique membre du genre. On la retrouve dans les forêts
sèche et humide d’Australie (Queensland, New South Wales,
Victoria), en Nouvelle Guinée et en Nouvelle-Calédonie. En
Nouvelle-Calédonie cette espèce n’est reconnue officielle-
ment qu’en forêt humide (Jaffré et al., 2001). Cependant,
nous avons choisi de travailler dessus car elle a été observée
à plusieurs reprises en forêt sèche, et en Australie, elle est
considérée comme une plante de forêt sèche (ANPS, 2010a).
Elle se présente souvent comme une liane plus ou moins
vigoureuse. Les fleurs mesurent environ 15 mm de diamètre,
elles sont blanches ou rose pâle, et les pétales sont recou-
verts de poils. Des baies orange suivent les fleurs, chaque
baie contient plusieurs graines noires. Les fruits peuvent
rester sur la plante durant plusieurs mois. La racine
d’Eustrephus latifolius est comestible (ANPS, 2010a).
Rémy Amice
Utilisation Photo 5 : Eustrephus latifolius, port général
Eustrephus latifolius est une espèce illustrée comme plante
ornementale potentielle depuis longtemps (Sims, 1810). En
Australie, elle est recommandée pour son feuillage ainsi que
ses fruits voyants (Wrigley et Fagg, 2007) qui attire les
oiseaux. La floraison a lieu du début du printemps au début
de l’été.
Eustrephus latifolius est parfois confondu avec
Geitonoplesium cymosum, mais certaines différences
permettent la distinction : les pétales de G. cymosum n’ont
pas de poils, et les fruits, indéhiscents, sont noirs (Loudon,
1832, ANPS, 2010a).
La multiplication utilisée est le semis de graines fraiches.
Photo 6 : Eustrephus latifolius, détails des fruits
8MELODINUS SCANDENS
Présentation
Melodinus est un genre découvert en Nouvelle-Calédonie par
Forster et dont certaines espèces potentiellement ornemen-
tales ont été illustrées (Sims, 1825). Il s’agit de lianes ligneuses,
présentes en Asie du Sud-Est jusqu’en Océanie tropicale. Alors
que onze espèces étaient identifiées en Nouvelle-Calédonie,
dont dix endémiques (Boiteau, 1981), une révision a mis en
synonymie cinq espèces ainsi que toutes les variétés (Leeu-
wenberg, 2003). L’espèce type du genre est Melodinus scan-
dens, une liane pouvant atteindre la cime des plus grands
arbres. On la retrouve en forêt sclérophylle, mais aussi dans la
végétation rudérale ainsi qu’en bordure du littoral (Jaffré et al.,
2001). Ses rameaux sont jaunes ou jaunâtres et présentent,
dans leurs parties lignifiées, de nombreuses lenticelles
blanches. Les feuilles sont opposées. Les inflorescences sont en
position pseudo-terminales ou bien sur des rameaux courts à
l’aisselle des feuilles. Les fruits mesurent entre 4 et 6 centi-
mètres de diamètre, contiennent une centaine de graines. La
pulpe des fruits est sucrée et comestible, et est aussi recher- Photo 7 : Melodinus scandens, détail des fleurs
chée pour la préparation des boissons fermentées (Boiteau,
1981).
Utilisation
Le genre Melodinus a d’ores et déjà été utilisé en culture ornementale
(Henderson, 1910). Ainsi, Melodinus cochinchinensis (anciennement
Melodinus monogynus) est cultivé pour la beauté de son port et de ses
fruits (Sims, 1825, Schnizlein, 1866, Mabberley, 2008). Melodinus
villosus, originaire de Java, est vendu pour son feuillage (Maatschappij
voor tuinbouw, 1862). En Australie, Melodinus baueri, qui est une
espèce endémique à l’île de Norfolk (Lange et al., 2005), connue pour
ses fleurs et ses fruits (Fagg, 1995). Melodinus est, au sein de la famille
des Apocynaceae un genre prometteur pour la culture ornementale, au
même titre que les Alstonia, Alyxia ou encore Ochrosia. Les espèces de
Melodinus calédoniennes présentes en forêt sèche ont toutes fait l’objet
d’essais de multiplication excepté Melodinus scandens. L’IAC a en effet
testé avec succès la multiplication végétative de Melodinus celastroides
Photo 8 : Melodinus scandens, pied-mère et Melodinus phylliraeoides (Gildas Gâteblé, communication
personnelle), regroupées depuis 2003 en l’unique espèce Melodinus
philliraeoides (Leeuwenberg 2003). Comme les autres espèces du genre, Melodinus scandens est
intéressante notamment pour son feuillage et ses fleurs odorantes.
9OCHROSIA INVENTORUM
Présentation
Ochrosia est un genre étendu
dans les îles de l’Océan indien
et du Pacifique (Boiteau, 1981).
En Nouvelle-Calédonie, sept
espèces sont présentes, dont
six endémiques et une
autochtone. Ochrosia
inventorum est un petit arbre
pouvant être buissonnant,
atteignant quatre à cinq mètres
de haut. Parfois, plusieurs
troncs sont observés sortant du
même pied, ce qui renforce
l’impression d’arbuste. Cette
espèce est micro-endémique,
elle a été découverte et décrite
au début des années 80
(Allorge, 1984). Elle n’a été Photo 9 : Ochrosia inventorum, pied-mère
observée que dans deux sites,
sur la pointe Maa à Païta, dans une vallée évasée et peu encaissée et plus récemment dans une forêt
relictuelle appartenant au FSH, avant la baie de Toro (nommée dans la suite de ce rapport Forêt FSH de la
route de la Baie de Toro). Le substrat naturel est constitué d’éboulis et de cailloux. Comme de nombreuses
Apocynaceae, Ochrosia inventorum possède un latex, blanc. Il peut se montrer irritant pour la peau et plus
ou moins toxique. Les fleurs, de l’ordre de 2cm, sont blanches. La floraison, discrète, a lieu en début de
saison chaude. C’est la floraison et la fructification qui rend cette espèce intéressante (Graindorge, 2005).
Les fruits, à la peau ridée, sont toujours par paire, de couleur rouge grenat à noir, et mesurent environ 5 cm
de long (Allorge, 1984). Les fruits d’Ochrosia elliptica sont toxiques (Lewis, 2003). Il faudra donc être
prudent avec ceux d’Ochrosia inventorum, dans l’attente de la confirmation ou non d’une toxicité des
fruits.
Utilisation
Le genre Ochrosia est déjà utilisé en culture ornementale, ainsi Ochrosia marianensis par exemple, est
cultivé dans les Iles du Pacifique et en Micronésie (Graf, 1992).
En Nouvelle-Calédonie, l’espèce Ochrosia elliptica est utilisée en ornemental (Gâteblé, 2008). Des essais de
multiplication sur Ochrosia mulsantii ont été réalisés en 2009 à l’IAC. Les pourcentages de réussites ont
montré qu’il s’agissait d’une plante relativement facile à bouturer et à cultiver en pépinière à condition de
respecter certains principes, notamment un pré-trempage des boutures dans l’eau tiède afin d’éviter la
formation d’un bouchon de latex.
10La multiplication d’Ochrosia mulsantii a été
réalisée dans un objectif de restauration de
sites miniers (Udo et Gâteblé, 2010), mais
l’expérience peut être utile aux autres espèces
du genre. En ce qui concerne Ochrosia
inventorum, qui est un arbuste développant un
port en boule lors d’une exposition ensoleillée,
il a déjà été utilisé en aménagements paysagers
(Station de Saint-Louis au Mont-Dore) et en
restauration de forêt sèche (Pointe Maa)
(Gâteblé, 2008). Pour l’instant, cette espèce
n’avait pas été valorisée car les propriétaires de
la Pointe Maa s’opposaient à toute valorisation
commerciale de cette espèce micro-endémique
(cf. article 3.8 de la convention PCFS/ SCI Pointe
Ma du 14 octobre 2005) et Mme Domergue-
Schmidt, gérante de la SCI nous a refusé l’entrée
de sa propriété en 2010. Depuis sa redécouverte
Photo 10 : Ochrosia inventorum, détail des fruits
dans un autre site, il devient enfin possible de
pouvoir envisager sa valorisation.
11PAVETTA OPULINA
Présentation
Pavetta est un genre regroupant entre 350 et 400
espèces réparties en milieux tropical et subtropical
(Afrique, Asie, Australie) (Herman, 2007). En Nouvelle-
Calédonie, la seule espèce du genre est Pavetta opulina,
que l’on retrouve en forêt sèche et en forêt humide
(Jaffré et al., 2001), espèce que l’on retrouve aussi au
Vanuatu.
Utilisation
En Afrique, plusieurs espèces de Pavetta sont utilisées
en culture ornementale. Pavetta lanceolata est la plus
cultivée, vient ensuite P. gardeniifolia, P. cooperi, P.
revoluta et P. schumanniana. Il est recommandé de les
planter dans un premier temps à l’ombre ou mi-ombre,
mais une fois bien installées, ces espèces poussent en
plein soleil. Ces espèces sont appréciées pour les fleurs,
regroupées en grappe en forme de parapluie ou de
boules et qui apparaissent au moment de noël
(Herman, 2006). Les fleurs, ainsi que les fruits, attirent
de nombreux insectes et oiseaux. En Australie, l’espèce
Pavetta australiensis est cultivée et recommandée pour Photo 11 : Pavetta opulina, pied-mère
son feuillage et sa magnifique floraison qui attire les
papillons (Wrigley et Fagg, 2007, SOWN,
2010). En Nouvelle-Calédonie, il a été
observé que Pavetta opulina attire les
monarques, comme l’atteste la photo
prise par J.-M. Veillon (Endemia),
l’identification de l’espèce ayant été
confirmé (Thierry Salesne,
communication personnelle). Au regard
du grand intérêt ornemental des espèces
de ce genre, et Pavetta opulina étant la
seule espèce présente en Nouvelle-
Calédonie, il a donc semblé très
intéressant d’essayer de la multiplier.
Photo 12 : Pavetta opulina, détail de la floraison
12PHYLLANTHUS SPP .
Présentation
Le genre Phyllanthus est représenté par environ 800 espèces, principalement en zone paléotropicale. En
Nouvelle-Calédonie, une centaine d’espèces a été reconnue, dont la quasi-totalité considérées comme
endémiques.
Phyllanthus conjugatus var. maaensis appartient à une espèce qui a été scindée en trois variétés
(Schmid, 1991). Cette variété a été localisée dans un premier temps sur la Pointe Maa (Jaffré et al., in prep)
mais depuis, d’autres populations ont été découvertes, notamment dans la Forêt FSH de la route de la Baie
de Toro. Cette variété se retrouve en sous-bois, sur sol noir argileux et substrat plus ou moins calcarifère,
en zone littorale. Il s’agit d’un sous-arbuste de 20 à 35 centimètres, pseudo-monocaule, dont les
inflorescences, bien que axillaires, paraissent terminales. Les fleurs rouges sont réunies en glomérules. Les
individus sont généralement bisexués, mais avec prédominance de l’un ou l’autre sexe. La différence de
cette variété avec les autres se situe au niveau du limbe obové et des nervations bien visibles, au moins sur
la face supérieure.
Photo 13 : Phyllanthus conjugatus var. maaensis
Phyllanthus deplanchei est un arbuste ou petit arbre pouvant atteindre 5 ou 6 mètres. Le tronc, de
l’ordre de 15 centimètres de diamètre, est entièrement glabre. On retrouve cette espèce en forêt sèche
(Jaffré et al., 2001), sur les littoraux coralliens (Schmid, 1991) jusqu’à 300 mètres d’altitude, sur les terrains
calcaires en plein soleil (Barrault, 2006), principalement sur la côté ouest de la Grande terre. Les fleurs sont
sexuées, les fleurs mâles sont réunies en inflorescence à l’aisselle des feuilles, tandis que les fleurs femelles
sont plus souvent solitaires. Dans les deux cas les pétales sont blanc verdâtre, c’est-à-dire très discrets. Les
fruits sont petits, ils mesurent entre 3 et 5 mm. Leur couleur évolue du jaune au noir bleuté en passant par
le rouge.
13Utilisation
A l’échelle mondiale, de nombreuses espèces de Phyllanthus sont cultivées comme ornementales. On
retrouve par exemple Phyllanthus acidus en Asie, qui est la plus cultivée (Collectif, 2006), et Phyllanthus
arbuscula en Jamaïque (Graf, 1992). Phyllanthus acidus est un arbre atteignant rapidement sa taille adulte
de 10m pour un étalement de 3m. Il offre des grappes denses de minuscules fleurs rouges (Collectif, 2006).
En Australie, les Phyllanthus ont peu à offrir : les fleurs sont petites et les fruits ont aussi peu d’intérêt
(Wrigley et Fagg, 2007). Toutefois, le feuillage de certaines espèces est très attrayant, et celles-ci sont alors
cultivées. C’est par exemple le cas de Phyllanthus cuscutiflorus. On le retrouve ainsi dans des
recommandations d’aménagements paysagers (Townsville, 2009). En Nouvelle-Calédonie, le genre
Phyllanthus est très diversifié, et de nombreuses espèces méritent d’être essayées en ornemental.
La multiplication de Phyllanthus conjugatus var. maaensis est doublement utile au regard de sa
particularité d’être une espèce micro-endémique. S’agissant d’un sous-arbuste, cette espèce pourrait être
utilisée dans les aménagements paysagers et dans les jardins, en massif ou en couvre-sol par exemple.
En ce qui concerne Phyllanthus deplanchei, il est déjà multiplié par semis, et a été intégré dans
divers aménagements en Calédonie (Païta – lotissement Savannah – Nouméa, etc.) depuis quelques
années. Des données sur son comportement ex situ sont donc disponibles, et il s’avère qu’il se comporte
très bien pour une intégration dans un aménagement paysager. L’intérêt majeur reste le port général du
Phyllanthus deplanchei, qui, s’il est taillé convenablement, n’est pas sans rappeler celui du flamboyant nain.
La floraison discrète n’offre que peu d’intérêt, la fructification reste modeste mais la couleur noire des
fruits à maturité peut apporter un intérêt supplémentaire (Gâteblé, 2008).
Photo 14 : Phyllanthus deplanchei utilisé en aménagement paysager
14PITTOSPORUM SPP .
Présentation
Le genre Pittosporum est présent en Australie, Océanie, Asie, et dans quelques zones d’Afrique. Parmi les
quelques 200 espèces du genre, 45 sont endémiques à la Nouvelle-Calédonie.
Pittosporum cherrieri est un arbuste élancé pouvant atteindre 5 mètres de hauteur. Il peut parfois
se présenter sous forme d’un arbrisseau diffus. Ses rameaux grêles portent des inflorescences terminales et
axillaires, mais surtout caulinaires. Les glomérules regroupent de 5 à plus de 30 fleurs blanches sub-sessiles,
les fleurs étant généralement mâles ou femelles. On le retrouve dans la moitié sud de la Grande-Terre,
fréquemment dans les fourrés littoraux et les forêts sclérophylles (Jaffré et al., 2001), notamment sur
calcaires coralliens, mais aussi sur basaltes et schistes. La floraison est abondante de juin à août, et s’étend
parfois jusqu’en septembre ou octobre (Tirel et Veillon, 2002). La fructification a lieu d’octobre à mars.
Photo 15 : Pittosporum cherrieri, floraison
Pittosporum pancheri est une autre espèce endémique parmi les 45 Pittosporum de Nouvelle-
Calédonie. Il peut se trouver sous différentes formes. Il peut s’agir d’un arbuste ou arbrisseau de 2 à 4
mètres, en touffe, très dense, ou bien d’un arbre de 5 à 10 mètres. L’écorce du tronc est grise, parfois brun
clair. Les inflorescences terminales de 2 à 4 centimètres regroupent de 6 à 30 fleurs mâles ou femelles. Les
fleurs sont jaunes. C’est une espèce très fréquente dans la région de Nouméa, qui n’a pas été récoltée au-
delà de la ligne Bourail-Houaïlou. Pittosporum pancheri croît en forêt sèche et humide (Jaffré et al., 2001),
sur terrains schisteux ou calcaires. La floraison s’étend de juillet à septembre. Des jeunes fruits ont été
observés dès octobre, et des capsules peuvent rester en place sur les rameaux alors que la floraison
suivante a lieu (Tirel et Veillon, 2002).
15Utilisation
De nombreux Pittosporum sont des sujets horticoles très intéressants, robustes et avec des fruits et des
graines colorés (Wrigley et Fagg, 2007). Les espèces les plus cultivées comme plantes ornementales sont
Pittosporum eugenoides (« Tarata ») et Pittosporum tenuifolium (« Kohuhu ») de Nouvelle-Zélande ainsi
que Pittosporum tobira (« Cheeswood ») originaire du Japon (Graf, 1992, Scheper, 1996). En climat à l’hiver
doux, les Pittosporum sont des plantes adéquates pour écran ou brise-vent, en individu isolé ou plantés en
haies denses. Les fleurs sont parfumées. Pittosporum est aussi un genre qui peut être cultivée en plante
d’intérieur, sous forme de bonsaï.
Pittosporum cherrieri est un arbrisseau qui peut être particulièrement attractif lors de sa floraison
blanche (Gâteblé, 2008).
Pittosporum pancheri est dans la liste des espèces potentiellement intéressantes pour la culture
ornementale (Gâteblé, 2008). Sa floraison jaune est un atout.
Photo 16 : Pittosporum pancheri, floraison
16PREMNA SERRATIFOLIA
Présentation
Le genre Premna est représenté par environ 200 espèces
(Leeratiwong, 2009) réparties en zone tropicale et subtropicale
d’Asie, Afrique, Australie, et îles du Pacifique (Harley et al., 2004,
cité par Leeratiwong, 2008). Le genre a été décrit avec l’espèce
Premna serratifolia (Linnaeus, 1771). Cette espèce est la seule
représente du genre en Nouvelle-Calédonie, mais elle est aussi
distribuée le long de nombreuses côtes tropicales et
subtropicales. C’est un arbuste ou arbre pouvant atteindre 15
mètres de hauteur, que l’on retrouve principalement en forêt
sèche, mais aussi parfois en forêt humide et maquis (Jaffré et al.,
2001). Il croît à basse altitude. Les fleurs, blanches et petites,
sont regroupées en inflorescences en position terminale
(Barrault, 2006). La floraison et la fructification sont
apparemment continuelles (Mabberley et De Kok, 2004). Une
Photo 17 : Premna serratifolia, pied-mère étude poussée en Nouvelle-Guinée a montré que les pieds
femelles ont des inflorescences plus petites avec des anthères
vides (Mabberley, 1992). Il serait intéressant de faire une étude sur les clones présents en Nouvelle-
Calédonie, car un clone mâle, ne produisant que des fleurs tout au long de l’année, présenterait un plus
grand intérêt ornemental.
Utilisation
Plusieurs espèces de Premna sont utilisées. Certaines sont
commercialisées pour leur intérêt ornemental et/ou olfactif ,
comme par exemple Premna quadrifolia (JPS, 2010), d’autres
servent en plus pour leurs propriétés médicinales ou culinaires,
c’est notamment le cas de Premna serratifolia (Thaman, 2000).
En effet, en Malaisie et en Indonésie, les jeunes feuilles sont
cuisinées comme un légume. Une infusion des feuilles et des
racines est utilisée contre la fièvre. En Chine, les feuilles et les
racines sont utilisées dans la médecine traditionnelle comme
diurétique et fébrifuge. Premna serratifolia est aussi utilisé en
ornemental dans la conception de haies et comme arbre de rue Photo 18 : Premna serratifolia, détail de la
(De Kok, 2010a). D’autre part, deux espèces, Premna floraison
serratifolia et Premna microphylla, sont utilisées, et très
prisées, en tant que bonsaï (Steven, 2010). Aux Maldives, Premna serratifolia est considéré comme un bois
de chauffage idéal. Il y est aussi cultivé comme arbre de rue, dans les écoles et autres établissements
publics. Il est aussi utilisé pour faire des sculptures et des outils (Selvam, 2007). Premna serratifolia est
aussi une espèce qui fournit un bois veiné utilisé pour faire des manches de couteaux (Mabberley et De
Kok, 2004). Il est fort possible que Premna serratifolia soit une espèce mellifère qui attire papillons et
abeilles, comme l’atteste plusieurs observations personnelles.
17Vous pouvez aussi lire