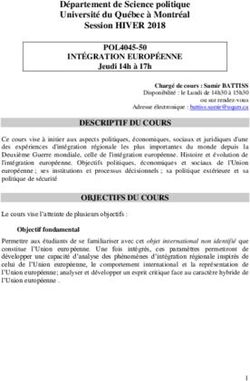Stratégie de conservation de l'Engoulevent d'Europe en Valais 2022 - Jean-Nicolas Pradervand
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Stratégie de conservation de l’Engoulevent
d’Europe en Valais – 2022
Jean-Nicolas Pradervand
Rapport interneEngoulevent: Stratégie de conservation 1 Impressum Stratégie de conservation de l’Engoulevent d’Europe en Valais – 2022 Rapport interne Auteur Jean-Nicolas Pradervand Photos, illustrations (page de titre) Jean-Nicolas Pradervand Citation recommandée Pradervand J.-N. (2022) : Stratégie de conservation de l’Engoulevent d’Europe en Valais – 2022. Station ornitho- logique suisse, Antenne valaisanne, Sion. Contact Jean-Nicolas Pradervand, Station ornithologique suisse, Antenne valaisanne, Rue du Rhône 11, CH–1950 Sion Tél. : 027 456 88 56, e-mail : jean-nicolas.pradervand@vogelwarte.ch © 2022, Station ornithologique suisse de Sempach Ce rapport ne peut être publié, même partiellement, sans l'autorisation de la Station ornithologique suisse. Station ornithologique suisse, 2022
Engoulevent: Stratégie de conservation 2
Contenu
Résumé 3
1. Introduction 4
1.1 Distribution de l’espèce en Valais 4
1.2 Utilisation de l’habitat et structure de la végétation 5
2. Résultats et synthèse des différentes études 6
2.1 Les sites de nidification 7
2.1.1 Typologie des sites de nidification 7
2.1.2 Mesures de conservation dans les sites de nidification 9
2.2 Les sites de chasse 10
2.2.1 Typologie des sites de chasse 10
2.2.2 Mesures de conservation dans les sites de chasse 12
Zones ouvertes : prairies et pâturages 12
Le vignoble 13
2.3 Schéma décisionnel pour la mise en place de mesures en faveur
de l’Engoulevent d’Europe 14
2.4 Sélection des zones pour des mesures en faveur de l’Engoulevent 15
3. Références 16
Station ornithologique suisse, 2022Engoulevent: Stratégie de conservation 3 Résumé L’Engoulevent d’Europe est une espèce discrète, dont les mœurs restent peu connues. Il a fortement régressé en Suisse, y compris dans ses derniers bastions valaisans et tessinois. Malgré de nombreuses mesures forestières en sa faveur, les nouveaux sites créés restent peu utilisés. Une récente campagne de terrain a permis de suivre la plupart des individus connus en Valais via GPS. Il en résulte une connaissance fine des sites utilisés pendant la période de nidification. Jusqu’alors connus pour utiliser essentiellement les forêts semi-ouvertes, on sait désormais que les Engoulevents chassent régulièrement sur des prairies ou sur le vignoble, parcourant en moyenne 1,3 km (!"0,7 km) pour rallier leurs sites de nourrissage. Des recherches ciblées sur ces habitats montrent que les sites de nidification doivent comporter une part importante de sol nu, sans végétation herbacée, ainsi qu’une couverture dense (entre 30% et 55%) en buissons rampants (type Juniperus). Idéalement, la couverture en arbres (> 6 m) doit être réduite et la présence de bois mort au sol, servant de perchoirs ou de camouflage, doit être conséquente. Les sites de nourrissage sont assez variables, mais doivent être diversifiés en termes d’habitat. Les Engoulevents utilisent des prairies extensives à semi-intensives (Mesobromion – Arrhenatherion) pour chasser, avec la présence de haies et de perchoirs. Lorsqu’il est utilisé pour chasser, le vignoble doit comporter des structures diversifiées, comme des haies, des arbres isolés, ainsi qu’un enherbement conséquent. Les mesures de conservation dans les sites de nidification doivent se concentrer dans des zones à proximité de sites de chasse potentiels. Les sites doivent arborer des surfaces semi-ouvertes avec peu de végétation herbacée. On limitera la densité de buissons rampants et de végétation au sol. Si les mesures forestières ne peuvent pas se faire dans des zones où la repousse sera lente (zones rocailleuses avec peu de sol), un suivi avec une pâture régulière, afin d’éviter la repousse, devra être envisagé. Dans les sites de chasse, on veillera à promouvoir les structures en tout genre, de type haies, bandes herbeuses, spécifiquement à proximité de prairies extensives ou de vignes enherbées. Station ornithologique suisse, 2022
Engoulevent: Stratégie de conservation 4 1. Introduction En Suisse, l’Engoulevent était jadis régulier en amont du coude du Rhône, dans l’Ouest lémanique au pied du Jura, sur les collines séchardes du Plateau, ainsi que dans quelques vallées alpines de Suisse orientale (Knaus et al. 2011, 2018). Actuellement, on ne le trouve plus que dans le Haut-Valais, au Tessin et dans quelques vallées des Grisons, jusque vers 1800 m. Sa diminution au niveau national, malgré de nombreuses mesures forestières en sa faveur, demeure mal comprise. Plusieurs facteurs peuvent expliquer son déclin en Suisse, à commencer par la diminution drastique de la biomasse en gros insectes (Wagner et al. 2021), la densification des forêts, notamment par l’arrêt du pâturage en forêt, et la disparition des zones de chasse et de nidification (Evens et al. 2021). De ré- centes études belges et anglaises nous amènent une nouvelle vision de l’écologie de l’espèce. Alors que l’Engoulevent était considéré comme une espèce forestière, cet insectivore a besoin d’habitats complémentaires pour chasser, notamment de prairies et de pâturages (Sharps et al. 2015; Evens et al. 2018b), rendant les mesures actuelles probablement peu attractives si les clairières créées ne com- portent pas ces habitats secondaires à proximité. C’est sur cette base qu’une étude approfondie de l’espèce a été conduite en Valais. Pendant trois an- nées consécutives (2018-2020), des Engoulevents ont été capturés entre Salquenen et Viège et équi- pés de GPS miniatures (Evens et al. 2021), puis d’accéléromètres (Eisenring et al. 2022). Les données récoltées permettent d’obtenir une image fine de l’habitat occupé par cet insectivore nocturne et discret. Ces données, une fois reclassifiées en fonction du comportement des oiseaux (point GPS sur site de nidification, site de nourrissage ou en vol) nous permettent d’investiguer l’écologie de l’espèce et pro- poser des mesures générales de conservation en lien avec les habitats, mais aussi de définir des sites spécifiques nécessitant soit une protection particulière, soit des mesures ciblées. Le présent rapport a deux buts principaux : premièrement, passer en revue les différents travaux réali- sés sur l’Engoulevent en Suisse ces dernières années, afin de définir au mieux l’utilisation de l’habitat et proposer les mesures de conservation les plus ciblées possibles. Deuxièmement, définir les zones utilisées sur le sol valaisan afin de pouvoir cibler précisément les sites pour une mise en pratique des mesures proposées en préambule. Il est aussi important de mettre un accent particulier sur la caracté- risation des différents habitats utilisés, afin de proposer des mesures de conservation claires et un schéma décisionnel strict pour déterminer si des mesures sont envisageables ou non dans une zone donnée. Récolte et classification des données 1.1 Distribution de l’espèce en Valais La zone de l’étude se situe entre les dalles Salquenen (Blättä) et la forêt incendiée près de Oberstalden, sur la commune de Visperterminen. Une zone supplémentaire a ensuite été découverte en 2020 dans les hauts de Savièse (fig. 1). Ce sont majoritairement des forêts clairsemées de type chênaies ou pi- nèdes, mais l’on trouve aussi des pessières clairsemées en limite de la zone de combat. Tous ces sites sont à proximité de structures comme des prairies extensives ou des vignobles enherbés. Station ornithologique suisse, 2022
Engoulevent: Stratégie de conservation 5
Carte de chaleur basée
sur les données GPS
Fig. 1. Carte de type «carte de chaleur» indiquant la présence des Engoulevents en Valais. L’échelle indique le
nombre de points GPS couverts par une zone tampon de 2000 m. © Swisstopo
1.2 Utilisation de l’habitat et structure de la végétation
Fig. 2. Engoulevent équipé d’un GPS, prêt à être lâché. Photo : J.-N. Pradervand
Les Engoulevents ont été attrapés par attraction acoustique au moyen de filets (ultra fine mist nets,
Ecotone) puis équipés de GPS nanoFix (Pathtrack) et d’un tag radio (Biotrack) pour un total de 2,5 g.
Les GPS, fixés par des liens en cellulose, se détachaient en moyenne 4 jours après la pose (Evens et
al. 2018a). Ce sont au total 85 déploiements qui ont été effectués sur 46 individus, dont 14 ont été
équipés deux années (fig. 2). Ainsi, plus de 43'000 points GPS ont pu être collectés sur les 3 ans du
projet. Les données GPS ont ensuite été classifiées afin de séparer les zones de nidification de celles
de nourrissage et des données en vol, suivant une méthodologie éprouvée sur des jeux de données
similaires (Evens et al. 2018b, 2021). Pour chaque catégorie, les clusters de points ont ensuite permis
de tirer au sort un certain nombre de sites dans les zones de nidification et de nourrissage, afin d’y faire
des relevés de structure et de végétation.
Sur la base des données GPS, 251 points en zone de nidification et 150 sur les sites de nourrissage
ont été définis. Cela représente les sites utilisés par 36 individus avec, pour les sites de nidification, 3
points par individus, ainsi que 3 points de contrôle situés à moins de 500 m et, pour les sites de nour-
rissage, 1 à 5 points par individu avec autant de contrôles. Sur ces sites, la végétation a été quantifiée
Station ornithologique suisse, 2022Engoulevent: Stratégie de conservation 6 par strates et des relevés de la végétation ligneuse ont été faits, le tout sur des zones allant de 10 m x 10 m à 40 m x 40 m (pour plus de détails : Winiger et al. 2018, Wildi 2021). 2. Résultats et synthèse des différentes études Il y a eu, ces dernières années, plusieurs études effectuées en Valais sur l’écologie et l’habitat de l’En- goulevent d’Europe (Sierro et al. 2001; Winiger et al. 2018; Sierro & Erhardt 2019; Wildi 2021; Evens et al. 2021; Eisenring et al. 2022). Ces différents travaux ont porté sur l’écologie de l’espèce, sur son utilisation de l’habitat, en cherchant ainsi à expliquer pourquoi certains sites ont été abandonnés. Fig. 3. Carte de chaleur pour la région de Salquenen à Visperterminen, avec données GPS classifiées. En bleu sites de nidification, en rouge sites de chasse. © Swisstopo La raison de la campagne de terrain de 2018 à 2020 se fonde dans l’utilisation de la technologie GPS apportant une plus-value extrêmement importante par rapport aux données antérieures et permettant une vision fine de l’utilisation de l’habitat. Un effort de terrain considérable a permis d’échantillonner deux tiers à trois quarts des territoires d’Engoulevents connus en Valais. Cela nous permet donc d’avoir une vision très poussée des sites utilisés par l’espèce. La classification des données entre sites de nidification et sites de chasse nous a aussi permis de séparer l’habitat en fonction de son type d’utilisa- tion (fig. 3; Evens et al. 2021). La donnée principale issue de cette campagne de terrain confirme que les Engoulevents, tout comme dans le reste de l’Europe, vont se nourrir dans des habitats annexes aux sites de nidification, parcourant parfois des distances importantes (moyenne 1,3 km !"0,7 km, fig. 4). Ces habitats sont en priorité des prairies, mais peuvent aussi être des vignes ou de la forêt. Station ornithologique suisse, 2022
Engoulevent: Stratégie de conservation 7
Distance parcourue vers les sites de chasse [m]
Site
Fig. 4. Distances pour atteindre les sites de nourrissage en lien avec 4 sites de nidification. La ligne horizontale
représente la médiane.
2.1 Les sites de nidification
2.1.1 Typologie des sites de nidification
Les sites de nidification sont caractérisés par des forêts clairsemées sur sol très drainant, avec souvent
peu de végétation herbacée. Ce sont soit des forêts climaciques de type pinèdes ou chênaies buisson-
nantes, soit des zones où des feux de forêt ont eu lieu. Il faut en effet des zones sèches où la végétation
peine à s’installer de façon uniforme. Winiger et al. (2018) mentionnent déjà l’importance de surfaces
suffisantes de sol nu. Détail que l’on retrouve aussi dans l’étude de Wildi (2021) qui montre que la
couverture herbacée des sites de nidification doit être limitée afin de conserver son attractivité. On res-
tera toutefois prudent, car ce résultat n’est que partiellement significatif (fig. 5). L’importance des buis-
sons rampants semble quant à elle cruciale. Ils permettent aux oiseaux de s’abriter pendant la journée,
de cacher leur nid ou leurs poussins. La couverture idéale en buissons rampants, par exemple du genre
Juniperus, semble s’étendre entre 30% et 55% (fig. 5).
Fig. 5. Variables d’importance dans l’étude de Wildi et al. 2021 sur la présence (1) ou l’absence (0) de l’Engoulevent
d’Europe. La proportion de buissons rampants A), ainsi que la couverture en arbres C) sont significatives (pEngoulevent: Stratégie de conservation 8
En Valais, l’engoulevent est connu principalement des chênaies et pinèdes thermophiles et xériques,
deux récentes découvertes nous font toutefois garder en mémoire que l’espèce peut occuper des habi-
tats variés : un couple était présent dans une pessière venant d’être rouverte, quasiment au niveau de
la zone de combat, à 1700 m d’altitude, et une population importante a été détectée sur le coteau d’Aus-
serberg dans une zone de couloirs d’avalanche. Cela nous laisse penser que d’autres sites pourraient
être mis au jour, dans des habitats plus extrêmes que ceux habituellement visités. L’espèce semble
avoir besoin de forêts semi-ouvertes avec un substrat pauvre, ne permettant pas ou peu à la végétation
herbacée de se développer ainsi qu’à des structures buissonnantes denses et basses. Ces milieux
peuvent se trouver de la plaine jusqu’à 1800 m d’altitude.
On notera qu’une partie importante des sites actuellement occupés ont aussi été victimes de feux de
forêt, ce qui explique en partie leur structure actuelle. Alors que certains sites restent encore favorables,
d’autres voient leur attractivité diminuer ; c’est notamment le cas de la forêt incendiée de Loèche, qui
se referme rapidement dans sa partie basse et voit les oiseaux occuper des territoires plus en altitude.
1° Abondance de sol nu (> 40%)
2° Bois mort en abondance au sol
3 °Peu de végétation herbacée (< 30%)
4° Buissons rampants (30-55%)
5° Faible couverture en arbres (< 30%)
Fig. 6. Habitat favorable de nidification pour l’Engoulevent d’Europe. Photo : J. Wildi.
Fig. 7. A gauche site idéal pour la nidification de l’Engoulevent d’Europe. Photo : R. Evens. A droite clairière
forestière comportant une structure idéale, mais probablement trop de végétation herbacée au sol pour être
favorable à l’engoulevent. Photo : A Sierro.
Un résumé du site de nidification idéal se compose de : 1° une partie importante de sol nu (> 40%) ;
2° du bois mort en abondance pour servir de perchoirs ou de camouflage au sol ; 3° peu de végétation
herbacée (< 30%) ; 4° une couverture en buissons rampants entre 30% et 55% ; 5° une faible quantité
Station ornithologique suisse, 2022Engoulevent: Stratégie de conservation 9 d’arbres de plus de 6 m de haut (fig. 6 et 7). Ces critères sont utilisés au chapitre 3.3. Schéma décision- nel pour la mise en place de mesures en faveur de l’Engoulevent d’Europe, en page 14. 2.1.2 Mesures de conservation dans les sites de nidification La création ou l’entretien de clairières pour les Engoulevents reste une mesure peu plébiscitée par l’espèce (Sierro 2016). Cependant, les données GPS nous ont montré que les Engoulevents utilisent des sites avec des mesures forestières. C’est notamment le cas dans le pourtour de la Blättä, de la forêt incendiée de Loèche ou aux Mayen-de-la-Zour. Le manque d’attractivité des clairières ciblant l’espèce est probablement dû à deux facteurs : tout d’abord, au fait que les clairières se concentraient sur des sites historiquement occupés, mais qui ont actuellement perdu les zones de chasse à proximité. C’est d’autant plus marquant entre Sion et le coude du Rhône, où il n’y a quasiment plus de prairies extensives disponibles pour chasser. Deuxièmement, les clairières créées semblent très rapidement se couvrir de végétation herbacée (Sierro 2016), diminuant alors la quantité de sol nu disponible. Ces facteurs sont pourtant essentiels au maintien d’un site attractif (Winiger et al. 2018; Polakowski et al. 2020; Wildi 2021). Il est nécessaire que les coupes forestières créées gardent une végétation éparse. Il convient dès lors de prendre des mesures dans des zones où la repousse sera limitée ou de faire pâturer ces zones afin de limiter cette dynamique. Le nom de l’Engoulevent (Ziegenmelker, Succiacapre, Capri- mulgus…) nous rappelle d’ailleurs qu’il fréquentait les zones pâturées par des chèvres. Une pâture printanière ou d’automne est donc tout à fait indiquée afin de favoriser l’espèce. Les oiseaux nichant au sol, on limitera la pâture pendant la période de mi-avril à mi-août afin de ne pas déranger les pontes et mettre en danger les nichées. Fig. 8. Les clairières de Finges ne semblent pas favorables à l’Engoulevent, car il ne reste pas de matériel au sol, ni de buissons rampants. La zone de droite, aux alentours de Flanthey, est favorable, bien que la quantité de grands arbres soit probablement un peu élevée. Photos : J.-N. Pradervand Un site idéal de nidification se constitue donc de coupes forestières ou d’éclaircissements d’au minimum 1 à 1,5 ha. Mais, idéalement, les mesures devraient se faire en mosaïque sur des surfaces plus grandes, 3,2 ha pouvant accueillir déjà deux couples d’Engoulevents (Glutz von Blotzheim & Bauer 1980). Ces zones doivent être constituées d’une végétation variée, de quelques grands arbres, de bois mort en abondance au sol mais ne cloisonnant pas la clairière (parfois le bois mort est stocké en andins continus créant une barrière naturelle, c’est à éviter). Il est important de conserver les buissons rampants de type Juniperus et de veiller à avoir du sol nu à disposition. Afin de maintenir les sites de nidification et de chasse ouverts, une pâture de printemps ou d’automne pourrait être favorable, selon ce qui a été mis en place sur le coteau de Loèche par exemple (Jacot & Revaz, 2014). La qualité des sites complémentaires de chasse semble être aussi importante que celle des sites de nidification et explique probablement la diminution de l’espèce en Suisse (Evens et al. 2021). Les oi- seaux sont capables de parcourir des distances importantes pour aller chasser sur des prairies ou des vignes enherbées, mais une offre suffisante en habitats secondaires doit toutefois être disponible à Station ornithologique suisse, 2022
Engoulevent: Stratégie de conservation 10 proximité des sites de nidification. En effet, les vols vers les sites de nourrissage font en moyenne une distance de 1,3 !"0,7 km. Le succès des mesures de conservation pourrait tenir d’un respect strict des critères concernant les sites de nidification, ainsi que de l’accès à des sites de chasse complémentaires. 2.2 Les sites de chasse 2.2.1 Typologie des sites de chasse Les Engoulevents quittent les sites de nidification en fonction de l’heure de la nuit, de la saison et de la phase de lune (Evens et al. In prep). Lors des soirées et nuits avec une forte luminosité ambiante, les oiseaux vont chasser sur des prairies, se comportant à la façon de gobemouches, postés à l’affût sur un perchoir ou au sol et attrapant leurs proies par des vols courts. Hormis les oiseaux d’Ausserberg, attrapés en fin de saison et sur une plus courte période, tous les oiseaux marqués par GPS ont utilisé des sites complémentaires pour chasser. Sur les hauts d’Ausserberg, le signalement d’oiseaux sur des prairies alpines lors de la période atlas (2013-2016), laisse aussi fortement penser que ce comportement de chasse peut être généralisé à tous les sites valaisans. Les sites utilisés dans les prairies (fig. 10) ou sur le vignoble (fig. 11 & 12) doivent être diversifiés en termes d’habitats, en comportant des structures brisant l’homogénéité des cultures. La qualité des her- bages visités varie de la prairie à fromental (Arrhenatherion) à la prairie à brome (Mesobromion), les steppes (Stipo-Poion) étant plutôt caractéristiques des sites de nidification. Certains sites forestiers sont aussi utilisés pour la chasse et comprennent des forêts plus fermées (fig. 9). Fig. 9. Variables d’importance dans l’étude de Wildi et al. 2021 pour les sites de chasse en fonction de la présence (1) ou de l’absence (0) de l’Engoulevent d’Europe. La diversité dans l’utilisation du sol est importante, que ce soit dans le vignoble (C) ou dans les prairies (A). La couverture en arbres doit être soit très faible, soit importante dans les sites forestiers utilisés par l’Engoulevent pour chasser (B). On notera toutefois que, pour ces 3 modèles, l’intervalle de confiance est élevé vers les parties extrêmes des courbes en raison du manque de données et nécessite une interprétation prudente. Station ornithologique suisse, 2022
Engoulevent: Stratégie de conservation 11 Fig. 10. Site de chasse de l’Engoulevent en Valais central dans une prairie extensive. Photo : J.-N. Pradervand Fig. 11. Site de chasse de l’Engoulevent en Valais central dans une vigne enherbée. Ces vignes ont très souvent des structures supplémentaires, comme des haies, des arbres ou des talus de route. Photo : R. Evens. Station ornithologique suisse, 2022
Engoulevent: Stratégie de conservation 12 Fig. 12. Des structures enherbées, ainsi que des arbres et des buissons, rendent le vignoble très attractif pour l’Engoulevent, mais aussi pour l’Alouette lulu et le Bruant zizi. Photo : F. Leugger. 2.2.2 Mesures de conservation dans les sites de chasse La mise en place de mesures en faveur de l’Engoulevent nécessite la prise en compte de plusieurs facteurs. Le premier point consiste à vérifier la disponibilité en prairies extensives et/ou en vignes en- herbées à proximité des sites de nidification, soit dans un rayon de 1,3 km, 2 km au maximum. Il ne semble pas que des surfaces importantes d’habitats secondaires soient nécessaires, en tout cas dans le vignoble, puisque quelques parcelles extensives suffisent à attirer les oiseaux. Il est en revanche important de conserver des structures en mosaïque, alternant des zones de structures avec des zones d’herbages. On ne dispose pas de chiffres exacts, mais le manque de zones complémentaires pourrait potentiellement limiter la densité d’oiseaux nicheurs. On favorisera donc les mesures dans les zones tampons bordant les sites de nidification sur maximum 2 km, afin de proposer des sites de fourragement complémentaires aux sites existants (ces derniers doivent bien sûr être conservés). Zones ouvertes : prairies et pâturages Les prairies sont un point majeur pour la conservation de l’espèce. L’extensification de zones de prairies en plaine et sur le coteau est un élément capital pour le maintien de l’espèce en Valais, voire pour la reconquête de ses anciens bastions. L’Engoulevent profite d’un paysage varié et diversifié. Son utilisa- tion du territoire dépend principalement de la présence de prairies extensives. Ces prairies doivent com- porter des éléments de structure permettant la chasse à l’affût (par vols courts depuis un perchoir, à la façon des gobemouches). La présence de haies, d’arbres morts et de perchoirs en tout genre est donc très importante (fig. 10). L’entretien des prairies est nécessaire pour permettre le maintien de cette espèce exigeante. L’utilisation de prairies est variée puisque les individus chassent dans les zones steppiques dans les sites de nidification, mais utilisent des prairies sur leurs sites de chasse. Ainsi, des prairies de fauche et des pâturages semi-extensifs à semi-intensifs sont plébiscités sur les sites de chasse. Il est toutefois important que l’irrigation reste minimale, de même que les apports en lisier. On privilégiera une fauche tardive en mosaïque (15 juin pour la zone 1 de plaine et 1er juillet pour la zone Station ornithologique suisse, 2022
Engoulevent: Stratégie de conservation 13 2), tout en limitant idéalement la hauteur de coupe à 10 cm afin de ne pas attaquer le sol et de permettre à un maximum d’invertébrés de survivre à la fauche. Dans l’idéal, on laissera des bandes herbeuses non fauchées d’une année à l’autre afin que les insectes puissent effectuer leurs cycles complets. La présence d’Engoulevent est tout à fait compatible avec le pâturage pour autant qu’il reste extensif en limitant les UGB. Le pâturage permet d’ailleurs de conserver des prairies ouvertes et est donc à favoriser dans les zones de chasse. Finalement, la mesure de protection la plus efficace consisterait à ce que ces zones agricoles utilisées par l’espèce puissent passer en zone agricole protégée dans les nouveaux plans d’affectation de zones afin de garantir la pérennité de ces sites. De même ces sites devraient figurer dans les projets de réseaux écologiques. Le vignoble L’espèce utilise principalement le vignoble dans la région de Salquenen. Cela vient probablement du fait que la surface de vignes enherbées y est très importante et que les structures y sont localement nombreuses (haies et petites surfaces agricoles). Fig. 13. Exemples de mesures permettant de regagner des structures dans le vignoble. A gauche, une haie bordant un chemin, rehaussée de fruitiers haute tige. A droite, une parcelle abandonnée où une prairie est en cours d’installation, bordée par des buissons et quelques haute-tige. Photo : F. Steffen Une amélioration de l’attractivité des parcelles de vigne peut être mise en œuvre via des mesures de plantation de haies et d’arbres à haute-tige, et d’un enherbement du sol diversifié et clairsemé (fig. 13 à gauche). De plus, la situation actuelle avec l’augmentation de parcelles de vignes abandonnées offre la possibilité de transformer ces dernières en prairies sèches, pâturages extensifs ou vergers haute-tige (Fig. 13 à droite). On favorisera ces zones dans un rayon de 1,3 km à 2 km autour des sites de nidifica- tion, afin de s’assurer de leur accessibilité pour les oiseaux. Ce projet, déjà en cours dans la région de Salquenen et de Loèche, vise la mise en prairie ou la plantation de haies ou de fruitiers dans de petites parcelles de vignoble, afin de restaurer la diversité perdue au cours de années. Il faut aussi profiter de la situation juridique demandant d’instaurer des bandes tampon exemptes de pesticides et herbicides entre la vigne et les cours d’eaux (Ordonnance sur la protection des cours d’eaux, art. 41c, al. 3, ainsi que l’Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques ORRChim, Annexes 2.5 et 2.6). Ces espaces peuvent être récupérés pour créer des structures favorables à la faune sans empiéter sur le vignoble. Station ornithologique suisse, 2022
Engoulevent: Stratégie de conservation 14 2.3 Schéma décisionnel pour la mise en place de mesures en faveur de l’Engoulevent d’Europe Station ornithologique suisse, 2022
15 2.4 Sélection des zones pour des mesures en faveur de l’Engoulevent Le choix de zones pour mettre en œuvre des mesures pour l’Engoulevent d’Europe doit suivre le schéma décisionnel (chapitre 3.3). En cas de mesures sur les sites de nidification, il est nécessaire de travailler des zones qui sont voisines de sites occupés ou qui étaient jadis elles-mêmes occupées, afin de garantir que le site soit attractif. Il est important de prendre en compte la repousse de la végétation, facteur capital lors de la mise en place de mesures forestières. Une ouverture embroussaillée ne sera pas attractive pour l’Engoulevent. Un plan des différentes zones occupées par l’engoulevent, ainsi que des sites favorables (nidification et chasse) pour des mesures peuvent être fournis au cas par cas lors de la mise en place de mesures de conservation en Valais.
Engoulevent: Stratégie de conservation 16 3. Références Bosco, L. & A. Jacot (2020): Quantification of the ground vegetation cover in Valais vineyards based on satellite imageries – final report 2018. Schweizerische Vogelwarte, Sempach Eisenring, E., M. Eens, J.-N. Pradervand, J. Jacot, A., Baert, E. Ulenaers, M. Lathouwers & R. Evens (2022): Quantifying song behavior in a free-living, light-weight, mobile bird using accelerometers. Ecol. Evol. 12e8846 Evens, R., N. Beenaerts, E. Ulenaers, N. Witters & T. Artois (2018a): An effective, low-tech drop-off solution to facilitate the retrieval of data loggers in animal-tracking studies. Ring. Migr. 33: 10-18. Evens, R., N. Beenaerts, T. Neyens, N. Witters, K. Smeets & T. Artois (2018b): Proximity of breeding and foraging areas affects foraging effort of a crepuscular, insectivorous bird. Sci. Rep. 8: 3008. Evens, R., A. Jacot, T. Artois, E. Ulenaers, T. Neyens, L. Rappaz, C. Theux & J.-N. Pradervand (2021): Improved ecological insights commission new conservation targets for a crepuscular bird species. Anim. Conserv. 24: 457-469. Glutz von Blotzheim, U. N. & K. M. Bauer (1980): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 9, Columbiformes - Piciformes. Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden. Jacot, A. & E. Revaz (2014): Massnahmen zur Rettung des Ortolans in den Leuker Felsensteppen. Schlussbe-richt Phase 1: 2010–12. Schweizerische Vogelwarte, Aussenstelle Wallis, Sion. Knaus, P., R. Graf, J. Guélat, V. Keller, H. Schimd & N. Zbinden (2011): Atlas historique des oiseaux nicheurs. La répartition des oiseaux nicheurs de Suisse depuis 1950. Station ornithologique suisse, 336 pp. Knaus, P., S. Antoniazza, S.Wechsler, J. Guélat, M. Kéry, N. Strebel & T. Sattler (2018): Atlas des oiseaux nicheurs de Suisse 2013-2016. Distribution et évolution des effectifs des oiseaux en Suisse et au Liechtenstein. Station ornithologique suisse, 648 pp. Polakowski, M., M. Broniszewska & L. Kirczuk (2020): Habitat Selection by the European Nightjar Caprimulgus europaeus in North-Eastern Poland : Implications for Forest Management. Forests. 11: 291. Sharps, K., I. Henderson, G. Conway, N. Armour-Chelu & P. M. Dolman (2015): Home-range size and habitat use of European Nightjars Caprimulgus europaeus nesting in a complex plantation-forest landscape. Ibis. 157: 260-272. Sierro, A. (2016): Interventions forestières en faveur de l’Engoulevent en Valais (Alpes suisses). - Bilan de 22: 1993–2014. Station ornithologique suisse. 33 pp. Sierro, A. & A. Erhardt (2019): Light pollution hampers recolonization of revitalised European Nightjar habitats in the Valais (Swiss Alps). J. Ornithol. 160: 749-761. Sierro, A., R. Arlettaz, B. Naef-Daenzer, S. Strebel & N. Zbinden (2001): Habitat use and foraging ecol- ogy of the nightjar (Caprimulgus europaeus) in the Swiss Alps: towards a conservation scheme. Biol. Cons. 98: 325-331. Wagner, D. L., E. M. Grames, M. L. Forister, M. R. Berenbaum & D. Stopak (2021): Insect decline in the Anthropocene : Death by a thousand cuts. PNAS. 118: 1-10. Wildi, J. (2021): Modelling habitat preference of the endangered European Nightjar in the Swiss Alps. Université de Lausanne, 45 pp. Winiger, N., P. Korner, R. Arlettaz & A. Jacot (2018): Vegetation structure and decreased moth abun- dance limit the recolonisation of restored habitat by the European Nightjar. Rethink. Ecol. 3: 25–39. Station ornithologique suisse, 2022
Vous pouvez aussi lire