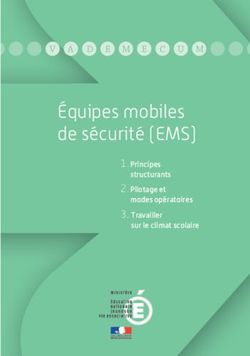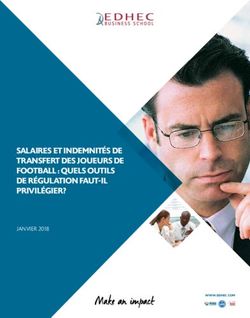Analyse de la procrastination en lien avec des stratégies de régulation émotionnelle cognitive consciente chez des
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Mémoire de Master en enseignement secondaire II (Master of Advanced Studies) « Analyse de la procrastination en lien avec des stratégies de régulation émotionnelle cognitive consciente chez des gymnasiens vaudois » Auteures : Cachot Amélie & Curto Reyes Verdad Sous la direction de : Phillipe Gay Membre du jury : Elena Lucciarini Lausanne, juin 2021
1
Table des matières 1. Introduction 3 Histoire de la procrastination 3 Définition de procrastination 3 Causes et corrélations de la procrastination 3 Stratégies de régulation émotionnelle 5 2. Objectifs de la recherche 6 3. Méthodologie 6 3.1. Participants et procédure 6 3.2. Mesures 6 3.2.1. Mesure de la procrastination 6 3.2.2. Mesure des stratégies de régulation émotionnelle 7 4. Résultats et Discussion 7 4.1. Analyses préliminaires 7 4.2. Analyses descriptives et corrélationnelles 7 4.2.1 Analyse de la procrastination 8 4.2.2. Analyse de la régulation émotionnelle consciente 9 4.2.3. Analyse de la corrélation entre la procrastination et la régulation émotionnelle consciente 10 4.2.4. La question de la motivation en lien avec la procrastination 12 4.3. Analyse qualitative liée à la tâche 13 4.4. Analyses complémentaires 14 5. Conclusion et Perspectives 15 6. Références 17 7. Annexe 20 Annexe I. Table supplémentaire 20 Annexe II. Table supplémentaire 20 Annexe III. Questionnaire PPS 21 Annexe IV. Questionnaire CERQ 22 Annexe V. Fiche de consigne pour la tâche 25 2
1. Introduction Histoire de la procrastination La procrastination a été depuis les débuts de l'histoire humaine considérée comme un trait négatif de la personnalité d’un individu. Les premières mentions au fait de procrastiner datent de la Grèce antique, où les poètes comme Hésiode (800 a. JC) ou des hommes politiques, tel que Thucydide (400 a. JC), la décrivent dans leurs écrits comme l’une des caractéristiques les plus indésirables des Hommes. De la même façon, Cicéron utilise la procrastination dans l’un de ses discours pour critiquer certaines attitudes de Marcus Aurelius vers l'an 44 a. JC. Durant l’âge moderne, elle est mentionnée à plusieurs reprises dans des homélies et des textes qui alertent sur le caractère négatif de la procrastination en tant que péché capital. La première analyse historique de la procrastination a été effectuée par Milgram (1992) qui établit un lien avec le développement des sociétés actuelles. Les sociétés “civilisées” et leurs progrès techniques imposent des nombreuses échéances et engagements qui causent une augmentation de la procrastination. Au contraire, les sociétés agraires, moins développées, semblent moins affectées. Définition de procrastination Le terme procrastination dérive du latin et est composé du mot procrastinatio qui signifie « délai, ajournement », lui-même dérivé, par l’intermédiaire de crastinus, « relatif au lendemain » et de cras, « demain ». Le dictionnaire de la langue française définit la procrastination comme une tendance à remettre au lendemain, à différer les tâches que l’on doit accomplir. Cette définition est la plus considérée et acceptée par la société, dans la compréhension du concept général de la procrastination. Steel (2007) étend cette définition en mentionnant notamment les conséquences liées à la procrastination : “Le report volontaire et non nécessaire d’une action, malgré ses inévitables conséquences négatives et/ou désagréables”. La procrastination traitée dans ce mémoire sera centrée dans sa dimension académique. La procrastination dans le milieu académique, a été décrite par Senécal, Julian, et Guay (2003) comme la prédisposition irrationnelle à retarder le début et/ou la complétion d’une tâche académique. Certaines recherches montrent que les élèves citent la procrastination comme l’un des plus importantes sources de stress et également comme la cause de leur mauvaise performance académique. Contrairement à ces ressentis et perceptions, les résultats d’analyses de la relation entre la procrastination et la performance académique montrent une corrélation très modérée ou inexistante entre ces deux variables, indiquant une plus grande complexité au recours à la procrastination, que l’utilisation de mauvaises habitudes d'apprentissage ou d’un effet de sentiments perturbateurs (Day, Mensink, & O'Sullivan, 2000). Causes et corrélations de la procrastination Actuellement, la recherche se concentre principalement dans l’exploration des différentes causes, conséquences et éventuelles corrélations de la procrastination avec différents domaines. Klingsieck (2013) a proposé une classification des travaux publiés sur la procrastination en fonction de la perspective traitée : trait de personnalité (perspective de la psychologie différentielle), sa relation avec la psychologie clinique, l’étude des aspects d’une tâche qui suscitent un comportement procrastinateur (perspective situationnelle), ainsi que sa corrélation avec des variables motivationnelles (perspective de la psychologie motivationnelle). 3
1. Perspective de la psychologie différentielle. Selon ce point de vue, la procrastination est
abordée comme un trait de personnalité et la recherche est centrée sur la corrélation entre ce
trait et d’autres traits. Les études montrent que la procrastination est principalement liée avec
un neuroticisme et un perfectionnisme accru ainsi qu’avec une attention au détail, une estime
de soi et un optimisme réduit.
2. Perspective de la psychologie clinique. Cet aspect se centre principalement sur les
conséquences négatives de la procrastination, tels que l’anxiété, la dépression et le stress.
Engberding, Frings, Höcker, Wolf, et Rist (2011) ont proposé leur catégorisation comme
trouble psychologique, sous certaines conditions de durée, intensité et conséquences physiques
et psychologiques.
3. Perspective situationnelle. Cette optique est portée sur le contexte qui entoure la
procrastination. Les caractéristiques autour de la tâche seraient donc les responsables d’avoir
recours au fait de procrastiner : difficulté et attractivité de la tâche (Ackermann & Gross, 2005),
caractéristiques du professeur (Schraw, Wadkins, & Olafson, 2007), entre autres.
4. Perspective de la psychologie volitionniste et motivationnelle. Cette approche considère la
procrastination comme un manque de motivation ou/et volition qui mène à l’échec de transposer
des intentions en faits (intention-action gap, pour une revue, voir Sheeran & Webb, 2016). Dans
ce domaine, la recherche s’est centrée sur l’analyse de la corrélation entre des variables
motivationnelles et la procrastination. Les résultats ont montré que les individus procrastinent
moins si l’activité à faire est motivée intrinsèquement, imposée pour soi-même ou procure un
sentiment élevé d’efficacité personnel (increased self-efficacy), tandis qu’une basse aptitude
d’autorégulation et d'autocontrôle sont souvent liés au fait de procrastiner. En outre, la capacité
à gérer et s’orienter dans le temps ainsi que des stratégies d’apprentissage influencent sur les
comportements procrastinateurs.
La perspective motivationnelle a engendré plusieurs théories explicatives de la procrastination. La plus
exhaustive étant la Théorie de la motivation temporelle (Steel & König, 2006) qui met l’accent sur le
temps comme facteur principal dans la motivation à accomplir une tâche. Cette théorie est composée
de quatre facteurs : l’expectative (efficacité), valeur (récompense associée au résultat de la tâche), délai
(temps jusqu’à finaliser la tâche) et impulsivité (incapacité à résister des désirs étrangers à la tâche). La
relation entre ces facteurs est exprimée par la formule suivante :
Motivation = (Expectative × Valeur) / {1 + (Impulsivité × Délai)}
Dans cette équation, la motivation est le désir que possède un individu dans l’obtention d’un résultat
pour une tâche concrète. La motivation pour accomplir une tâche sera d’autant plus haute si la valeur
portée à la tâche et l’efficacité de l’individu est élevée, tandis que l’impulsivité et un délai étendu pour
accomplir une tâche diminuent la motivation. En résumé, la motivation résulte de la valeur accordée à
une tâche donnée, l’attente estimée afin d’accomplir une tâche, l'immédiateté de la récompense et notre
capacité à retarder la satisfaction à court terme (Steel, 2012).
La procrastination implique donc une altération du cours de l’action d’une tâche et interfère,
présumablement, avec la performance dans celle-ci. Les tâches académiques et liées à la sphère du
travail sont les plus affectées (Tice & Baumeister, 1997). Or, il est surprenant que les études révèlent
une faible corrélation entre la procrastination et la performance, en dépit du niveau de stress qu’elle
engendre (Steel, 2007). Ce caractère stressant de la procrastination a une influence directe sur la santé
physique et mentale des élèves, en faisant un enjeu majeur, au centre de la recherche actuelle.
4Les interventions de type cognitive désirant atténuer, entre autres, le perfectionnisme, la peur de l’échec et le manque de confiance en soi, qui interfèrent avec la capacité à s’engager dans une tâche, sont souvent mises en place afin de diminuer des comportements procrastinateurs (Rozental & Carlbring, 2014). Dans notre travail de recherche, nous désirons établir un possible lien entre la procrastination et les stratégies de régulation émotionnelle. De fait, une évaluation de ces potentiels liens, permettrait par la suite et par diverses interventions, l’encouragement de stratégies de régulation émotionnelle adaptatives en vue d'atténuer ce comportement. De plus, la question de la procrastination considérée sous l’optique d’une perspective motivationnelle, en lien avec les stratégies de régulation émotionnelle, nous a semblé importante à analyser, afin d’également présenter différentes clés d’action aux élèves. Stratégies de régulation émotionnelle Le concept de régulation émotionnelle a été défini par Thompson en 1994 comme “tous les processus intrinsèques et extrinsèques responsables de surveiller, évaluer et modifier des réactions émotionnelles, surtout leurs caractéristiques temporelles et d’intensité, afin de réussir nos objectifs”. Les émotions sont régulées d’une part, par des changements physiologiques : une augmentation dans la fréquence respiratoire, une hausse du pouls sanguin ou une augmentation de la transpiration, entre autres. D’autre part, la régulation émotionnelle est faite par des processus cognitifs non conscients (projection, déni, distorsion de la mémoire... et conscients (rumination, dramatisation, blâme de soi…) (Garnefski et al., 2002). Dans leur article descriptif du Cognitive Emotional Regulation Questionnaire ou CERQ, Garnefski et collègues décrivent neuf stratégies cognitives de régulation des émotions qui sont utilisées de façon volontaire. Ces neuf stratégies sont, à leur tour, divisées en deux groupes : stratégies adaptatives et non- adaptatives. Les auteurs décrivent une corrélation entre l’utilisation de stratégies non adaptatives et une hausse des symptômes de dépression et anxiété et le contraire, une diminution de ces symptômes à la suite de l’application de stratégies adaptatives (Garnefski et al., 2001). En ce qui concerne les stratégies adaptatives, on peut retrouver cinq types : 1. L'acceptation - Pensées concernant l’acceptation et la résignation de ce qu’il est passé. 2. La centration positive - Pensées centrées sur des événements joyeux en dépit de l'événement réel. 3. La centration sur l’action - Concernant les pensées sur comment gérer l'événement négatif et quelles actions mettre en place pour le résoudre. 4. La réévaluation positive - Pensées donnant un sens positif à l'événement en termes de développement personnel 5. La mise en perspective - Référant aux pensées diminuant l’importance de l’événement et sa relativité en comparaison avec d’autres événements. Concernant les stratégies non-adaptatives, on en retrouve quatre : 1. Le blâme de soi - Référant aux pensées de blâme à soi-même pour ce qui est arrivé. 2. Le blâme d’autrui - Regroupant les pensées de blâme dirigées aux autres pour ce qu’on a vécu. 3. La rumination - Pensées centrées sur les sentiments et pensées associés à l’événement négatif. 4. La dramatisation - Toutes les pensées relatives à emphatiser la terreur d’une expérience. 5
Dans ce mémoire de master, nous nous sommes donc concentrées sur l’importance d’évaluer les différentes stratégies mises en place par les élèves et leur corrélation avec leurs niveaux de procrastination. Étant donné que la procrastination est associée non seulement à des conséquences négatives concernant la tâche à effectuer, mais également à une réduction de la qualité de vie (Klingsieck, 2013) des procrastinateurs, les résultats obtenus nous permettront d’émettre des recommandations d’outils afin de mieux gérer les émotions et réduire les comportements associés à une haute procrastination. 2. Objectifs de la recherche 1. Mesurer la procrastination des élèves vaudois suivant la maturité gymnasiale. 2. Évaluer les stratégies de régulation émotionnelle des élèves vaudoises suivant la maturité gymnasiale. 3. Décrire les possibles corrélation entre les facteurs (délai volontaire et observé) de la procrastination et les stratégies adaptatives et dysfonctionnelles de régulation émotionnelle. 4. Émettre des recommandations en concordance avec les résultats obtenus afin d’améliorer la qualité de vie des élèves. 3. Méthodologie 3.1. Participants et procédure L’échantillon est composé de 98 élèves de maturité (74 femmes, 24 hommes) recrutés directement dans les classes dans lesquelles nous effectuons nos stages. Les élèves sont âgés de 15 à 20 ans (m=16.45, =1) et effectuent leur maturité dans le canton de Vaud. Les classes concernées impliquent uniquement des élèves en maturité gymnasiale, dont les élèves interrogées sont actuellement en première année soit de culture générale (socio-pédagogique) ou maturité (options mixtes), des élèves en deuxième et troisième année, soit en discipline fondamentale ou options spécifiques de disciplines distinctes. La récolte des données s’est effectuée entre les mois d’avril et de mai 2021. Tous les questionnaires anonymes ont été remplis par les répondants via un questionnaire en ligne “Google Forms”. 3.2. Mesures Après une brève série de questions démographiques (âge, genre, parcours de formation et degré d’enseignement) visant essentiellement à caractériser les participants, ces derniers ont complété les questionnaires présentés ci-dessous. 3.2.1. Mesure de la procrastination L’adaptation française de l’échelle Pure Procrastination Scale ou PPS, a été utilisée afin d’évaluer la procrastination de manière auto-rapportée (PPS; Rebetez et al., 2014; version originale, Steel, 2010). Le questionnaire est composé de 11 items, sur une échelle en 5 points (1 = très rarement ou pas du tout, 5 = très souvent ou toujours). Deux facteurs de la procrastination sont mesurés : le Délai volontaire, mesuré par 8 items (p.ex. « Je me dis sans cesse « je le ferai demain »), et le Délai observé, mesuré par 6
3 items (p.ex. « Je me retrouve souvent à manquer de temps »). Ces deux facteurs dépendent d’un construit sur-ordonné de la procrastination. Des scores élevés montrent une forte tendance à procrastiner. 3.2.2. Mesure des stratégies de régulation émotionnelle Pour évaluer les stratégies de régulation émotionnelle, nous utiliserons la version francophone du CERQ (Jermann et al., 2006), un questionnaire en 36 items évalués sur une échelle de Likert à cinq modalités de réponse allant de 1 (presque jamais) à 5 (presque toujours). Le CERQ permet d’identifier neuf stratégies de régulation émotionnelle cognitive utilisées de manière consciente ou volontaire et fournit en plus un score de stratégies adaptatives (regroupant l’acceptation, la centration positive, la centration sur l’action, la réévaluation positive, et la mise en perspective) en ce qu’elles permettent de réduire le niveau de dépression et d’anxiété, et un score de stratégies dysfonctionnelles (regroupant le blâme de soi, la rumination, la dramatisation et le blâme d’autrui) en ce qu’elles exacerbent les difficultés émotionnelles. Pour tous ces scores, des valeurs plus élevées correspondent à une utilisation accrue de ces stratégies. 4. Résultats et Discussion 4.1. Analyses préliminaires Pour l’ensemble des données recueillies, les conditions d’applications des analyses réalisées étaient acceptables. Afin de mesurer la fiabilité de l’ensemble du questionnaire, un alpha de Cronbach a été calculé pour chacunes des sous-échelles des deux questionnaires (cf. Table 1 et 2). L’alpha de Cronbach est une mesure variant entre 0 et 1, dont un score égal à 1 indique une très bonne cohérence interne dans les réponses données (George & Mallery, 2003). L’analyse préliminaire de la tâche ayant démontré un taux de participation de 34.7% sur l’ensemble de la cohorte d’élèves ayant répondu aux questionnaires PPS et CERQ (n=98), et le constat d’une participation dite complète (soit une passation des deux questionnaires et une participation à la tâche) mineure (moins de 10 élèves) au sein de ces deux groupes, nous a poussé à traiter et associer les données de la tâche effectuée avec les données quant à la procrastination et la régulation émotionnelle consciente, uniquement sous un angle qualitatif. 4.2. Analyses descriptives et corrélationnelles Le postulat des analyses préliminaires étant respecté, nous avons procédé avec l’analyse des corrélations entre les différentes variables mesurées. Étudier la corrélation entre deux variables revient à étudier l’intensité de la liaison existante entre ces dernières. Une corrélation forte indique de multiples liens entre les variables, à l’inverse une corrélation faible indique l’absence de liens entre les variables. Le coefficient de corrélation de Pearson, compris entre -1 et +1, a été utilisé pour les diverses corrélation testées. Une corrélation positive (située entre 0 et +1) indique que les variations des deux variables vont dans le même sens. Une corrélation négative (située entre 0 et -1) indique que les variations des deux variables vont dans un sens opposé. En sciences humaines, une corrélation est considérée comme forte lorsqu’elle est située entre -1 et -0.5 ou entre 0.5 et 1 ; elle est moyenne lorsqu’elle se situe entre -0.1 et 7
-0.5 ou entre 0.1 et 0.5 et faible lorsqu’elle est entre 0.1 et 0 ou entre -0.1 et 0. Dans la suite de ce mémoire, le coefficient de corrélation est annoté avec la lettre r. Plusieurs hypothèses ont été établies dans le but de répondre aux différents objectifs de recherche mentionnés précédemment: soit (i) mesurer la procrastination des élèves vaudois suivant une maturité gymnasiale; (ii) évaluer les stratégies de régulation émotionnelle des élèves vaudois suivant la maturité gymnasiale; (iii) décrire les possibles corrélation entre les facteurs (délai volontaire et observé) de la procrastination et les stratégies adaptatives et dysfonctionnelles de régulation émotionnelle puis (iv) émettre des recommandations en concordance avec les résultats obtenus afin d’améliorer la qualité de vie des élèves. La première hypothèse prévoit un niveau de procrastination inversement corrélé aux stratégies de régulation émotionnelle conscientes adaptatives, en particulier avec la réévaluation positive. La deuxième hypothèse préfigure un niveau de procrastination positivement corrélé avec les stratégies non adaptatives de la régulation émotionnelle consciente, en particulier avec la dramatisation, la rumination et le blâme de soi. Finalement, la dernière hypothèse postule l’existence d’une corrélation négative entre la procrastination chez les élèves présentant des moyennes en sciences et/ou une motivation associée à ces disciplines significativement plus élevée. Afin de tester ces hypothèses, les questionnaires PPS et CERQ ont été utilisés. Les Tables 1 et 2 illustrent les moyennes, les écarts-types et les indices de consistance interne relevés sur l’ensemble des participants. En addition, la question de la motivation autoévaluée par les élèves et leur moyenne dans les disciplines scientifiques de la biologie et de la physique ainsi qu’une brève étude de l’effet de genre sur le score de la procrastination, ont été mesurées (cf. Annexe I et Annexe II). 4.2.1 Analyse de la procrastination Comme illustré dans la Table 1, deux facteurs additionnels de la procrastination ont été mesurés, en addition de l’analyse de la procrastination dite général. Le facteur 1, appelé “délai volontaire”, est lié aux sous-échelles 1 à 8 et définit une dimension de la procrastination, dont le sujet remet volontairement à plus tard les tâches ou décisions à effectuer (p.ex. “Je me dis sans cesse, je le ferai demain”). Le second facteur, appelé “délai observé”, est lié aux sous-échelles 9 à 11 et inclut une réalisation du sujet de ne pas effectuer des tâches ou décisions dans un temps imparti (p.ex. “Je me retrouve souvent à manquer de temps”). Cependant, ce dernier ne prend pas systématiquement en compte la dimension volontariste du délai, face à une tâche ou une décision (Rebetez et al., 2014). Les alphas de Cronbach obtenus pour ces mesures s’étendent de 0.63 à 0.88 et sont donc considérés comme “acceptable” pour le facteur délai observé et “excellent” pour la procrastination générale et le délai volontaire. De façon générale, les valeurs pour les différentes sous-échelles du PPS sont comparables aux résultats obtenus par Rebetez et collègues (2014) (PPS; Rebetez et al., 2014; version originale, Steel, 2010), avec une moyenne pour la procrastination générale d’environ 38.33 (8.03). Bien que présentant des cohortes dont la moyenne d'âge diffère significativement, et dont le contexte s’étend au-delà du milieu scolaire, il est intéressant de noter la présence systématique de procrastination chez l’ensemble des participants. Cette observation valide une estimation de 75% à 90% de la procrastination au sein des élèves (O’Brien, 2002), mais également l’existence plus systémique d’une procrastination chronique affectant 15-20% des adultes (Harriott & Ferrari, 1996; “Haven’t Filed Yet,” 2003). Ces résultats suggèrent une perméabilité partielle et une continuité dans l’utilisation de la procrastination entre le domaine scolaire et hors scolaire. 8
Comme attendu, les deux sous dimensions de la procrastination montrent entre-elles une corrélation significative positive (r = .53, p < .05**), et sont également corrélées de manière significative avec la procrastination générale ((r = .96, et r = .75, p < .05**pour le délai volontaire et pour le délai observé, respectivement). Moyenne Écart-type α PPS PPS Procrastination générale 38.33 8.03 0.88 PPS - F1 Procrastination F1 (délai volontaire) 29.43 6.31 0.88 PPS - F2 Procrastination F2 (délai observé) 8.9 2.64 0.63 Table 1. Moyennes, Écarts-types et Alpha de Cronbach des participants de cette étude au questionnaire PPS. Les analyses portent sur une cohorte de 98 participants. (PPS : « pure procrastination scale » soit la procrastination de manière auto-rapportée, PPS-F1: délai volontaire et PPS-F2: délai observé) 4.2.2. Analyse de la régulation émotionnelle consciente L’analyse descriptive des résultats obtenus quant à la régulation émotionnelle consciente est représentée dans la Table 2. Globalement, l’ensemble des valeurs obtenues pour les moyennes, les écarts-types et les alphas de Cronbach des différentes sous-échelles du CERQ sont comparables aux valeurs trouvées au sein d’une population francophone de Jermann et al. (2006) ainsi que dans diverses études internationales portant sur des adolescents (Garnefski et al., 2002; Garnefski & Kraaij, 2007) Moyenne Écart-type Étendue α CERQ Acceptation 11.7 3.35 4 - 20 0.77 Centration positive 15.86 3.25 4 - 20 0.86 Centration sur l’action 13.75 3.38 4 - 20 0.84 Rée ́valuation positive 11.87 3.82 4 - 20 0.74 Mise en perspective 14.51 3.42 4 - 20 0.85 Blâme de soi 14.13 3.21 4 - 20 0.81 Rumination 14.08 3.99 4 - 20 0.72 Dramatisation 9.28 3.57 4 - 20 0.64 Blâme d’autrui 9.24 3.2 4 - 20 0.78 Stratég ies adaptatives globales 70.44 10.92 20 - 100 0.86 Stratég ies non adaptatives globales 43.96 8.68 20 - 100 0.8 Table 2. Moyennes, Écarts-types, Étendues et Alpha de Cronbach des participants de cette étude au questionnaire de la régulation émotionnelle consciente. Les analyses portent sur une cohorte de 98 participants. (CERQ : questionnaire de la régulation émotionnelle consciente) À l’exception de l’échelle “dramatisation”, qui présente une cohérence interne “acceptable”, les autres sous-échelles évaluées sont considérées comme “bonnes ou excellentes”. 9
Les résultats montrent notamment un score moyen supérieur dans les stratégies adaptatives (moyenne : 70.44) en comparaison aux stratégies non adaptatives (moyenne : 49.36). Les stratégies adaptatives les plus mobilisées semblent inclure la mise en perspective et la centration positive. Au contraire, la rumination et le blâme de soi constituent des stratégies non adaptatives prépondérantes au sein des élèves interrogés. 4.2.3. Analyse de la corrélation entre la procrastination et la régulation émotionnelle consciente Premièrement, les liens entre la PPS et les stratégies adaptatives du CERQ, distinguées en deux groupes, soit les stratégies adaptatives générales et non adaptatives générales, ont été analysés et représentés dans la Figure 1. Les Tables 3 et 4 montrent de manière plus étendue, les coefficients de corrélation de Pearson entre les diverses sous-échelles des stratégies adaptatives et non adaptatives du CERQ et la PPS mesurés à travers cette analyse. Les résultats montrent une absence de corrélation entre les stratégies adaptatives et la procrastination générale. En revanche, les résultats abordant la relation entre procrastination avec les différentes échelles des stratégies adaptatives montrent une corrélation significative pour la dimension du délai observé de la procrastination et la capacité de mise en perspective, en tant que stratégie adaptative, en particulier (r = .25 , p
50 60 70 80 90 100 50 ppsParamG * 40 Density 0.24 0.021 30 20 100 x cerqParamAdapt 90 80 Density −0.12 70 60 50 70 x cerqParamInadapt 60 50 Density 40 30 20 30 40 50 30 40 50 60 70 x Figure 1. Corrélation entre la procrastination et les stratégies adaptatives ou non adaptatives de la régulation émotionnelle consciente. Ces corrélations ont été effectuées sur une cohorte de 98 participants. Les p-values sont annotées selon *,** et ***p< .05 (PPS: pure procrastination scale; cerqParamAdapt : stratégies adaptatives de la régulation émotionnelle consciente ; cerqParamInadapt : stratégies non adaptatives de la régulation émotionnelle consciente) La procrastination serait donc la résultante évolutive de l’impulsivité (Gustavson et al., 2014). Ce lien semble d’autant plus renforcé par une présence élevée de pensées intrusives, notamment sous la forme de pensées prolongées et répétitives sur soi, ses expériences et préoccupations propres, appelées rumination (Stainton, Lay & Flett, 2000). L’absence de corrélation entre la procrastination et la rumination observée, bien qu’élevée au sein de notre cohorte, peut peut-être s’expliquer par la mesure trop générale des caractéristiques de la rumination. En effet, et comme suggéré par Rebetez et al. (2018), au contraire de pensées furtives et préoccupations transitoires (daydreaming), la rumination impliquant une tendance procrastinatrice semble être médiée par des pensées plus intiment reliées à une vision négative du soi. Globalement, la nuance observée par les deux sous dimensions de la procrastination et l’impact distinct qu’elles induisent quant aux régulations émotionnelles conscientes, appuient l’importance de la distinction du délai volontaire et du délai observé et valide une conception multidimensionnelle de la procrastination, évoquée dans d’autres études (Díaz-Morales et al., 2006; Rebetez et al.,2015). 11
Stratégies Centration Centration sur Réévaluation Mise en Acceptation adaptatives positive l’action positive perspective globales PPS 0.06 [-.16, .28] -0.1 [-.31, .12] 0.08 [-.14, .29] -0.06 [-.28, .16] 0.09 [-.14, .30] 0.02 [-.20, .24] PPS - F1 0.02 [-.20, .24] -0.1 [-.31, .13] 0.05 [-.17, .27] -0.11 [-.32, .11] 0.01 [-.21, .23] -0.04 [-.26, .18] PPS - F2 0.14 [-.08, .35] -0.07 [-.29, .15] 0.11 [-.11, .33] 0.07 [-.16, .28] .25* [.03, .45] 0.16 [-.06, .37] Table 3. Corrélation entre le questionnaire PPS et les stratégies de régulation émotionnelle adaptatives mesurées par le questionnaire CERQ. Les corrélations ont été effectuées sur une cohorte de 98 participants. Les valeurs indiquées entre crochets représentent l’intervalle de confiance de 95% pour chaque corrélation et les p-values sont annotées selon *,** et ***p< .05 . (PPS: procrastination générale ; PPS-F1 : délai volontaire ; PPS- F2 : délai observé et CERQ : questionnaire régulation émotionnelle consciente). Stratégies non Blâme de soi Rumination Dramatisation Blâme d’autrui adaptatives globales PPS 0.06 [-.16, .28] -0.1 [-.31, .12] 0.08 [-.14, .29] -0.06 [-.28, .16] .24* [.02, .44] PPS - F1 0.02 [-.20, .24] -0.1 [-.31, .13] 0.05 [-.17, .27] -0.11 [-.32, .11] .30** [.02, .44] PPS - F2 0.14 [-.08, .35] -0.07 [-.29, .15] 0.11 [-.11, .33] 0.07 [-.16, .28] 0.01 [-.21, .23] Table 4. Corrélation entre le questionnaire PPS et les stratégies de régulation émotionnelle non adaptatives mesurées par le questionnaire CERQ. Les corrélations ont été effectuées sur une cohorte de 98 participants. Les valeurs indiquées entre crochet représentent l’intervalle de confiance de 95% pour chaque corrélation et les p-values sont annotées selon *,** et ***p< .05 . (PPS : procrastination générale ; PPS-F1 : délai volontaire et PPS-F2 : délai observé et CERQ : questionnaire régulation émotionnelle consciente). 4.2.4. La question de la motivation en lien avec la procrastination L’analyse des résultats, représentée en annexe (cf. Annexe I), montre une absence de corrélation significative, qu’elle soit positive ou négative, entre la motivation autoévaluée des participants et les notes obtenues dans les disciplines scientifiques en lien la procrastination. De même, aucune corrélation n’a été observée entre les moyennes de sciences et la motivation autoévaluée des participants. Ainsi, les résultats de notre étude semblent rejeter nettement la troisième hypothèse posée dans le cadre de ce mémoire. Ces observations sont en lien avec la littérature, dont le lien entre la procrastination et les performances des élèves est majoritairement faible, voire inconsistant. Ainsi, bien que génératrice de stress, la procrastination semble avoir un impact que mineur sur l'assiduité dans l'exécution des devoirs, la moyenne générale des élèves et leur performance dans les examens finaux (Steel, 2007). 12
La distinction de trois co-construits de la motivation évoquée par Rebetez et al. (2015), incluant ; la motivation intrinsèque, dont l’impulsion est conduite uniquement par l’intérêt et le plaisir que l’individu trouve à la tâche ; la motivation extrinsèques, résultante de contingences externes (tel que des aspects de punition, récompense, pression sociale, ...) et la motivation, dont la personne a le sentiment d’être soumis à des facteurs hors de tout contrôle, permet de nuancer ce constat. En effet, si nos résultats quantitatifs valident l’absence de corrélation entre la procrastination, la motivation et les performances, les résultats liés à la tâche suggèrent une tendance moins procrastinatrice des élèves dont la motivation extrinsèque, soit une sanction dans le cas d’une non-participation à la tâche, était plus haute. L’analyse qualitative liée à la tâche est présentée au point suivant. 4.3. Analyse qualitative liée à la tâche En regard de la tâche imaginée dans le cadre de ce projet, et comme représenté dans la Figure 2, seuls 34 élèves soit 34.7% de la cohorte des 98 participants ayant répondu au questionnaire en ligne, ont effectué le devoir demandé. Parmi les 34 élèves, 10 (29.4%) ont rendu leur dossier à la date limite ; 16 élèves (47%) ont rendu leur dossier 1 jour ; 5 élèves (14.7%) ont rendu leur dossier 2 jours avant la date limite et seulement 3 élèves ont rendu leur dossier 3, 5 et 12 jours respectivement avant la date butoir. A B 34.7% 1Date limite 29.4% 21 jour avant 47 % 32 jours avant 14.7 % 43 jours avant 2.9 % 55 jours avant 2.9 % 612 jours avant 2.9 % Figure 2. Graphique représentant le pourcentage de participation et la date du rendu de la tâche. Panel A. Pourcentage de participation à la tâche (n=34). Panel B. Pourcentages des différents rendus des élèves, en fonction de l’échéance de rendu de la tâche parmi les 34 élèves. Par ailleurs, sur les 34 élèves mentionnés, 20 élèves font partie d’une classe de première année de culture générale, dont la consigne donnée lors de la présentation de la tâche, sanctionnait une absence de rendu. Ceci n’a pas été formulé au sein des autres classes participatives. Il est donc intéressant de relever que la majorité des élèves ayant effectué la tâche étaient sous “la menace” d’une sanction, contrairement au reste des élèves. Ici et comme évoqué plus haut, la motivation extrinsèque exercée sur cette classe semble avoir eu un impact fort sur la capacité des élèves à réguler et contenir l’urgence de satisfaire des besoins immédiats et le système de récompenses qui leur sont associés. D’autre part, l’impact de la diminution du délai évoqué dans la théorie de la motivation proposée par Steel (2012), permet d’expliquer la concentration observée des élèves ayant envoyé leur devoir 1 jour avant la date butoir. 13
4.4. Analyses complémentaires Bien que ne faisant pas partie des hypothèses de départ pour ce mémoire, de nombreuses études examinent les potentielles différences du genre dans la procrastination et l’utilisation de régulation émotionnelle consciente. Notamment, la complexité observée quant à l’anticipation de l’impact du genre sur la procrastination, dû à l’imbrication de celle-ci avec la dimension de maîtrise de soi reportée comme significativement plus élevée chez les femmes (Else-Quest et al.,2006), nous est apparue comme intéressante à comparer avec les stratégies émotionnelles conscientes invoquées dans notre propre cohorte. De plus, face au constat d’une nette différence en termes du nombre de stratégies émotionnelles conscientes utilisées entre les sexes et de la dépendance marquée des femmes quant aux stratégies de rumination, dramatisation et centration positive (Garnefski et al., 2004), les analyses corrélationnelles complémentaires par distinction de genre, permettent d’apporter une complémentarité aux résultats obtenus, notamment à l’absence de corrélation entre procrastination et stratégies adaptatives observées dans notre étude. De fait, l'analyse effectuée montre l’existence d’une différence marquée dans l’utilisation de stratégies de la régulation émotionnelle consciente entre les hommes et les femmes. Comme illustré dans la Figure 3 et l’annexe IV, les hommes montrent un score significativement plus élevé que les femmes quant aux stratégies adaptatives de régulation émotionnelle consciente (t (98) = -3.96, p < .05***)). À l’inverse, l’analyse corrélationnelle faite entre les stratégies non adaptatives en relation avec le genre, n’a montré aucune différence. Similairement, aucun impact du genre a été relevé dans l’analyse de la procrastination, et ce dans toutes ses dimensions, ce qui contraste avec d’autres études (Rozental & Carlbring, 2014). Ainsi, la prédiction d’une tendance légèrement plus forte à la procrastination chez les hommes et inversement, une corrélation négative significative, associée à une autorégulation et un contrôle plus élevé chez les femmes (Feingold, 1994; Else-Quest et al., 2006) n’est pas vérifiée dans notre étude. A B CERQ – Stratégies non adaptatives CERQ – Stratégies adaptatives *** Femme Homme Femme Homme Figure 3. Box plots représentant le score moyen des différentes stratégies émotionnelles conscientes en lien avec le genre. Les scores moyens des stratégies adaptatives et non adaptatives sont représentés dans le panel A et B, respectivement. Ces tests ont été effectués sur une cohorte de 98 participants. Les groupes « Femme » et « Homme » ont été comparés en utilisant Welch t-test dont les p-values sont annotées selon *,** et ***p< .05 . (CERQ : questionnaire régulation émotionnelle consciente) 14
5. Conclusion et Perspectives La procrastination a été reportée comme associée à de plus importantes détresses psychologiques, notamment au niveau de la régulation des émotions, et des maladies physiques (Tice & Baumeister, 1997; Sirois & Tosti, 2012), une plus grande anxiété et dépression (Solomon & Rothblum, 1984) et une auto-efficacité basse (Klassen et al.,2008). Les nombreuses conséquences négatives liées à la procrastination et le constat de son étendue dans les milieux académiques, en fait un sujet de recherche important tant dans la compréhension de ses origines, que dans le développement d’outils d’évaluation mesure fiable et valide pour apporter des solutions concrètes aux personnes, et notamment aux élèves, présentant des tendances procrastinatrices. Plusieurs limitations doivent être mentionnées et prises en considération dans cette étude. Premièrement, les données utilisées reposent majoritairement sur une autoévaluation des participants et sont donc influencées par une vision biaisée de soi, parfois associée à des projections influencées par la société (Dunning et al., 2004). De plus, n’ayant mesuré que des variables liées à la motivation et la régulation émotionnelle consciente, cette étude n’approche une définition de la procrastination que dans ses dimensions restreintes. Une analyse incluant de plus amples dimensions, soit par leur conséquences ou causes, liées à la procrastination, contribuerait à la construction d’une vision plus complète de celle- ci. La variabilité intrinsèque aux différentes classes interrogées, allant de classes en première année culture générale à des troisièmes options spécifiques dans les branches scientifiques traités, bien qu’intéressante dans une vision plus systémique de l’identification de marqueurs de la procrastination, peut avoir entraînée des variations dans les résultats, notamment dans l’utilisation des notes moyennes en sciences et la motivation identifiée dans celles-ci. Par ailleurs, le manque de données associées à la tâche prévue, a grandement limité les associations possibles entre la procrastination mesurée de manière auto-rapportée et généralisée en termes de comportement, en comparaison avec une tâche ciblée sur les sciences, et dont la mesure aurait été plus précise. Malgré ces limitations, les analyses effectuées ont permis d’établir principalement une utilisation significativement plus importante de stratégies non adaptatives dans la régulation émotionnelle consciente chez des élèves identifiés comme présentant un score plus élevé de procrastination. Il est intéressant de relever que seule l'accumulation de plusieurs stratégies non adaptatives semble corrélée avec une plus haute procrastination, validant une construction multidimensionnelle de celle-ci. Au contraire, nos résultats démontrent l’absence de corrélation entre la procrastination et les stratégies adaptatives, ainsi qu’avec la moyenne la motivation et/ou des élèves interrogés. Le constat de l’absence d’un aspect motivationnel liée à la procrastination, en parallèle à une participation à la tâche mineure, réduite aux élèves dont la consigne du rendu impliquait une sanction, évoque le développement de stratégies « utilitaristes » au sein des participants. Ainsi, selon le cadre imposé, notamment l’implication de sanction selon un format d’évaluation sommative ou punitif, la majorité des élèves interrogés arrivent à réguler leurs tendances procrastinatrices pour ne pas se mettre en situation d’échec. Au regard de ces observations, et dans un aspect se rattachant davantage à notre pratique, il serait intéressant de travailler avec les élèves sur le développement de méthodes pour modifier leur propre pattern de procrastination, non seulement scolaire mais également dans une visée plus systémique. En effet, les tendances à une procrastination académique étant corrélées à une procrastination plus élevée dans les habitudes de vie générales des personnes interrogées (Ferrari, 2000), la construction d’alternatives dans un objectif d’éducation des futurs citoyens dont la bonne santé psychique et physique, semble être un enjeu majeur. 15
Les stratégies possibles et proposées en réponse à la procrastination agissent sur deux niveaux complémentaires. Elles incluent notamment des interventions dites comportementales et des interventions cognitives. Les interventions comportementales se construisent sur un ensemble de mesures permettant d’augmenter des automatismes, de faciliter la gestion du temps et de prévenir le sujet des distractions possibles lors de l'exécution d’une tâche (Van Eerde, 2000). La gestion de l'impulsivité face à des stimuli externes est un aspect qui peut être développé et discuté en partenariat avec les élèves, dans la sélection d’un espace filtrant une partie des distractions extérieures et permettant au sujet de lier directement le lieu à un comportement de travail attendu, tel que la création d’accès en salle d’étude ou en bibliothèque selon un temps limité (Ziesat, Rosenthal, & White, 1978). Parallèlement, les interventions cognitives tendent notamment à réduire et conscientiser l’écart existant entre ce que le sujet se représente d’une situation donnée et les objectifs réels et réalistes à atteindre. La fragmentation d’un objectif en sous-objectif plus proximaux, tant au niveau du contenu que dans la fixation d'échéance intermédiaire, favorise un sentiment d'auto-efficacité de l’élève et permet de diminuer les croyances irrationnelles associée à des stratégies d’évitement et d’auto-sabotage. Ainsi, cette reconstruction cognitive permet à l’élève de se mettre en action et constitue une étape importante dans le développement de stratégies adaptatives (McDermott, 2004; Hayes et al., 2010). Finalement, le recours à des sessions courtes (Calma-Biring & Gurung, 2017) de pleine conscience (Mindfulness) sous forme de médiation en contexte scolaire, a démontré accroître le bien-être, les apprentissages (Black, 2015) et également les résultats des élèves (Jha, Krompinger & Baime, 2017). De nombreuses études constatent également un réel impact de ces sessions de pleine de conscience avec la santé générale des élèves (Grossman et al. 2004), dont le niveau de joie, relaxation, concentration et conscience de soi autoévaluée augmente (Lucciarini et al., 2019). 16
6. Références Ackerman, D. S., & Gross, B. L. (2005). My instructor made me do it: Task characteristics of procrastination. Journal of Marketing Education, 27, 5–13. Arvey, R. D., Rotundo, M., Johnson, W., Zhang, Z., & McGue, M. (2006). The determinants of leadership role occupancy: Genetic and personality factors. The Leadership Quarterly, 17(1), 1–20. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2005.10.009 Black, D. S. (2015). Mindfulness Training for Children and adolescents. Handbook of mindfulness: Theory, research, and practice, 283, 246-263. Calma-Birling, D., & Gurung, R. A. (2017). Does A Brief Mindfulness Intervention Impact Quiz Performance?. Psychology Learning & Teaching, 16(3), 323-335. Day, Victor & Mensink, David & O'Sullivan, Michael. (2000). Patterns of Academic Procrastination. Journal of College Reading and Learning. 30. 10.1080/10790195.2000.10850090. Díaz-Morales, J. F., Ferrari, J. R., Díaz, K., & Argumedo, D. (2006). Factorial structure of three procrastination scales with a Spanish adult population. European Journal of Psychological Assessment, 22(2), 132–137. https://doi.org/10.1027/1015-5759.22.2.132 Dunning D, Heath C, Suls JM. Flawed Self-Assessment: Implications for Health, Education, and the Workplace. Psychological Science in the Public Interest. 2004;5(3):69-106. doi:10.1111/j.1529-1006.2004.00018.x Elliot, R. (2002). A ten-year study of procrastination stability. Unpublished master’s thesis, University of Louisiana, Monroe. Else-Quest, N.M., Hyde, J.S., Goldsmith, H.H. and Van Hulle, C.A. (2006) Gender Differences in Temperament: A Meta-Analysis. Psychological Bulletin, 132, 33-72. https://doi.org/10.1037/0033-2909.132.1.33 Engberding,M., Frings, E., Hçcker, A., Wolf, J., & Rist, F. (2011, July). Is procrastination a symptom or a disorder like other Axis-1-disorders in the DSM? Steps towards delineating a case definition. Presentation given at the 7th Biennial Conference on Procrastination, Amsterdam, The Netherlands. Essen, T. v., Heuvel, S. v. d., & Ossebaard, M. (2004). A Student Course on Self-Management for Procrastinators. In H. C. Schouwenburg, C. H. Lay, T. A. Pychyl, & J. R. Ferrari (Eds.), Counseling the procrastinator in academic settings (p. 59–73). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/10808-005 Feingold, A. (1994). Gender differences in personality: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 116(3), 429– 456. https://doi.org/10.1037/0033-2909.116.3.429 Ferrari JR (2000). Procrastinationa and attention: Factor analysis of attention deficit, boredomness, intelligence, self-esteem, and task delay frequencies. J. Soc. Behav. Personal, 15(5): 185-196. Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems. Personality and Individual Differences, 30(8), 1311–1327. https://doi.org/10.1016/S0191- 8869(00)00113-6 Garnefski, N., Van Den Kommer, T., Kraaij, V., Teerds, J., Legerstee, J., & Onstein, E. (2002). The relationship between cognitive emotion regulation strategies and emotional problems: Comparison between a clinical and a 17
Vous pouvez aussi lire