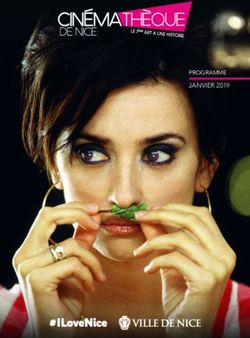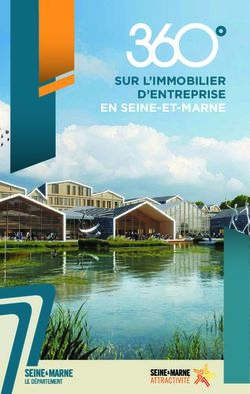CONTRIBUTION DU CSA RAPPORT 2018 DE LA CNCDH SUR LA LUTTE CONTRE LE RACISME
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
RAPPORT 2018 SUR LA LUTTE CONTRE LE RACISME, L’ANTISEMITISME ET LA XENOPHOBIE - CONTRIBUTION DU CSA
CONTRIBUTION DU CSA
RAPPORT 2018 DE LA CNCDH
SUR LA LUTTE CONTRE LE RACISME
La loi du 30 septembre 1986 a confié au Conseil supérieur de l’audiovisuel, autorité publique
indépendante, le soin de garantir la liberté de communication audiovisuelle et de veiller au
respect, par l’ensemble des services de communication audiovisuelle relevant de sa
compétence, des principes définis par la loi. Il est chargé, en particulier, de s’assurer que
ceux-ci respectent les principes d’ordre public (article 1er de la loi du 30 septembre 1986), et
notamment l’interdiction de diffuser des programmes incitant à la haine ou à la violence pour
des raisons de race, de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité (article 15 de la loi du
30 septembre 1986).
Depuis la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, l’article 3-1 de la loi du
30 septembre 1986 consacre la compétence du Conseil dans la lutte contre les
discriminations en précisant que celui-ci « contribue aux actions en faveur de la cohésion
sociale et à la lutte contre les discriminations dans le domaine de la communication
audiovisuelle ». Quelques années plus tard, la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à
l’égalité et à la citoyenneté est venue compléter les compétences du Conseil en la matière
en lui confiant la mission de veiller « […] à ce que la diversité de la société française soit
représentée dans les programmes des services de communication audiovisuelle et que cette
représentation soit exempte de préjugés. »
L’action du Conseil s’exerce à l’égard de l’ensemble des services de communication
audiovisuelle définis à l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 et établis en France selon
les critères prévus à l’article 43-3 de la loi ou relevant de sa compétence en application des
critères prévus à l’article 43-4.
Ceux-ci comprennent les services de télévision et de radio et, depuis la loi du 5 mars 2009
relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, les
services de médias audiovisuels à la demande (SMAD). Ces derniers sont définis au sixième
alinéa de l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 comme « tout service de communication
au public par voie électronique permettant le visionnage de programmes au moment choisi
par l'utilisateur et sur sa demande, à partir d'un catalogue de programmes dont la sélection
et l'organisation sont contrôlées par l'éditeur de ce service ». Certains services sont
expressément exclus de cette définition par la loi, comme ceux diffusant des contenus créés
par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échange. En pratique, les SMAD sont
constitués de services de vidéos à la demande, dont des services de télévision de
rattrapage, qui permettent de regarder en différé des programmes diffusés sur les services
de télévision linéaires.
L’ensemble de ces services relève de la compétence du Conseil quels que soient le support
de réception (téléviseur, téléphone mobile, ordinateur, tablette, etc.) et le réseau de
communications électroniques emprunté (ADSL, câble, satellite, hertzien terrestre, etc.).
Enfin, la loi du 30 septembre 1986 donne également au Conseil des moyens d’action à
l’égard des chaînes extracommunautaires diffusées par satellite et dont les programmes
seraient porteurs d’incitation à la haine ou à la violence. La saisine du Conseil d’Etat pour
demander qu’il soit ordonné à l’opérateur de réseau satellitaire de faire cesser la diffusion
d’un service de télévision relevant de la compétence de la France et la mise en demeure de
1RAPPORT 2018 SUR LA LUTTE CONTRE LE RACISME, L’ANTISEMITISME ET LA XENOPHOBIE - CONTRIBUTION DU CSA
l’opérateur de réseau satellitaire ou de l’éditeur sont les principaux moyens d’action du
Conseil supérieur de l’audiovisuel à l’égard des chaînes extracommunautaires aux contenus
illégaux. Le Conseil peut également saisir le procureur de la République. Certains de ces
moyens peuvent être mis en œuvre conjointement.
La présente note vise à répondre aux questions posées par la Commission nationale
consultative des droits de l’Homme.
Question 1 : Les actions et les interventions du Conseil supérieur de
l’audiovisuel en matière de lutte contre le racisme, l’antisémitisme la
xénophobie et les discriminations qui y sont liées en 2017-2018
1. Le cadre juridique de l’action du Conseil
Le Conseil veille à ce que les programmes des services de télévision et de radio soient
exempts de propos racistes ou antisémites.
Les interventions du Conseil peuvent se fonder sur la loi du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication, les délibérations qu’il édicte et les conventions qu’il signe avec les
éditeurs, ainsi que le cahier des charges des sociétés nationales de programme.
La loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication
La lutte contre les discriminations
L’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifié consacre la compétence du Conseil
dans la lutte contre les discriminations en précisant que celui-ci « contribue aux actions en
faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations dans le domaine de la
communication audiovisuelle ».
L’incitation à la haine ou à la violence
Le dernier alinéa de l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que le Conseil veille
également « à ce que les programmes des services de radiodiffusion sonore et de télévision
ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de
sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité ».
Délibérations, dispositions conventionnelles et réglementaires en vigueur en
matière de lutte contre le racisme et l’antisémitisme
Le Conseil a imposé certaines obligations aux éditeurs de services dans la lutte contre le
racisme et l’antisémitisme.
Il a, pour ce faire, adopté notamment une délibération le 20 décembre 2011 relative à la
protection du jeune public, à la déontologie et à l’accessibilité des programmes sur
les SMAD et une recommandation le 20 novembre 2013 relative au traitement des
conflits internationaux, des guerres civiles et des actes terroristes par les services de
communication audiovisuelle. Le Conseil a également inclus des stipulations dans les
conventions conclues avec les éditeurs de services leur imposant de respecter certaines
obligations déontologiques en la matière. Le cahier des charges de la société nationale
de programme France Télévisions et le cahier des missions et des charges de Radio
France comportent également des dispositions permettant de lutter contre la diffusion de
propos racistes ou antisémites.
2RAPPORT 2018 SUR LA LUTTE CONTRE LE RACISME, L’ANTISEMITISME ET LA XENOPHOBIE - CONTRIBUTION DU CSA
Délibération du 20 décembre 2011 relative à la protection du jeune public, à la
déontologie et à l’accessibilité des programmes sur les SMAD
Le Conseil rappelle les principes de respect de l’ordre public et de la dignité de la personne
humaine, l’interdiction de l’incitation à la haine ou à la violence, des contenus nuisant
gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. Les principes
d’honnêteté des programmes et l’obligation de respecter les droits de la personne sont
également prescrits.
Recommandation du 20 novembre 2013 relative au traitement des conflits
internationaux, des guerres civiles et des actes terroristes par les services de
communication audiovisuelle1
La recommandation reprend les dispositions existantes dans les différents textes applicables
au sujet : la Convention de Genève du 12 aout 1949 et ses protocoles additionnels, la loi
n°86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, la
recommandation du 7 juin 2005 aux éditeurs de services de télévision concernant la
signalétique jeunesse et la classification des programmes ainsi que la délibération du 17 avril
2007 relative à l’intervention des mineurs dans le cadre d’émissions de télévision diffusées
en métropole et dans les territoires ultramarins. Elle reprend également les dispositions des
recommandations n°2003-2 du 18 mars 2003 relative au conflit au Moyen-Orient et n°2004-8
du 7 décembre 2004 relative aux conflits internationaux et à leurs éventuelles répercussions
en France qui ont été abrogées.
Trois axes de rédaction ont été retenus pour l’élaboration de ce texte :
- dignité de la personne humaine ;
- ordre public et honnêteté de l’information ;
- protection des personnes.
La recommandation préconise notamment une attitude responsable des médias dans le
traitement de l’actualité liée aux conflits internationaux. Ainsi, lorsque des conflits
internationaux sont susceptibles d'alimenter des tensions et des antagonismes au sein de la
population ou d'entraîner, envers certaines communautés ou certains pays, des attitudes de
rejet ou de xénophobie, il est demandé aux opérateurs audiovisuels de traiter
l’information avec la pondération et la rigueur indispensables.
Les conventions conclues avec les éditeurs privés de télévisions ou de radios
Les conventions avec les éditeurs privés stipulent que « la société est responsable du
contenu des émissions qu'elle programme » et « conserve en toutes circonstances la
maîtrise de son antenne conformément à son dispositif de contrôle interne. »
De plus, l’éditeur doit veiller particulièrement « à respecter les différentes sensibilités
politiques, culturelles et religieuses du public ; à ne pas encourager des comportements
discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion, ou de la nationalité ; à
promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République […] »
Le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions
1
Cette recommandation est le résultat d’une concertation sur le traitement des images de guerre menée, durant l’année 2013,
avec les chaînes, les syndicats de journalistes et certaines associations. La présente recommandation abroge les deux
recommandations existantes relatives aux conflits internationaux et à leurs répercussions en France (recommandations n°2003-
2 du 18 mars 2003 relative au conflit au Moyen-Orient et n°2004-8 du 7 décembre 2004 relative aux conflits internationaux et à
leurs éventuelles répercussions en France)
3RAPPORT 2018 SUR LA LUTTE CONTRE LE RACISME, L’ANTISEMITISME ET LA XENOPHOBIE - CONTRIBUTION DU CSA
L’article 36 du cahier des charges prévoit une disposition indiquant que « la société veille au
respect de la personne humaine et de sa dignité. Elle contribue, à travers ses programmes
et son traitement de l'information et des problèmes de société, à la lutte contre les
discriminations et les exclusions de toutes sortes. »
Le cahier des charges met particulièrement en avant la lutte contre les discriminations et lie
celle-ci à la nécessité d’une meilleure représentation de la diversité de la société française à
l’antenne. France Télévisions affirme « sa valeur d’exemplarité en ce qui concerne la lutte
contre les discriminations et la représentation de la diversité de la société française »
(préambule) et veille à l’intégration des populations étrangères vivant en France, notamment
en contribuant « à la lutte contre les discriminations et les exclusions » (article 50).
La société doit accorder « une attention particulière au traitement par les programmes qu’elle
offre des différentes composantes de la population » et, de façon générale, promouvoir « les
valeurs d'une culture et d'un civisme partagés », le titre de l’article 37 du cahier des charges
renvoie expressément à « la lutte contre les discriminations et la représentation de la
diversité à l’antenne ».
Le préambule indique également que la société, outre ses nouveaux engagements en
matière de diversité à l’antenne et dans ses programmes, notamment grâce à son effort de
production, doit être « un lien fort, puissant, entre tous les citoyens, quel que soit leur
origine […] ». Elle doit également favoriser le débat démocratique, l'insertion sociale, la
citoyenneté et « promouvoir les grandes valeurs qui constituent le socle de notre société ».
Le cahier des missions et des charges de Radio France
L’article 5-1 du cahier des missions et des charges de Radio France prévoit également une
disposition relative à la lutte contre les discriminations raciales : « La société participe aux
actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations. »
Le cahier des charges de la société nationale de programme en charge de
l'audiovisuel extérieur de la France
L’article 23 du cahier des charges de France Médias Monde prévoit, quant à lui, une
disposition relative à la lutte contre les discriminations et représentation de la diversité à
l'antenne : « Dans la représentation à l'antenne de la société française, la diversité des
origines et des cultures de la communauté nationale est prise en compte (…). Les
programmes donnent une image la plus impartiale possible de la société française dans
toute sa diversité. Une attention particulière est également accordée au traitement des
différentes composantes de la population par les programmes (…). De façon générale, la
société veille à ce que les programmes assurent la promotion des valeurs d'une culture et
d'un civisme partagés (…). Dans le cadre des recommandations du Conseil supérieur de
l'audiovisuel, des actions sont mises en œuvre pour permettre d'améliorer la représentation
de la diversité de la société française. »
Les chaînes extracommunautaires
Le Conseil veille à ce que les chaînes extracommunautaires relevant de sa compétence, au
sens des critères définis par la directive européenne « Services de médias audiovisuels »,
ne mettent pas à l’antenne des programmes pouvant véhiculer des thèses racistes ou
antisémites. Il surveille ces chaînes avec attention, notamment à la suite de plaintes
émanant d’associations ou de particuliers relatives au caractère raciste, xénophobe ou
antisémite de certains contenus.
4RAPPORT 2018 SUR LA LUTTE CONTRE LE RACISME, L’ANTISEMITISME ET LA XENOPHOBIE - CONTRIBUTION DU CSA
Le Conseil a, en application de l’article 42-11 de la loi de 1986, la possibilité de saisir le
procureur de la République à propos des infractions aux dispositions de la loi de 1986 qui
auraient été relevées sur une de ces chaînes.
Le Conseil peut également saisir le Conseil d’Etat, qui peut statuer en référé, afin d’ordonner
à l’éditeur d’un service relevant de la compétence de la France de mettre fin à une
irrégularité ou d’en supprimer les effets (référé audiovisuel).
Le Conseil est particulièrement vigilant quant au respect de ces dispositions.
2. Interventions du Conseil en matière de lutte contre les discriminations et le
racisme
Il y a lieu de rappeler que les interventions du Conseil peuvent prendre la forme d’une lettre
de rappel à la réglementation (lettre à vocation informative ou pédagogique), d’une lettre de
mise en garde (lettre constatant un manquement avéré), ou d’une mise en demeure
(intervention à valeur d’avertissement), cette dernière étant un préalable nécessaire à
l’ouverture d’une procédure de sanction.
En 2017
Une sanction a été prononcée à l’égard de Radio Courtoisie
- Le Conseil a, le 4 octobre 2017, prononcé à l’encontre de l’association Comité de
défense des auditeurs de Radio Solidarité (CDARS) une sanction pécuniaire d’un montant
de 25 000 euros, soit près de 3 % de son chiffre d’affaires2. Il a observé qu’au cours de
l’émission du 28 mars 2016, des propos de nature à encourager des comportements
discriminatoires à l’égard des personnes en raison de leur appartenance à une ethnie, une
nation, une race ou une religion avaient été tenus. Ces propos n’ont par ailleurs suscité
aucune réaction à l’antenne tendant à les modérer ou y apposer un regard critique. Le
Conseil a ainsi considéré qu’il s’agissait là d’un manquement caractérisé aux stipulations des
articles 2-4 et 2-10 de la convention du 8 février 2012 et a prononcé une sanction
proportionnée à la gravité des faits. La décision du Conseil fait actuellement l’objet d’un
recours devant le Conseil d’Etat.
Une mise en demeure a été adressée.
- Le Président de SOS Racisme a alerté le Conseil au sujet de propos tenus le 2 février
2017 sur l’antenne de RTL dans la chronique « On n’est pas forcément d’accord ». Le
plaignant regrettait que, sous couvert d’une analyse de la nomination, par le Président
américain, d’un nouveau juge à la Cour Suprême des Etats-Unis, le chroniqueur ait justifié «
sans fard la discrimination envers les étrangers, les femmes, les homosexuels et les
musulmans ». Lors de la séance du 14 juin 2017, le Conseil a constaté que les propos en
cause, consistant en une interprétation critique de la jurisprudence de la Cour Suprême des
Etats-Unis et, partant, de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, du Conseil
Constitutionnel et du Conseil d’Etat, traduisaient également une apologie du concept et de la
pratique de la discrimination. Il a considéré qu’un tel discours était contraire aux valeurs
d’intégration et de solidarité que RTL doit veiller à promouvoir, et qu’il méconnaissait
l’obligation plus générale de lutte contre les discriminations. Le Conseil a également relevé
que ces propos n’avaient fait l’objet d’aucune contradiction ni mise en perspective à
l’antenne alors même que leur auteur aurait été en mesure de le faire, préalablement à la
diffusion de la séquence, lors de la rédaction de sa chronique Compte tenu de la gravité de
2
Le montant de la sanction pécuniaire (article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986) doit être fonction de la gravité des
manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires.
5RAPPORT 2018 SUR LA LUTTE CONTRE LE RACISME, L’ANTISEMITISME ET LA XENOPHOBIE - CONTRIBUTION DU CSA
ces propos, le Conseil a décidé de mettre en demeure les responsables de RTL de
respecter les stipulations précitées de l’article 2-4 de leur convention qui prévoient
que l’éditeur doit « promouvoir les valeurs d’intégration et de solidarité qui sont celles
de la République » et contribuer « aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la
lutte contre les discriminations ». A la suite d’un recours devant le Conseil d’Etat, la
mise en demeure a été annulée dans une décision du 15 octobre 2018. En l’espèce, la
haute juridiction administrative a jugé que « les principes républicains, notamment le
principe d 'égalité devant la loi, qui interdit les discriminations et exige que des
différences de traitement soient justifiées par des différences de situation objectives
et pertinentes ou par l'intérêt général, confèrent une place éminente aux valeurs
d'intégration et de solidarité ainsi qu'à l'objectif de cohésion sociale ; que
l'engagement prévu à l'article 2-4 précité de la convention relative au service RTL de
promouvoir ces valeurs et de contribuer à la lutte contre les discriminations doit se
combiner avec le principe de la liberté de communication des pensées et des
opinions, consacré et protégé par les dispositions de valeur constitutionnelle de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et rappelé par les
dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 ; qu'eu égard à ce
principe, cet engagement ne saurait être interprété comme imposant à l'éditeur du
service de prohiber sur son antenne toute critique des principes et des valeurs
républicains ».
Quatre lettres d’observations ont été adressées.
- Le Conseil a été saisi par de nombreux téléspectateurs concernant une séquence du
journal télévisé de 13 heures diffusée le 10 novembre 2016 sur TF1, dans laquelle le
journaliste a indiqué, à la suite d’un reportage sur les sans-abris et en transition avec le sujet
suivant sur les migrants, « Voilà, plus de places pour les sans-abris mais en même temps les
centres pour migrants continuent à ouvrir partout en France ». L’article 9 de la convention
conclue entre le Conseil et la société qui exploite le service de télévision privé TF1 prévoit
que « La société veille dans son programme (…) à respecter les différentes sensibilités
politiques, culturelles et religieuses du public ; à ne pas encourager des comportements
discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion ou de la nationalité ; à
promouvoir les valeurs d’intégration et de solidarité qui sont celles de la République (…) ».
Lors de sa séance du 4 janvier 2017, le Conseil a regretté la formulation choisie par le
journaliste, estimant que celle-ci était de nature à sous-entendre que les migrants seraient
privilégiés par les autorités par rapport aux personnes sans domicile fixe. Par conséquent, il
a considéré que les propos pouvaient encourager un comportement discriminatoire a
demandé aux responsables de TF1 de veiller à parfaitement respecter, à l’avenir, les
dispositions précitées de l’article 9 de sa convention.
- Le Conseil a été saisi concernant une séquence de l’émission de radio Les Grandes
Gueules diffusée sur RMC le 7 novembre 2016. Le plaignant considérait que le propos «
ayant bossé comme un nègre », tenu lors d’un débat sur le Régime Social des Indépendants
(RSI), était raciste. Lors de sa séance du 10 mai 2017, le Conseil a décidé d’adresser un
courrier aux responsables de la station, dans lequel il a indiqué qu’il regrettait
l’utilisation d’un mot à connotation raciste tout en précisant néanmoins que cela ne
constituait pas un manquement de la radio à ses obligations.
- Le Conseil a été alerté par une dizaine de téléspectateurs ainsi que par l’Organisation
juive européenne, le Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme, le Conseil
représentatif des institutions juives de France et le Collectif d’urgence à la suite de la
diffusion, le 18 décembre 2016 sur M6, du magazine « Enquête exclusive » intitulé «
Jérusalem : quand la ville se déchire ». Les plaignants considéraient globalement que dans
un climat de fortes tensions, l’émission procédait à des « raccourcis et des occultations »
6RAPPORT 2018 SUR LA LUTTE CONTRE LE RACISME, L’ANTISEMITISME ET LA XENOPHOBIE - CONTRIBUTION DU CSA
pour donner une présentation déformée et orientée de l’histoire ainsi que de la situation
actuelle dans cette région. Lors de sa séance du 21 juin 2017, le Conseil a vivement regretté
que le traitement historique du conflit, au début de l’émission, ait été exposé de manière
imprécise et erronée s’agissant des faits tels qu’ils se sont déroulés. Il a constaté que, dans
la seconde partie du reportage, la plupart des témoignages retenus et les exemples mis en
avant concernant les agissements de certains Israéliens de confession juive avaient pour
conséquence une mise en cause unilatérale de ces derniers et une vision controversée de la
situation à Jérusalem et dans les territoires occupés. Ainsi, le Conseil a considéré que le
traitement réservé à ce sujet manquait de pondération et était de nature à venir
alimenter sur le territoire national des tensions et des antagonismes au sein de la
population ou d’entraîner, envers certaines communautés ou certains pays, des
attitudes de rejet ou de xénophobie. Il a, dans un courrier, demandé à l’éditeur de veiller à
mieux respecter, à l’avenir, les dispositions de l’article 22 concernant la rigueur dans la
présentation et le traitement de l’information de la convention de M6 ainsi que de la
recommandation du 20 novembre 2013 relative au traitement des conflits internationaux.
- Le Conseil a été alerté par de nombreux téléspectateurs à la suite de propos tenus par
un intervenant, invité le 21 avril 2017 sur Cnews afin de commenter la fusillade survenue la
veille sur les Champs-Elysées et au cours de laquelle un policier avait perdu la vie. Les
plaignants ont regretté que cet intervenant ait affirmé que « 27% des Français musulmans se
réclamaient de l’idéologie de l’État islamique et 50% des jeunes musulmans des cités », en
citant une enquête de l’Ifop pour l’Institut Montaigne. Lors de sa séance du 26 juillet 2017, le
Conseil a donc examiné la séquence litigieuse.
Le Conseil a constaté que l’intervenant avait fait une citation erronée de certaines données
figurant dans l’enquête précitée et a relevé que si, au cours de l’émission, certains discours
avaient pu faire l’objet de contestations ou de contextualisations notamment de la part du
journaliste qui animait le débat, les propos litigieux n’avaient été discutés ni par celui-ci, ni
par les contradicteurs présents sur le plateau et n’avaient pas non plus fait l’objet d’une
vérification. Dans ces conditions, il a considéré que cette extrapolation, en particulier au sein
d’une émission spéciale consacrée à un acte terroriste commis la veille en France et
revendiqué par l’Etat islamique, était peu compatible avec l’obligation de promotion des
valeurs d’intégration et de solidarité qui sont celles de la République qui figure à
l’article 2-3-3 de la convention de CNews. Il a par ailleurs estimé que l’absence de
réaction à de tels propos constituait une insuffisance de maîtrise de l’antenne, en
contravention avec les dispositions de l’article 2-2-1 de la convention de CNews. Au regard
de la gravité des propos tenus, susceptibles de donner lieu à des amalgames, le
Conseil a, dans un courrier, demandé aux responsables de la chaîne de veiller à mieux
respecter les obligations conventionnelles précitées.
En 2018
Deux mises en demeure ont été adressées.
- Le Conseil a été saisi à la suite de la diffusion sur radio RSL, les 2 et 16 septembre
2017, de propos tenus par M. Thierry Robert. Au cours de l’émission diffusée le 2 septembre
2017, ce dernier a exprimé de vives critiques à l’encontre de certaines personnalités
réunionnaises : « […] Je n’ai pas peur, mon nombril a été coupé à la Réunion. Moi je suis là
pour défendre les réunionnais […] ». Le Conseil a estimé que ces propos, qui tendent à
marquer une distinction entre les différentes origines qui composent la population
réunionnaise, contribuent à véhiculer des préjugés identitaires de nature à encourager des
comportements discriminatoires à l’égard des personnes en raison de leur origine. Ces
propos constituent, par conséquence, un manquement de l’éditeur aux stipulations de
l’article 2-4 de la convention du service « RSL Radio ». Le Conseil a décidé de mettre en
demeure les responsables de « RSL Radio » de respecter les stipulations précitées.
7RAPPORT 2018 SUR LA LUTTE CONTRE LE RACISME, L’ANTISEMITISME ET LA XENOPHOBIE - CONTRIBUTION DU CSA
- Le Conseil a été saisi au sujet de propos tenus par un invité dans l’émission Village
Médias, diffusée sur Europe 1 le 17 octobre 2017. Celui-ci, faisant écho à une polémique
l'opposant publiquement à un acteur français, avait déclaré : « Je sais bien qu'entre Trappes
et Hollywood, il n'a pas eu le temps de maîtriser la langue française ... ». Après examen de
la séquence, le CSA a considéré que l’animateur de l’émission avait fait preuve d’une
insuffisante maîtrise de l’antenne alors qu’étaient tenus des propos véhiculant des
stéréotypes stigmatisants à l’égard des habitants de certaines villes. Le CSA a donc mis en
demeure la société Lagardère Active Broadcast, éditrice du service de radio Europe 1, de se
conformer aux obligations des articles 2-4 et 2-10 de sa convention en vertu desquelles elle
est tenue, d’une part, de promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles
de la République et de contribuer aux actions en faveur de la cohésion sociale et de lutter
contre les discriminations et, d’autre part, de conserver la maîtrise de son antenne.
Une lettre simple de rappel aux obligations conventionnelles a été envoyée.
- Le Conseil a été saisi suite à la diffusion, dans le cadre de la coupe du monde de
football, du match opposant l’équipe du Nigéria à l’équipe d’Islande, le 22 juin 2018 à 17h sur
BeIn Sport 1, durant lequel un commentateur sportif aurait fait une allusion déplacée. Les
plaignants déplorent que Gregory Paisley ait conseillé au joueur de l’équipe du Nigéria de «
[prendre] du Banania » à la suite d’une manœuvre manquée. Lors de sa séance du 24
octobre 2018, le Conseil a constaté que le commentateur fait référence à la célèbre marque
française de boisson et de produits chocolatésqui renvoie dans l’inconscient collectif à la
représentation des personnes de couleur durant la période coloniale. Quand bien même il a
été relevé que le présentateur revient sur ses propos lors la diffusion du match, le Conseil a
considéré que les mots employés dans un tel contexte ne s’inscrivaient pas dans l’exigence
de promotion des valeurs d’intégration et de solidarité qui sont celles de la République et de
lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il a appelé la vigilance de la chaîne
sur le respect des dispositions de l’article 2-3-2 de la convention précitée et de l’article 3-1 de
la loi du 30 septembre 1986.
Question 2 : Les actions et les interventions du Conseil supérieur de
l’audiovisuel en matière de représentation de la diversité française
L’article 3.1 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 définit le rôle et les missions du CSA
par un alinéa aux termes duquel : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel contribue aux
actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations dans le
domaine de la communication audiovisuelle. Il veille, notamment, auprès des éditeurs de
services de radio et de télévision, compte tenu de la nature de leurs programmes, à ce que
la programmation reflète la diversité de la société française et contribue au rayonnement de
la France d’outre-mer. Il rend compte chaque année au Parlement des actions des éditeurs
de services de télévision en matière de programmation reflétant la diversité de la société
française et propose les mesures adaptées pour améliorer l’effectivité de cette diversité dans
tous les genres de programmes ».
Le Conseil a inscrit la représentation de la diversité de la société française au cœur de son
action de régulation en incitant chaque éditeur, tout en tenant compte de sa situation
particulière, à favoriser concrètement l’expression de cette diversité.
1. Mise en place d’outils afin de favoriser la représentation de la diversité
Afin de mener à bien cette mission, le Conseil s’est doté d’outils permettant de suivre les
actions en faveur de la diversité mises en œuvre par les éditeurs de services de télévision et
de radio :
8RAPPORT 2018 SUR LA LUTTE CONTRE LE RACISME, L’ANTISEMITISME ET LA XENOPHOBIE - CONTRIBUTION DU CSA
- un Observatoire de la diversité dans les médias audiovisuels a ainsi été créé
dans le but de suivre les actions mises en œuvre par les chaînes de télévision et les
radios en faveur de la promotion de la diversité de la société française et pour lutter
contre les discriminations comme cela est prévu à l’article 3-1 de la loi du 30
septembre 1986 modifiée ;
- le Conseil fait réaliser, chaque année, un baromètre destiné à évaluer la
perception de la diversité à la télévision selon les critères du sexe, de l’origine,
des catégories socioprofessionnelles, du handicap, de l’âge, de la situation de
précarité3 –depuis 2017- et du lieu de résidence –depuis 2018- en prenant également
en compte des critères qualitatifs (rôle positif, négatif ou neutre des personnes
intervenant à l’écran). ;
- une délibération tendant à favoriser la représentation de la diversité de la
société française dans les programmes des chaînes nationales hertziennes
gratuites et de Canal + a été adoptée le 10 novembre 2009. L’objectif du Conseil
consiste à provoquer, chez les éditeurs, une démarche volontariste fondée sur des
engagements formels pris annuellement. Le texte a été modifié le 17 septembre 2015
afin d’y intégrer les services de radio ;
- aux termes de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, un rapport annuel porté
au Parlement fait l’état de la représentation de la diversité dans les médias
audiovisuels.
2. La poursuite des actions pour améliorer la représentation des origines à
l’antenne et en faveur d’une plus forte cohésion sociale
La diffusion d’un clip, sous l’impulsion du Conseil, en faveur de la cohésion sociale à
l’occasion du 14 juillet 2017
Chaque année depuis 2013, à l’initiative de la conseillère Mémona Hintermann-Affejée, des
messages de promotion de la diversité de la société française et de la cohésion sociale sont
réalisés par les opérateurs audiovisuels et diffusés sur leurs antennes, à leurs frais, à
l’occasion de la fête nationale.
Les chaînes de télévision des groupes France Télévisions, France Médias Monde, TF1,
Canal, M6, NRJ, NextRadioTV et les chaînes Gulli, L’Equipe et RMC Story ainsi que les
radios (Radio France, RFI, Sud Radio, Europe 1, RFM, Virgin Radio, Radio FG, NRJ, RTL,
RTL2, Fun Radio ainsi que les radios du groupe Indés Radios) participent à l’opération,
certaines en créant même un nouveau message.
3. La prise en compte de la représentation des personnes en situation d’exclusion
- La représentation des personnes en situation de précarité dans les médias
audiovisuels
3
Conformément à un arrêté de 1992 qui donne une définition officielle des catégories de personnes qui sont en situation
de précarité, sont indexés en situation de précarité les personnages suivants : chômeurs ; bénéficiaires du RMI ; titulaires
d'un contrat emploi solidarité ; personnes sans domicile fixe ; jeunes âgés de 16 à 25 ans exclus du milieu scolaire et
engagés dans un processus d'insertion professionnelle.
9RAPPORT 2018 SUR LA LUTTE CONTRE LE RACISME, L’ANTISEMITISME ET LA XENOPHOBIE - CONTRIBUTION DU CSA
En 2017, les travaux du Conseil ont porté, en particulier, sur la représentation des personnes
en situation de pauvreté et, plus généralement, sur le traitement du thème de la pauvreté à
l’antenne.
Les associations de lutte contre la pauvreté-ATD Quart Monde, Emmaüs France et le
Secours Catholique – ont été reçues en audition par l’Observatoire de la diversité. Elles ont
toutes dressé le même constat sur la représentation et l’expression de la pauvreté dans les
médias. Selon elles, la « pauvrophobie » est importante dans notre société. Les personnes
pauvres sont dans une situation de honte et sont confrontées à un sentiment d’indifférence,
de rejet et de mépris. Les personnes en situation de précarité sont peu reconnues, sauf
événements exceptionnels. Les associations souhaiteraient que la pauvreté soit évoquée de
façon plus positive sans tomber dans le misérabilisme, les préjugés et les stéréotypes.
Il est en effet notable que les personnes en situation de pauvreté sont sous-représentées sur
les antennes et il est relevé que globalement, la thématique de la pauvreté est peu traitée
par les médias audiovisuels alors qu’il y a en France 8,8 millions de personnes pauvres.
Fort du constat quantifié établi par le baromètre de la diversité qui a introduit en 2017 le
critère de mesure de la représentation des personnes en situation de pauvreté, le Conseil a
cherché à impulser une prise de conscience auprès des éditeurs afin de rendre visible ces
catégories de personnes. Il apparait donc essentiel que l’ensemble des médias audiovisuels
se mobilise pour leur donner une place et c’est ce qui est attendu, dans les engagements
des chaînes, pour les années à venir.
- La représentation des personnes issues des quartiers sensibles
Le Conseil s’est intéressé, au cours de cette même année, à la représentation des
personnes issues des quartiers sensibles de France. Il apparaît que cette perception des
quartiers est dégradée à l’instar de la situation objective des habitants, en comparaison des
autres territoires et ce, notamment, en matière d’emploi, de réussite scolaire, de
délinquance. Le traitement journalistique est souvent pointé du doigt quand il s’agit de
trouver les responsables de l’image négative et, souvent, stéréotypée véhiculée dans les
médias. Or, sans données quantitatives ni qualitatives, il est malaisé d’établir un état des
lieux précis de la situation.
C’est pourquoi le baromètre de la diversité 2018 intègre le lieu de résidence comme critère
d’indexation pour chaque intervenant d’une émission. Cette étude devrait être publiée en
début d’année 2019.
4. L’accent mis sur la représentation du handicap sur les antennes et en interne
La représentation du handicap à la télévision et à la radio figure également parmi les
missions du Conseil (article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée). La délibération n°
2009-85 du 10 novembre 2009 du Conseil impose aux chaînes gratuites et à Canal+ de
prendre des engagements annuels pour améliorer significativement la représentation de la
diversité de la société française, notamment en termes de représentation du handicap.
Au-delà de ses missions, le Conseil a mis en place des actions avec des partenaires
extérieurs dans le but d’améliorer la présence des personnes handicapées dans
l’audiovisuel.
Le partenariat avec le ministère délégué aux personnes handicapées : la charte visant
à favoriser la formation et l'insertion professionnelles des personnes handicapées
dans le secteur de la communication audiovisuelle
10RAPPORT 2018 SUR LA LUTTE CONTRE LE RACISME, L’ANTISEMITISME ET LA XENOPHOBIE - CONTRIBUTION DU CSA
Le 11 février 2014 a été signée, au CSA, la charte visant à favoriser la formation et l'insertion
professionnelles des personnes handicapées dans le secteur de la communication
audiovisuelle. Cette charte, élaborée en relation avec les télévisions et les radios d’une part
et les écoles et centres de formation aux métiers de l’audiovisuel d’autre part, est le résultat
d’une action d’envergure lancée par le Conseil avec le ministère délégué aux personnes
handicapées.
Parmi les engagements de la charte figure l’instauration d’un comité de suivi qui se réunit
tous les ans pour dresser un bilan de son application et convenir d’axes d’amélioration et de
travail.
Dans son dernier bilan d’application de la charte, le Conseil a relevé que de nombreux
efforts avaient été réalisés par les chaînes de télévision et les radios qui ont, pour la plupart,
mis en œuvre un véritable plan d’actions interne portant sur le handicap.
La mobilisation des chaînes par le Conseil pour la « Journée internationale des
personnes handicapées », le 3 décembre 2017
A l’occasion de la « Journée internationale des personnes handicapées », le 3 décembre
2017, le Conseil a demandé aux chaînes de télévision et aux radios de mettre en place une
programmation spéciale. Il a relevé avec satisfaction leur mobilisation.
5. Collaboration du Conseil avec le Défenseur des droits pour l’égalité contre le
racisme
Une convention de partenariat avec le Défenseur des droits a été signée le
24 novembre 2014. Une plateforme numérique intitulée « Egalité contre racisme », a été
créée fin 2014. Cette dernière s’adresse aux personnes qui sont témoins ou victimes de
propos ou d’actes racistes. Elle a vocation à les informer à travers trois rubriques - « Je
veux agir », « Je veux alerter » et « Je veux me défendre » - sur leurs droits, recenser les
textes juridiques applicables et porter à leur connaissance les moyens d'actions proposés
par différents organismes. A noter que dans la rubrique « Je veux alerter », un renvoi vers le
formulaire de signalement du Conseil est fait.
Par ailleurs, le Conseil participe aux réunions du Comité de suivi de cette plateforme.
Question 3 : L’extension des compétences du CSA à des contenus sur Internet,
et particulièrement en matière de lutte contre les contenus racistes,
antisémites et xénophobes.
Au cours des derniers mois, la garantie des droits et libertés dans l’espace numérique est
devenue un enjeu incontournable pour les autorités publiques nationales et communautaires.
Pour l’heure, la compétence du CSA sur les messages audiovisuels sur internet dépend de
la nature du service qui les diffuse. Sur internet, le CSA est le régulateur des services de
médias audiovisuels à la demande, au sens de l’article 2 al. 5 de la loi du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication (dits SMAD, par ex. vidéo à la demande à l’acte ou à
l’abonnement). A l’égard de ces services, comme de tout autre service de communication
audiovisuelle, le Conseil fait valoir les exigences essentielles qui lui sont confiées en matière
de lutte contre le racisme et les discriminations, conformément aux dispositions de l’article
15 al. 5 de la loi du 30 septembre 1986.
Jusqu’à présent le Conseil n’a jamais eu à intervenir contre un SMAD en raison d’un
programme à caractère raciste, ce qui s’explique pour beaucoup par le caractère
11RAPPORT 2018 SUR LA LUTTE CONTRE LE RACISME, L’ANTISEMITISME ET LA XENOPHOBIE - CONTRIBUTION DU CSA
professionnel des programmes diffusés par ces services (ex. : films, documentaires, fictions
audiovisuelles).
Au-delà, le Conseil constate que les enjeux de lutte contre le racisme et les
discriminations à l’occasion de contenus audiovisuels sur internet sont
principalement localisés sur des espaces de communication numérique qu’il n’a pas
pour mission de réguler.
Cependant, les missions du Conseil pourraient très prochainement s’étendre aux
plateformes de partage vidéo numériques, sous l’effet conjugué de l’évolution du cadre
juridique européen et français.
Concernant le droit communautaire, le 2 octobre 2018, le Parlement européen a renforcé le
dispositif juridique de lutte contre les discours de haine en étendant certaines dispositions de
la directive SMA aux plateformes numériques. Ainsi, les fournisseurs de services de médias
audiovisuels devront mettre en place des mesures appropriées pour lutter contre les
contenus incitant à la violence, à la haine et au terrorisme. Quant à la violence gratuite et à
la pornographie, leur encadrement devra obéir à des règles plus strictes. Enfin, les
plateformes de partage de vidéos devront réagir rapidement aux signalements de vidéos par
les utilisateurs. Le Parlement souhaite ainsi que les plateformes créent un mécanisme
transparent et accessible permettant aux utilisateurs de signaler un contenu litigieux.
Cette évolution du droit communautaire, qui devra être transposé en droit français, fait écho
à un certain nombre de réflexions relatives au renforcement de la lutte contre les discours de
haine sur internet, en particulier le rapport remis par la députée Laetitia Avia le jeudi 20
septembre 2018.
Question 4 : Les recommandations du CSA pour améliorer la représentation de
la diversité de la société française dans les médias
Le Conseil, dans son dernier rapport au Parlement sur la représentation de la diversité
à la télévision et à la radio, a formulé les préconisations suivantes :
Prendre des engagements chiffrés en ce qui concerne la présence des
personnes représentatives de la diversité dans les programmes au regard des
résultats du baromètre de la diversité.
Le Conseil souhaiterait que les engagements annuels des diffuseurs puissent être
pris en fonction des résultats obtenus par eux dans baromètre de la diversité de
l’année précédente et milite pour une montée en charge de l’indicateur le plus bas du
dernier baromètre de la diversité de la chaîne.
Mettre en avant les réussites individuelles afin de permettre notamment aux
jeunes de nourrir des ambitions nouvelles. Le Conseil préconise que les chaînes
fassent systématiquement intervenir dans chaque édition des journaux télévisés, des
personnes représentatives de la diversité (origine, âge, handicap, catégorie socio-
professionnelle) en qualité d’experts et de simples témoins.
Encourager le traitement des sujets spécifiques dits « diversité » de manière
banalisée en évitant de cantonner ces sujets à des émissions dédiées.
Mettre en place des modules de e-learning afin de lutter contre les préjugés,
clichés et autres stéréotypes
12RAPPORT 2018 SUR LA LUTTE CONTRE LE RACISME, L’ANTISEMITISME ET LA XENOPHOBIE - CONTRIBUTION DU CSA
Prendre des engagements pédagogiques s’adressant particulièrement aux
jeunes publics comme par exemple la création de modules « diversité »
explicitant une thématique dite de « diversité » (ex : la journée internationale des
migrants le 18 décembre).
Faire évoluer significativement la place des personnes issues de la diversité de
la société française dans les fictions, notamment par la création d’ateliers
d’écriture, ouverts à de jeunes talents, réalisateurs et scénaristes, afin de leur donner
la possibilité de participer à ce travail de conception.
Faire avancer la représentation des personnes en situation de handicap dans
les médias audiovisuels :
- Rédiger une charte sur la représentation du handicap dans les médias
audiovisuels pour parvenir à ce qu’elle soit améliorée, tant quantitativement que
qualitativement. Cette charte serait notamment l’occasion d’élaborer un lexique
des bons termes à employer face au handicap pour éviter les propos ou
expression blessantes sans tomber pour autant systématiquement dans le
compassionnel ;
- Soutenir et participer à l’opération « Duo Day », aux côtés du ministère
chargé des personnes handicapées.
- Recevoir les diffuseurs afin notamment d’engager une réflexion sur les
enjeux médiatiques des Jeux Paralympiques de 2024 : Cette réflexion visera à
éclairer le rôle central des médias audiovisuels dans l’accompagnement des
politiques sportives, en particulier en matière de cohésion sociale. Ces derniers
ont un rôle à jouer au travers de l’exposition des compétitions sportives, lors des
Jeux mais aussi lors des rendez-vous internationaux ou nationaux de chaque
discipline paralympique en amont de l’événement.
Prendre des engagements en matière de gestion du personnel :
- Systématiser la formation des personnels à la diversité au sein des
entreprises audiovisuelles ;
- Renforcer l’accueil des personnes issues de la diversité aux emplois,
stages, contrats en alternance au sein des entreprises audiovisuelles.
Question 5 : L’implication du ministère dans la mise en œuvre du Plan d’action
contre le racisme et l’antisémitisme 2018-2020 et dans la phase d’élaboration
du prochain plan d’action
Question 6 : Le bilan statistique dont dispose le CSA pour évaluer le racisme,
l'antisémitisme et la xénophobie dans l'audiovisuel.
Le Conseil ne dispose pas d’outil statiques spécifique dédié à la mesure du racisme, de
l’antisémitisme et de la xénophobie dans l’audiovisuel.
Ainsi, concernant les dossiers ayant donné lieu à une intervention du Conseil en 2017
et 2018 sur le fondement des obligations relatives à la diversité4, les services du
Conseil ont répertorié 146 plaintes transmises via le formulaire de contact mis à la
disposition du public sur le site internet du CSA.
4
Voir la liste des dossiers figurant pp. 5-8.
13Vous pouvez aussi lire