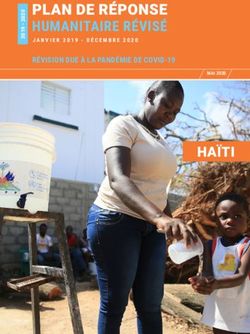Coordination et subordination revisitées : des structures traces d'opérations ? Discussion théorique à partir d'un corpus anglais - Brill
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Coordination et subordination revisitées :
des structures traces d’opérations ? Discussion
théorique à partir d’un corpus anglais
Martine Sekali
1. INTRODUCTION
Le mot «structure», désignant des constructions complexes, est principalement
employé en syntaxe. Sont ainsi définies et catégorisées par exemple des
structures coordonnées ou subordonnées, ayant des comportements syntaxiques
et distributionnels distincts, notamment opposés sur la notion de «hiérarchie».
Ces mêmes structures analysées en sémantique deviennent des «énoncés
complexes», et sont appréhendées comme des agencements de marqueurs traces
d’opérations de repérage inter-énoncés souvent orientés de façon inverse à la
catégorisation syntaxique. Je propose dans cet article une réflexion théorique sur
la notion de «structure» en tant qu’elle peut être appréhendée de façon cohérente
et non contradictoire dans une interface entre syntaxe, sémantique et discours :
peut-on considérer, dans cette interface, des «opérations de structures», ou
schèmes opératoires distinctifs de différentes structures ? Je propose ici de
revisiter la distinction entre coordination et subordination à partir de données en
langue anglaise, dans cette interface où le critère discriminant de la hiérarchie
n’est plus opérant, et où un autre profilage des structures complexes peut être
avancé.
2. LES STRUCTURES COMME TRACES D’OPÉRATIONS
2.1. Syntaxe, parataxe, hypotaxe : question de préfixes
Les énoncés complexes, contenant plusieurs propositions, sont généralement
d’abord distingués, dans les études de syntaxe, en deux grands ordres, selon le
‘rang’ occupé par la deuxième proposition par rapport à la première. Le préfixe
grec hypo- dans «hypotaxe» (comme son équivalent latin dans subordination),
signale un ordonnancement dans lequel l’une des propositions occupe un rang
«inférieur» par rapport à l’autre, c'est-à-dire une place argumentale dans la
proposition principale, une fonction de complémentation du verbe dans la
principale (sujet, COD, circonstancielle). Dans cette logique syntaxique, c’est
Université Paris Ouest Nanterre. Courriel : sekali@u-paris10.fr
Downloaded from Brill.com09/10/2021 05:23:04PM
via free access138 Martine Sekali
cette fonction de complémentation qui vaut alors à la proposition hypotactique sa
valeur d’«enchâssée», et donc son niveau hiérarchique «inférieur». La parataxe
(ou co-ordination), dans cette très ancienne typologie des énoncés complexes,
ordonne les propositions les unes à côté des autres, de façon horizontale : aucune
des propositions reliées n’occupe un rang hiérarchiquement inférieur à une
matrice. Il n’y a donc pas de phénomène d’enchâssement, et les énoncés
paratactiques sont considérés comme étant de même niveau, c'est-à-dire dans une
relation paritaire. On observe dans ces définitions que la «hiérarchie» des
propositions est alors liée à l’appartenance argumentale de la deuxième
proposition à la première.
Les préfixes hypo- et sub- vont de pair avec une représentation spatiale des
rapports syntaxiques qui est néanmoins trompeuse : en quoi l’appartenance, ou
l’intégration d’une proposition à l’intérieur d’une autre lui confèrerait-elle une
verticalité, et une position hiérarchiquement inférieure ? Bien que la
représentation arborescente des phrases complexes en grammaire générative
contribue à cette représentation formelle, la relation entre intégration et
hiérarchie, entre le niveau de la principale et celui de la subordonnée, ou encore
entre horizontalité et parité, ne va finalement pas de soi, comme le remarque
d’ailleurs La Fauci (2010 : 92) :
Le rapport métaphorique entre syntaxe et espace est très ancien et il est encore
richement témoigné dans le débat moderne. Il ne serait pas inutile de se demander
toutefois si les participants à ce débat ont tous ou bien dans leur majorité clairement
conscience que le mouvement, les montées et, bien plus profondément, les à droite et
à gauche qui apparaissent très souvent dans les écrits contemporains de syntaxe ne
sont que des métaphores. On a en effet l’impression que non seulement les partisans
de l’approche chomskyenne mais aussi les tenants d’autres écoles (en principe
opposées) y songent comme à des véritables réalités linguistiques et proposent leurs
descriptions sur le présupposé de leur indiscutable réalité. On a l’impression, en
d’autres termes, que la métaphore spatiale en syntaxe théorique et descriptive n’est
plus traitée en tant qu’effet d’un (intéressant mais controversable) point de vue et
qu’elle est devenue un fait acquis et donc un véritable lieu commun.
Curieusement, ce ne sont pas les notions d’intra-prédicativité ou extra-
prédicativité de la relation qui sont le plus souvent évoquées pour distinguer
hypotaxe et parataxe, mais bien le concept de hiérarchie, ce qui pose de
nombreux problèmes. Dans les cas de relations asyndétiques par exemple, a-t-on
affaire à une relation paratactique ou hypotactique ? On parle plus volontiers de
«parataxe asyndétique», sous-catégorie de la parataxe, qui s’oppose à la
«parataxe syndétique», marquée par les coordonnants. On peut déduire de cette
sous catégorisation-même de la parataxe (syndétique/asyndétique), que la
parataxe est, en soi, un mode de mise en relation particulier (et donc un
processus, une opération) explicité ou non par un marqueur, et non une structure
fixe, ou une forme syntaxique spécifique. Par retour, une relation asyndétique
peut être paratactique ou hypotactique, puisqu’il n’y a pas correspondance stricte
entre la présence ou non de marqueurs de relation et l’existence d’une relation
complexe.
Downloaded from Brill.com09/10/2021 05:23:04PM
via free accessCoordination et subordination revisitées 139
Cette non correspondance est développée et analysée dans d’importants
travaux, en particulier Halliday and Hasan (1976), Charolles (1988), Culioli
(1990), Rotgé (1998), Trévise (2003), Crake-Rossette (2003), Trévise et
Constant (2007), et Beguelin, Avanzi et Corminboeuf (2010). Trévise (2003 : 4)
résume bien la situation :
L’asyndète se définissant en général comme l’absence de lexème marquant un lien
entre deux unités linguistiques qui ont cependant un rapport sémantique entre elles, le
problème restera de définir exactement ce que l’on entend par «marquage de lien» et
donc «absence de marquage de lien» entre les deux RP : la problématique inclut aussi
les problèmes, de natures hétérogènes, posées par la présence éventuelle de diverses
formes d’anaphores, de formes aspecto-temporelles différentes, de divers types de
liens entre des préconstruits notionnels ou de repérages (problèmes de thématisation
et de cohérence discursive). On voit que les critères purement syntaxiques, ou de
présence de tel ou tel connecteur par exemple, vont immédiatement, dans l’analyse,
être complexifiés par la présence de critères de repérages, mais aussi de
représentations liées aux compositions des notions complexes impliquées.
Ces observations sont un préalable nécessaire à une réflexion théorique sur le
rôle opérationnel des «structures» dans les représentations complexes. Plusieurs
éléments importants peuvent déjà en être déduits :
a) si une relation paratactique ou hypotactique peut être construite avec
différents marqueurs de relation, et même en l’absence de relateur, c’est que les
structures en elles-mêmes SONT la trace d’une opération de relation, et que
parataxe et hypotaxe (coordination et subordination) doivent être distinguées en
termes d’opérations invariantes respectives ;
b) la question corollaire est bien entendu de comprendre quel rôle propre
jouent les marqueurs de relation et quelle articulation s’opère entre opérations de
marqueurs et opérations de structures ;
c) les opérations de structures (parataxe et hypotaxe) étant des modes de
relation et non des formes fixes, elles ne peuvent être définies qu’à l’interface
entre syntaxe, sémantique et discours, c'est-à-dire dans la dynamique de
construction linguistique et représentative.
2.2. Coordination et subordination en sémantique et analyse du discours : la
hiérarchie fait toujours autorité
L’insuffisance d’une définition purement syntaxique des relations de
coordination et de subordination a été comblée par de nombreuses études en
sémantique et en analyse du discours. Mais c’est encore la notion de hiérarchie
qui est retenue dans ces études pour distinguer ces relations, quel que soit le
niveau considéré. Au niveau syntaxique, la subordination renvoie à une
construction de dépendance hypotactique résultant d’un processus
d’enchâssement, s’opposant à une structure non enchâssée et paratactique pour la
coordination. Au niveau sémantique et cognitif (cf. en particulier Langacker
1991, Cristofaro 2003, Fabricius-Hansen 2008, Blühdorn, 2008), la même
Downloaded from Brill.com09/10/2021 05:23:04PM
via free access140 Martine Sekali
différence de base entre les deux types de mise en lien est considérée au niveau
conceptuel, avec une opposition entre relation symétrique/asymétrique, une
relation asymétrique (subordonnante) exprimant une hiérarchie des domaines
conceptuels ou notionnels. Au niveau discursif (Polanyi 1988, Van Valin (93 ;
99) ; 2004, Asher et Vieu 2005), on oppose aussi la subordination et la
coordination en termes de hiérarchie/non hiérarchie des unités discursives par
rapport à une unité précédente ou de niveau supérieur.
Aux différents niveaux d’analyse, on retrouve dans les différentes études citées
ci-dessus, avec des terminologies quelque peu différentes, ce même trait distinctif
des deux opérations en termes de hiérarchie/non hiérarchie, et de dépendance ou
non des unités liées. Cette communauté définitoire aux différents niveaux de
l’analyse pourrait être considérée à la fois comme une preuve de la pertinence du
trait distinctif de la hiérarchie, et comme une ouverture sur des analyses de ces
phénomènes à l’interface des différents niveaux. Or il n’en est rien. En effet, il
n’y a pas de parallélisme nécessaire entre ces trois niveaux, de sorte que par
exemple une structure dite coordonnante en syntaxe peut être asymétrique (cf. les
exemples ci-dessous), et donc subordonnante selon la définition sémantique, et
vice versa.
2.2.1. Quand le coordonnant subordonne et que le subordonnant coordonne,
que reste-t-il de l’opposition coordination/subordination ? : Ce problème a été
soulevé par de nombreux linguistes, (Culicover and Jackendoff (1997) à propos
de ce qu’ils nomment «left subordinating-and», Deléchelle (1994), mais aussi
Trévise (1999), etc.).Voici deux exemples classiques de non-parallélisme avec le
coordonnant and :
(1) Give us the contents of this room, and we'll consider the account square.
[Brooklyn : 207]
(2) Ed Donnelly is still bothered by a side injury and will miss his starting turn.
[BROWN]
En (1), on a bien une structure de type coordination selon la définition
syntaxique, mais asymétrique et «sémantiquement subordonnante», selon les
définitions ci-dessus, puisqu’elle marque une relation de dépendance
conceptuelle de type repérage conditionnel, paraphrasable en If you give us the
content of this room, we’ll consider the account square. Le même constat peut
être fait concernant l’exemple (2), où and construit une relation interprétable
comme un lien de cause à conséquence, donc sémantiquement asymétrique,
puisque marquant une dépendance des prises en charge des validations, l’une
étant matrice, ou repère, de la validation de l’autre.
A l’inverse, certains marqueurs réputés subordonnants, notamment les
relateurs en WH (pour l’anglais), QUE (pour le français), peuvent dans certains
contextes contribuer à marquer des relations qui, d’après la définition
sémantique, relèveraient plutôt de la coordination, dans la mesure où ils ne
définissent pas de hiérarchisation conceptuelle. C’est le cas par exemple des
relatives appositives, continuatives et relatives dites «de phrases», comme
l’indique Loock (2007), à qui j’emprunte quelques exemples :
Downloaded from Brill.com09/10/2021 05:23:04PM
via free accessCoordination et subordination revisitées 141
(3) Luckily she landed on the bag itself, which burst.
(4) Luckily she landed on the bag itself, and it burst.
(5) She was found face down in the water and airlifted to hospital, where she died
hours later.
(6) This incredible spirit which Chelsea so clearly lack is summed up beautifully
by Gemmill, who has been unable to command a regular plane and has also
been a target for some of the fans on his rare appearances.
On peut, dès lors, opter pour deux résolutions théoriques possibles à ce
problème de non-parallélisme de la définition de la coordination/subordination
aux différents niveaux d’analyse. Une première solution consiste à conclure, à
l’instar de Bally et Ducrot (cf. Larcher 1992), ainsi que Blühdorn (2008) qui
montre de façon très complète cette absence de parallélisme, que ces trois
niveaux, syntaxique, sémantique et discursif, ne peuvent être analysés que de
façon séparée. Or c’est bien dans l’interface entre ces trois niveaux, ou plutôt ces
trois «dimensions» de la langue, qu’est construit le sens, et même s’il s’avère très
difficile de les prendre en considération simultanément, c’est à leurs points
d’interaction que je m’intéresse ici. Une deuxième solution consiste alors à
considérer que la coordination et la subordination sont en elles-mêmes des
opérations prédicatives et énonciatives particulières, justifiant l’emploi de
catégories plus ou moins étanches de marqueurs spécifiques, mais dont le trait
discriminant et définitoire, pour qu’il puisse tenir à l’interface des différentes
dimensions de la langue, doit être posé en d’autres termes que ceux de hiérarchie
ou non des éléments reliés.
2.3. De la hiérarchie aux repérages inter-énoncés
La Théorie des Opérations Prédicatives et Enonciatives fournit un appareil
théorique qui situe d’emblée l’analyse dans une interface entre syntaxe et
sémantique, de par le fait qu’elle considère non plus les phrases complexes mais
des énoncés complexes. Dans le cadre culiolien (cf. Culioli 1990 ; 1999), j’ai
proposé une analyse (Sekali 1992 ; 2011 ; 2012) qui distingue les différents
modes de relations complexes à partir de trois critères principaux :
les types de repérage inter-lexis
les types de repérages de la relation complexe par rapport aux coordonnées
énonciatives (S0, sujet origine de la prise en charge modale, ou T0, repère origine
des calculs spatio-temporels)
la portée (et le ciblage) de la relation (niveau prédicatif, énonciatif, etc.)
L’énoncé complexe y est analysé en tant que «macro-énoncé», résultant de la
prédication d’une macro-relation prédicative faisant l’objet de multiples
déterminations au niveau énonciatif, comme représenté dans la Figure 1 :
Downloaded from Brill.com09/10/2021 05:23:04PM
via free access142 Martine Sekali
< ξ0, ξ1, π0 > < ξ0, ξ1, π1
macro-lexis
S/P RELATEUR S/P
macro- relation
prédicative Assertion + Assertion +
repérage / T repérage / T
(localisation spacio- (localisation spacio-
temporelle) temporelle)
repérage / S repérage / S
(prise en charge (prise en charge
subjective) subjective)
Assertion de relation de repérage
repérage de la relation / T
(localisation spatio- temporelle)
repérage de la relation/ S
(prise en charge subjective)
macro- énoncé P connecteur Q
Figure 1 : schéma de structuration de l’énoncé complexe
Un grand nombre de travaux ont été consacrés, dans ce cadre théorique, à
l’analyse de la subordination (en particulier Deléchelle 1989, Sekali 1992, Wyld
2001, Deschamps 2003, Celle 2003, Albrespit 2003 ; 2008, et bien d’autres),
beaucoup moins à la coordination (Gournay 1998 ; 2007 ; 2011), et encore
moins, à ma connaissance, à une définition de ces deux modes de relation en
termes d’opérations distinctives (on peut citer Deléchelle 1994, qui propose
plutôt un «continuum», ainsi que Bril et Rebuschi (éds) 2006 sur la frontière
entre subordination et coordination).
Dans l’analyse de la subordination en TOPE, la notion de dépendance perd sa
verticalité, pour faire place à un réseau complexe de repérages à la fois
contextuels et situationnels. Comme l’indique A. Deschamps (2003 : 9) :
Le postulat de la subordination comme phénomène relevant obligatoirement et
prioritairement d’une structure hiérarchisée (arborescente), dans laquelle la
subordonnée vient se greffer comme complément à différents niveaux d’une phrase
matrice, ramène le problème à un phénomène de dépendance, d’adjonction ou de
complexification facultative d’un schéma canonique. Sur ce modèle de représentation,
on est en droit de se poser un certain nombre de questions […]. Il ne s’agit pas pour
autant de méconnaître ou de nier les phénomènes liés à la syntaxe, ou plutôt à une
description complète et fine des structures attestées ou inattestées, des permutations
possibles ou impossibles, des modifications minimales liées à l’emploi de tel ou tel
Downloaded from Brill.com09/10/2021 05:23:04PM
via free accessCoordination et subordination revisitées 143
marqueur, des contraintes liées à la postposition ou à l’antéposition, mais de définir
un cadre formel contraignant qui prenne en compte tous ces phénomènes, tout en
intégrant les variables qui permettent la construction du sens.
Les «dépendances» inter-énoncés peuvent, dans ce cadre, être traduites par la
construction de repérages inter-énoncés de différents types : spécification ou
construction (Paillard 1992), repères constitués, constitutifs, appositifs (Sekali
1992). Dans tous les cas, il s’agit de marquer une organisation thématique1 de
l’énoncé complexe, c'est-à-dire un ordre repère/repéré, un terme cible et un terme
source, bref, une thématisation au sein de l’énoncé complexe.
Cette organisation thématique est d’ailleurs souvent inverse à la catégorisation
syntaxique en «principale» et «subordonnée», la «subordonnée» étant souvent le
repère (c’est-à-dire source, ou matrice) d’un travail sur la «principale» repérée
(ou cible), notamment dans les circonstancielles :
(7) I’ll come round to see you if the weather is nice.
«principale» «subordonnée»
repéré repère
Figure 2 : organisation thématique dans les circonstancielles
De plus, l’organisation thématique de l’énoncé complexe dans une relation de
repérage inter-énoncé n’implique pas nécessairement un processus
d’enchâssement, et peut d’ailleurs tout à fait concerner les structures
coordonnées (cf. Fig. 3) :
(8) Ed Donnelly is still bothered by a side injury and will miss his starting turn.
[BROWN]
P and Q
Repère Repéré
Figure 3 : organisation thématique avec AND
1 Il va de soi que le terme «organisation thématique» ne renvoie pas à la théorie des «rôles
thématiques», mais à l’orientation du repérage au sein de l’ensemble complexe en terme
repère (source) et terme repéré (cible).
Downloaded from Brill.com09/10/2021 05:23:04PM
via free access144 Martine Sekali
De ces observations je tire trois conclusions provisoires :
a) la prédication d’une relation de repérage inter-énoncés (et donc de
dépendance inter-prédicative) dans une construction complexe, ne permet pas
directement de distinguer deux opérations de coordination ou de subordination :
le schéma général de tout énoncé complexe (ou macro-énoncé), qui se définit
comme la prédication d’un lien de repérage entre deux relations prédicatives,
concerne les deux structures (coordonnantes, par exemple l’énoncé 8 et
subordonnantes, par exemple l’énoncé 7) ;
b) le type d’organisation du repérage inter-énoncés dans la construction
complexe (le sens dynamique du repérage) n’est pas directement définitoire
d’une relation de coordination ou de subordination, ni même la présence (ou
absence) de tel ou tel marqueur de relation appartenant à une ‘catégorie’
(d’ailleurs bien difficile à établir) ;
c) la distinction entre opération de coordination et opération de subordination
ne peut pas être définie en termes de hiérarchie ou de dépendance inter-
propositionnelle, et se situe nécessairement ailleurs.
En conséquence, je fais l’hypothèse de l’existence d’«opérations de
structures», ou opérations complexes distinctives, dont le schéma opératoire
spécifique s’articule dans les énoncés complexe à celui des marqueurs de relation
sans toutefois s’y réduire. Je propose de revisiter la distinction entre coordination
et subordination en la considérant à l’interface2 entre syntaxe, sémantique et
discours, avec la proposition suivante : ce qui définit la coordination, et qui la
distingue de la subordination, ce n’est pas la construction d’une relation non-
hiérarchisée, non-dépendante, mais plutôt la convocation d’une relation
particulière à la dynamique linéaire du discours. Les données et exemples
proposés pour cette étude sont issus de corpus larges écrits et oraux (British
National Corpus, COCA, Brown), et d’une sélection de romans anglais et
américains3.
3. OPÉRATION DE COORDINATION ET OPÉRATION DE SUBORDINATION : POUR UNE
DÉFINITION À L’INTERFACE SYNTAXIQUE/SÉMANTIQUE/DISCOURS
3.1. Des contraintes syntaxiques révélatrices d’opérations
Si l’on se réfère aux observations de Quirk et al. (1985 : 631) sur les
contraintes distributionnelles communes qui justifient, d’après ces auteurs, une
catégorie syntaxique des coordonnants, on observe que, sur les six critères
2 J’emploie le mot «interface» au sens de locus d’interaction entre ces différentes
dimensions de la langue. L’objectif est de maintenir le même cadre théorique dans
l’analyse de cette interface, pour une description unifiée (et non contradictoire) de ces
phénomènes multidimensionnels. Les outils de la TOPE, élargis à une prise en compte de
la dynamique du discours, nous semblent tout à fait propices à une telle analyse.
3 Voir références en fin d’article.
Downloaded from Brill.com09/10/2021 05:23:04PM
via free accessCoordination et subordination revisitées 145
principaux dégagés, seuls les critères positionnels par rapport à l’ordre linéaire
du discours sont communes à tous les «coordonnants» anglais, and, but, or, et
même for :
1) The coordinator introduces the second or last coordinate (forming the expanded
coordinate).
2) The expanded coordinate cannot be preposed (moved to front position).
He tried hard but he failed / *But he failed he tried hard.
3) A coordinator cannot be preceded by another one.
*and or, *but and / and yet, but since
4) Coordinators can link clauses or constituents with possible subject gapping.
He tried hard and failed / *He failed because didn’t try hard enough
5) Coordinators can link subordinate clauses.
I wonder whether you should go and see her or whether it is better to write to her.
Yet BUT can only link that-noun clauses:
He said that John would take them by car but that he may be late.
6) Coordinators can link any number of coordinate terms, with possible gapping of
the first coordinator (except BUT, which can link only two).
You can come alone or bring Allen with you, or you can even come with your parents.
(John played football and Mary played tennis), but Alice stayed at home.
Les relateurs and, but, or and for, obéissent donc tous les quatre aux critères
distributionnels 1 à 3, les autres critères étant plus ou moins compatibles selon le
relateur (but et for étant de moins bons élèves sur les critères 4 à 6, ce qui leur a
valu l’appellation de «coordonnants moins centraux», et suggère une sorte de
continuum de la coordination).
De façon évidente, les trois critères sur lesquels les quatre relateurs
s’accordent renvoient à une dépendance stricte des coordonnants à l’organisation
linéaire du discours, là où les subordonnants peuvent détacher la relation de cet
ordonnancement linéaire. Cette observation n’est clairement pas une révélation,
mais elle est d’une importance cruciale dans la définition des «opérations de
structures» mentionnées plus haut, car je pense que c’est précisément dans cette
dépendance, cette contrainte d’ordre linéaire, que se trouve la spécificité de
l’opération de coordination, et une éventuelle justification à l’existence d’une
catégorie de marqueurs de coordination.
Il faut cependant définir précisément la nature de cette dépendance à la
dynamique de la chaîne linéaire de l’opération de coordination, ce qui suppose de
clarifier l’apport de l’une et de l’autre dans la mise en place des relations inter-
énoncés.
3.2. Précisions sur le pouvoir relationnel de la chaîne linéaire
La chaîne linéaire est gage de relation, comme l’ont abondamment montré de
nombreux linguistes, en particulier, pour l’anglais Delmas (1987) et Cotte
(1992). Elle marque déjà un ordonnancement des unités produites, avec un sens
directionnel. Au niveau de l’énoncé complexe, l’ordre linéaire des énoncés opère
une mise en relation syntactico-référentielle, une antécédence relationnelle de
Downloaded from Brill.com09/10/2021 05:23:04PM
via free access146 Martine Sekali
type anaphorique et prédicatif. Delmas (1987 : 15) décrit cette relation linéaire de
la façon suivante :
Le linéaire naît du traitement d’une structure antécédente, qui limite le dynamisme
potentiel de l’autre.
La chaîne linéaire impose donc sa dynamique comme la représentation d’une
progression prédicative et déterminative du discours. Il s’agit d’une dynamique
inchoative (un élément de discours est le point de départ de l’autre) qui définit
une progression prédicative linéaire, et marque donc déjà des relations inter-
propositionnelles et des enchaînements d’antécédence discursive, qui ne sont pas
forcément contigus d’ailleurs. La dimension déterminative et restrictive de la
relation linéaire se double d’un mouvement anaphorique métalinguistique :
A l’origine de l’énonciation est la motivation par la référence, et l’énonciation est de
retourner à celle-ci pour la dévoiler, la rendre explicite pour autrui. (Cotte 1992 : 65)
Une question se pose alors : à quel niveau de l’organisation des énoncés la
puissance relationnelle et prédicative de la chaîne linéaire joue-t-elle, ou, plus
précisément, qu’est-ce qui, dans la mise en place des relations inter-énoncés, est
défini par, ou lié à, ce que Cotte (1992) nomme le «programme linéaire», et
qu’est-ce qui ne l’est pas : les relations d’antécédence ? L’organisation
thématique (l’ordre des repérages) ? L’organisation de l’information et la
hiérarchisation des unités de discours en topic et comment ?
Anscombre (1990) à propos de l’article zéro, Corminboeuf (2010) à propos de
la causalité asyndétique dans le cadre de la théorie de la pertinence pragmatique,
évoquent un lien entre l’absence de déterminations explicites (au sein des
propositions, ou de la relation elle-même par simple juxtaposition asyndétique),
et la projection d’une inférence, ce que Corminboeuf 2010 appelle joliment une
«plus value inférentielle» : un énoncé peu informatif (peu déterminé) projette
l’apparition d’une seconde énonciation qui le complètera, et crée ainsi un lien
anticipé par cette projection. Les énonciations ‘projetantes’ sont peu pertinentes
pragmatiquement sans la suivante, et donc inchoatives d’une relation
d’antécédence et d’anaphore. Cette corrélation entre le degré d’indétermination
et le degré de prédicativité linéaire est intéressante. Je l’exemplifie dans le
paragraphe suivant, où le locuteur projette une sorte de scénario construit par la
juxtaposition d’énoncés en relations asyndétiques :
(9) I want to serenade her. Properly, Venice style. That's where you come in. You
play your guitar, I sing. We do it from a gondola, we drift under the window, I
sing up to her. We're renting a palazzo not far from here. The bedroom
window looks over the canal. After dark, it'll be perfect. The lamps on the
walls light things up just right. You and me in a gondola, she comes to the
window. All her favourite numbers. We don't need to do it for long, the
evenings are still kind a chilly. Just three or four songs, that's what I have in
mind. I'll see you're well compensated. What do you say? [Ishiguro: 10-13]
Les énoncés dans ce paragraphe comportent des déterminations verbales
minimales pour la plupart, avec des présents simples qui valident la
Downloaded from Brill.com09/10/2021 05:23:04PM
via free accessCoordination et subordination revisitées 147
représentation sur un plan fictif, à la manière de didascalies. La juxtaposition
asyndétique dans la chaîne linéaire met toutes ces représentations en relation,
dans le sens d’une détermination progressive du scénario imaginé, qui développe
la première phrase I want to serenade her, et qui est rassemblée dans la dernière
par la question what do you say? La dynamique linéaire a bien une fonction
prédicative et inchoative, dans une relation d’antécédence et d’anaphore
discursive et référentielle. Mais la nature sémantique des relations inter-énoncés
et donc l’organisation thématique des repérages dans ces relations, se sont pas
construites directement par la linéarité, mais par un réseau de marques
linguistiques de déterminations. Dans l’exemple cité, certaines relations
asyndétiques sont interprétables comme des relations de concomitance (you play
your guitar, I sing, avec deux relations prédicatives parallèles indéterminées,
mais un contraste au niveau des pronoms et des prédicats) ; de successivité (You
and me in a gondola, she comes to the window, où l’aspect lexical télique du
verbe come induit une nouvelle dynamique processuelle) ; d’autres encore sont
interprétées comme des retours explicatifs ou commentatifs (We don't need to do
it for long, the evenings are still kind a chilly, où cette fois la télicité impliquée
par l’opérateur to contraste avec l’aspect lexical statif du prédicat be chilly validé
par le présent simple. La relation prédicative validée est du coup posée comme le
repère explicatif de la modalisation par not need). Si la dynamique anaphorique
imposée par la chaîne linéaire est orientée prospectivement de la même façon
dans ces diverses relations asyndétiques, l’ordre des repérages, on le voit, est
donc différent.
Si la chaîne linéaire est «gage de relation», l’ordre des repérages dans l’énoncé
complexe, la nature sémantique de la relation, son orientation argumentative, ne
sont donc pas instruites directement ou uniquement par l’ordre linéaire, mais
liées à la construction des représentations (aspects lexicaux des prédicats,
pronoms, déterminations, prosodie, repérages situationnels et contextuels, et
marqueurs de relation). En (10) par exemple, la réponse négative à une demande
en mariage est expliquée par une relation linéaire asyndétique dont l’organisation
thématique (le sens du repérage) est définie principalement par le present perfect
suivi par le présent simple sur un verbe d’état :
(10) Marriage is for young people, for kids who want to have babies. We've
already done that. We're free. [Brooklyn : 279]
Le point de vue situationnel (ici la situation de l’énonciation, S0, T0), qui sert
de repère à l’évaluation du procès do, est également le repère de l’assertion we’re
free et induit un repérage proactif interprétable comme une relation de cause à
conséquence.
La chaîne linéaire imposant un mouvement prédicatif orienté, on peut alors
considérer que le rôle des marqueurs explicites (marqueurs d’anaphore,
déterminations verbo-nominale, connecteurs, etc.) est plutôt de
contraindre/restreindre l’éventail des relations (et donc des interprétations) à un
point du texte, et d’expliciter l’ordre des repérages inter-énoncés. Les relations
syndétiques (avec marqueurs explicites) comportent systématiquement une
instruction de clôture par rapport à une projection linéaire potentielle : par
Downloaded from Brill.com09/10/2021 05:23:04PM
via free access148 Martine Sekali
détermination, restriction, réélaboration de l’élément repris dans la relation,
travail métalinguistique sur le vouloir dire et les positionnements intersubjectifs.
Pour clarifier la réponse à la question «A quel niveau de l’organisation des
énoncés la puissance relationnelle et prédicative de la chaîne linéaire joue-t-
elle ?», je propose ci-dessous (Fig.4) de discerner le statut organisationnel des
éléments au sein de l’énoncé complexe, en précisant le lien entre ce statut et la
dynamique linéaire :
Statut organisationnel des éléments au sein d’un énoncé complexe
LIEN A LA
TERMES LOCUS CHAINE
LINEAIRE
ANTECEDENT ANAPHORE Ordre syntaxico- Défini par la
référentiel chaîne linéaire
Reprise d’un amont
pour nouvelle
prédication
Organisation
THEME RHEME thématique de la Non lié
Terme de départ macro-relation (structuration
de l’énoncé, cible prédicative (sens interne de
de la relation du repérage) l’énoncé)
TOPIC COMMENT Organisation Lié
Cadre discursif, Apport discursif syntaxico- (positionnement
support discursive des unités dans la
chaîne linéaire et
prosodie)
ANCIEN NOUVEAU Déterminations et Non lié
Acquis Posé repérages par (positionnement
Préconstruit Construit rapport aux intersubjectif sur
instances la relation
énonciatives prédicative
complexe)
Figure 4 : liens entre organisation de l’énoncé complexe et chaîne linéaire
Ainsi, l’ordre prédicatif linéaire n’est pas à l’origine de l’organisation
thématique de l’énoncé complexe, c’est-à-dire du choix du terme de départ dans
la macro-relation, et de l’ordre du repérage inter-énoncés. Comme dans un
énoncé ‘simple’ (comportant une seule relation prédicative), où la relation
prédicative est également orientée par le choix d’un terme de départ autour
duquel s’organise l’énoncé, l’ordre des mots ne définit pas nécessairement le
terme de départ de la relation prédicative, le sujet syntaxique n’est donc pas
nécessairement le thème. De la même manière, au niveau de l’énoncé complexe,
le thème (ou cible de la relation) est défini par le choix des structures et des
marqueurs de relation, ainsi que par tout un paramétrage au sein des énoncés
Downloaded from Brill.com09/10/2021 05:23:04PM
via free accessCoordination et subordination revisitées 149
connectés (lexique, déterminations, prosodie, repérages situationnels, etc.). De
plus, la valeur sémantique des relations inter-énoncés est associée non pas à
l’ordre linéaire mais à l’ordre thématique (sens du repérage), et c’est pourquoi
and par exemple, qui opère un repérage prospectif, peut instruire des valeurs
relationnelles de consécution ou de conséquence, mais pas de cause.
Si l’organisation des informations en informations nouvelles ou acquises n’est
pas liée à la linéarité, mais plutôt au repérage de la référence par rapport aux
instances énonciatives, en revanche, l’organisation des unités de discours en topic
et comment est étroitement liée à un positionnement linéaire de ces unités.
Les marqueurs de relation (de connexion, i.e. les connecteurs) ont donc un rôle
dans la mise en place de l’organisation thématique, c'est-à-dire dans l’instruction
de l’ordre du repérage inter-énoncés, ainsi que dans le marquage du repérage
énonciatif (et intersubjectif) des éléments reliés.
3.3. «Opérations de structures» et distinction entre les opérations de
coordination/subordination à l’interface syntaxe/sémantique/discours :
organisation thématique et linéarité
Parler d’«opérations de structure» peut paraître un paradoxe, dans la mesure où
le terme structure est souvent associé à une description purement syntaxique et
compositionnelle des «phrases». Le mot «structure» tel que je l’emploie ici ne
renvoie pas à des formes syntaxiques fixes, mais à des processus spécifiques de
mise en interface des dimensions syntaxique, sémantique et discursive dans
l’organisation des énoncés complexes. Les «structures de coordination et de
subordination», dans ce sens, peuvent être définies comme des opérations
relationnelles distinctes, c’est-à-dire des modes contraints d’association de deux
dynamiques relationnelles : la dynamique prédicative linéaire, et la dynamique du
repérage inter-énoncés marquée par les connecteurs et/ou par les paramètres de
détermination relationnelle inscrit dans les éléments joints (temps, aspects,
modalité, détermination nominale, pronominale, prosodique, etc.). En relation
avec les observations précédentes, je propose donc de considérer que
coordination et subordination correspondent à deux «schémas de structures» qui
instruisent deux opérations différentes. Ces opérations ne sont pas basées sur la
hiérarchisation ou non des éléments joints dans l’énoncé complexe, car elles
opèrent non pas sur la relation inter-énoncés elle-même, mais sur le lien entre
deux ordres d’organisation relationnelle :
SUBORDINATION : opération qui dissocie l’organisation thématique et
informationnelle de l’ordre prédicatif linéaire. L’ordre du repérage inter-énoncés
est directement instruit par le marqueur de relation ; la linéarité n’affecte que
l’organisation discursive des éléments joints (topicalisation par antéposition,
etc.). En revanche, la relation inter-énoncés est indexée aux coordonnées
situationnelles (S ou T), et donc rattachée à un repère situationnel.
COORDINATION : opération qui solidarise les deux ordres syntactico-
référentiels linéaires et thématiques. L’organisation thématique des énoncés
coordonnés (le sens du repérage inter-énoncés) est indissociablement liée à
l’ordre de chaîne linéaire et ne peut s’en détacher par des positionnements
Downloaded from Brill.com09/10/2021 05:23:04PM
via free access150 Martine Sekali
énonciatifs ou un reformatage discursif. La relation inter-énoncés est directement
indexée à l’ordre prédicatif linéaire dans sa dimension d’antécédence et
d’anaphore pour prédiquer une relation entre les entités coordonnées.
Dans un schéma opérationnel subordonnant, les ordres syntactico-référentiel et
thématique étant désolidarisés, la relation inter-énoncés peut être anaphorique ou
cataphorique ; elle ne peut être qu’anaphorique en coordination, qui ancre
l’énoncé complexe dans l’espace du discours, et instruit la prise en compte d’un
amont discursif (pas forcément contigu). On peut ainsi affirmer que l’opération
de coordination définit une relation prioritairement contextuelle (embrayage
contextuel linéaire) là où l’opération de subordination définit une relation
prioritairement situationnelle (embrayage situationnel).
Ce sont ces deux schémas opérationnels distincts, coordonnant et
subordonnant, qui permettent par exemple, de distinguer les énoncés complexes
avec and et if dans ce qui a été souvent nommé les «impératifs conditionnels» :
(11) Trust me darling and you will be all right. [Ashford: 42]
(12) If you trust me darling, you will be all right.
(13) You put me back in jail and I'm finished. I'm a dead man. [Brooklyn: 207]
(14) If you put me back in jail, I’m finished.
Dans les énoncés (11) et (13), avec and en interaction avec les marqueurs
contextuels de détermination minimale sur les prédicats try et put back in jail,
l’énonciateur impose le lien P/Q par le coordonnant, qui relaie le manque
d’assertion intra-énoncé par une assertion inter-énoncé très forte. Le coordonnant
and embraye ainsi la relation sur un repérage inter-énoncés prospectif et co-
orienté de P à Q, sur la base d’un point d’anaphore qui est ici la modalité
assertive dans P. Sont construites alors des relations de corrélation de validations
(ou plutôt de validabilité), la validabilité de Q découlant de celle de P. On ne
peut parler de «conditionnel» dans cette relation, qui relève plutôt d’une
dynamique thématique linéaire de cause à conséquence. Du fait de la mise en
place d’une dépendance inter-énoncés et de la suspension de l’assertion des
éléments liés dans ces configurations coordonnées, on a souvent rapproché ces
structures des constructions subordonnées en if qui construisent des repérages
conditionnels ou hypothétiques, comme c’est le cas dans les énoncés (12) et (14).
Ces énoncés en and sont souvent analysés dans une rubrique à part dans
l’analyse des coordonnants : soit ils sont considérés comme des emplois «non-
coordinatifs» (cf. en particulier Lang 1984, Culicover and Jackendoff 1997), soit
ils sont nommés «pseudo-impératifs conditionnels» (voir Perrin 1992 et Gournay
1998). Ces comparaisons ont d’ailleurs souvent amené ces auteurs à conclure
que, si on les envisage à l’interface syntaxe/sémantique, il n’y a pas lieu de
considérer la coordination et la subordination comme des opérations distinctes,
mais qu’il faut plutôt les envisager comme les deux pôles d’une même opération
sur un continuum de relations inter-propositionnelles (voir aussi Deléchelle 1994
sur cette proposition).
Ce constat récurrent est dû au fait que les structures de coordination et de
subordination sont toujours distinguées à partir de la notion de hiérarchie. Les
Downloaded from Brill.com09/10/2021 05:23:04PM
via free accessCoordination et subordination revisitées 151
propositions de redéfinition de ces opérations de structures présentées ci-dessus
visent justement y substituer un autre trait distinctif, plus opérant dans une
analyse unifiées des énoncés complexes dans leur irréductible multi-
dimensionnalité : dans cette interface même, coordination et subordination sont
des «opérations de structures» ayant une identité opératoire propre et distincte,
même si, dans l’interaction de ces opérations de structure et de celles des
marqueurs qui la constituent, des représentations assez proches peuvent être
construites. Ainsi, la différence entre les énoncés coordonnés ci-dessus et leur
paraphrase en if réside dans le fait que and est associé à une opération de
coordination, et construit donc une relation contextuelle où l’organisation
thématique est liée à la dynamique linéaire, alors que if est associé à une
opération de subordination, et embraye la relation sur un repérage situationnel à
partir d’un repère explicitement fictif. Les travaux en particulier de Trévise sur
l’anglais (cf. Trévise 1999, et Trévise et Constant 2007) et de de Vogüé sur le
français (de Vogüé 1986 ; 1999a), montrent que le subordonnant if construit un
repère fictif, un changement de plan par rapport au réel. Le marqueur if instruit le
balayage des deux branches de la bifurcation notionnelle, et la prise en compte de
l’occurrence de la protase (Q) comme repère de la validation de l’apodose (P).
L’organisation thématique en terme repère (Q)/terme repéré (P) n’est pas liée,
avec if, à la dynamique prédicative linéaire, elle est imposée par le subordonnant
if. L’énoncé repère peut donc être antéposé ou postposé à l’énoncé repéré, la
position n’ayant pas d’incidence sur l’ordre du repérage inter-énoncés, même si
elle influe clairement sur l’organisation discursive des relations inter-énoncés et
le marquage des processus de topicalisation (cf. Celle et Baumer à paraître sur
si/if cadratifs). La nature de la distanciation du repère fictif instruit par le
marqueur if par rapport à la situation de l’énonciation est, quant à elle, définie par
les paramètres de repérage situationnel, notamment les temps et aspects dans la
protase (menant à la construction de valeurs de potentiel, d’irréel, de
contrefactuel, etc.).
Dans l’énoncé (14) par exemple, la relation prédicative [you/put me back in
jail] est ancrée par if dans une situation fictive que le présent simple marque
comme potentielle par rapport à Sit0, et cette relation prédicative potentiellement
validée, est désignée par if, dans une alternative avec sa non validation, comme
repère de la validation tout aussi potentielle de l’apodose [I/be finished].
Si l’on retrouve avec if, comme dans l’analyse de la construction coordonnée
avec and (exemple (13)), une suspension de l’assertion dans la protase, celle-ci
est directement due au repérage fictif instruit par if. Par contre, le relateur and à
lui seul ne définit aucun repérage situationnel. La valeur non assertée et
décrochée du réel, de la relation prédicative P [you/put me back in jail] en (13)
est issue de la synergie entre l’opération marquée par le présent simple et
l’embrayage contextuel sur sa relation avec Q. En outre, le mouvement prédicatif
marqué par les deux relateurs n’est pas le même : avec and, conformément à sa
forme schématique, et à l’opération de structure coordonnante dans laquelle il
s’inscrit, l’organisation thématique est solidaire de la dynamique linéaire, et le
repérage inter-énoncés se fait non pas sur la base d’un repérage situationnel fictif,
mais par l’assertion d’un lien contextuel anaphorique.
Downloaded from Brill.com09/10/2021 05:23:04PM
via free accessVous pouvez aussi lire