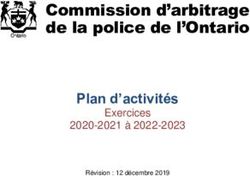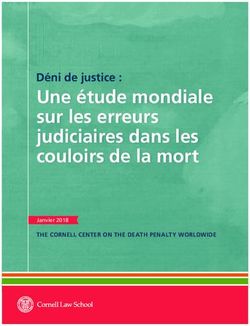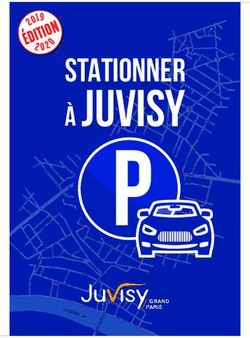Introduction Pascale Dufour et Francis Dupuis-Déri - Pascale Dufour et Francis Dupuis-Déri
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Introduction
Pascale Dufour et Francis Dupuis-Déri
Depuis quelques années, plusieurs initiatives populaires proposent de
surveiller la police pour documenter et dénoncer ses violences discrimi-
natoires1. Aux États-Unis, quand elles ciblent des Afro-Américains, on
les qualifie même de « crime contre l’humanité »2. En France, on a parlé
d’une « crise » de la police, avec la médiatisation de plusieurs cas de bru-
ISBN 978-2-7535-8701-4 Presses universitaires de Rennes, 2022, www.pur-editions.fr
talité policière (L’Heuillet, 2020)3. Les violences policières contre le mou-
vement des Gilets jaunes, en France, ont stimulé cette dynamique, alors
qu’au Québec, c’est la répression de la grande grève étudiante de 2012
(le Printemps érable), qui a provoqué une prise de conscience chez des
gens qui se sentaient peu ou pas concernés par le sujet4.
« Profilages policiers », Pascale Dufour et Francis Dupuis-Déri (dir.)
N. D. E. L’utilisation du genre masculin comme un neutre est une pratique de la
maison d’édition.
1. Les auteurs tiennent à remercier Louis Massé, étudiant au baccalauréat en économie
politique, et Imène Torkhani, doctorante en science politique, tous deux à l’Université de
Montréal, pour leur aide à la révision et la mise en forme du manuscrit de cet ouvrage.
2. Voir le rapport de l’International Commission of Inquiry on Systemic Racist Police
Violence Against People of African Descent in the United States, publié en 2021 par la
National Conference of Black Lawyers, l’International Association of Democratic Lawyers
et la National Lawyers Guild.
3. Signe de crispation sociale, plusieurs syndicats de la police ont organisé, en mai
2021, une manifestation devant l’Assemblée nationale, pour dénoncer les agressions à
l’endroit de leurs membres en service et exiger plus de moyens pour y faire face. Selon les
organisateurs, 35 000 personnes ont participé au rassemblement (ironiquement, la police
n’a pas fourni ses propres estimations). De nombreux parlementaires et le ministre de
l’Intérieur étaient présents pour exprimer leur « soutien aux forces de l’ordre » (Auffret,
2021).
4. Il faut toutefois se méfier de l’impression de « nouveauté », par exemple au sujet de
la « militarisation » du « maintien de l’ordre » (Pilorget-Rezzouk, 2020a), qui se traduit
aussi par une plus grande brutalité d’intervention pour un simple contrôle à domicile dans8 • prof i l age s p ol ici e r s
À l’été 2020, la mort très médiatisée de George Floyd, aux États-Unis,
étouffé par un policier, a provoqué une deuxième vague du mouvement Black
Lives Matter et entraîné des mobilisations contre la police un peu partout
dans le monde, y compris à Montréal et à Paris, où des milliers de personnes
ont répondu à l’appel. De plus, des observatoires sur les libertés et les pra-
tiques policières ont vu le jour à Bordeaux, à Montpellier, à Nantes, à Paris
et à Toulouse, entre autres, pour documenter la répression policière lors de
manifestations, notamment celles des Gilets jaunes. Des journalistes indé-
pendants, comme David Dufresne (2013) en France, ou des militants de
longue date comme Alexandre Popovic (2013) au Québec, participent à ce
mouvement de documentation et de dénonciation des violences policières.
À Montréal, des collectifs se mobilisent depuis de nombreuses années
contre les violences policières, comme le Collectif opposé à la brutalité
policière (COBP), de sensibilité punk et anarchiste ou la Coalition contre
la répression et les abus policiers (CRAP) ; des organisations implantées
dans les quartiers défavorisés, comme Hoodstock et la Clinique juridique
de Saint-Michel ou encore la Ligue des droits et libertés, la Commission
ISBN 978-2-7535-8701-4 Presses universitaires de Rennes, 2022, www.pur-editions.fr
des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Eid et Turenne, 2010)
et des avocats progressistes (Guay, 2020). Plus récemment, la Coalition
pour le définancement de la police, composée de 45 organismes inspirés
par le mouvement américain Defund the police, a présenté un budget
alternatif à la Ville de Montréal, qui proposait de transférer 50 % du budget
« Profilages policiers », Pascale Dufour et Francis Dupuis-Déri (dir.)
attribué au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) vers des
communautés marginalisées ciblées par la police (Buzzetti, 2020). En vain.
En 2021, le budget de la police a été augmenté, malgré le fait que la Ville
est, pour la première fois, gouvernée par une femme progressiste, Valérie
Plante, qui a milité dans des groupes féministes altermondialistes au début
des années 2000. Les actions de cette coalition rejoignent des préoccupa-
tions exprimées depuis des années par les populations autochtones,
notamment à propos des femmes disparues et assassinées, dont la police
se désintéresse (voir le Silent Witness Project)5.
le cadre de la « guerre à la drogue » (pour les États-Unis, voir : Balko, 2013). On a observé
plusieurs de ces nouveautés avant le 11 septembre 2001 (Masse et Bayon, 2013 ; Wood, 2015),
sans oublier la répression policière dont a été l’objet le mouvement altermondialiste, la
mouvance « anarcho-autonome » et les Black Blocs, établis par les autorités comme des
ennemis publics, potentiellement terroristes (Cahn, 2010 ; Cadocciani, 2019).
5. Maud Cucchi, « Femmes autochtones disparues et assassinées : le SPVM défaillant,
conclut une étude », Radio-Canada, 28 janvier 2021.I n t roduc t ion • 9
Des recherches-actions ont été menées en partenariat avec les com-
munautés tout particulièrement ciblées par les profilages, par exemple le
Projet X réalisé en 2020 avec des jeunes de 12 à 25 ans par l’association
À deux mains/Head et Hands, dans Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal6.
Ce projet faisait suite à #MtlSansProfilage, créé par 48 jeunes du quartier
Saint-Michel, toujours à Montréal, et qui a mené à la création d’une page
sur les réseaux sociaux et à la publication d’un rapport qui fait état de
jeunes ciblés par diverses pratiques policières (surveillance, contrôle
d’identité, fouille, arrestation, détention) et d’interpellations sans fonde-
ment juridique, vécues comme du harcèlement, ce qui entraîne du stress,
de la peur, un sentiment de culpabilité et un effritement de la confiance
envers le système judiciaire et policier (Livingstone, Rutland et Alix 2018 ;
voir aussi Livingstone, Meudec et Harim, 20217). Des partenariats entre
universitaires et communautés profilées sont également à l’œuvre dans
l’Observatoire sur les profilages de l’Université de Montréal (dont sont
membres les responsables de cet ouvrage).
Quand la police tue, il n’est pas rare que des comités soient formés
ISBN 978-2-7535-8701-4 Presses universitaires de Rennes, 2022, www.pur-editions.fr
par des proches de la victime et des activistes solidaires, comme le Comité
Vérité pour Adama, en France (Boutros, 2020), ou le Montréal-Nord
Républik, fondé en 2008 après la mort de Fredy Villanueva, à Montréal
(Hébert, 2010). En plus d’honorer la mémoire de la victime, ces comités
ont pour but d’exiger que la lumière soit faite sur le drame afin que leurs
« Profilages policiers », Pascale Dufour et Francis Dupuis-Déri (dir.)
responsables soient déférés devant les tribunaux.
Cette effervescence s’inscrit dans une longue histoire. Dans les années
1960, aux États-Unis, par exemple, le Black Panther Party (BPP) était créé
entre autres en réaction aux violences policières racistes. Dans son pro-
gramme en dix points, l’organisation exigeait la fin immédiate de la
brutalité policière et des meurtres de personnes noires ainsi que de
l’emprisonnement de masse. En plus de l’autodéfense armée, le BPP aurait
développé le cop watch, une pratique de sousveillance de la police – du
bas vers le haut, contrairement à la surveillance du haut vers le bas – où
des patrouilles se formaient dans les quartiers, équipées d’un bloc-notes,
d’un appareil photo ou même d’une caméra Super8 (Mire, 2015).
6. Le nom de l’auteure du rapport est Rachelle, coordonnatrice de À deux mains/
Head et Hands.
7. En plus du trio de rédaction, l’équipe de travail comprenait Zakarya Youness Abidou,
Walther Guillaume, Rhita Harim, Radney Jean-Claude, Marc-Kendy Milien et Larry Rémé.10 • prof i l age s p ol ici e r s
Dans les années 1970, à Montréal, Paul Déjean, du Bureau de la com-
munauté chrétienne des Haïtiens de Montréal (BCHM), se mobilisait avec
d’autres contre les agressions de la police ciblant de jeunes Noirs dans des
parcs. En 1979, le Centre communautaire noir déposait un rapport dans
le cadre de la consultation publique sur le Service de police de la
Communauté urbaine de Montréal (SPCUM) pour en dénoncer les « tac-
tiques de guérilla » (Rutland, 2020). La même année, l’Association pour
les droits des gais du Québec (ADGQ) sollicitait des témoignages d’homo-
sexuels harcelés ou même piégés par la police ; ce mandat a été repris, il
y a quelques années, par le collectif Cruise Control (Lénart, 2018).
Plusieurs initiatives existent aussi aux États-Unis, dont Say Her Name et
Incite !, qui documentent et dénoncent les violences policières contre les
femmes et les personnes queer racisées. L’exaspération populaire contre
la violence policière s’exprime aussi dans l’art, notamment par la musique
punk et le hip-hop.
Il ne s’agit ici que de quelques exemples de communautés défavorisées,
marginalisées, stigmatisées et de leurs alliés qui réagissent à la violence
ISBN 978-2-7535-8701-4 Presses universitaires de Rennes, 2022, www.pur-editions.fr
policière dont elles sont la cible. Alors que la rue se mobilise contre les
violences policières et les « bavures », y compris par des actes de sabotage
et de vandalisme ou des émeutes (Bertho, 2009 ; Dupuis-Déri, 2017 ; voir
notamment le dossier « Se protéger de la police, se protéger sans la police »,
Mouvement, no 92, 2017), la recherche universitaire évolue, qui propose
« Profilages policiers », Pascale Dufour et Francis Dupuis-Déri (dir.)
d’analyser de manière critique le travail de la police. Ce livre s’inscrit dans
cette lignée, en traitant des profilages policiers (racial, social et politique)
dans différents espaces nationaux (la France, le Québec et l’Argentine), et
en adoptant une perspective intersectionnelle qui rend visible l’imbrica-
tion des rapports sociaux de catégories socialement constituées comme
la classe, la race, le sexe et l’âge.
Bref survol des études universitaires sur la police
La science politique, qui est la discipline des deux responsables de
cet ouvrage, s’intéresse très peu à la police. En 2015, aux États-Unis, Jeffrey
C. Isaac, de l’Université de l’Indiana, à Bloomington, déplorait qu’en dix
ans, il n’y ait pas eu plus de cinq articles traitant de la police qui aient été
publiés dans les trois revues les plus importantes de la discipline
(American Political Science Review, American Journal of Political Science,I n t roduc t ion • 11
The Journal of Politics). Il notait alors que les manuels d’introduction à
la vie politique aux États-Unis du premier cycle universitaire n’ont
presque jamais de section sur la brutalité policière ou sur l’incarcération
de masse, en suggérant qu’un intérêt plus grand envers la police mènerait
des politologues à déceler un « dysfonctionnement politique dans la
démocratie aux États-Unis » (Isaac, 2015 : 610). Deux ans plus tard, Joe
Soss et Vesla Weaver ont partagé ce constat, qui remettait en cause une
des certitudes de la science politique aux États-Unis : plus les citoyens ont
d’interactions avec l’État, plus ils sont bien intégrés socialement et plus
les institutions sont « démocratiques ». Or c’est tout le contraire qui est
vrai quand on parle de la police et des prisons. Dans des villes comme
Ferguson, où des émeutes ont éclaté en 2014 après que la police a tué
l’Afro-Américain Michael Brown, les pratiques policières d’extorsion
(extractive policing) contribuent à 20 % du budget municipal, qui se tra-
duisent par une moyenne de trois mandats d’arrêt par foyer (Soss et
Weaver, 2017 : 566).
Même une discipline plutôt conservatrice comme la science politique
ISBN 978-2-7535-8701-4 Presses universitaires de Rennes, 2022, www.pur-editions.fr
peut être rattrapée par les événements et les mobilisations populaires. C’est
ainsi que la revue Perspectives on Politics, dans laquelle Jeffrey C. Isaac
avait publié, en 2015, ses propos critiques, a lancé, en 2021, un appel de
textes pour un dossier spécial sur le mouvement Black Lives Matter. En
France et au Québec, l’intérêt des universitaires pour la police reste aussi
« Profilages policiers », Pascale Dufour et Francis Dupuis-Déri (dir.)
l’exception en sciences humaines et sociales, si l’on excepte la criminologie,
mais il y a proportionnellement plus de recherches menées par les spécia-
listes sur les pratiques policières8.
8. Sans pouvoir nommer tous ces spécialistes ou prétendre à l’exhaustivité sur les
sujets de recherche, notons, pour la France, des études historiques et philosophiques sur
l’origine de la police (L’Heuillet, 2002) et des enquêtes en sociologie politique sur le rapport
de la police à l’« ordre social » (Fabre, 2009), y compris chez les futurs membres des forces
policières « disciplinés à discipliner » au cours de leur formation (De Bellaing, 2009). Des
études portent plus spécifiquement sur les pratiques policières face aux foules manifestantes
(Fillieule, 1997) et les changements d’approches selon l’époque et le contexte (Masse et
Bayon, 2004 ; Fillieule, 2013), en portant parfois une attention particulière à la répression
(Codaccioni, 2019 ; Cahn, 2010). D’autres encore ont examiné le rapport entre la police
française et son histoire coloniale (Blanchard 2018) ou les femmes, qu’elles soient elles-
mêmes policières ou les cibles des interventions policières (Darley, Gauthier, 2018). Des
spécialistes de la police ont aussi traité de profilage et de déviance des forces de l’ordre
(Jobard et de Maillard, 2015 ; Roché, 2016). D’autres, enfin, ont étudié la police en tant
profession et organisation (Monjardet, 1996) ou des unités en particulier, comme la Brigade
anticriminalité (BAC), mettant en lumière des pratiques prédatrices à forte connotation12 • prof i l age s p ol ici e r s
Les universitaires qui étudient la police, que ce soit en science poli-
tique, en sociologie, en criminologie ou en anthropologie (entre autres),
peuvent choisir de s’inscrire dans des perspectives plus ou moins critiques,
et de mener leurs recherches avec la police ou avec les individus qui en
sont la cible9. Ces différentes approches donnent lieu à des accusations,
de part et d’autre, d’être trop indulgente envers la police ou les mobilisa-
tions sociales, ou encore de manquer de rigueur et d’objectivité. Un
consensus existe tout de même sur l’idée d’une police « démocratique »
dans les régimes libéraux-républicains : celle-ci devrait être redevable à
la société civile et aux lois plutôt qu’au pouvoir politique, elle devrait
respecter et protéger les droits de la personne et n’avoir recours à la force
qu’en cas de nécessité, et de manière proportionnelle à la menace (Hinton
et Newburn, 2009 ; Bayley, 2006 ; Jones et al., 1994).
Quant à cet ouvrage, il s’inscrit explicitement dans le champ des
études critiques de la police, ou Critical Studies in Policing (ou Democratic
Policing [Manning, 2010]), qui est notamment marqué par une forte pré-
sence de femmes de différentes disciplines10. Ce champ n’est peut-être pas
ISBN 978-2-7535-8701-4 Presses universitaires de Rennes, 2022, www.pur-editions.fr
aussi « émergeant » que le prétend l’Association for Political and Legal
Anthropology (2016), mais son apport critique paraît d’autant plus impor-
tant qu’il est en phase avec les préoccupations et les mobilisations popu-
laires qui ont émergé, ces dernières années, à la suite de violences
raciste (Fassin, 2011), l’impunité policière (Pregnolato, 2020), etc. Au Québec, en plus des
« Profilages policiers », Pascale Dufour et Francis Dupuis-Déri (dir.)
travaux notables de Jean-Paul Brodeur sur la profession et l’institution policières (Brodeur,
2003), notons une étude sur les interventions policières se soldant par la mort de civils et
sur la possibilité de désarmer la police (Dubé et Beauchesne, 1993), des études sur les enjeux
de contrôle de la police (Bourgault et Gow, 2002), sur le rapport de la police aux femmes
(Beauchesne, 2009), sur de possibles manipulations de rapports d’enquête, afin d’éviter
que celles-ci se résolvent (Tremblay 2010), sur les transformations de l’attitude des policiers
envers le code de déontologie (Alain, 2011), sur la marchandisation des services policiers
(Mulone, 2012), sur l’intégration de la police canadienne dans des opérations internatio-
nales de maintien de la paix (Tanner, 2013), sur la police face aux femmes dans les mani-
festations (Pérusse-Roy et Mulone, 2020) et sur les caméras corporelles pour les policiers
en service (Boivin et D’Elia, 2020). D’autres ont travaillé sur les profilages et les déviances
policières (Armony, Bellot, Eid, Livingstone, Maynard, Niemi, Rutland, Sylvestre, etc.).
9. À noter que la police surveille des universitaires et même des associations univer-
sitaires comme l’a fait la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à l’égard de l’Association
canadienne de science politique, de la Canadian Historical Association, de la Canadian
Economics Association, de la Canadian Sociology and Anthropology Association et de la
Canadian Peace Research and Education Association (Hewitt, 1998).
10. Comme on le constatera en consultant les tables des revues Lien social et Politiques
(no 84, 2020) et Mouvements (no 92, 2017) et la liste des membres de l’Observatoire des profi-
lages ; alors que, traditionnellement, l’étude de la police était une chasse gardée masculine.I n t roduc t ion • 13
policières qui semblent contredire cet idéal démocratique. Il s’agit alors
d’examiner ces pratiques policières, d’identifier les « problèmes sociaux »
qui en découlent et d’évaluer si elles ont pour conséquence de (re)produire
des rapports de domination, d’exacerber les inégalités et de limiter la
participation citoyenne ou celle des sans-papiers et l’autonomie des com-
munautés et des individus (Sklansky, 2007 ; Ward et Stone, 2000).
Ces approches critiques de la police ont souvent pour objet le racisme,
comme c’est le cas pour la théorie d’inspiration marxiste de la « menace
raciale ou ethnique » (racial and ethnic threat), développée à partir des années
1960. Elle affirme que les villes ou les quartiers dont la population majori-
tairement blanche perçoit l’installation d’Afro-Américains comme une
menace consacrent plus de ressources à la police et que celle-ci est plus
agressive envers les nouveaux venus. Les recherches qui s’inspirent de cette
théorie privilégient surtout une approche macrosociologique, en comparant,
par exemple, les transformations démographiques d’un quartier avec les
fluctuations des budgets et des effectifs des corps policiers, le nombre d’arres-
tations, le taux d’emprisonnement, etc. Des études par sondage cherchent
ISBN 978-2-7535-8701-4 Presses universitaires de Rennes, 2022, www.pur-editions.fr
aussi à comprendre les perceptions de la majorité blanche face aux « Autres »
(Afro-Américains, Latino-Américains, etc.), puisque la théorie postule que
celle-ci influence fortement les autorités politiques qui, à leur tour, influencent
la police qui serait, en définitive, au service de cette majorité (Smith 2021 ;
Gray et Parker, 2020 ; Holmes, 2018 ; Stults et Swagar, 2018 ; Snipes, Maguire
« Profilages policiers », Pascale Dufour et Francis Dupuis-Déri (dir.)
et Wang, 2019 ; Jobard et de Maillard, 2015 ; Parker et al., 2005)11.
Plusieurs contributions à cet ouvrage montrent comment le sentiment
d’insécurité (politique et économique) influence les pratiques policières
et se traduit en préjugés, notamment lors de patrouilles chargées de sur-
veiller certains groupes marginaux ou subalternes. Les institutions de
surveillance et la police acquièrent un « savoir » sur ce que les autorités
politiques attendent d’elles dans les régimes libéraux-républicains et
peuvent être influencées par ce qui est perçu comme l’« opinion publique »
de la majorité (pour une étude se prévalant de la théorie de la menace
ethnique au Canada, voir Carmichel et Kent, 2015).
Cet ouvrage adopte l’approche des « profilages » policiers discrimina-
toires, qui s’est d’abord intéressée au profilage racial, pour ensuite porter son
11. En 1999, une étude révélait que plus les communautés haïtienne et jamaïcaine
sont importantes dans un quartier à Montréal, plus il y a de mises en accusation par la
police (Tremblay, Tremblay et Léonard 1999).14 • prof i l age s p ol ici e r s
attention sur d’autres formes de profilage, par exemple social et politique.
Contrairement à la théorie de la « menace raciale », qui se penche sur la réalité
macrosociologique (la société en général), celle des profilages cherche à saisir
la réalité mésosociologique (les organisations policières, les institutions
carcérales, etc.) ou microsociologique (les individus et leurs interactions).
Anne-Marie Livingstone, Marie Meudec et Rhita Harim (2021) soulignent
que les recherches sur le profilage adoptent souvent une approche quantita-
tive, évaluant par exemple les pourcentages d’interpellations policières en
fonction de catégories ethniques ou raciales d’une population donnée (pour
Montréal, voir entre autres Armony et al., 2019 ; Faubert et al., 2015 ; Bernard
et McCall, 2010 et 2008 ; pour les États-Unis, Harcourt, 2007 ; pour le pro-
filage social des personnes en situation d’itinérance à Montréal, voir Bellot
et Sylvestre, 2017). Livingstone, Meudec et Harim (2021), pour leur part,
insistent sur l’importance de prendre en considération l’expérience concrète
des personnes ciblées par le profilage, comme le proposent plusieurs contri-
butions de cet ouvrage. Mais avant d’aborder ces expériences contempo-
raines, il importe d’en définir les racines historiques.
ISBN 978-2-7535-8701-4 Presses universitaires de Rennes, 2022, www.pur-editions.fr
L’origine de la police et des profilages
L’histoire de la police en Europe, puis en Amérique, mérite d’être rappelée,
même si elle ne détermine pas entièrement la réalité d’aujourd’hui. « La
« Profilages policiers », Pascale Dufour et Francis Dupuis-Déri (dir.)
police est une institution neuve », comme le rappellent Fabien Jobard et
Jacques de Maillard (2015 : 21), même si les communautés humaines ont
évidemment toujours connu des manières de se protéger contre des indi-
vidus violents et dangereux. Ainsi, des Premières Nations autochtones au
Canada ont développé des cercles de parole qui inspirent aujourd’hui des
processus de justice réparatrice ou transformatrice, mais l’exil ou la mise
à mort étaient aussi des solutions face à Windigo, un être maléfique et
dangereux avec qui il n’y avait pas de dialogue possible et qu’il fallait
neutraliser (Firedland et Napoleon, 2017 ; pour un exemple de justice
transformatrice chez des féministes au Québec, voir Ingenito et Pagé,
2017 ; Galaway et Hudson, 1996).
En Europe, au Moyen Âge, il n’y avait pas de police, et chacun avait
la responsabilité d’assurer l’ordre public et d’accourir au moindre cri d’une
victime – le « haro », dans Royaume de France, ou le « hue and cry », dans
le Royaume d’Angleterre (Grillo, 2017 ; Gutton, 1979). Il convenait alorsI n t roduc t ion • 15
d’arrêter criminel et de le traîner devant les autorités ou d’attendre l’ar-
rivée de la (petite) milice, qui avait surtout une fonction militaire. Cette
manière de procéder à la criée avait des effets pervers, par exemple quand
les deux partis criaient simultanément et s’accusaient mutuellement.
Artisans et boutiquiers – les « possédants » (Jobard et de Maillard,
2015 : 22) – ont mis sur pied des patrouilles de jeunes bourgeois volontaires,
connus sous le nom de watchmen (les gardiens) dans les paroisses
anglaises. Ces milices arpentaient les rues pour prévenir le crime, ce que
rappellent des toiles célèbres comme La ronde de nuit de Rembrandt
(1642). Il s’agissait de surveiller et de neutraliser les vagabonds, les rôdeurs
nocturnes et les autres individus « désordonnés » qui perturbaient la paix
publique et menaçaient la propriété privée.
Le terme « police » désignait alors, en Europe, des agents qui s’assu-
raient du bon approvisionnement des villes en plein développement,
surveillant la circulation sur les chemins ou à l’entrée des villes et dans
les ports, en vérifiant les poids et mesures des marchandises (L’Heuillet,
2002). Bref, rien à voir avec la police comme on l’entend aujourd’hui.
ISBN 978-2-7535-8701-4 Presses universitaires de Rennes, 2022, www.pur-editions.fr
Quant au sheriff, au Royaume-Uni et dans ses colonies d’Amérique, c’était
avant tout un collecteur de taxes qui s’assurait du bon respect des règle-
ments, sans chercher à combattre le crime (Eichenberg et Hankhouse,
2018). Dans le Royaume de France, la « haute police » relevait de la cou-
ronne et tentait de déjouer les complots, alors que la maréchaussée chassait
« Profilages policiers », Pascale Dufour et Francis Dupuis-Déri (dir.)
les déserteurs, sans s’intéresser à la criminalité (L’Heuillet, 2001).
Lasse d’assurer elle-même la tâche des patrouilleurs, la bourgeoisie
va finalement engager des milices rémunérées « sur le mode du mercena-
riat » (Jobard et de Maillard, 2015 : 22). Dans les États esclavagistes du sud
des États-Unis, des « patrouilles esclavagistes » (slave patrols) sont mises
sur pied à la suite des révoltes d’esclaves et de la proclamation de l’indé-
pendance d’Haïti, en 1804. Elles contrôlaient la population servile, pour-
chassaient les esclaves en fuite et pouvaient interpeller des Blancs suspectés
d’aider les esclaves à se révolter ou à fuir (Eichenberg et Hankhouse, 2018).
Ainsi, l’apparition de corps de police officiels et publics, en uniforme et à
la solde de l’État, est précédée par un ensemble d’arrangements privés
plus ou moins formels et stables, généralement mis en place par les élites
économiques urbaines ou rurales (Reichel, 1988).
L’idée d’un corps de police public faisait craindre à la bourgeoisie non
seulement de nouvelles taxes, mais aussi des contrôles qui menaceraient16 • prof i l age s p ol ici e r s
ses libertés individuelles (Popescu, 2021). Or cette bourgeoisie devait com-
poser avec une nouvelle menace, plus épeurante encore que l’idée d’une
police publique, à savoir l’élargissement des classes populaires, considérées
comme dangereuses et associées à la délinquance – vagabondage et men-
dicité, ivresse sur la voie publique, prostitution, vols et bagarres, etc. – et
même à la révolution. Ces catégories sociales font alors l’objet d’une atten-
tion particulière de la presse qui traque les crimes à sensation et même les
scandales, qui sont mis en scène dans les populaires romans policiers à
feuilleton. L’élite est également effrayée par des révoltes d’artisans déclassés
(les luddites) ou d’ouvriers, ainsi que par des rébellions républicaines,
comme celle, en 1837-1838 au Canada, des « patriotes » et, en Europe, du
« Printemps des peuples ». En Grande-Bretagne, les classes dangereuses
sont surtout constituées par des gens qui migrent des campagnes vers les
villes, alors qu’aux États-Unis elles sont composées par immigrants venant
d’Europe centrale et de l’Est, souvent juifs ou catholiques, parfois socia-
listes et même anarchistes (Eichenberg et Hankhouse, 2018). Tout cela
convainc les autorités civiles de former les premières unités de police
ISBN 978-2-7535-8701-4 Presses universitaires de Rennes, 2022, www.pur-editions.fr
(Popescu, 2021 ; Jobard et de Maillard, 2015 ; L’Heuillet, 2001), alors que
quelques attentats anarchistes contre des chefs d’État justifient la mise en
place des premiers accords de coopération policière internationale, après
la Conférence internationale de Rome pour la défense sociale contre les
anarchistes en 1898 (Jensen, 1981 et 2014).
« Profilages policiers », Pascale Dufour et Francis Dupuis-Déri (dir.)
Le développement des corps policiers a donc suivi les transformations
des sociétés européennes, comme le remarquait d’ailleurs le célèbre
« père » intellectuel du libéralisme économique, Adam Smith. Il constatait,
en 1763, qu’au moins un meurtre était commis chaque nuit dans la capitale
française, mais pas plus de trois ou quatre par année dans la capitale
anglaise. Comment expliquer cette différence ? Pour Smith, c’est parce
que la criminalité est la conséquence d’écarts importants de richesse et
que la pauvreté est plus répandue et plus importante à Paris qu’à Londres.
Smith a aussi proposé une théorie générale de l’évolution des sociétés en
quatre stades, le gouvernement et la police n’apparaissant qu’au deuxième
stade des sociétés de bergers, qui connaissent un début de division du
travail inégalitaire, d’accumulation de capital et d’appropriation de terres.
Le premier stade est celui de la chasse et de la pêche, sans accumulation
de capital et donc sans besoin d’autorité politique ou policière, ce qui
correspond d’ailleurs aux conclusions de recherches anthropologiques etI n t roduc t ion • 17
historiques au sujet des Premières Nations au Canada. Cette histoire est
même racontée aux futures recrues du programme de techniques poli-
cières du Cégep de Rimouski, dans le manuel Clientèles diversifiées (2013)
qui associe l’apparition de la police à celle des inégalités de richesse. Le
manuel présente d’abord la société autochtone précoloniale d’Amérique
du Nord « fondée sur l’égalité des hommes » et marquée par une « absence
de pouvoir de coercition et de l’État au-dessus des individus : la règle du
don assure l’ordre et la paix sociale ». On compare ensuite cette société
égalitaire et sans police à la société européenne coloniale, caractérisée par
l’« apparition d’inégalités sociales basées sur le travail », ce qui se traduit
par la « présence d’un ordre extérieur et coercitif à l’égard de l’individu »,
c’est-à-dire une police (inspiré de Robert Campeau et al., 1993 ; Denis-
Pelletier, 2020). Chez Adam Smith, les troisième et quatrième stades
désignent des sociétés agricoles et des sociétés commerciales, toutes
marquées par des inégalités économiques et donc par une autorité civile.
Ainsi, « le gouvernement civil, en tant qu’il a pour objet la sécurité des
propriétés, est, dans la réalité, institué pour défendre les riches contre les
ISBN 978-2-7535-8701-4 Presses universitaires de Rennes, 2022, www.pur-editions.fr
pauvres, ou ceux qui ont une certaine propriété contre ceux qui n’en ont
pas du tout » et il permet aux riches « de dormir tranquille 12 ». Sur cette
question, le libéralisme et l’anarchisme s’entendent : « [S]ans le gendarme,
le propriétaire ne pourrait pas exister », rappelait ainsi l’anarchiste italien
Errico Malatesta (2000, 40). C’est aussi par peur d’être assassinés dans
« Profilages policiers », Pascale Dufour et Francis Dupuis-Déri (dir.)
leur lit en pleine nuit que les propriétaires d’esclaves du sud des États-Unis
ont mis sur pied les slave patrols (Eichenberg et Hankhouse, 2018).
Cette histoire de l’origine de la police est parfois reconnue explicite-
ment par l’institution policière elle-même. Le SPVM, par exemple, rappelle,
sur son site web, que ce sont les marchands qui ont d’abord exigé, au xviiie
siècle, la constitution d’un corps d’une vingtaine de watchmen, des veilleurs
de nuit qui criaient chaque demi-heure « All is well » (ce qui leur vaudra
d’être surnommés les « bazouelles »). Ce n’est qu’en 1843 que l’autorité
municipale formera un corps de police professionnel, qui faisait suite à un
premier corps de police imposé aux villes de Montréal et de Québec en
12. Considérer que la police a été conçue au départ pour être au service de la bour-
geoisie ne relève donc pas d’un « vieux marxisme », comme le prétendent des spécialistes
comme le criminologue Marc Ouimet (Buzzetti, 2020), mais bien d’une connaissance de
l’histoire de cette institution et même de la philosophie du libéralisme économique. Voir
Adam Smith, Wealth of Nations, livre V, chapitre I, partie II « On the Expense of Justice ».18 • prof i l age s p ol ici e r s
1838 par les autorités coloniales britanniques, après les révoltes républi-
caines des « patriotes », corps policier lui-même calqué sur le modèle de la
Royal Irish Constabulary créée en 1822 pour surveiller et neutraliser les
activités républicaines en Irlande (Leclerc, 1989 ; Popovic, 2017).
La police publique patrouillera alors avec une attention particulière
les chantiers et les canaux de navigation pour s’assurer que le travail s’y
déroule paisiblement. Les corps policiers auront aussi à l’œil les immi-
grants juifs de tendance socialiste et anarchiste qui débarquaient à
Montréal et à New York au début du xxe siècle. La police est épaulée par
les services douaniers, comme aux États-Unis où la Loi sur l’immigration
des étrangers, aussi connue comme la loi des anarchistes et des étrangers,
permettra d’expulser vers la Russie des anarchistes célèbres vivant depuis
des décennies aux États-Unis, comme Emma Goldman (également d’ori-
gine juive)13. Cette loi se montrait généreuse en catégories ciblées, dans
un inventaire à la Prévert :
Tous les idiots, les personnes démentes, les épileptiques […] les pauvres, et
les personnes risquant de devenir une charge publique, les mendiants pro-
ISBN 978-2-7535-8701-4 Presses universitaires de Rennes, 2022, www.pur-editions.fr
fessionnels, les personnes affectées par une maladie contagieuse […] les
polygames, les anarchistes ou les personnes qui croient ou prônent le ren-
versement par la force ou la violence du gouvernement des États-Unis et de
tous les gouvernements […] ou l’assassinat des détenteurs d’une fonction
publique, les prostituées et les personnes qui trafiquent ou tentent de faire
venir des prostituées ou des femmes pour servir de prostituées.
« Profilages policiers », Pascale Dufour et Francis Dupuis-Déri (dir.)
Pour sa part, la classe ouvrière était plutôt opposée à la création d’une
police, perçue avec raison comme un instrument de surveillance, de
contrôle et de répression au service des élites et du statu quo (Popescu, 2021).
Outre les pauvres, les esclaves, les ouvriers, les immigrants et les
républicains, les socialistes et les anarchistes, d’autres catégories sociales
ont été soumises à la surveillance, au contrôle et à la répression : les jeunes,
les femmes de « mauvaises mœurs » (Gauvard et al., 2016), les personnes
noires pendant et après l’esclavage dans les Amériques, les Autochtones
dans les régions colonisées. Au Canada, par exemple, la Gendarmerie
royale du Canada (GRC) – la célèbre « police montée » – a été créée au
xixe siècle pour contrôler les populations autochtones des nouveaux ter-
ritoires soumis à l’autorité du parlement (Kapesh, 1976). En France, les
13. American Journal of International Law, vol. 1, no 2, 1907, p. 238-239.I n t roduc t ion • 19
agents de police pouvaient se déplacer dans les colonies, par obligation
ou pour des avantages professionnels et financiers, et rapporter leurs
techniques policières dans la métropole pour les appliquer aux popula-
tions migrantes en provenance des (ex)colonies (Rigouste, 2012 ; Slaouti
et Jobard, 2020 ; Blanchard, 2018).
Cette histoire, racontée ici à grands traits, n’a pas déterminé toutes
les pratiques et les actions de la police d’aujourd’hui. Évidemment, il est
possible pour des gens pauvres, par exemple, de faire appel à la police, ou
pour des femmes violentées par leur conjoint de bénéficier d’une inter-
vention et même d’une certaine protection de la police, ou encore pour
des communautés autochtones de mettre sur pied leur propre corps de
police plus ou moins autonome (Joly, 2017 ; Gendron et al., 2020). Mais
au-delà de ses slogans, qui évoquent l’utilité publique et une certaine
neutralité – « Protéger et servir », « Défendre le droit », « Toujours juste »
– la police reste une institution qui participe aussi à la constitution, à la
consolidation et à la perpétuation de divers systèmes de domination,
d’oppression et d’exclusion, dont l’étatisme (colonial ou non), le capita-
ISBN 978-2-7535-8701-4 Presses universitaires de Rennes, 2022, www.pur-editions.fr
lisme, le racisme et le sexisme.
Le profilage comme technique ou comme discrimination14
Il importe de rappeler que c’est la police elle-même qui a d’abord proposé
« Profilages policiers », Pascale Dufour et Francis Dupuis-Déri (dir.)
la notion de « profilage » (profiling), pour désigner une méthode d’enquête
de crimes exceptionnellement violents, par exemple des meurtres en série
dont les victimes étaient des travailleuses du sexe. La littérature savante
présente souvent l’enquête (inaboutie) sur Jack L’Éventreur comme l’un
des premiers cas de profilage criminel (Bartol et Bartol, 2013). On peut
remonter plus loin dans le temps pour évoquer les manuels pour la chasse
aux sorcières ou encore rappeler les thèses sur le « criminel né » dévelop-
pées à la fin du xixe siècle par le célèbre criminologue Cesare Lombroso
(1835-1909). Ce dernier affirmait qu’on peut reconnaître un criminel par
des traits physiques héréditaires (mâchoire, arcades sourcilières, etc.),
mais aussi psychologiques (manque d’empathie, etc.) et culturels
(tatouages, etc.) (Renneville, 2005). Fait intéressant, Lombroso considérait
14. Cette section reprend des éléments de Dupuis-Déri (2014) et s’inspire de St-Jacques
(2016a).20 • prof i l age s p ol ici e r s
que les mêmes traits se retrouvaient chez les anarchistes violents, annon-
çant en quelque sorte le profilage politique. Cela dit, Lombroso était
socialiste et posait que cette violence pouvait être évitée par des politiques
publiques et sociales réduisant la pauvreté (Bass, 2019).
Plus près de nous, le « profilage criminel » en tant que technique
d’enquête formalisée a vu le jour aux États-Unis, puis dans divers services
de police en Amérique du Nord, et a même mené à la création de la pro-
fession de « profileur », dont la popularité est assurée par des représenta-
tions plus ou moins fantaisistes dans des romans et des séries télévisées.
Le SPVM affirme que le « profilage criminel est une pratique policière
légitime utilisée pour identifier un suspect » (Okomba-Deparice, 2012 : 42).
Dans son document Relations avec les citoyens : Politique (no Po. 170,
24 novembre 2011), le SPVM reprend la définition du « profilage cri-
minel » de Martin Scheinin (2007 : §33) comme une « association systéma-
tique d’un ensemble de caractéristiques physiques, comportementales ou
psychologiques à un certain type d’infraction, et l’utilisation de ces carac-
téristiques pour justifier les décisions prises par les services de police »
ISBN 978-2-7535-8701-4 Presses universitaires de Rennes, 2022, www.pur-editions.fr
(Okomba-Deparice, 2012 : 13). Si le profilage criminel devait permettre de
retrouver plus facilement le coupable après le crime, le « profilage pros-
pectif » a pour but d’identifier des suspects potentiels avant qu’un méfait
ne soit commis, en particulier dans le cas d’attentats. Ce « profilage pros-
pectif » se traduit par une surveillance accrue de certaines catégories
« Profilages policiers », Pascale Dufour et Francis Dupuis-Déri (dir.)
d’individus et par leur interpellation avant même qu’un méfait n’ait été
commis. Cela dit, un rapport publié par la Commission canadienne des
droits de la personne et la Fondation canadienne des relations raciales
conclut que « [l]a recension des écrits scientifiques [n’a] pas permis de
légitimer la pratique du profilage prospectif sur les plans scientifique, légal
et moral, ni même sur le plan de l’évaluation du risque pour des événe-
ments rarissimes statistiquement » (Bourque et al., 2009 : 6).
La notion de profilage a ensuite été reprise et redéfinie par des groupes
de défense des droits de la personne et par des universitaires pour souligner
le caractère discriminatoire de certaines unités de police ou d’interventions
ciblant des catégories spécifiques de la population. La notion de « profilage
racial », d’abord développée aux États-Unis, a servi de modèle aux autres
types de profilage discriminatoire, qui évoquent une propension de la police
à moduler ses interventions en fonction de perceptions subjectives de la
normalité et la déviance, puisqu’elle tend à distinguer des « bons » et deI n t roduc t ion • 2 1
« mauvais » individus, y compris dans les manifestations (Dupuis-Déri, 2006,
2014 ; Della Porta et Reiter, 1998, 24-27 ; Fillieule, 1997 ; Favre, 1990). Si cer-
taines dynamiques peuvent être semblables dans les différentes formes de
profilage discriminatoire, chacune a évidemment ses particularités. En
Amérique du Nord et en Europe, par exemple, le profilage racial est de loin
le plus meurtrier et celui qui mène au plus grand nombre d’emprisonnements.
Ailleurs dans le monde, le profilage politique peut lui aussi être très meurtrier,
par exemple sous des régimes autoritaires qui ne tolèrent pas la dissidence.
Profilage racial et contrôle au faciès
Même si le phénomène existait bien avant d’être désigné par cette expression,
le « profilage racial » est souvent associé, aux États-Unis, à l’Operation
Pipeline, mise sur pied dans les années 1980 par des patrouilleurs qui ont
consciemment adopté des critères raciaux pour intercepter des trafiquants
de drogues sur les routes du pays. Des études ont révélé que, sur les auto-
routes du Maryland, par exemple, le trafic routier ne comptait que 17 %
ISBN 978-2-7535-8701-4 Presses universitaires de Rennes, 2022, www.pur-editions.fr
d’automobilistes noirs, mais ceux-ci représentaient 72 % des personnes
interceptées pour de banales infractions,dans le but de procéder à une fouille
pour trouver de la drogue (Harris, 2020). D’où l’expression « driving while
black » (conduire et être Noir), qui évoque les risques plus élevés des Afro-
Américains d’être interceptés par la police au volant d’une voiture (Harris,
« Profilages policiers », Pascale Dufour et Francis Dupuis-Déri (dir.)
1999). En 1998, la Chambre des représentants a voté à l’unanimité une loi
(Traffic Stops Statistics Study Act) devant limiter une telle pratique raciste.
Aujourd’hui, la notion de « profilage racial » peut avoir une définition
très large, par exemple lorsqu’elle est synonyme de racisme institutionnel
pour qualifier tout à la fois les discours de la police, du gouvernement et
même des médias qui justifient des pratiques et des comportements racia-
lisants, c’est-à-dire qui construisent des catégories et des identités raciales,
qui mobilisent la notion de « race » pour expliquer ou justifier un com-
portement, une attitude, une situation ou qui associent les problèmes
sociaux et la dangerosité à certaines « races » (Tator et Henry, 2006).
De manière plus précise, la juriste afro-américaine Renée McDonald
Hutchins a défini trois conceptualisations du « profilage racial » dans les
débats juridiques et médiatiques aux États-Unis.22 • prof i l age s p ol ici e r s
1. L’attitude de la police qui perçoit les hommes noirs comme suspects
pour nulle autre raison que la couleur de leur peau (une définition
« race-seulement ») ;
2. L’attitude de la police qui perçoit qu’un suspect est d’autant plus sus-
pect en raison de la couleur de sa peau, par exemple s’il regarde dans
des voitures stationnées ou marche seul très tard le soir (une défini-
tion « race-en-plus ») ;
3. L’attitude de la police qui contrôle tous les individus d’une catégorie
précise, car on recherche un suspect appartenant à cette catégorie.
Par exemple, un jeune homme noir vole le sac à main d’une femme
et la police commence par contrôler dans la rue tous les jeunes
hommes noirs (une définition « race-spécifique »).
Pour Renée McDonald Hutchins, ces trois définitions évoquent en
apparence des phénomènes distincts, mais répondent à une même logique
et ont des effets similaires. Il s’agit dans tous les cas pour la police de sou-
mettre des individus à une surveillance accrue en raison – uniquement ou
ISBN 978-2-7535-8701-4 Presses universitaires de Rennes, 2022, www.pur-editions.fr
partiellement – de leur « race », c’est-à-dire la couleur perçue de leur peau.
Le profilage racial a aussi des effets sur la manière dont la police est perçue
selon la catégorie à laquelle les gens appartiennent. Ainsi, les personnes
noires ont une perception moins favorable de la police, elles sentent qu’elles
sont traitées inéquitablement, à cause de la couleur de leur peau, sans
« Profilages policiers », Pascale Dufour et Francis Dupuis-Déri (dir.)
compter qu’elles sont plus critiques du profilage racial (Weitzer et Tuch,
2002 ; Samuels-Wortley, 2021). On ne se surprendra donc pas que tant
d’intellectuels afro-américains aient souligné cette répression policière,
comme le sociologue W. E. B. Du Bois, qui disait que « la police [est] notre
gouvernement15 », Audre Lorde, qui rappelait dans son poème Power l’assas-
sinat d’un adolescent noir par un policier blanc, acquitté, ou encore Malcom
X, qui affirmait qu’« un homme noir aux États-Unis vit dans un État poli-
cier. Il ne vit pas dans une démocratie […] » (Soss et Weaver 2017 : 575).
Le profilage racial fonctionne comme un « régime de contrôle social »
et de dressage des corps et des esprits (Khoury, 2009). Les personnes
profilées intériorisent des normes et se disciplinent pour rester à leur
« place ». Cette socialisation différenciée modélise des corps qui doivent
exprimer la soumission face à la police, pour éviter une interpellation
15. Expression reprise dans le titre de l’article de Soss et Weaver, 2017.Vous pouvez aussi lire