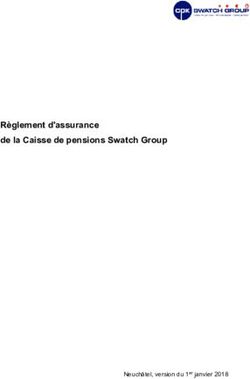L'expérience fait oeuvre : l'action corporelle créatrice - Revue Proteus
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Revue Proteus – Cahiers des théories de l’art
L’expérience fait œuvre :
l’action corporelle créatrice
Nous pouvons parler d’art expérientiel 1 dès que interactive, puis, dans l’approche expérientielle
l’intention première de l’artiste est d’agir sur le – car centrée sur l’expérience du sujet – nous ana-
corps d’un individu à travers son œuvre. Cepen- lyserons le vécu de son visiteur. Ces examens
dant différentes catégories d’implication corpo- seront complétés et illustrés par des observations
relle peuvent être réclamées par cet art. Certaines issues d’une étude comportementale menée sur
œuvres d’art expérientiel, comme par exemple le l’œuvre Vection des artistes Olivier Lamarche et
travail de Richard Serra, exigent, pour être vécues, Nathanaëlle Raboisson.
une implication du sujet et de son corps. Pour
vivre pleinement l’expérience de l’œuvre le sujet
doit se déplacer autour, dans l’œuvre de l’artiste. La situation interactive,
Cependant, cette situation reste selon nous de vers le « sujet expansé »
l’ordre du « spectaculaire » car l’action, même si
elle influe sur la réception, ne modifie en rien Nous définirons la situation interactive en trois
l’œuvre. points : son système figuratif, sa temporalité, puis
Le rapport dialogique instauré par une œuvre son couplage visiteur/œuvre.
interactive implique un engagement corporel dif-
férent. Au travers de son interaction, le visiteur Son système figuratif
(nous le nommerons ainsi) est confronté à une
œuvre dont il devient le co-auteur et qui évolue, Le dispositif interactif déplace l’objet de la créa-
en temps réel, simultanément à son expérience. tion en modifiant le système figuratif de l’œuvre.
L’interaction influe sur la réception de l’œuvre et En proposant à ses visiteurs d’influer sur l’exis-
modifie l’œuvre elle même. tence de l’œuvre, il construit de nouvelles condi-
Nous n’établirons pas de distinction qualitative tions d’être au monde. L’œuvre interactive est une
entre une œuvre non interactive, que nous quali- actualisation. En l’absence de son visiteur, l’œuvre
fions de « spectaculaire », et une œuvre interactive. existe potentiellement, en attente de l’action
Il s’agit, dans ces deux cas, d’une expérience déterminant son existence sensible. L’œuvre spec-
entière, mais selon nous de nature différente, taculaire nous habitue à disposer, sans contrainte,
entraînant un renouveau de l’expérience esthé- d’une représentation prédéterminée qui est celle
tique. Ce renouveau semble naître du fait que le de son auteur. Bien que le point de vue de chacun
visiteur de l’œuvre interactive, par son action influe sur sa réception, cette œuvre, son contenu
« corporelle », peut modifier le contenu sensible, et son agencement, restent identiques. L’objet,
ou les modes de présentation de l’œuvre. De fait, œuvre spectaculaire, est immuable. Il est l’expres-
nous considérons que l’expérience est différente sion de la pensée intellectuelle et sensible de
selon les modalités d’actions proposées, et selon l’artiste traduisant ainsi sa relation au monde. Cet
les conséquences de l’action sur l’œuvre. artiste propose une représentation subjective, la
Ainsi, nous aborderons la question du renou- sienne, à interpréter intellectuellement et à vivre
veau de l’expérience esthétique offert par les sensiblement par le spectateur (nous le nomme-
œuvres interactives. Pour ce faire, nous étudierons rons ainsi).
le dispositif et les particularités de la situation À travers le dispositif interactif, l’artiste pro-
pose au visiteur, un environnement, avec un
contenu sensible, les procédés de diffusion de ce
1. Alva NOË, « Experience and experiment in art », in contenu (construction d’un espace : parois, haut
Journal of Consciousness Studies, vol. 7, no 8-9, 2001
35Revue Proteus no 6, le spectateur face à l’art interactif
parleurs, etc.), puis les procédés d’apparition Le couplage œuvre/visiteur
(modalités interactives). De fait, l’œuvre interac-
tive simule les circonstances de notre rapport au Les interfaces démultiplient les possibilités
monde. Chaque situation interactive est nouvelle, d’action du sujet en l’appareillant au mieux selon
et le visiteur doit appréhender de manière « sen- l’objectif escompté par l’artiste. Edmond Cou-
sori-moteur » cette construction environnemen- chot parle de « sujet interfacé1 » ; hybridation du
tale afin de se l’approprier. L’interaction permet sujet avec des processus computationnels, à tra-
d’actualiser cet environnement qui se « présente » vers les interfaces. De nouveaux outils d’externali-
en temps réel à son nouvel auteur. Cet environne- sation, de plus en plus pertinents et précis, per-
ment fait office de réalité temporaire pour son mettent « d’acter » l’appareil sensoriel du visiteur,
visiteur. et ainsi de démultiplier ses modalités perceptives.
L’œuvre spectaculaire propose à son spectateur Ainsi, la conscience réflexive du sujet et de ses
d’expérimenter une interprétation, celle que relations habituelles avec l’environnement est alté-
l’artiste fait du monde. Grâce à l’interaction et à la rée ; le sujet doit se redéfinir.
co-autorialité qu’elle instaure, le visiteur d’une Nous pensons que les interfaces tangibles
œuvre interactive expérimente directement une réduisent les qualités de l’expérience interactive.
« présentation », dont il est l’acteur. La position du Le visiteur, avec l’interface en main (ou autres sys-
sujet n’est plus frontale, mais centrale. tèmes portatifs, embarqués), centre son attention
sur l’outil et son maniement. L’interface externa-
Sa temporalité lise la fonction sollicitée du sujet, en induisant une
posture spécifique de l’usager qui génère un rap-
Dans les œuvres spectaculaires, les temps de la pel à l’ordre du corps en tant qu’opérateur. Une
création et de la réception sont généralement des trop forte concentration intellectuelle liée à
temps longs et dissociés, directement liés à l’idée l’appropriation de « l’outil interface » peut, selon
de support. L’action du spectateur crée une expé- nous, réduire l’accueil des données sensorielles de
rience dont la temporalité est liée à la réception de l’œuvre, être un frein à la réceptivité.
l’œuvre. Certaines interfaces reprennent des schèmes
Le dispositif interactif, non actualisé, est un comportementaux habituels afin de réduire leur
contenant. Cette « œuvre contenant » a une forme temps d’appropriation. Cependant, il semble que
générale, soit une architecture et une organisation l’interfaçage tangible (comportementale ou non)
spécifique et déterminée de ses composants. De maintienne le sujet dans une position de specta-
l’actualisation des données, ou de la création de teur. Même si ce dernier est actif et participe de
données, par le visiteur, qui actionne les interfaces l’actualisation de l’œuvre, l’interfaçage oblige le
d’entrées et/ou de sorties selon le programme du sujet à s’extraire de l’environnement pour être
contenant, résulte la forme processuelle de ce que attentif à sa manipulation. Comme nous le ver-
nous nommerons l’« œuvre contenu ». rons dans le paragraphe sur le modèle énactif,
Le temps de l’œuvre contenu est intrinsèque- cette situation interactive nous semble proche de
ment lié au rapport dialogique action/réception. l’œuvre spectaculaire.
L’interaction crée une expérience dont la tempo- Les modalités interactives sont les liens entre
ralité est immédiate, liée à la présentation de les points d’interaction, les gestes, et les informa-
l’œuvre en temps réel en fonction de l’implication tions extéroceptives qui en résultent. On convien-
du visiteur. Ce « temps de l’interaction » permet la dra qu’il existe des dispositifs interactifs aux
construction d’un « je immanent » dont la tempo- modes conversationnels de qualités variables. La
ralité fusionne avec celle de l’œuvre. L’œuvre première situation interactive serait de type
émerge, comme prolongement d’un vécu à la pre- action/réaction, dans laquelle le visiteur a un rôle
mière personne.
1. Edmond COUCHOT, La Technologie dans l’art. De la
photographie à la réalité virtuelle , Nîmes, Jacqueline
Chambon, 1998, p. 226.
36Revue Proteus – Cahiers des théories de l’art
« déclencheur ». Ce dernier actualise l’œuvre, mais L’action du visiteur permet de construire l’envi-
se retrouve immédiatement en position d’observa- ronnement œuvre en temps réel. Cette tempora-
teur du contenu déclenché. Un mode dialogique lité spécifique, liée à la simultanéité du geste et de
s’installe ici, mais la boucle rétroactive est trop l’écoute, conduite dans la forme processuelle de
longue pour que l’action influe sur la réception. l’œuvre, lie l’environnement au sujet à travers son
Pour que action et réaction se codéterminent, la expérience. Le dispositif est invisible et sa mani-
boucle rétroactive doit être continue. Cela est pulation intuitive. Le visiteur ne perçoit plus uni-
rendu possible par des situations interactives de quement par un sens isolé, mais par le corps. C’est
type action/création qui permettent une action l’apprentissage du corps attentif à lui-même, à ses
simultanée à la perception. Dans ce dernier cas, le gestes, à ses déplacements et de son rapport à
mode dialogique instauré permet de tendre vers l’environnement, à la manière dont il va influencer
ce que nous avons nommé le temps de l’interac- et modifier ce dernier, à « ses sons », que donne à
tion. expérimenter et à vivre le dispositif.
Vection est une installation sonore immersive Ce dispositif crée un « sujet expansé », somme
et interactive conçue en 2011 par les artistes Oli- de « je immanent », devenant partie intégrante de
vier Lamarche et Nathanaëlle Raboisson et explo- l’environnement grâce à ce que nous nommerons
rant les technologies développées au MotusLab 1. ses associations « gestosensorielles » (gestoaudi-
Vection a été créée pour l’étude comportementale tives, gestovisuelles, etc.).
menée à la Cité des Sciences et de l’Industrie, à
Paris, de novembre 2011 à janvier 2012.
Lorsque le dispositif Vection n’accueille pas de L’approche expérientielle
visiteur, une ambiance sonore bucolique est diffu- de l’œuvre interactive,
sée dans l’installation. Dès que le visiteur est vers l’action corporelle créatrice
détecté, cette ambiance disparaît, et laisse appa-
raître un nouvel environnement sonore, plus Après avoir dégagé les particularités de la situation
mécanique, suggérant à la personne qu’elle est interactive, l’absence d’interface tangible nous
désormais active sur l’environnement : chaque semble propice à une expérience singulière, que
geste et chaque déplacement modifie le contenu nous allons définir dans cette deuxième partie.
et ses modalités de diffusion. Le visiteur de Vec-
tion évolue seul, dans une pièce d’une surface Le modèle énactif
minimum de quatre mètres sur trois, entièrement
occultée. La durée de sa visite lui est laissée libre. Le paradigme énactif est, à notre avis, le modèle
Il ne manipule aucune interface. idéal permettant de mieux comprendre les proces-
Vection est un environnement uniquement sus cognitifs qui ont lieu dans le dispositif que
sonore, diffusé en octophonie et spatialisé, dont le nous étudions.
contenu et son évolution dépendent des gestes et Le biologiste, neurologue et philosophe chilien
déplacements du visiteur. Un tel interfaçage per- Francisco Javier Varela, en collaboration avec
met de construire et de diffuser du symbole en Humberto Maturana, invente à la fin des années
donnant au geste la capacité de créer du sens. 90 le concept d’autopoïèse. Ce concept définit la
Vection construit une réalité particulière, c'est-à- propriété d’un organisme vivant à se définir lui
dire un rapport sujet/monde déstabilisant, dans même, au fil des interactions avec son environne-
laquelle le visiteur doit se redéfinir afin de pouvoir ment. Cette capacité d’adaptation est rendue pos-
agir intentionnellement en usant des nouvelles sible grâce à l’énaction. Cette notion définit le
potentialités sensori-motrices proposées par les sujet comme étant le résultat sans cesse renouvelé
artistes. du couple perception/action. Dans la théorie de
l’autopoïèse, la notion de couplage structurel per-
met d’appréhender la relation sujet/monde et se
1. Laboratoire de recherche de Motus,
définit par la structure sensori-motrice du sujet
[consulté le 15 (son corps) dans son environnement. Le sujet y
août 2013]. devient un système autonome et dynamique, qui
37Revue Proteus no 6, le spectateur face à l’art interactif
se transforme face aux perturbations provoquées Les œuvres de Richard Serra ou de Olafur
par sa confrontation avec l’environnement. Il voit Eliasson sont des exemples d’œuvres expérien-
ainsi son monde émerger du couplage structurel tielles dans lesquelles l’expérience esthétique se
qu’il entretient avec son environnement. Sujet et construit à travers l’exploration de l’œuvre, et où,
environnement sont codéterminés. en retour, le corps est « marqué » par cette explo-
Le modèle énactif peut être appliqué au pro- ration. Nous souhaitons défendre la particularité
cessus de réception de toutes œuvres, interactives de la situation interactive sans interface embar-
ou non. Le « faire émerger » caractérise la relation quée. L’implication corporelle requise par cette
du sujet et de l’œuvre, le processus de réception situation y est tout aussi importante mais selon
en général. Cependant, il nous semble que la nous d’un enjeux autre. La seule « exploration »,
situation interactive sans interface embarquée est de Vection par exemple, ne suffit pas à l’expé-
propice à un couplage structurel complexe, diffé- rience de l’œuvre car l’interaction mise en place
rent de celui lié à l’œuvre spectaculaire ou interac- par un tel dispositif ne permet pas uniquement la
tive avec interface. De ce couplage complexe relation sujet/œuvre, mais aussi la création d’un
émerge la particularité de l’expérience d’un dispo- contenu, en cohésion avec le sujet. L’approche
sitif comme Vection par exemple. neurophysiologique que nous ferons plus bas
Nous résumons ci-dessous, schématiquement, confirme en effet l’importance de l’efficience de
pour trois catégories d’œuvre, les modèles énactifs l’action dans l’expérience de telle œuvre. L’œuvre
et les différents couplages structurels s’y rappor- n’est pas uniquement le contenu sensible créé par
tant, puis nous expliciterons plus bas la spécificité l’interaction – contenu qui est bien souvent éphé-
du couplage que nous étudions. mère de fait de l’actualisation en temps réel – mais
aussi et avant tout l’expérience de l’interaction.
– L’œuvre spectaculaire L’expérience esthétique ne se construit plus seule-
Les acteurs du modèle : le sujet, l’œuvre ment dans la relation sujet/œuvre, elle devient cet
Les acteurs du couplage : le sujet, l’œuvre état que nous nommons « action corporelle créa-
Émergence : expérience de l’œuvre trice » où sujet (corps) et œuvre sont solidaires,
interdépendants et empreints l’un l’autre.
– Le dispositif interactif avec interface Si nous revenons à nos différents modèles et
Les acteurs du modèle : le sujet, l’interface, couplages, nous constatons que, selon la nature de
l’« œuvre contenant » l’œuvre, les acteurs du couplage diffèrent. La spé-
Les acteurs du couplage : le sujet, l’« œuvre conte- cificité de la situation interactive sans interface
nant » via l’interface réside dans les différents niveaux de couplage et
Émergence : expérience de l’« œuvre contenu » d’émergence qu’elle propose. Comme nous
l’avons amorcé plus haut, la distinction qualitative
– Le dispositif interactif sans interface faite sur l’interfaçage se poursuit ici. L’apprentis-
Les acteurs du modèle : le sujet, l’« œuvre conte- sage du fonctionnement de l’interface outil, son
nant », l’« œuvre contenu » appropriation, bloquent selon nous l’accès au
1. Les acteurs du premier couplage : le sujet, deuxième niveau de couplage qu’offre le dispositif
l’« œuvre contenant » sans interface. L’interface, enferme le visiteur
Émergence : expérience de l’« œuvre contenu » dans une situation de manipulateur, en accaparant
2. Les acteurs du deuxième couplage : le sujet, son système sensori-moteur. De fait, ce dernier ne
l’« œuvre contenu » peut être acteur du couplage sujet/œuvre
Émergence : expérience de « l’action corporelle contenu. Or, c’est l’expérience de ce couplage qui
créatrice » qui fait œuvre va selon nous conditionner et construire l’« action
corporelle créatrice ».
Toute expérience esthétique est empreinte de la Dès lors, nous postulons que le couplage
relation sujet/œuvre. Or, chaque catégorie sujet/œuvre contenu, positionnant le sujet dans
d’œuvre implique une posture spécifique du sujet. une situation sensori-motrice inédite, nécessite
pour le visiteur une réévaluation interne et un
apprentissage particulier.
38Revue Proteus – Cahiers des théories de l’art
Le savoir-faire interactif dation est la modification de l’organisme en fonc-
tion des modifications du milieu. Les mêmes pro-
Le couplage sensori-moteur offert par un disposi- cessus d’assimilation et d’accommodation seraient
tif sans interface tangible exigerait un nouveau à l’œuvre lors de l’expérience d’un dispositif inter-
savoir-faire ; de nouveaux schémes d’action, que actif sans interface tangible.
le visiteur inexpérimenté ne connaît pas, ne maî- À la suite de structurations successives dues
trise pas, ne possède pas et qu’il doit appréhender aux différents stades du développement, l’adulte
et apprendre à « contrôler ». Ce savoir-faire est le arrive à un équilibre final. La proposition nouvelle
geste interactif. Le visiteur n’ayant jamais vécu de couplage représenterait pour lui une perturba-
cette situation, devrait apprendre à se mouvoir, tion de cet équilibre atteint et ferait naître un nou-
non pas pour marcher ou pour saisir un objet, veau niveau d’adaptation, celui des nouvelles
mais pour produire du son, de l’image, du sens. structures d’intelligence liées aux nouvelles habili-
L’acquisition de ce geste interactif nécessiterait tées. Lors de l’étude comportementale menée sur
certaines réévaluations voir acquisitions de com- Vection, nous avons pu analyser des captations
portements moteurs et donc perceptifs. Ces pro- vidéo infrarouges de 166 visiteurs. Ces derniers,
cessus d’appropriation nous ont orienté vers la en grande partie, lorsqu’ils pénètrent dans l’instal-
notion de schème en tant que système d’organisa- lation, expérimentent le dispositif en agissant
tion du mouvement et d’opérations. Grâce aux selon des schémes d’action simples, connus, qui
recherches du psychologue et biologiste Jean Pia- ne demandent pas d’efforts cognitifs supplémen-
get, nous avons trouvé dans le modèle constructi- taires liés à un apprentissage : danse, mouvement
viste un moyen de comprendre les processus de gymnastique, de nage, etc. Dans cette phase de
d’acquisition mis en œuvre dans le développement contact, le visiteur cherche un point d’encrage
des connaissances liées à l’acquisition motrice et à dans l’installation. Lorsqu’il détecte un point
l’usage « pratique » du geste interactif. d’interaction, c’est-à-dire un point de dialogue
Le constructivisme suppose que l’image de la entre le sujet et l’œuvre contenu, il rentre dans
réalité qu’a le sujet est le résultat de son interac- une phase d’exploration durant laquelle il s’appro-
tion avec celle-ci, et non une simple représenta- prie le couplage sensori-moteur. À ce stade, si le
tion. Cette théorie de l’apprentissage considère visiteur n’a jamais été confronté à une telle situa-
donc non seulement le couple sujet/environne- tion, il va devoir élaborer de nouveaux schèmes
ment dans le processus d’acquisition des connais- d’action. Dans ce cas il y a accommodation entre
sances, mais également l’expérience, soit le vécu l’organisme et le milieu. S’il a déjà vécu une situa-
du sujet. tion similaire il va pouvoir puiser dans des
En tant que biologiste, Jean Piaget considère schèmes préexistants pour répondre à la situation.
l’esprit, l’intelligence, comme une des formes Dans ce cas l’apprentissage du nouveau couplage
prises par l’adaptation biologique face aux condi- est facilité, il y a assimilation entre l’organisme et
tions changeantes du milieu. L’intelligence serait le milieu. En effet, nous avons constaté dans
donc un cas particulier de l’adaptation biologique. notre étude comportementale sur Vection, que les
(Nous voyons ici la limite du modèle Piagétien musiciens ont souvent plus de facilités à com-
face au modèle énactif. F. J. Varela considère le prendre les modalités interactives que les non
biologique et la cognition comme étant coexten- musiciens. L’étude comportementale nous a per-
sifs, tandis que J. Piaget subordonne encore le bio- mis de chiffrer les informations suivantes : la
logique au cognitif. Toutefois le constructivisme vitesse de déplacement, la vitesse d’exécution des
initie le modèle énactif en cela qu’il prend en gestes, la surface d’occupation du dispositif,
compte, dans le développement cognitif, le couple l’amplitude des gestes. Nous avons pu conclure
sujet (action sensori-motrice)/environnement et que la phase d’exploration est caractérisée par des
leur codétermination.) vitesses de déplacement et d’exécution des gestes
J. Piaget aborde l’étude de la connaissance en plus lentes que durant la phase de contact. Nous
considérant deux aspects en interaction. Selon pouvons expliquer cela par la concentration et
J. Piaget, l’assimilation est l’incorporation l’écoute attentive, que requiert l’appropriation du
d’éléments du milieu à l’organisme, et l’accommo- couplage sensori-moteur. La phase de pratique est
39Revue Proteus no 6, le spectateur face à l’art interactif
caractérisée par des vitesses de déplacement et organe sensoriel valide. Nous pouvons prendre
d’exécution des gestes plus rapides, que nous l’exemple du TVSS (Tactile Vision Substitution
avons assimilées à un comportement de maîtrise System) développé par Bach-y-Rita qui convertit
du geste interactif. Les musiciens ont une phase une image optique, captée par une caméra vidéo,
de contact très brève voir inexistante (10 secondes en une stimulation électrique ou vibro-tactile sur
en moyennes pour les musiciens, contre 1’20 sec. une matrice de stimulateurs tactiles en contact
en moyenne pour les non musiciens). Le point avec une partie du corps comme le bas du dos,
d’interaction lié au bras droit est systématique- l’index, l’abdomen ou la langue. Une fois le fonc-
ment trouvé. La phase d’exploration, alors qu’elle tionnement du système acquis, les utilisateurs,
qualifie la plupart des visites, est plus brève chez actifs, semblent clairement dissocier la sensation
les musiciens qui semblent rapidement vouloir tactile de la perception de l’objet ainsi traduit. Plus
exploiter l’aptitude expressive offerte par le dispo- l’apprentissage avance, plus la sensation est immé-
sitif. Les gestes effectués sont cohérents avec les diatement traduite en perception (traduction men-
modalités proposées. La vitesse d’exécution est tale de l’objet), l’utilisateur oubliant le système de
rapide (6,11 mètres par seconde en moyenne pour traduction. La sensation est ainsi traitée en terme
un musicien, contre 3,2 m/s en moyenne pour un sémantique.
non musicien). Nous supposons que ce panel, de L’interfaçage à distance, considéré comme un
part sa pratique instrumentale, possède des système de substitution sensorielle, offre une
schèmes sensori-moteurs favorisant l’apprentis- potentialité d’action rare en permettant au sujet
sage des modalités interactives de Vection, qui est d’agir à distance sur son environnement. Il ne
un dispositif lié à l’exploration sonore. Le visiteur s’agirait donc pas, dans cet interfaçage, de pallier à
adapte un schème déjà existant pour répondre à la un sens défaillant grâce à un autre, mais plutôt, de
situation qui se présente à lui. Le visiteur peut proposer à un sens une nouvelle potentialité
également déjà posséder le schème sensori- effective sur l’environnement.
moteur correspondant au couplage. En effet, Le Professeur Alain Berthoz (Chaire de phy-
nous avons constaté lors de notre étude, que siologie de la perception et de l’action au Collège
lorsque un même visiteur renouvelle l’expérience, de France) désigne, en sus des cinq sens ordinaire-
les comportements liés à la phase de contact sont ment nommés, un sixième sens, réunissant
absents. Le visiteur développe rapidement un l’ensemble des capteurs sensoriels et nous per-
comportement où il approfondit la connaissance mettant d’analyser le mouvement et l’espace : le
du couplage en s’appropriant ces schèmes sens du mouvement1 ou kinesthésie. Il s’agirait
d’action pour, dans une troisième phase pratique, donc, pour notre étude, de comparer l’interfaçage
en exploiter le potentiel expressif. Le dispositif à distance avec un système de substitution senso-
mis en place par l’artiste peut se transformer en rielle permettant au sens du mouvement d’acqué-
véritable instrument lorsque les schèmes d’action rir une nouvelle potentialité, « expressive ». Et
qu’il propose sont assimilés par le visiteur. donc, plutôt que de pallier un sens défaillant, de
Cet instrument, à travers un savoir-faire que pallier une défaillance dans l’utilisation de ce sens
nous nommerons geste interactif, permet au visi- en dénonçant un déficit d’attention dans son utili-
teur de s’exprimer de manière inédite. sation. La qualité expressive du mouvement étant
en effet peu prise en considération au quotidien
Le sujet expansé (sauf cas des danseurs, instrumentistes, sportifs
de haut niveau, etc.), l’interfaçage à distance pro-
L’approche neurophysiologique que nous allons poserait une nouvelle configuration, permettant
faire du geste interactif, complète celle psycholo- au sens du mouvement de s’exprimer via de nou-
gique exposée ci-dessus, car elles permettent, velles potentialités sémiotiques (son, lumière,
ensemble, d’étudier l’agent « sujet » du modèle image etc.). Nous développerons cette vision
énactif.
Un dispositif de substitution sensorielle com-
plète ou remplace une ou plusieurs fonctions d’un 1. Alain BERTHOZ, Le Sens du mouvement, Paris, Odile
organe sensoriel défaillant à l’aide d’un autre Jacob, 1997.
40Revue Proteus – Cahiers des théories de l’art
méliorative de l’interfaçage à distance en conclu- englobant toute la zone accessible avec le râteau.
sion de cet article, grâce aux travaux du philo- L’étude précise que l’extension du champ récep-
sophe Richard Shusterman. teur visuel est provisoire (3 min.), et qu’elle n’est
Alain Berthoz définit la notion de schéma cor- constatée que lorsque l’outil est utilisé de façon
porel comme un mécanisme d’identification du fonctionnelle.
corps propre par le sujet, une sorte de modèle L’étude faite par S. Aglioti3, chez des humains
interne des limites corporelles du « je ». Ce souffrant de lésions du lobe pariétal droit (Le lobe
modèle interne en rapport avec l’environnement, pariétal est le site d’intégration des données sen-
peut être inné, ou bien acquis, « constitué par sorielles ; une lésion du lobe pariétal droit entraî-
l’activité, le jeu, l’expérience, l’apprentissage 1 ». nant la plupart du temps un syndrome neuropsy-
Face aux couplages sensori-moteurs inédits pro- chologique d’héminégligence gauche), a démontré
posés par certains dispositifs d’interfaçage à dis- l’intégration d’un objet dans le schéma corporel
tance, nous postulons que le visiteur en action humain, lorsque cet objet est habituellement lié au
doit réévaluer son schéma corporel. membre gauche (la personne ne reconnaît plus
Ce sont les études menées par Iriki Atsushi et l’objet lié à l’hémisphère gauche de son corps).
Miki Taoka2 sur les aspects neurophysiologiques Les premières études des conséquences de
de l’utilisation d’outils et de l’influence de cette l’utilisation d’outils sur le schéma corporel ont été
utilisation sur le schéma corporel et la représenta- faites par Frassinetti Francesca et Anna Berti4
tion de l’espace qui nous permettent de pour- chez des patients également atteints d’héminégli-
suivre notre hypothèse. gence. En voici les conclusions :
Au niveau cérébral, ce sont les neurones bimo- – l’outil est intégré dans le schéma corporel,
daux qui sont à la base de l’intégration sensorielle. cette intégration redéfinissant les frontières entre
Ces neurones présentent la particularité de espace péri-personnel et extra-personnel (hors de
répondre à des stimulations dans des modalités portée).
différentes. En ce qui concerne les neurones – dans l’espace péri-personnel, l’héminégli-
bimodaux répondant aux modalités visuo-taciles, gence est persistante que cela soit avec l’utilisation
Iriki Atsushi et Miki Taoka travaillent, chez le d’un outil physique (bâton) ou virtuel (pointeur
singe, sur un neurone bimodal visuo-tactile dont laser ; NB : le faisceau laser ne prolonge pas phy-
le champ récepteur tactile correspond à la face siquement le bras.)
palmaire de la main droite. Le champ visuel cor- – dans l’espace extra-personnel, l’héminégli-
respond à cette même main puis à l’environne- gence persiste uniquement avec l’utilisation d’un
ment immédiat (que le singe regarde sa main ou outil physique. Le pointeur laser (par exemple) ne
non), ce qui montre que le singe aurait une repré- suffit pas à étendre le schéma corporel.
sentation de son espace péri-personnel (à portée Des études complémentaires menées par
de main), liée à tout ou partie de son corps, et non l’équipe d’Ackroyd et al.5 ont démontré que ce
à une image rétinotopique. Après avoir exercé des n’était pas la caractéristique physique de l’outil qui
singes à l’utilisation d’un râteau pour récupérer de lui permettait d’être intégré au schéma corporel
la nourriture, on observe, et ce rapidement mais son aspect « fonctionnel ». Il faut que l’outil
(5 min), que le champ récepteur visuel des mêmes ait une action effective sur l’environnement pour
neurones bimodaux s’est élargi, de l’environne-
ment immédiat, à un environnement plus large
3. S. AGLIOTI, N. SMANIA, M. MANFREDI, G. BERLUCCHI,.
Disownership of left hand and objects related to it in a
patient with right brain damage. Neuroreport, 8 (1), 1996,
1. Alain BERTHOZ, Jean-Luc PETIT, Phénoménologie et p. 293-296.
physiologie de l’action, Paris, Odile Jacob, 2006, p. 186. 4. Anna BERTI, Francesca FRASSINETTI, « When far becomes
2. Atsushi IRIKI, Miki TAOKA, « Triadic (ecological, neural, near: remapping of space by tool use. », Journal of
cognitive) niche construction: a scenario of human brain Cognitive Neuroscience, 12 (3), 2000, p. 415-420.
evolution extrapolating tool use and language from the 5. K. ACKROYD, M. J. RIDDOCH, et al., « Widening the sphere
control of reaching actions », Philosophical transactions of of influence: using a tool to extend extrapersonal visual
the royal society biological sciences, no 367, 2012, p. 10-23. space in a patient with severe neglect ». Neurocase, 8, 2002,
p. 1-12.
41Revue Proteus no 6, le spectateur face à l’art interactif
que le schéma corporel soit étendu. La situation interactive que nous étudions permet-
Selon les conditions de notre hypothèse, la trait de développer une conscience corporelle
réévaluation du schéma corporel sera efficiente si réflexive, grâce à la mise en place d’un savoir-faire
le sujet agit et modifie de manière intentionnelle que nous avons qualifié de geste interactif. Ce
son environnement, dans son espace péri-person- geste interactif offre au visiteur la possibilité
nel ou extra-personnel, et ce même en l’absence d’expérimenter l’« action corporelle créatrice », qui
d’outil physique. Situation que nous comparons favorise la conscience d’un corps et de son rôle
avec celle de l’expérience d’un environnement comme site de l’expérience. En prenant
interactif sans interface embarquée. L’action conscience de son soi relationnel et transaction-
effective sur l’environnement permet de boucler nel, d’un soi non autonome, le visiteur se consi-
la boucle sensori-motrice en attestant d’un lien dère comme élément constitutif de son environ-
réel entre le sujet et l’environnement, bien que nement. Le sujet est actif et son existence rééva-
l’outil soit virtuel. luée.
Là où la sensation tactile est traitée en terme Nous ne revenons pas sur le rôle essentiel du
sémantique dans les TVSS par exemple, nous visiteur dans l’actualisation de l’œuvre, mais sur
espérons que cela pourrait être le « sens du mou- l’expérience de cette actualisation. Dans Vection
vement », qui pourrait être assimilé à son expressi- (par exemple), le corps du visiteur, via l’interac-
vité, c’est-à-dire au contenu sémantique de l’envi- tion, conditionne non seulement le couplage, mais
ronnement sonore ou visuel qu’il génère. également une composante du couplage, l’œuvre
Nous concluons, dans l’étude de l’œuvre inter- contenu. Il ne s’agit plus d’une action dans un
active, que l’interface tangible externalise la fonc- espace temps, mais d’une action qui est espace
tion sollicitée du sujet. Nous souhaitons désor- temps. L’expérience interactive est une connais-
mais affirmer que le corps du visiteur que nous sance immédiate, immanente au couplage. La sen-
étudions, plus qu’interface (ou sujet interfacé), sation d’« extension » corporelle, expliquée plus
plus qu’un simple outil de modulation de l’envi- haut à travers l’évidente flexibilité du schéma cor-
ronnement en temps réel, serait, grâce à l’interfa- porel induite par des situations sensori-motrices
çage à distance, expansé à sa fonction expressive. particulières, s’exprime également dans le cadre
spécifique des espace/temps interactifs proposés
par ces installations. De plus, il est évident que
Conclusion cette expérience ne peut exister que s’il y a inté-
gration complète des modalités interactives par le
Nous avons démontré que l’interfaçage à distance, visiteur qui doit en user de manière aisée, intuitive
propose au visiteur une situation inhabituelle qui et volontaire. L’expérience interactive fait partie
implique de nouveaux rapports à l’œuvre d’art et de la troisième phase décrite dans l’approche psy-
qui sollicite de nouvelles postures d’appropriation, chologique. Lorsque la pratique du dispositif n’est
de nouveaux comportements. L’expérience esthé- plus contact, n’est plus exploration, mais expres-
tique devient une expérience transformatrice. sion – ce que nous nommons dans cet article
La soma-esthétique, dont le principal représen- l’« action corporelle créatrice ».
tant est le philosophe Richard Shusterman,
s’occupe de l’étude critique et de la culture méliora- Nathanaëlle RABOISSON
tive de notre expérience et de notre usage du corps
vivant en tant que site d’appréciation sensorielle et
de façonnement créateur de soi1.
1. Richard SHUSTERMAN, Conscience du corps, Pour une
soma-esthétique, Paris, L’éclat, 2007, p. 11.
42Vous pouvez aussi lire