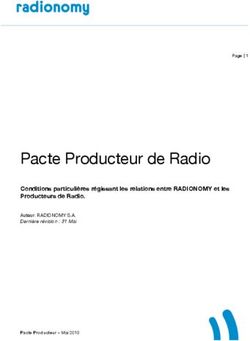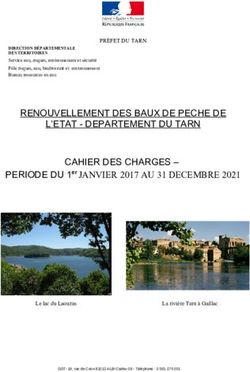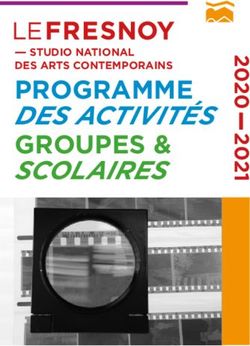Le juge étatique à l'épreuve de la convention d'arbitrage au Togo
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Le juge étatique à l’épreuve de la convention d’arbitrage au
Togo
par TCHA-BOZIRE Fousseni*
ABSTRACT AND KEY WORDS
When an arbitral convention has been agreed upon, an ordinary tribunal is ipso facto pre-
cluded from entertaining the dispute between the parties. This view may stand if arbitration
is seen simply as a dispute settlement mechanism administered by private individuals with-
out any State authority. Nonetheless, this is a merely a principle. In fact, the OHADA's Uni-
form Act relating to Arbitration procedure envisions both implied and express prerogatives
of a State's judge with regard to arbitration procedure.
In connection to ad hoc arbitration procedure, the State`s judge prerogative are mani-
fold and could be classified into two main categories. On the one hand, he enjoys shared
competences with the arbitral tribunal. These competencies are either conditioned upon the
default of the arbiters or on the failure of the parties to put the process into motion, or other-
wise on the undue constitution of the arbitral tribunal. This is usually the case where ad-
equate cooperation/collaboration is required between both institutions for the administra-
tion of arbitral justice. On the other hand, the State's judge may enjoy exclusive compe-
tences. This is the case in post-arbitration situations where the recognition or the exequatur
of the arbitral decision is sought, or when a civil tribunal is called upon to entertain re-
course for cancellation.
« Chasser le naturel, il revient au galop », cet adage populaire illustre la situation du
juge étatique dans la procédure arbitrale de règlement des différends. En effet, l’arbitrage
est « l’institution d’une justice privée grâce à laquelle les litiges sont soustraits aux juridic-
tions de droit commun, pour être rendus par des individus, revêtus pour la circonstance de
la mission de les juger ».1 C’est donc un mode alternatif de résolution des différends par
lequel les parties à un tel différend acceptent d’en confier la solution à une ou plusieurs per-
sonnes choisies par elles plutôt que de s’adresser au juge. Au regard de cette définition, la
première idée qui vient souvent à l'esprit, confortée par une certaine pratique juridiction-
nelle, est que la conclusion d'une convention d'arbitrage entraîne inéluctablement l'incom-
pétence des tribunaux étatiques (et donc du juge étatique) à statuer sur l'affaire que les par-
ties soumettent ainsi à la justice arbitrale. Cela peut paraître vrai si l'on définit l'arbitrage
* Doctorant, Directeur pédagogique, Institut Supérieur de Droit et d’Interprétariat,
tbozire@gmail.com, BP 302/ 228 22 50 94 14/ 228 90 88 42 49, Lomé-TOGO
1 Robert J., Moreau B., L’arbitrage, droit intermédiaire privé, 1987, n°1.
394 KAS African Law Study Library – Librairie Africaine d’Etudes Juridiques 4 (2017)
https://doi.org/10.5771/2363-6262-2017-3-394, am 13.02.2023, 04:52:53
Open Access – - http://www.nomos-elibrary.de/agbLe juge étatique à l’épreuve de la convention d’arbitrage au Togo
simplement comme un mode de règlement des différends administré par des particuliers
non investis de leur mission par l'État.2
Le juge est un magistrat, personne physique, investi par l'État de la mission de trancher
les litiges qui opposent les personnes, et de rendre justice en son nom.3 La notion peut s’en-
tendre d’un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, mais il est censé être un profes-
sionnel. Le juge étatique désignerait donc le juge institué par l'État et rendant par consé-
quent justice en son nom. Ce qui contraste avec le juge nommé par de simples particuliers
en l’occurrence l'arbitre. La notion du juge ici évoquée, ne doit pas s’entendre ou se réduire
au seul juge d'instance, à l'exclusion de ceux d'appel ou de cassation.4 Dès lors, le juge dont
il est question ici est tout magistrat investi de sa mission par l'État (ou dans une autre di-
mension par une organisation internationale), peu importe qu'il soit d'instance, d'appel ou de
cassation.5
La notion de« juge compétent dans l’Etat-partie » chargé d’aider à la procédure arbi-
trale n'étant pas expressément explicitée dans l'AU.A,6 sa détermination dépend du système
juridique de chaque État membre.7C'est de ces différents juges désignés ou non par un texte
qu'il sera question dans le cadre de cette réflexion.
Selon Le Petit Robert,8 une épreuve désignerait une action d’éprouver quelque chose ou
quelqu’un. Elle peut désigner une résistance. Par conséquent, être à l’épreuve de, implique-
rait être capable de résister à. C’est donc une contre-épreuve.9 Le juge étatique serait donc
face à une épreuve en présence d’une convention d’arbitrage. En effet, il y a toujours eu,
dans l'esprit de certains juges, le fait que la justice arbitrale est en concurrence avec la jus-
tice étatique parce qu'elle les empêcherait d'exercer l’exclusivité de rendre justice au sein de
l'État. Pire, certains juges se montrent assez réticents pour se prononcer sur des affaires
pour lesquelles les parties ont conclu une convention d'arbitrage. Une telle situation est
2 Selon Jarrosson Ch., La notion d’arbitrage, 19871, p. 372, l’arbitrage serait « une institution par
laquelle un tiers règle un différend qui oppose deux ou plusieurs, en exerçant la mission juridiction-
nelle qui lui a été confiée par celles-ci ».
3 Guillien R., Vincent J., Lexique des termes juridiques, Paris, 2004. P.334.
4 Cela se justifie par le fait que dans la procédure arbitrale, il n’y a pas que le juge de première ins-
tance qui intervienne. Les juges d'appel et de cassation sont aussi concernés.
5 Dans la pratique, le législateur opte pour la notion de « juge compétent dans l’Etat-partie » pour
désigner ce juge. Pour sa part, le Règlement d'arbitrage de la CCJA désigne la CCJA en matière de
l'arbitrage institutionnel CCJA.
6 Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage adopté le 11 mars 1999.
7 Il faut relever que le Togo n’a pas encore dit clairement quel est le juge compétent. Mais on peut
estimer au regard de la pratique, qu’il s’agit des présidents des tribunaux comme au niveau des
cours d’appel. Cependant, et conformément à l’article 25 alinéa 3 AU.A le juge compétent pour sta-
tuer en cassation est celui de la CCJA.
8 Robert P., LE NOUVEAU PETIT ROBERT, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue
française, 2002, p. 929.
9 Exemple le gilet à l’épreuve des balles.
395
https://doi.org/10.5771/2363-6262-2017-3-394, am 13.02.2023, 04:52:53
Open Access – - http://www.nomos-elibrary.de/agbTCHA-BOZIRE Fousseni
source d'insécurité pour le justiciable surtout lorsqu’il s’agit non pas de juger l'affaire au
fond, mais de prendre une simple mesure provisoire.
Le processus d’arbitrage trouve son fondement dans l’existence de la convention d’ar-
bitrage. Sans convention d’arbitrage, l’arbitrage ne peut donc pas être mis en œuvre. La
convention d’arbitrage se présente comme un accord des parties au contrat principal10 de
soumettre leurs éventuels différends à des arbitres et de se soumettre à leur décision. Elle
porte le nom de clause compromissoire lorsqu’elle est rédigée en vue d’un litige éventuel
futur et celui de compromis lorsqu’elle porte sur un litige déjà né.11
La réflexion menée ici est relative à la place du juge étatique dans une procédure arbi-
trale. En effet, faut-il le rappeler, tout en visant à faire donner la solution d'une question
intéressant les rapports entre deux ou plusieurs personnes par une ou plusieurs autres per-
sonnes tenant leurs pouvoirs d'une convention privée et statuant sur la base de cette conven-
tion, l'arbitrage ne fait pas partie de l'ordre juridictionnel interne de l'État. Les arbitres ne
sont donc pas investis de leur mission par l'État; et, par conséquent, ne bénéficient pas, par
exemple, du pouvoir d'ordonner l'exécution forcée de la sentence.
Par ailleurs, l'arbitrage présente deux facettes essentielles. C'est une institution à la fois
d'origine contractuelle et de nature juridictionnelle. Il peut être ad hoc ou institutionnel; ci-
vil ou commercial; interne ou international; il peut être en droit ou en équité. Le droit de
l'arbitrage OHADA est assez particulier sur plusieurs de ces points. Il établit une différence
fondamentale entre arbitrage ad hoc (dit encore traditionnel ou de droit commun) régi par
l'AUA et arbitrage institutionnel sous l'égide de la CCJA. Cependant, il n'y a aucune dis-
tinction entre arbitrage civil et arbitrage commercial. Il s'agit d'une évolution notable du
droit de l'arbitrage OHADA (qui a vocation, conformément à l'article 1er AUA, à s'appli-
10 La grande spécificité de la convention d'arbitrage reste sans doute son autonomie par rapport au
contrat principal qui le contient. Cette autonomie se manifeste sur le plan du rattachement de la
convention d'arbitrage par rapport au contrat principal de sorte que la nullité de ce dernier est sans
incidence sur la convention d'arbitrage. L'indépendance à l'égard du contrat qui comporte la clause
compromissoire a été historiquement décelée par la jurisprudence et évaluée par la doctrine
française (Francescakis, Phocion, « Le principe jurisprudentiel de l'autonomie de l'accord compro-
missoire », Rev. arb. 1974.67; Mayer, Pierre, « L'autonomie de l'arbitre international dans l'appré-
ciation de sa propre compétence », R.C.A.D.I. 1989.V.t. 217). La jurisprudencefrançaise est en ef-
fet fixée depuis l’arrêt Gosset du 7 mai 1963 (Cass. civ. 1ère 7 mai 1963 : Bull. civ. 1963 I n°246;
J.D.I. 1964 n°. J.-D. Bredin). Il s'agit là d'une règle matérielle (par opposition à une règle de conflit
de lois) faisant partie des principes généraux du droit de l'arbitrage commercial international. Les
règlements des plus importants centres d'arbitrage commercial international ont adopté le principe
d'autonomie: C.C.I., C.N.U.D.C.I., L.C.I.A., A.A.A… Le droit Ohada (AUA) consacre ce principe
à travers son article 4.
11 Il faut cependant relever qu’alors que le Traité OHADA utilise les deux termes pour désigner les
deux types de convention, l’AUA de son côté n’a adopté que le terme de « convention d’arbi-
trage ». Il faut également noter que si les termes « convention d’arbitrage » et « clause compromis-
soire » sont parfois interchangeables, dans la réalité, ces deux terminologies ne sont pas à
confondre. On dira d’ailleurs qu’il y a une convention d’arbitrage qui contient une clause compro-
missoire. On assimilera dès lors les deux notions lorsque la convention d’arbitrage ne contient
qu’une seule clause, la clause compromissoire.
396 KAS African Law Study Library – Librairie Africaine d’Etudes Juridiques 4 (2017)
https://doi.org/10.5771/2363-6262-2017-3-394, am 13.02.2023, 04:52:53
Open Access – - http://www.nomos-elibrary.de/agbLe juge étatique à l’épreuve de la convention d’arbitrage au Togo
quer à tout arbitrage, sans aucune exception que celle liée à l'arbitrabilité du litige). Il n'y a
pas non plus de différence entre arbitrage interne et arbitrage international.12 Dans la pra-
tique, l'arbitrage ad hoc peut poser de sérieuses difficultés à même de susciter l'intervention
du juge étatique, contrairement à l'arbitrage administré par une institution d'arbitrage, où le
centre gère certaines difficultés en lieu et place du juge étatique.
Au regard de ce qui vient d'être dit, on se demande alors quelle est la place du juge éta-
tique dans l'arbitrage OHADA? Quels sont les pouvoirs, les prérogatives du juge étatique
dans l'arbitrage OHADA? Quelle est la nature de ces pouvoirs : s'agit-il des pouvoirs
concurrentiels, exclusifs, ou plutôt complémentaires?
A la vérité, l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage apporte des éclaircissements
sur cette problématique : le choix par les parties de la convention d’arbitrage exprimerait le
désir de retirer le litige du giron du juge étatique. Cependant, ce choix ne retire pas au juge
étatique toutes ses prérogatives. Ces prérogatives du juge étatique dans l'arbitrage en géné-
ral et ad hoc en particulier, sont nombreuses et peuvent être classées en deux principales
catégories. D'une part, il exerce certaines compétences en concurrence avec le tribunal arbi-
tral. Il s'agit des compétences subordonnées à la condition de défaillance des arbitres ou des
parties à les mettre en œuvre ou, en dehors de cette défaillance, que le tribunal arbitral ne
soit pas déjà constitué. Il en est ainsi dans l'instance arbitrale où sa collaboration est souvent
nécessaire à une administration idoine de la justice arbitrale. D'autre part, le juge étatique
exerce des compétences qui lui sont propres ou exclusives de l'intervention des arbitres.
C'est le cas dans la phase post-arbitrale où il a l'exclusivité des compétences, que ce soit
pour la reconnaissance ou l'exequatur de la sentence arbitrale que pour connaître d'un éven-
tuel recours en annulation exercé contre celle-ci.
Au regard de ce constat, notre réflexion consistera à démontrer d’une part que face à
une convention d’arbitrage, le juge étatique est un juge renié (A) et d’autre part que malgré
ce désir de reniement, ce juge reste sollicité (B).
A. Un juge renié
En insérant une convention d’arbitrage dans un contrat de partenariat, les parties
conviennent ainsi qu’elles ne seront pas soumises à un juge de droit commun, c’est-à-dire le
juge étatique, mais exclusivement à un tribunal arbitral. Il s’agit là d’un rejet du juge éta-
tique, d’une renonciation au profit d’un particulier (I). Cependant, si ce choix au rejet a une
quelconque efficacité à l’égard du juge de droit commun, c’est bien parce que le législateur
l’a voulu (II).
12 Cette unité de régime des deux types d'arbitrage a été dénoncée comme factice. En effet, elle ne
correspond pas toujours à la réalité de certaines dispositions de l'AUA qui ne peuvent valablement
être appliquées que si l'on est en présence d'un litige ayant un caractère international.
397
https://doi.org/10.5771/2363-6262-2017-3-394, am 13.02.2023, 04:52:53
Open Access – - http://www.nomos-elibrary.de/agbTCHA-BOZIRE Fousseni
I. Le reniement prévu par le législateur
Dans son application, la convention d’arbitrage devrait amener non seulement les parties à
ne pas soumettre leur différend au tribunal étatique mais aussi ce dernier à s’abstenir d’en
connaitre. C’est le devoir de répondre négativement à une telle demande. On parle alors du
devoir d'abstention du juge étatique. Il s’agit du pendant de l'efficacité positive de la
convention d'arbitrage qui oblige les parties à soumettre aux arbitres le litige visé dans la-
dite convention. C’est en d’autres termes l'effet négatif de la convention d'arbitrage consis-
tant dans une incompétence des juridictions étatiques à l'égard de litiges pour lesquels une
clause compromissoire ou un compromis ont été rédigés.
Cet effet est consacré par la Convention de New York de 1958,13 qui dispose par
exemple que « le tribunal d'un État contractant, saisi d'un litige sur une question au sujet
de laquelle les parties ont conclu une convention au sens du présent article, renverra les
parties à l'arbitrage (...) ». Il en est de même de la loi type de la Commission des Nations-
Unies pour le droit du commerce international (CNUDCI) dont l’article 8 dispose que « le
tribunal saisi d'un différend sur une question faisant l'objet d'une convention d'arbitrage
renverra les parties à l'arbitrage si l'une d'elles le demande au plus tard lorsqu'elle soumet
ses premières conclusions quant au fond du différend (...) ». La convention de Genève14et
les droits communautaires notamment l’OHADA abondent la question dans le même sens.
En effet, l'AU.A traite de la question à l'article 13 de deux façons différentes et complé-
mentaires.
D'abord, l'alinéa 1er dispose que « lorsqu'un litige, dont le tribunal arbitral est saisi en
vertu d'une convention arbitrale, est porté devant une juridiction étatique, celle-ci doit, si
l'une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente ».15
Ensuite, par contre et selon l’alinéa 2, si le tribunal arbitral n’a pas encore été saisi, la
juridiction étatique doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d'ar-
bitrage ne soit manifestement nulle.16 A cet égard, il est utile de préciser que la caducité
d’une clause compromissoire n’entraîne pas la nullité de celle-ci.
Selon le législateur Ohada, le principe de l'incompétence des juridictions étatiques est
ainsi traité différemment selon que le tribunal arbitral est ou n'est pas déjà saisi du litige.
13 Conv.de NY, art. 2, § 3.
14 Art.VI, § 3.
15 Dans le même ordre d’idées, l’article 23 du traité de l’OHADA dispose que « tout tribunal d’un
Etat partie saisi d’un litige, que les parties étaient convenues de soumettre à l’arbitrage se déclarera
incompétent si… ».
16 Il faut souligner qu’en France, à la faveur de la réforme intervenue en 2011, la rédaction de l’ar-
ticle 1448 se substitue à la formule de l’ancien article 1458 du CPC qui ne prévoyait pas le cas de
la convention d’arbitrage « manifestement inapplicable ». Désormais il faut donc souligner le ca-
ractère cumulatif de ces deux conditions« manifestement nulle ou manifestement inapplicable ».
V. Civ., 26 juin 2006, Rev. arb., 2001, p. 529. A cet égard, il est utile de préciser que la caducité
d’une clause compromissoire n’entraîne pas la nullité de celle-ci (Cass., civ. 1ère, 11 février 20092,
n° 08-10341).
398 KAS African Law Study Library – Librairie Africaine d’Etudes Juridiques 4 (2017)
https://doi.org/10.5771/2363-6262-2017-3-394, am 13.02.2023, 04:52:53
Open Access – - http://www.nomos-elibrary.de/agbLe juge étatique à l’épreuve de la convention d’arbitrage au Togo
Dans la première hypothèse, si une partie saisie le juge étatique, malgré l’existence
d’une clause compromissoire, l’autre partie peut soulever l’incompétence du juge étatique.
Il s’agit bien d’une incompétence du juge étatique (une exemption de procédure) et non
d’une fin de non-recevoir. En effet, le juge étatique n’est pas compétent car une clause com-
promissoire existe entre les parties, mais, ce n’est pas un défaut de pouvoir étant donné que
si les parties renoncent à l’arbitrage ou si le délai d’arbitrage expire, le juge étatique re-
trouve sa compétence pour trancher ce litige.17
Dans la seconde hypothèse, il peut avoir, sous certaines conditions, une vocation subsi-
diaire à intervenir.18
A la lecture de ces différentes dispositions législatives, un constat peut être fait : il est
impossible pour les juridictions étatiques de soulever d'office l'incompétence du tribunal ar-
bitral en présence d'une convention d'arbitrage.19 La clause d’arbitrage étant précisément
destinée à dessaisir tout tribunal étatique du droit de trancher un litige y afférent. C’est l’ef-
fet négatif du principe « compétence-compétence ». En effet, « en présence d’une conven-
tion d’arbitrage qui n’est pas manifestement nulle, le juge étatique est invité à renvoyer les
parties à l’arbitrage, de sorte à mettre les arbitres à même de statuer les premiers sur la
question de la validité et de la portée de la convention d’arbitrage ».20
Au regard de tout ce qui précède, il est donc évident que le législateur exclut expressé-
ment le juge étatique du règlement d’un litige pour lequel les parties ont opté pour l’arbi-
trage. Ce rejet se concrétise également par le désire des parties de soustraire leur litige de
son giron naturel. D’où le reniement voulu par les parties.
II. Le reniement voulu par les parties
L’existence d’une convention d’arbitrage21 dans un contrat, doit manifester son efficacité.
Cette efficacité se traduit par le rôle élusif de la convention. En effet, la convention produit
17 B. Y. MEUKE, « Recours devant une juridiction étatique de l'espace OHADA et clause compro-
missoire : "A quel moment doit-on soulever l'incompétence de la juridiction étatique pour que la
mise en œuvre de la clause compromissoire ne soit pas tardive?" », Jurifis Info n° 10, mars-avril
2011, p. 1 et suivantes.
18 Ce qui sera traité dans la seconde partie de notre travail.
19 Il faut cependant réserver la question de la détermination du moment d'appréciation de l'existence
et de la validité de la convention d'arbitrage par les juges nationaux. En effet si la question ne sou-
lève guère de problèmes en France(Art. 1458 N.C.P.C (disposition interne étendue à l'arbitrage in-
ternational; Cass. civ. 1ère, 28 juin 1989, Eurodif. Cass. civ. 2e, 10 mai 1995, aff. Coprodag : Bull.
civ. 1995 II n 135 p. 77; Rev. arb. 1995.617 n. Gaillard)), quand bien même le tribunal arbitral ne
serait pas encore saisi(Aff.Jaguar, Paris, 7 déc. 1994, RTD com. 1995.401 obs. Dubarry & Lo-
quin), la Convention de New York (art. II § 3) et la loi-type CNUDCI (art. 8)(Comp. Conv. Ge-
nève, 1961, art. VI § 3) permettent cependant aux juridictions étatiques de ne pas reconnaître l'effet
négatif de la convention d'arbitrage, pareillement à certaines lois modernes sur l'arbitrage interna-
tional (droit belge, droit néerlandais, loi suisse de 1987 sur le droit international privé).
20 Art. 13 AU A préc.
21 Qu’elle soit une clause compromissoire ou un compromis d’arbitrage.
399
https://doi.org/10.5771/2363-6262-2017-3-394, am 13.02.2023, 04:52:53
Open Access – - http://www.nomos-elibrary.de/agbTCHA-BOZIRE Fousseni
entre les parties, un effet majeur : l’incompétence des juridictions étatiques. Par le choix
de l’arbitrage, les parties manifestent ainsi leur volonté de soustraire leurs contrats de l’in-
fluence des ordres juridiques nationaux et de leurs juridictions
Le principe ressort clairement de l’article 13 de l’AU A aux termes duquel« lorsqu’un
litige, dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d’une convention arbitrale, est porté de-
vant une juridiction étatique, celle-ci doit, si l’une des parties en fait la demande, se décla-
rer incompétente… ».L’effet identique à toutes les conventions d’arbitrage est donc d’attri-
buer le pouvoir de trancher le différend à un ou plusieurs arbitres. Négativement, il s’agit
d’un accord entre parties à ne pas recourir aux tribunaux de droit commun pour le règle-
ment du litige.22L’arbitrage serait à cet égard, un mécanisme destiné à préserver les contrats
de l'influence des ordres juridiques nationaux et de leurs juridictions.23
Le respect de cette convention devrait donc amener les parties à ne pas soumettre leur
différend au tribunal étatique. C’est l’expression du principe incontestable selon lequel l’ar-
bitrage trouve son fondement dans la seule volonté des parties et que celle-ci doit être sans
équivoque. Mieux, il s’agit là de la traduction juridique de l’autonomie de la volonté, corol-
laire de l’efficacité reconnue à toute convention. L’incompétence du juge étatique s’ex-
plique donc par le fait que comme tout contrat, la convention d’arbitrage est revêtue de la
force obligatoire interpartes,24 car, en principe, le contrat d’arbitrage ne produit d’effet
qu’entre les parties contractantes. La signature de la convention entraîne les conséquences
suivantes :
● L’obligation de respecter ce qu’on a voulu dans le contrat;
● Les parties à une convention d’arbitrage se sont entendues sur un fait majeur; celui de ne
pas soumettre leur litige au juge étatique, mais plutôt au juge privé. Ceci s’impose aux
parties par simple application de la règle de l’effet obligatoire des contrats conformé-
ment à l’article 1134 du Code civil.
Par la conclusion de la convention d’arbitrage, les parties s’obligent à soumettre leurs li-
tiges à l’arbitrage à l’exclusion de tout autre mode de règlement de leurs différends contrac-
tuels. Cette obligation existant même si l’une des parties est une personne morale (Etat, une
collectivité publique ou un établissement public.25 L’Etat ne pourrait donc pas paralyser la
convention d’arbitrage à laquelle il est partie et à laquelle il a librement consenti.26
22 Rubbens A., Le droit judiciaire congolais, T. II, 2003, p. 265.
23 Cf Robert J., L’arbitrage, droit interne, droit international privé, 1993 n° 1. Selon cet auteur, l’arbi-
trage serait « l’institution d’une justice privée grâce à laquelle les litiges sont soustraits aux juri-
dictions de droit commun, pour être rendus par des individus, revêtus pour la circonstance de la
mission de les juger ».
24 SakhoA., Acte uniforme sur l’arbitrage, Communication du Centre de documentations et des re-
cherches juridiques, in http://www.bj.refer.org/benin_ct/edu/ersuma/presenta.htm, janvier 2017, p.
28.
25 Art. 2 AU A.
26 Meyer P., OHADA Droit de l’arbitrage, 2002, p. 97.
400 KAS African Law Study Library – Librairie Africaine d’Etudes Juridiques 4 (2017)
https://doi.org/10.5771/2363-6262-2017-3-394, am 13.02.2023, 04:52:53
Open Access – - http://www.nomos-elibrary.de/agbLe juge étatique à l’épreuve de la convention d’arbitrage au Togo
Si la volonté des parties de confier leur litige à un arbitre est donc clairement exprimée,
le juge est tenu de la respecter; il ne saurait retenir sa compétence en dépit d’une conven-
tion d’arbitrage régulièrement excipée par une des parties, la convention d’arbitrage a donc
une force obligatoire qui s’impose non seulement aux parties mais également au juge éta-
tique. Lorsque les parties sont convenues donc de soumettre leurs différends à un arbitrage,
il doit y avoir exclusivité de la procédure arbitrale vis-à-vis des juridictions étatiques.
Cependant, l'incompétence des tribunaux nationaux étatiques n'est pas toujours battue
en brèche. Le juge étatique est ainsi sollicité dans la procédure arbitrale.
B. Un juge sollicité
L'arbitrage n'est pas totalement isolé des tribunaux de droit commun même si dans son
principe, l’arbitrage comme mode de règlement des litiges, a vocation à se dérouler sans
l’intervention du juge étatique. On ne soulignera jamais assez la part que le juge étatique a
pris dans l’essor de la justice arbitrale, avec laquelle il entretient des rapports confiants de
collaboration, grâce à l’assistance qu’il ne lui a jamais refusée et à l’esprit libéral qui
l’anime dans le contrôle des sentences. C’est dire donc que le juge étatique partage cer-
taines compétences avec le tribunal arbitral (I); et d'autre part, il dispose des prérogatives
propres, exclusives de toute intervention du tribunal arbitral (II).
I. Un juge coopérant ou concurrent de l’arbitre
Le principe de l'incompétence du juge étatique en présence d'une convention d'arbitrage
n'est pas d'ordre public. Le juge étatique peut donc, sous certaines conditions, connaître du
litige qui devait être soumis à l'arbitrage. Les hypothèses sont nombreuses : c'est le cas si la
convention d'arbitrage est manifestement nulle; c'est aussi le cas si les parties renoncent à
l'application de la convention d'arbitrage. Il en est de même s’agissant des hypothèses de
règlement des difficultés de constitution initiale du tribunal arbitral, et celles pouvant affec-
ter ultérieurement la composition dudit tribunal.
L’implication du juge étatique dans la procédure arbitrale ne contredit pas son devoir
d’abstention. Car si le juge est amené à intervenir, il le fait à la demande des parties, non
pour exercer une éventuelle tutelle sur l’arbitrage, mais pour consolider un arbitrage fragili-
sé par la survenance d’une difficulté.
Aux termes de l'article 13 alinéa 2 AU.A, « si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi,
la juridiction étatique doit également se déclarer incompétente à moins que la convention
d'arbitrage ne soit manifestement nulle ».
L'intérêt d'une telle disposition est d'éviter la poursuite d'une procédure arbitrale vouée
à l'échec en raison de la nullité manifeste de la convention d'arbitrage. Les auteurs pensent
que la notion de nullité manifeste n'étant pas définie par les textes, sa constatation devrait
401
https://doi.org/10.5771/2363-6262-2017-3-394, am 13.02.2023, 04:52:53
Open Access – - http://www.nomos-elibrary.de/agbTCHA-BOZIRE Fousseni
résulter de l'apparence de la convention, d'un simple examen extrinsèque et non de son ana-
lyse.27
Pour sa part, 'article 13 alinéa 3 AU.A dispose que : « (...) la juridiction étatique ne
peut relever d'office son incompétence ». Il s'agit là de l'affirmation la plus évidente du ca-
ractère relatif de cette incompétence. Et de fait, l'accord compromissoire signé par les par-
ties est une convention privée qui repose uniquement sur leur volonté. Celles-ci peuvent,
par conséquent, y renoncer pour recourir aux juridictions étatiques, soit expressément, soit
tacitement. La renonciation expresse ne pose pas beaucoup de difficultés parce qu'il appar-
tient aux parties, malgré la survenance du litige, de conclure une nouvelle convention attri-
buant compétence au juge étatique pour en connaître.
Quant à la renonciation tacite, elle est plus subtile et nécessite beaucoup de vigilance de
la part des parties et du juge étatique saisi. Il n'appartient pas au juge étatique saisi de soule-
ver son incompétence. Ainsi, d'une part, le demandeur renonce au bénéfice de la convention
d'arbitrage en assignant sur le fond son cocontractant devant le juge étatique. D'autre part,
le défendeur accepte cette compétence en comparaissant sans soulever l'incompétence du
juge étatique.28
La vocation subsidiaire du juge étatique à connaître de l'affaire soumise à l'arbitrage est
une prérogative importante dans la mise en œuvre de la convention d'arbitrage, mais n'est
pas la seule, car le juge étatique peut aussi intervenir pour aider les parties à vaincre les
difficultés de constitution du tribunal arbitral.
Le principe demeure celui de la primauté de la volonté des parties dans la désignation
des arbitres. Ainsi, s'il s'agit d'un arbitre unique, les parties se mettent d'accord pour le dési-
gner; s'il s'agit d'un tribunal composé de trois arbitres, chacun désigne un arbitre et les deux
autres désignent le troisième, ou celui-ci est désigné selon d'autres modalités prévues par
les parties ou par le règlement d'arbitrage choisi. C'est la situation idéale où tout se passe
bien.
Force est de reconnaître cependant que tel n'est pas toujours le cas. En effet, il peut sur-
gir plusieurs difficultés dans cette phase. Ainsi, le défendeur refuse de désigner un arbitre
alors même que le demandeur à l'arbitrage s'est attelé à cette tâche dans sa demande intro-
ductive d'instance. C'est aussi le cas des deux parties ou des deux premiers arbitres qui ne
s'entendent pas pour désigner l'arbitre unique ou le troisième arbitre.
Dans ces hypothèses, les règles légales de désignation des arbitres doivent être mises en
œuvre. L'article 5 autorise la saisine du juge étatique par la partie la plus diligente afin que
l'obstacle soit levé.
Concrètement, en cas d'arbitrage à trois arbitres, l'article 5 alinéa 2a AU.A prévoie que
si l'une des parties « ne nomme pas un arbitre dans le délai de trente jours à compter de la
27 Meyer P., Commentaire de l'AU A, in J. Issa-Sayegh et alliés, OHADA, Traité et actes uniformes
commentés et annotés, juriscope, 2002. p.119.
28 CCJA,1ère ch., arrêt no 09 du 29 juin 2006, aff. F.K.A c/ H.A.M, in Juris-Ohada n° 4/2006, p.2, et
www.ohada.com/ Ohadata J-07-23.
402 KAS African Law Study Library – Librairie Africaine d’Etudes Juridiques 4 (2017)
https://doi.org/10.5771/2363-6262-2017-3-394, am 13.02.2023, 04:52:53
Open Access – - http://www.nomos-elibrary.de/agbLe juge étatique à l’épreuve de la convention d’arbitrage au Togo
réception d'une demande à cette fin émanant de l'autre partie, ou si les deux arbitres ne
s'accordent pas sur le choix du troisième arbitre dans un délai de trente jours à compter de
leur désignation, la nomination est effectuée par le juge compétent dans l'État partie ».29
S'agissant de la difficulté de désignation des arbitres par un tiers préconstitué ou par un
centre chargé d'organiser l'arbitrage, le problème se pose lorsque ce tiers n'est pas désigné
avec la plus grande précision possible. Tel a été le cas en France dans une affaire dont la
clause compromissoire conclue entre les deux parties domiciliées à l'étranger soumettait
leurs différends à « la chambre de commerce officielle à Paris », or une telle chambre
n'existe pas à Paris. Pour résoudre cette difficulté, le Président du TGI de Paris décida alors
que « s'il n'existe pas, à Paris, une « chambre de commerce officielle », la chambre de com-
merce internationale, organisme de droit privé, constitue manifestement le centre d'arbi-
trage reconnu à Paris par la pratique des relations internationales, tant en France qu'à
l'étranger, pour organiser les procédures de règlement des différends par la voie arbitrale,
quelles que soient la nature du litige, la nationalité des parties en cause ou la loi appli-
cable » (TGI Paris, ordonnance du 13 décembre 1988, Rev. arb. 1990. 521). Pareille solu-
tion pourrait servir de source d’inspiration pour le juge étatique de l'espace OHADA dans le
cadre de sa collaboration à la mise en place initiale du tribunal arbitral; ou quand il s'agira
de résoudre les difficultés ultérieures affectant ce tribunal hypothèse prévue par l’article 8
AUA.
Au total, le juge étatique peut donc parfaitement trouver un rôle à jouer concomitam-
ment au déroulement de la procédure d’arbitrage tant que son intervention ne porte pas at-
teinte à la compétence des arbitres et qu’il ne touche pas au fond du litige. Cette solution
peut se justifier par l’idée que la loi ne vise que l’incompétence du juge étatique pour le
règlement des litiges au fond. Mis à part son rôle de juge concurrent, le juge étatique
conserve certaines prérogatives exclusives dans la procédure arbitrale.
II. Un juge à compétence exclusive dans la procédure arbitrale
Les sentences arbitrales sont des décisions qu'on ne peut rattacher de droit à un ordre juri-
dique déterminé, mais les différents ordres juridiques ont à leur égard une position quasi
unique : la sentence arbitrale ne peut produire directement ses effets et être exécutée
comme une décision émanant d'une juridiction nationale. Elle doit passer par la procédure
d'exequatur ou de reconnaissance. Celles-ci sont du ressort exclusif du juge étatique. A ces
deux procédures, il faudra ajouter le recours en annulation exercé contre la sentence.
29 Il reste néanmoins des problèmes non expressément résolus par l'AU.A, notamment celui de la
« clause blanche », et celui de la désignation indirecte des arbitres par un tiers préconstitué. Que
faire lorsque ces difficultés surviennent? La clause blanche est celle qui prévoie tout simplement le
recours à l'arbitrage, mais ne fixe aucune modalité quant à la désignation des arbitres, encore
moins leur nombre. Il nous semble que le juge étatique devra entendre les parties à la suite de quoi
il pourra fixer le nombre d'arbitres et leur désignation par les parties. Mais, il est déjà arrivé dans
un cas extrême que le juge étatique désigne les arbitres lui-même (v. Fouchard Ph., Gaillard E. et
Goldman B., Traité de l'arbitrage commercial international, Paris, 1996 n° 859.
403
https://doi.org/10.5771/2363-6262-2017-3-394, am 13.02.2023, 04:52:53
Open Access – - http://www.nomos-elibrary.de/agbTCHA-BOZIRE Fousseni
La notion de reconnaissance est intimement lié au droit international public et désigne
un acte unilatéral et discrétionnaire par lequel un État prend position sur une situation ou un
fait qui s'est produit en dehors de lui et dont il est disposé à tenir compte. Cette définition,
rejoint pratiquement les mêmes préoccupations que celle de l'exequatur, à savoir faire pro-
duire les effets à un acte extérieur à l'ordre juridique d'un État. La consécration par l'AU A
de la reconnaissance est inspirée de la convention de New York du 10 juin 1958. La ques-
tion de la reconnaissance de la sentence doit être envisagée à travers deux hypothèses pos-
sibles :
Dans la première hypothèse, une partie peut avoir intérêt à l'introduction de la sentence
dans l'ordre juridique interne pour tirer avantage de sa force probante. En effet, bien que
n'étant pas un acte exécutoire, les mentions que contient la sentence ne peuvent être igno-
rées par un tribunal. Ainsi, elle peut permettre de constater le rejet d'une prétention. En
plus, on sait qu'un jugement ou une sentence étrangère non exécutoire est un titre privé qui
peut justifier une saisie conservatoire. Pour toutes ces raisons, une partie peut valablement
demander la reconnaissance de la sentence en dehors d'une procédure d'exequatur.30
Dans la seconde hypothèse, qui est relative à la double condition d'établir la preuve de
l'existence de la sentence et sa non contrariété manifeste à l'ordre public international des
Etats-membres de l'OHADA, une partie peut invoquer, à titre incident devant une juridic-
tion étatique, la reconnaissance de la sentence. Dans ce cas, le juge saisi de l'incident peut
donner effet à la sentence sans se dessaisir au profit du juge de l'exequatur.31
L'exequatur est défini comme un ordre d'exécution donné par une autorité judiciaire à
une sentence rendue par une justice privée.32 C'est justement le cas de la sentence arbitrale.
Dans cette occurrence, l'exequatur est « un bon à exécuter » et non point un acte d'exécu-
tion.33
30 Alexandre D.,« les effets des jugements indépendants de l'exequatur », trav. Com. Fr. dr. Int. Pr.,
1975.77 cité parLoussouarn Y.et Bourel P., in Droit international privé, Paris, 1994. n° 510 et s.
31 Cette hypothèse découle expressément de l'art. 1498 NCPC français. Elle n'est pas expressément
prévue par l'OHADA même si l'article 31 AU.A pose les conditions de la reconnaissance et de
l'exequatur que l'article 1498 NCPCC. Cette hypothèse est critiquable parce qu'elle se concilie mal
avec l'idée que la sentence a autorité de chose jugée dès qu'elle est rendue, sauf si l'on s'assure du
respect sans examen au fond des deux conditions de la reconnaissance et de l'exequatur. V. dans ce
sens, Fouchard Ph.et alliés, op. cit., n° 1567.
32 V. article 30 AU A.
33 La confusion entre les deux notions ne devrait pas, comme semble le faire l'AU A, être faite. En
effet, l'exécution consiste pour le bénéficiaire d'un titre exécutoire, c'est-à-dire déjà revêtu de la
formule exécutoire, de mobiliser un agent d'exécution afin de mettre en œuvre ou matérialiser la
décision obtenue.
Sur le plan temporel, la différence entre les deux notions est encore plus nette. En effet, la formule
exécutoire précède l'exécution proprement dite. L'exequatur est la condition sine qua non d'exécu-
tion forcée d'une sentence parce qu'étant dépourvu d'imperium, l'arbitre ne peut l'apposer sur la
sentence qu'il rend. On doit faire recours au juge étatique, qui à l'issue d'un contrôle sommaire,
appose la formule exécutoire, préalable à l'exécution.
404 KAS African Law Study Library – Librairie Africaine d’Etudes Juridiques 4 (2017)
https://doi.org/10.5771/2363-6262-2017-3-394, am 13.02.2023, 04:52:53
Open Access – - http://www.nomos-elibrary.de/agbLe juge étatique à l’épreuve de la convention d’arbitrage au Togo
Au total, la reconnaissance vise beaucoup plus à établir l'existence de la sentence sans
forcément en tirer toutes les conséquences juridiques, notamment son exécution matérielle.
C'est comme s'il s'agissait seulement de reconnaître une situation de fait que constate un
titre qui n'est même pas authentique. Tel n'est pas l'objet de l'exequatur qui vise à obtenir
l'autorisation d'exécuter la sentence sur un territoire donné. Au besoin avec le concours de
la force publique.
On en vient alors à conclure que la différence est davantage conceptuelle que fonction-
nelle.
Le procès arbitral s’achève avec le prononcé de la sentence arbitrale. Celle-ci peut
néanmoins être l’objet d’un recours devant le juge judiciaire.34Même si l’ordonnance d’exe-
quatur n’a pas été rendue, le recours en annulation est possible puisque l’article 27 déclare
que le recours en annulation est recevable dès le prononcé de la sentence. Ce recours est
suspensif de l’exécution de la sentence. Il n’en va autrement que si la sentence est assortie
de l’exécution provisoire.35Le recours n’est ouvert que dans les six cas limitativement énu-
mérés à l’article 26 AUA et est porté devant le juge compétent de l’Etat partie.
Il faut noter que même si aucune disposition de l’AUA n’est consacrée aux effets de
l’annulation de la sentence, la question peut être posée de savoir si, une fois la sentence an-
nulée, les parties devront porter leur litige au fond devant le juge judiciaire, poursuivre l’ar-
bitrage commencé, avec les mêmes arbitres ou sans eux, si cette deuxième phase devra ou
non tenir compte de ce qui a déjà été accompli.
L’effet naturel d’une annulation est connu, c’est l’anéantissement rétroactif de l’acte et
donc le retour au statuquo ante comme l’enseigne le droit civil. En matière arbitrale, les
conséquences de la nullité vont varier selon un certain nombre d’éléments tels que la nature
de la convention d’arbitrage, la nature de la sentence ou le motif de l’annulation.
Conclusion
Le choix de l'arbitrage comme mode de règlement des litiges a pris une nouvelle dimension
dans l'espace OHADA avec l'adoption des textes y relatifs. L'arbitrage est un mode de rè-
glement des litiges dont le choix par les parties en conflit exclue la compétence du juge éta-
tique de l'affaire soumise à l'arbitrage. Le juge étatique perd son droit « naturel » de
connaitre le litige que les parties confient aux particuliers (arbitres). D’où son « refoule-
ment »; une sorte de rejet de la part des parties ayant fait le choix de l’arbitrage.
Il s'agit là certes d'un principe établi, mais qui admet de nombreux tempéraments.
Ceux-ci ouvrent des possibilités à l'intervention du juge étatique dans l'arbitrage d'où « la
sollicitation » du juge étatique.
34 Article 25 AU A.
35 Le contentieux de l’exécution provisoire est soumis au juge compétent de l’Etat partie. (Article 28
alinéa 2). Mais il faut relever que lorsqu’il est sollicité, le juge de l’Etat partie annule la sentence
sans statuer sur le fond.
405
https://doi.org/10.5771/2363-6262-2017-3-394, am 13.02.2023, 04:52:53
Open Access – - http://www.nomos-elibrary.de/agbTCHA-BOZIRE Fousseni
Le travail a donc consisté à démontrer que si le juge étatique semble a priori exclu du
débat, cela ne reste qu’un leurre. Le juge étatique n’est pas totalement exclu du débat. Il y
joue encore un rôle non moins important. Ce rôle est tantôt concurrentiel ou de coopération,
tantôt exclusif.
C’est pour tenir compte de ce constat que le travail a été envisagé à travers deux hypo-
thèses à savoir que d'une part, le juge étatique est a priori exclu partage du règlement du
litige; et d'autre part, il est sollicité pour jouer un rôle déterminant dans l'épanouissement de
l'arbitrage.
En effet, si le juge étatique n’est pas compétent pour juger le fond de litige lorsqu’il est
en présence d’une convention d’arbitrage,36 il est, toutefois, compétent pour rendre des me-
sures provisoires si le tribunal arbitral n’a pas été préalablement saisi. Il est également com-
pétent pour trancher le fond du litige si la clause compromissoire est nulle. Enfin, le juge
étatique est compétent si les parties n’ont pas soulevé son incompétence avant le débat au
fond et ont renoncé à soumettre le litige au tribunal arbitral.37
Il faut cependant relever que ces interventions du juge étatique ne sont admises qu’à des
endroits stratégiques, afin de faciliter la bonne marche de la procédure arbitrale et non pour
récupérer le litige dans son giron. L'arbitrage constituant une institution autonome, qui s'au-
to suffit sur le plan juridictionnel. Ses caractéristiques fondamentales rendaient nécessaire
cette intégration inédite à l'organisation judiciaire étatique.
Au total, l’arbitrage étant une discipline juridique à part entière, un secteur de l’écono-
mie non négligeable et même un champ de recherche sociale, comme l’a souligné à juste
titre le professeur Emmanuel Gaillard dans sa remarquable communication à l’Académie
des sciences morales et politiques, le17 octobre 2015, il vit aujourd’hui une vie qui lui est
propre. Mais, du fait même de son succès, il est devenu un enjeu de puissance et de prospé-
rité auquel les États (à travers le juge étatique) ne sauraient demeurer étrangers. Un équi-
libre délicat doit dès lors être recherché entre ces diverses considérations. C’est probable-
ment à travers les mécanismes d’intervention évoqués plus haut que cet équilibre peut être
atteint. C’est sans nul doute dans ce sens qu’il faudrait comprendre un auteur selon lequel,
« L'arbitrage ne peut avoir une force suffisante pour constituer un mode efficient de règle-
ment des litiges que si les systèmes juridiques étatiques lui accordent cette force ».38
36 C’est le cas également lorsque le tribunal a déjà été saisi du litige.
37 B. Y. MEUKE, op. cit.
38 Jacques BÉGUIN, «Le droit français de l'arbitrage international et la Convention de New York du
10 juin 1958», dans Nabil ANTAKI et Alain PRUJINER (dir), L'arbitrage commercial international,
Actes du 1er colloque, Montréal, 1986, 224.
406 KAS African Law Study Library – Librairie Africaine d’Etudes Juridiques 4 (2017)
https://doi.org/10.5771/2363-6262-2017-3-394, am 13.02.2023, 04:52:53
Open Access – - http://www.nomos-elibrary.de/agbVous pouvez aussi lire