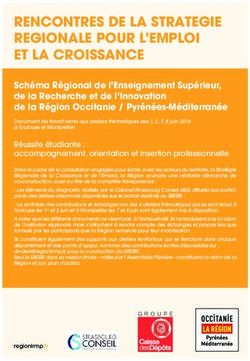RECHERCHE ET INNOVATION : RELEVER LE DEFI DE LA COHERENCE
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
RECHERCHE ET INNOVATION :
RELEVER LE DEFI DE LA COHERENCE
MEMOIRE TRANSMIS AU
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DE L’INNOVATION
DANS LE CADRE DE LA
CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA
STRATEGIE QUEBECOISE DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 2022
14 MAI 2021Table des matières
Préambule ................................................................................................................................................... 2
1. La Stratégie québécoise de recherche et d’innovation ............................................................................. 2
2. La SQRI 2017-2022 ................................................................................................................................. 3
3. Le fardeau administratif ........................................................................................................................... 5
4. La commercialisation de l’innovation ........................................................................................................ 7
5. L’attraction des talents et la pénurie de main-d’œuvre ........................................................................... 11
6. L’utilisation responsable des données ................................................................................................... 13
7. L’accès aux contrats publics .................................................................................................................. 14
Conclusion ................................................................................................................................................. 15
1PREAMBULE
Grâce à son vaste réseau de plus de 130 chambres de commerce et de 1 100 entreprises établies au Québec,
la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant
leurs activités dans tous les secteurs de l’économie et sur l’ensemble du territoire québécois.
Considérée comme le plus important réseau de gens d’affaires et d’entreprises au Québec, la FCCQ est à la
fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Elle défend les
intérêts de ses membres au chapitre des politiques publiques, favorisant ainsi un environnement d’affaires
innovant et concurrentiel, respectueux des principes de développement durable.
À ces fins, la FCCQ se fait un devoir de participer aux débats publics et de formuler des recommandations sur
les enjeux politiques, économiques et sociaux qui font les manchettes de même que sur les enjeux qui
préoccupent ses membres.
1. LA STRATEGIE QUEBECOISE DE RECHERCHE ET D’INNOVATION
La Stratégie québécoise de recherche et d’innovation (SQRI) actuelle ayant été présentée en 2017 et prenant
fin en 2022, le ministère de l’Économie et de l’innovation a lancé une consultation publique en vue l’élaboration
de la prochaine édition de la SQRI. Chaque nouvelle édition de cette stratégie constitue une étape importante
dans l’évolution des politiques gouvernementales en matière de recherche et d’innovation. Cette année,
l’objectif visé par le gouvernement du Québec est « d'identifier les meilleures pratiques, les solutions
novatrices et les avenues les plus porteuses, pour favoriser la création de richesse au Québec à partir des
activités de recherche et d’innovation ».
La FCCQ compte parmi ses membres de nombreuses entreprises directement concernées par la SQRI,
notamment dans les secteurs des technologies de l’information (TI), du manufacturier et des sciences de la
vie. La FCCQ appuie ses différents membres qui participent, en leur nom individuel ou via leur association
sectorielle, à la présente consultation publique. Cependant, nous considérons important de présenter un
mémoire qui rassemble certaines priorités qui nous apparaissent incontournables et qui sont communs à
l’ensemble des secteurs économiques visés par les mesures de la SQRI.
22. LA SQRI 2017-2022
L’objectif global de la SQRI 2017-20221 était de positionner, d’ici 2022, le Québec dans le « top 10 » de
l’OCDE en Recherche et Innovation (R&I). De manière plus spécifique, la SQRI 2017-2022 déclinait cet
objectif en trois axes d’intervention :
a) Développer les talents, les compétences et la relève
La cible retenue pour cet axe était d’améliorer la place du Québec (5e rang) au Canada en ce qui concerne le
poids relatif du nombre de travailleurs ayant complété des études universitaires (employés du secteur privé et
public) par rapport au nombre total de personnes en emploi. Les mesures associées à cet objectif sont liées à
l’enseignement des sciences, à la promotion des carrières scientifiques et à l’appui financier aux chercheurs.
b) Accroître la capacité de recherche du Québec et soutenir l’innovation sous toutes leurs formes
Les cibles retenues pour cet axe étaient d’améliorer la place du Québec (10e rang) dans les dix premiers
rangs au classement de l’OCDE en ce qui concerne le nombre de personnes en recherche et en
enseignement supérieur par milliers de personnes actives et le nombre de personnes en recherche et
développement en entreprise par milliers de personnes actives. Les mesures associées concernent le
financement des regroupements de chercheurs, le nouveau programme Innovation du MEI, les crédits d’impôt
pour la R&D, le soutien financier aux grands projets de recherche et les investissements dans les
infrastructures de recherche.
c) Accélérer et amplifier le transfert et la commercialisation des innovations
Les cibles retenues pour cet axe étaient de hisser le Québec (12e rang) dans les dix premiers rangs au
classement de l’OCDE en ce qui concerne les investissements des entreprises en technologies de
l’information et des communications en pourcentage du produit intérieur brut ainsi que d’améliorer la place du
Québec (4e rang) au Canada en ce qui concerne le pourcentage d’entreprises innovantes (celles effectuant
l’un des quatre types d’innovations : de produits, de procédés, organisationnelle ou de commercialisation). Les
mesures associées concernent l’appui à QuébecInnove, aux grappes industrielles et à Startup Québec, le
programme Premier brevet, l’initiative Manufacturier innovant, la Stratégie PerforME, l’utilisation des achats
publics comme vitrines technologiques.
La FCCQ avait accueilli positivement les orientations de la SQRI 2017-20222, notamment parce qu’un pan
complet était destiné à la commercialisation des innovations. Cet enjeu crucial était au cœur du mémoire
présenté par la Fédération lors des consultations tenues en 2016, intitulé Du transfert technologique à la
commercialisation de l’innovation – Vers un système d’innovation plus intégré et plus productif.
Il est cependant ardu de réaliser un bilan quantitatif et objectif de la stratégie actuelle puisque le choix des
cibles retenues s’y prête mal. L’objectif global était basé sur une appréciation subjective de 10 indicateurs où
le Québec se situait entre le 3e et le 20e rangs entre 2013 et 2015. Ces données ne sont donc pas mises à
jour au même rythme les unes par rapport aux autres et il est hasardeux de tenter de les combiner en un « top
10 » sans d’abord les pondérer pour établir quelles mesures sont plus importantes.
1
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE LA SCIENCE ET DE L’INNOVATION, Oser innover : Stratégique québécoise de la recherche et de l’innovation
2017-2022, 2017, https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/economie/publications-adm/politique/PO_SQRI_2017-
2022_MEI.pdf?1568820440
2
FCCQ, Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation (SQRI) 2017-2022 : Vers un système d’innovation plus intégré et productif, 12 mai
2017, https://www1.fccq.ca/strategie-quebecoise-de-la-recherche-et-de-linnovation-sqri-2017-2022-vers-un-systeme-dinnovation-plus-integre-et-
productif/
3Recommandation 1
Baser les objectifs de la SQRI sur des cibles quantitatives transparentes en indiquant clairement le résultat à
atteindre, comment ce résultat sera calculé et à quel moment ce calcul devrait être réalisé, afin de permettre
aux chercheurs, au milieu économique et à l’ensemble de la population d’en mesurer l’atteinte ou non.
43. LE FARDEAU ADMINISTRATIF
À l’heure actuelle, une douzaine de programmes, de mesures fiscales et d’autres interventions
gouvernementales sont en place dans le cadre de la SQRI. Règle générale, ces programmes sont appréciés
des entreprises qui en bénéficient. La difficulté réside davantage, comme c’est souvent le cas en ce qui
concerne les programmes gouvernementaux, dans la facilité d’accès à ces programmes. Les sections
suivantes de notre mémoire aborderont des enjeux et recommandations précis concernant les mesures d’aide
aux entreprises, mais le principe général qui devrait guider la révision de ces programmes est de les faire
connaitre auprès des entreprises et de tendre vers davantage de flexibilité dans leurs critères d’accès.
En ce qui concerne la connaissance des programmes disponibles, les entrepreneurs s’attendent à ce que la
mise en commun de la force de frappe d’Investissement Québec (IQ) et du ministère de l’Économie et de
l’Innovation (MEI), à la suite de l’adoption de la Loi 27, amène une amélioration significative de la
compréhension. La réduction du nombre de portes auxquelles un entrepreneur doit cogner pour obtenir des
informations sur l’aide que peut lui apporter l’État dans la réalisation de ses projets de recherche et
d’innovation, est la bienvenue. L’étape suivante est de s’assurer que IQ et le MEI entreprennent eux-mêmes
davantage de démarches pour faire connaître leur offre de services liée à la SQRI auprès d’entreprises qui n’y
sont pas familières.
À cet égard, les chambres de commerce, incluant les jeunes chambres, sont particulièrement bien
positionnées pour faciliter le maillage entre les experts et conseillers, et les entreprises des différentes régions
qui pourraient bénéficier de soutien dans leurs efforts de recherche et d’innovation.
Recommandation 2
Consacrer davantage de ressources (humaines et financières) à la diffusion proactive d’information sur les
différents programmes issus de la SQRI auprès des milieux d’affaires, notamment via le réseau des chambres
de commerce.
La FCCQ a contribué à l’élaboration du Plan d’action gouvernemental en matière d’allègement réglementaire
et administratif 2020-20253 qui contient justement plusieurs mesures concrètes qui, une fois mises en place,
pourraient répondre aux objectifs recherchés. La prochaine SQRI doit donc impérativement être élaborée en
conformité avec ce plan d’action atténuer les irritants liés au fardeau bureaucratique qui nuit à l’efficacité des
interventions gouvernementales.
Ainsi, le gouvernement s’est engagé à mettre en place les mesures suivantes au sein du Plan :
Mesure 10
Développer un parcours afin que les entreprises, dans le secteur de la transformation agroalimentaire et
dans tous les autres secteurs, puissent inscrire une seule fois leurs informations qui seront transmises à
travers les différents ministères et organismes lors d’une demande auprès du gouvernement.
Conformément à la décision du Conseil des ministres prise dans le cadre du présent plan d’action, chaque
ministère et organisme devra présenter un échéancier pour être présent sur le guichet unique du
gouvernement. Centraliser le dossier de l’entreprise avec tous les documents déposés d’une entreprise,
commun à tous les ministères et organismes.
Horizon de réalisation : Hiver 2024
3
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DE L’INNOVATION, Moins de paperasse – Pour une relance innovante et efficace : Plan d’action gouvernemental
en matière d’allègement réglementaire et administratif 2020-2025, janvier 2021 https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-
contenu/adm/min/economie/publications-adm/plans-action/PL-plan-action-allegement-2020-2025.pdf
5Mesure 42
Développer un parcours afin d’éliminer des étapes lors des démarches des entreprises avec le
gouvernement.
Horizon de réalisation : Hiver 2025
Mesure 46
Confier à un groupe de travail interministériel le mandat de recenser les obstacles réglementaires et
administratifs à l’émergence et à la mise en œuvre de nouvelles technologies et de modèles d’affaires
innovants par les entreprises. Le groupe de travail :
• sera présidé par le secteur de la science et de l’innovation du ministère de l’Économie et de
l’Innovation ;
• sera composé des ministères et organismes concernés par l’innovation ;
• devra déposer un rapport d’étape à l’automne 2021 et un rapport final en juin 2022.
Horizon de réalisation : Automne 2021 (rapport d’étape) et juin 2022 (rapport final)
Recommandation 3
Intégrer dans la SQRI les mesures 10 et 42 du Plan d’action gouvernemental en matière d’allègement
réglementaire et administratif 2020-2025 afin de réduire la quantité de renseignements à fournir lors de
demandes d’aide lorsque ces renseignements ont déjà été transmis au gouvernement et d’éliminer des
étapes lors de ces mêmes démarches auprès du gouvernement.
Recommandation 4
S’engager dans la prochaine SQRI à réduire de manière significative les obstacles à l’innovation qui auront
été identifiés dans le rapport du groupe de travail interministériel formé en lien avec la mesure 46 du Plan
d’action gouvernemental en matière d’allègement réglementaire et administratif 2020-2025; à cet effet, des
actions concrètes devront être identifiées et assorties d’un échéancier de réalisation.
Un autre enjeu qui contribue malheureusement au fardeau administratif est le délai de traitement des dossiers
par les différents ministères et organismes. Là aussi, les entreprises œuvrant en recherche et en innovation ne
sont pas à l’abri de cela. Présentement, une PME qui utilise le programme de crédits d’impôt sur la R&D du
Québec peut attendre jusqu’à 18 mois après la fin d'année financière pour recevoir le remboursement qui lui
est dû. Cela crée un manque de liquidité qui peut être difficile à supporter pour les entreprises qui doivent
s’assurer de maintenir les liquidités à flot.
Recommandation 5
Améliorer significativement l’administration du programme de crédits d’impôt sur la R&D au Québec en
facilitant l’accès aux remboursements rapides, en réduisant au maximum les délais.
64. LA COMMERCIALISATION DE L’INNOVATION
Tel qu’indiqué précédemment, cet enjeu crucial était au cœur du mémoire présenté par la Fédération lors des
consultations tenues en 2016, intitulé Du transfert technologique à la commercialisation de l’innovation – Vers
un système d’innovation plus intégré et plus productif.4 Nos priorités étaient alors les suivantes :
• Multiplier les relations entre l’entreprise et les milieux de l’enseignement, au niveau collégial et
universitaire, notamment en favorisant l’émergence de centre de formation au sein même des
entreprises.
• L’enseignement et la recherche publique plus actifs au sein du système d’innovation
• Intensité de la R-D et technologies manufacturières
• Un système d’innovation plus intégré
• Connexion des acteurs :
o Incubation de l’innovation
o Valorisation par la propriété intellectuelle
o Plus de vitrines de commercialisation
La réforme d’Investissement Québec, incluant le rôle accru accordé à IQ International ainsi que l’intégration du
Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) à IQ, s’inscrit dans l’esprit de ces priorités. Le milieu des
affaires s’attend maintenant à ce que le gouvernement poursuive dans cette lancée et bonifie son action en
matière de soutien à la commercialisation de l’innovation.
D’abord, pour demeurer compétitives et améliorer leur productivité, les entreprises doivent innover et investir
dans de nouvelles technologies. Toutefois, il appert que l’aspect financier apparaît comme un frein majeur à
l’investissement en nouvelles technologies pour plusieurs entreprises. Les entreprises sont conscientes de la
révolution en cours, mais doivent être davantage soutenues afin de pouvoir faire l’acquisition des nouvelles
technologies. Il est important d’agir rapidement pour favoriser l’investissement privé et la transition vers le 4.0.
Une façon de favoriser ce virage est simplement de subventionner l’intégration, par les entreprises, de
technologies existantes, comme le fait le crédit d’impôt pour l’intégration des technologies de l’information (TI).
Toutefois, l’aide fiscale à cette fin représente une fraction de celle accordée à la recherche scientifique et au
développement expérimental (RS&DE). D’ailleurs, les crédits d’impôt RS&DE ont fait leurs preuves et la FCCQ
appuie leur maintien.
Recommandation 6
Maintenir et reconduire les principales mesures fiscales favorisant l’innovation, notamment :
- Le crédit d’impôt pour l’intégration des technologies de l’information
- Les crédits d’impôts relatifs à la recherche scientifique et au développement expérimental
- Le crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques
Cependant, dans le but ultime d’augmenter la productivité, l’intégration par les entreprises de technologies
existantes, même sans véritable R&D, est une stratégie presque aussi valable que la R&D au sens strict. Plus
de la moitié de la R-D réalisée provient du secteur manufacturier. L’enjeu de base, à traiter en priorité, pour la
relance du secteur manufacturier est la carence en valeur ajoutée et en intensité technologique des produits
québécois
4
FCCQ, Du transfert technologique à la commercialisation de l’innovation : Vers un système d’innovation plus intégré et plus productif, novembre 2016,
https://www1.fccq.ca/wp-content/uploads/2017/08/Positionnement_FCCQ_Commercialisation-innovation.pdf
7D’autres mesures fiscales complémentaires aux programmes de RS&DE pourraient permettre d’accélérer
l’adoption de technologies existantes afin d’améliorer significativement la productivité des entreprises. Par
exemple, la création d’un « matching fund » gouvernemental qui octroierait automatiquement des fonds en
fonction d’un ratio des dollars investis ou sur une base de retour sur investissement pour le gouvernement
pourrait favoriser l’atteinte de cet objectif, tout comme l’ajout d’incitatifs à la commercialisation à l’intérieur des
programmes d’aide existants.
Recommandation 7
Instaurer un programme de « matching fund » gouvernemental pour les investissements en innovation, afin
notamment, d’accélérer l’adoption de technologies existantes chez les entreprises.
Recommandation 8
Bonifier les programmes d’aide existants de la SQRI en ajoutant des incitatifs liés au recours à des plans
d’innovation, des services d’intelligence économique et des analyses de marché.
Un autre aspect important en matière de commercialisation est la protection de la propriété intellectuelle
développée par nos entreprises ainsi que la conformité normative de nos produits innovants. Beaucoup
d’entreprises développent des produits innovants sans envisager l’intérêt de la certification des produits et de
l’investissement en protection des droits de propriété intellectuelle. Cela réduit leurs capacités de
commercialisation tout en privant les entreprises québécoises d’une protection à l’égard des tiers. Cela peut
également priver les entreprises québécoises de sources de revenus, puisque les entreprises innovantes
peuvent d’obtenir des redevances en contrepartie de licence d’exploitation des droits de propriété
intellectuelle. Cette problématique est associée à un manque de ressources, d’expertise et d’information.
Cet enjeu est particulièrement important lorsqu’il est question d’accéder aux marchés internationaux, ce qui est
directement lié à une autre stratégie gouvernementale avec laquelle la SQRI devra s’arrimer : le Plan d’action
pour la relance des exportations (PARE)5 présenté au printemps 2021 par le gouvernement du Québec. Le
processus d’exportation est semé d’embûches pour les entrepreneurs, d’autant plus que les pratiques
commerciales peuvent différer selon les pays. Le réseau d’IQ International et du ministère des Relations
internationales et de la Francophonie, incluant les délégations du Québec à l’étranger, peuvent jouer un rôle-
clé pour aider les innovations québécoises à faire leur place à travers le monde.
Recommandation 9
Renforcer les mesures incitant le recours à la protection de droits de propriété intellectuelle et l’octroi de
licences commerciales en vue de consolider et de diffuser les résultats de l’innovation.
Recommandation 10
Assurer la cohérence de la SQRI avec le Plan d’action pour la relance des exportations, notamment en
améliorant l’accompagnement des entreprises innovantes sur les marchés d’exportation et valorisant le rôle
du Bureau de normalisation du Québec (BNQ) et des autres organismes de certification québécois en ce qui
a trait à la conformité normative sur les marchés à l’exportation.
5
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DE L’INNOVATION, Fait au Québec, exporté dans le monde : Plan d’action pour la relance des exportations, mars
2021, https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/economie/publications-adm/plans-action/PL_plan_action_relance_exportations_MEI-2021-
03.pdf?1616602668
8Le « bac à sable réglementaire » (regulatory sandbox) est un concept développé dans l’industrie des services
financiers, fortement réglementée, mais qui s’applique aussi à la plupart des industries réglementées. Il s’agit
de permettre à des entreprises innovantes de tester dans le marché des produits, des services, des modèles
économiques ou des modes de distribution innovants, qui dérogent aux cadres réglementaires existants. Le
test de marché se fait sous la supervision du régulateur sectoriel. Les clients sont avertis au préalable qu’ils ne
sont pas protégés par la totalité des règlements existants.
Ce procédé favorise l’innovation et la compétition, réduit le délai pour amener des innovations au marché et
facilite l’accès des entreprises innovantes au capital de risque. Le test de marché permet de mieux distinguer,
dans la réglementation existante, les composantes qui sont essentielles à la protection des consommateurs ou
la sécurité des travailleurs de celles qui constituent surtout des barrières à l’entrée protectionnistes ou
corporatistes. Le projet pilote réalisé avec Uber, de 2016 à 2019, peut être vu comme une forme de bac à
sable réglementaire avant l’adoption et l’entrée en vigueur du projet de loi 17 réformant l’industrie du taxi.
Le « bac à sable réglementaire » peut donc être compté parmi les outils dans le coffre d’un « champion des
innovateurs ». Il pourrait être utilisé pour différents secteurs économiques
Recommandation 11
La FCCQ recommande au ministre de recourir au concept de bac à sable réglementaire dans les marchés
dont il est le régulateur (ex : vente d’alcools produits localement) et d’encourager ses collègues à faire de
même dans ceux sous leur responsabilité.
Enfin, le projet de zones d’innovation est au cœur de la vision économique du gouvernement du Québec, qui
vise à augmenter la productivité du Québec se situant en deçà, depuis plusieurs décennies, du Canada et de
l’OCDE.
Une piste importante de solution passe par des zones d’innovation axées plutôt sur le développement et la
commercialisation de nouveaux produits, en misant sur la collaboration entre la recherche universitaire et les
entreprises, avec l’appui des gouvernements. Il y a un large consensus émanant de la performance de telles
zones, bien connues en Europe et aux États-Unis, soit que les zones d’innovation contribuent à
l’accroissement de la productivité et à l’essor économique. Cependant, pour réussir, ces zones doivent
satisfaire un certain nombre de facteurs de succès clés. Ces facteurs incluent :
✓ La compétence de base : il doit exister une raison économique pour les zones – une activité
économique dans laquelle la région se démarque d’emblée et développe sa force concurrentielle;
✓ Les ressources humaines et la formation : les exigences pour réussir nécessitent un leadership fort, des
chercheurs hautement qualifiés axés sur les enjeux de développement des entreprises et une main-
d’œuvre formée ayant accès à la formation continue, ce qui requiert un maillage serré avec les
instances éducatives;
✓ Une demande sophistiquée : un des enjeux les plus souvent cités pour expliquer le manque de
productivité de nos entreprises est la faible demande pour intégrer les innovations dans les entreprises.
Les nouveaux produits et services doivent trouver un marché. Ce marché peut être domestique, stimulé
par des appels d’offres des gouvernements misant sur l’innovation, ou encore à l’échelle nationale ou
internationale, appuyé par un accompagnement du gouvernement;
✓ L’accès au financement : les entreprises en démarrage ont besoin d’un soutien financier. Le
financement est également nécessaire pour l’infrastructure des zones, incluant bureaux, laboratoires,
etc.;
9✓ L’investissement en infrastructure : les actifs physiques et les équipements publics tels que les
aéroports, les routes, les installations portuaires, l’Internet haute vitesse, les logements et le parc
immobilier constituent la base d’une zone d’innovation;
✓ L’environnement réglementaire : des processus lourds pour l’obtention de permis peuvent ralentir, voir
même freiner, le développement de zones d’innovation;
✓ La culture : la culture requise pour l’épanouissement d’une zone d’innovation nécessite une culture
d’entreprise et de recherche et des infrastructures physiques qui favorisent le partage des idées ainsi
qu’un mode de vie qui attire des personnes de calibre mondial.
Recommandation 12
La FCCQ recommande que le gouvernement s’assure de la mise en place des mesures législatives et
réglementaires pour assurer la mise en œuvre des facteurs nécessaires au succès des zones d’innovation.
105. L’ATTRACTION DES TALENTS ET LA PENURIE DE MAIN-D’ŒUVRE
La pénurie de main-d’œuvre a continué de s’aggraver en 2020, malgré le contexte de la crise de la COVID-19.
Selon la plus récente étude de l’Institut du Québec, « au quatrième trimestre de 2020, le nombre de postes
vacants s'est élevé à 148 460, en hausse de 21 730 par rapport au quatrième trimestre de 2019, soit un an
plus tôt. »6 Au-delà du nombre de postes vacants lui-même, il est important de souligner que la situation était
déjà critique au quatrième trimestre de 2019, avant la pandémie. Cette pénurie est loin d’épargner les secteurs
économiques à forte intensité de R&I, notamment le secteur des technologies de l’information. Le Québec a
atteint le point où des projets d’innovation sont freinés par le manque de travailleurs spécialisés qui pourraient
les mener à bien.
Dans la SQRI 2017-2022, cet enjeu était abordé essentiellement sous l’angle de la formation, par exemple en
incitant les élèves à se diriger vers les champs d’étude et les carrières dits « STEM » (science, technologie,
ingénierie et mathématiques) et en augmentant le financement alloué à la recherche universitaire. La FCCQ
souhaite voir ces mesures être maintenues et prolongées, tout en constatant qu’elles ne suffisent pas à
combler la demande croissante pour des travailleurs qualifiés et spécialisés.
Il s’agit d’ailleurs d’une problématique généralisée qui date d’avant la pandémie. Le nombre de travailleurs
qualifiés admis est en baisse depuis 2012. Le Québec n'en a jamais reçu aussi peu depuis au moins 2006.
Force est de constater que la politique d'immigration n'a pas suivi l'évolution du besoin économique et s'est
plutôt inscrite dans le sens contraire, exacerbant les difficultés de recrutement des entreprises. Aux yeux de la
FCCQ, on doit faire mieux et agir rapidement en facilitant l’arrimage des candidats à l’immigration et les
entreprises en recherche de main-d’œuvre tout en diminuant de façon importante les délais de traitement des
demandes.
Comme la FCCQ l’a déjà indiqué lors des consultations sur la Planification de l’immigration 2020-20227, nous
demandons de hausser le niveau moyen des admissions de travailleurs qualifiés nombre total de manière à
atteindre un niveau maximum d'admissions de près de 60 000 à la fin de la période de planification, en 2022.
Cette augmentation devrait se faire en tenant constants les niveaux planifiés pour les autres catégories
d'immigration, soit le seuil d'immigration permettant d'éviter une baisse de la population de 20-64 ans en deçà
du niveau de 2011. Il s'agit aussi du seuil global que préconise la FCCQ.
Dans le cas précis des travailleurs spécialisés dont ont besoin les entreprises afin de réaliser leurs projets de
recherche et d’innovation, l’élargissement du Programme pilote d'immigration permanente des travailleurs de
l'intelligence artificielle, des technologies de l'information et des effets visuels8 doit être rapidement envisagée,
puisque la limite de 550 personnes par année risque de s’avérer nettement insuffisante pour combler la
demande. L’accélération et la simplification des procédures d’immigration doit également faire partie de la
solution, toujours en cohérence avec le plan d’action gouvernemental en matière d’allègement administratif.
Recommandation 13
Hausser le nombre de travailleurs qualifiés admissibles à l’immigration au Québec afin de contribuer à
résorber la pénurie de main-d’œuvre et simplifier les démarches administratives imposées aux demandeurs et
aux employeurs dans le cadre du processus de sélection de travailleurs qualifiés.
6
INSTITUT DU QUÉBEC, Marché du travail au Québec : Éclairage sur l’emploi et les postes vacants au 4e trimestre 2020,
https://institutduquebec.ca/wp-content/uploads/2021/03/202103-IDQ-POSTES-VACANTS-1.pdf
7
FCCQ, Immigration : des objectifs ambitieux à la hauteur de nos moyens, https://www1.fccq.ca/wp-content/uploads/2019/08/19-08-13-
M%C3%A9moire-planification-de-limmigration-2020-2022_Final.pdf
8
https://www.quebec.ca/immigration/programmes-immigration/intelligence-
artificielle#:~:text=Ce%20programme%20pilote%20permet%20de,secteur%20des%20technologies%20de%20l'
11Recommandation 14
Élargir le Programme pilote d'immigration permanente des travailleurs de l'intelligence artificielle, des
technologies de l'information et des effets visuels afin d’accueillir davantage de travailleurs de ces secteurs et
envisager la création d’un programme similaire pour les travailleurs d’autres secteurs comme le manufacturier
innovant et les sciences de la vie.
La pénurie de main-d’œuvre doit également forcer le gouvernement à revoir les critères de certains de ces
programmes, notamment dans le cadre de la SQRI. Plusieurs programmes d’aide financière destinés aux
entreprises considèrent le nombre d’emplois créé comme étant un facteur important dans l’analyse du projet.
Or, en contexte de pénurie de main-d’œuvre, ce critère devient de plus en plus difficile à remplir, puisque, trop
souvent, les travailleurs potentiels ne sont tout simplement pas au rendez-vous lors de créations de postes.
Là encore, il serait important d’agir avec cohérence. Le gouvernement souhaite que les entreprises
augmentent leur productivité en passant au manufacturier 4.0. Or, si les entreprises augmentent
l’automatisation et la robotisation afin d’être plus productives et qu’elles investissent des sommes
considérables dans l’atteinte de cet objectif, il est difficile de s’engager du même souffle à créer des emplois!
Recommandation 15
Réviser les critères et les grilles d’analyse des programmes gouvernementaux afin de favoriser les projets
innovants qui contribuent à la pérennité des entreprises et des emplois qu’elles génèrent, plutôt que de viser
la création d’emplois pour lesquels la main-d’œuvre qualifiée n’est pas disponible.
126. L’UTILISATION RESPONSABLE DES DONNEES
Au moment où se tient la consultation publique sur la SQRI 2022, l’Assemblée nationale procède à l’étude
détaillée du projet de loi 64, Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des
renseignements personnels. Le Québec est donc en voie de se doter d’un cadre législatif et réglementaire très
strict avec comme objectif d’accroitre la confiance du citoyen quant à l’utilisation qui est faite de ses données
personnelles, tant par l’État que par l’entreprise privée.
Sans présumer du libellé final de ce projet de loi et de son adoption, il apparaît tout de même clair qu’un
encadrement qui permettrait de donner confiance au public tout en n’entravant pas indûment le
développement de nos entreprises qui valorisent les données devrait être pris en compte dans la SQRI. Il
s’agirait d’un changement de paradigme qui pourrait avoir des conséquences importantes dans plusieurs
secteurs innovants de notre économie.
Dans le secteur des sciences de la vie, l’enjeu de l’accès aux données du réseau québécois de la santé et des
services sociaux, notamment celles de la Régie de l’assurance-maladie du Québec (RAMQ), a soulevé la
controverse récemment et mérite d’être replacé dans son contexte. Dès 1992, l’Ontario s’est dotée de ce qui
est aujourd’hui l’Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES), un centre de recherche chargé d’étudier des
questions de santé en valorisant les données administratives de santé du gouvernement ontarien. Comme le
faisaient remarquer dans une publication récente les chercheures Catherine Haeck et Marie Connolly, le
Québec a une longueur de retard en cette matière :
« Au Québec, certains groupes de chercheurs ont des accès privilégiés aux données administratives de la
santé, quoique rien n’ait l’ampleur de l’ICES. […] Le Québec doit miser sur ses expertises en recherche et
utiliser de manière démocratique le fort potentiel des données administratives réparties dans ses différents
ministères pour répondre à des questions qui touchent directement le bien-être de sa population. »9
Il est donc impératif de recadrer le débat et de faire de l’utilisation des données un projet enthousiasmant pour
la société québécoise. En ce sens, la SQRI constitue une occasion en or : bien encadrée, cette utilisation
permettrait aux groupes de chercheurs ainsi qu’aux entreprises innovantes du secteur des sciences de la vie
de mener des recherches débouchant sur de nouveaux traitements et de nouvelles technologies médicales, au
bénéfice de la population québécoise.
Recommandation 16
Favoriser l’utilisation responsable et la valorisation des données anonymisées du réseau québécois de la
santé et des services sociaux dans le cadre de projets privés de recherche et d’innovation.
En plus du projet de loi 64, le gouvernement réfléchit actuellement à l’élaboration d’une stratégie québécoise
en matière d’intelligence artificielle (IA), un autre secteur économique en pleine croissance qui tourne autour
de l’utilisation de données.
Recommandation 17
Arrimer la prochaine SQRI et la future Stratégie IA afin d’assurer leur complémentarité et d’éviter les
dédoublements.
9
Point de vue : L’accessibilité aux données des administrations publiques, dans « Le Québec économique 9 : Perspectives et défis de la transformation
numérique », 13 janvier 2021
137. L’ACCES AUX CONTRATS PUBLICS
Les contrats publics du gouvernement du Québec avoisinent annuellement les 12 G$. Recourir aux produits et
aux services des entreprises québécoises innovantes représente une occasion à ne pas manquer pour l’État
québécois de faire des dépenses publiques un véritable levier de développement économique. De nombreux
exemples ont démontré au cours des dernières années que le critère du plus bas prix conforme oblige les
soumissionnaires à limiter les actions de planification, à choisir les matériaux et les technologies les plus
traditionnels, à ne pas tenir vraiment compte de la durabilité du produit et des frais d’entretien subséquents. Il
constitue donc un frein important à l’innovation et, surtout, à la commercialisation de l’innovation.
Par exemple, en matière de réfection et de construction de bâtiments gouvernementaux, qu’il s’agisse
d’écoles, d’hôpitaux ou de bureaux administratifs, les entreprises québécoises développent de nouvelles
techniques de construction plus durables et de nouvelles technologies d’immotique. Intégrer ces innovations
dans une soumissions en augmente le prix à court terme, mais augmente la performance du bâtiment et sa
durabilité. Il en va de même des contrats publics dans des secteurs aussi variés que les systèmes
informatiques et la cybersécurité ainsi que les équipements médicaux et produits pharmaceutiques : l’option la
moins chère et l’option la plus innovante sont souvent différentes. Dans ces deux grands secteurs, la FCCQ
avait d’ailleurs plaidé pour une plus grande importance à accorder aux critères d’innovation et de qualité dans
son mémoire sur le projet de loi 3710.
Cette importance accordée à la notion du plus bas soumissionnaire par le gouvernement du Québec dans
l’octroi des contrats publics figure parmi les préoccupations les plus importantes entendues chez les
entreprises, depuis maintenant plusieurs années. La FCCQ est intervenue à plusieurs reprises dans la
dernière année afin de rappeler cette préoccupation, notamment dans le cadre des consultations sur les
projets de loi 6111, 6612 et 7213.
Conséquemment, les propos récents de la présidente du Conseil du trésor, Sonia Lebel, qui a affirmé
« travailler dans l’option de déposer un éventuel projet de loi »14 afin d’inclure des critères environnementaux
dans les appels d’offres du gouvernement suscitent donc passablement d’espoir de la part du milieu des
affaires québécois. La FCCQ réclame une telle action depuis de nombreuses années et encourage le
gouvernement à poursuivre dans cette voie.
D’ailleurs, le secteur privé a déjà franchi ce pas : un nombre croissant de manufacturiers qui agissent comme
fournisseurs ou comme sous-traitants pour des entreprises de plus grande taille se font déjà demander d’où
proviennent leurs matières premières afin de respecter les critères environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG) de ces grandes entreprises. La prochaine étape prévisible sera de devoir se soumettre à
une évaluation de l’empreinte carbone de leurs activités dans le cadre de ce genre d’octroi de contrats privés.
10
FCCQ, Pour que les achats gouvernementaux deviennent un levier d’innovation et de développement économique - Projet de loi no 37 :
commentaires de la FCCQ, octobre 2019, https://www1.fccq.ca/wp-content/uploads/2019/10/M%C3%A9moire-PL-37-Favoriser-linnovation-et-le-
d%C3%A9veloppement-%C3%A9conomique-VF.pdf
11
FCCQ, Consultations particulières sur le projet de loi n° 61 : La FCCQ insiste pour diminuer l’importance du plus bas soumissionnaire et prévoir un
quota minimum de contenu québécois dans les appels d’offres publics, juin 2020, https://www1.fccq.ca/consultations-particulieres-sur-le-projet-de-loi-n-
61-la-fccq-insiste-pour-diminuer-limportance-du-plus-bas-soumissionnaire-et-prevoir-un-quota-minimum-de-contenu-quebecois-dans-les-a/
12
FCCQ, Consultations particulières sur le projet de loi n° 66: La FCCQ souligne la nécessité d’accélérer les projets d’infrastructure et réitère
l’importance d’autres éléments pour stimuler la relance économique, octobre 2020, https://www1.fccq.ca/consultations-particulieres-sur-le-projet-de-loi-
n-66-la-fccq-souligne-la-necessite-daccelerer-les-projets-dinfrastructure-et-reitere-limportance-dautres-el/
13
FCCQ, Un coup de pouce important pour la restauration… et l’occasion d’aller encore plus loin!, novembre 2020, http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-
parlementaires/commissions/CI/mandats/Mandat-43781/memoires-deposes.html
14
BERGERON, Patrice, Appels d’offres – Le gouvernement songe à imposer des critères écologiques, 30 mars 2021,
https://www.lapresse.ca/actualites/2021-03-30/appels-d-offres/le-gouvernement-songe-a-imposer-des-criteres-ecologiques.php
14Si l’importance des critères environnementaux n’est plus à démontrer, il en est de même pour les critères
d’innovation, comme pour ceux de qualité, d’expertise et de durabilité. Tous ces éléments contribuent favoriser
nos entreprises les plus performantes et sont de nature à inciter l’ensemble des entreprises à améliorer leurs
produits et leurs services, ce qui contribue ensuite à les rendre plus compétitives dans les autres marchés où
elles sont présentes.
Par ailleurs, la FCCQ tient à rappeler qu’au-delà de ce qui est permis ou non par les lois et règlements en
matière d’octroi de contrats, c’est souvent leur application qui pose un problème pour les entreprises. La
révision de la LCOP doit être accompagnée d’un signal clair envoyé aux ministères et organismes ainsi qu’aux
municipalités : ils doivent mettre pleinement en œuvre les dispositions qui permettent de rendre plus
intelligents leurs appels d’offres. L’innovation doit devenir un objectif commun qui se reflète dans l’ensemble
de nos stratégies d’approvisionnement gouvernementales.
Recommandation 18
Revoir la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) afin que le plus bas prix conforme ne soit plus le
critère principal d’évaluation dans l’octroi des contrats publics et s’assurer que le choix des soumissionnaires
mise d’abord et avant tout sur la valeur globale, incluant des critères de qualité, d’innovation, d’expertise et de
durabilité des solutions proposées ainsi que la garantie sur les résultats.
Recommandation 19
Inciter les ministères et organismes ainsi que les municipalités à utiliser pleinement les dispositions
règlementaires, tant existantes que futures, afin de maximiser le poids des critères de qualité, d’innovation,
d’expertise et de durabilité dans leurs appels d’offres.
15CONCLUSION
La FCCQ offre son entière collaboration au gouvernement dans le processus d’élaboration de la prochaine
Stratégie québécoise de recherche et d’innovation. Nos recommandations ont pour but d’en arriver à une
SQRI qui soit à la fois ambitieuse et efficace.
Pour ce faire, il nous apparaît incontournable de débuter par une meilleure diffusion de l’offre de services
gouvernementale liée à la SQRI. Nous demandons également qu’y soient intégrées les mesures pertinentes
du Plan d’action gouvernemental en matière d’allègement réglementaire et administratif et que les délais de
traitement des dossiers, notamment les remboursements de crédits d’impôt, soient significativement accélérés.
Comme lors de la consultation tenue en vue d’élaborer l’actuelle SQRI, nous tenons à insister sur l’importance
de la commercialisation de l’innovation. Plusieurs mesures permettraient d’aller plus loin que ce qui est déjà en
place, que ce soit en ajoutant des mesures fiscales complémentaires et bonifiées ou encore en favorisant la
protection de la propriété intellectuelle et la certification des produits et services.
L’attraction des talents en contexte de pénurie de main-d’œuvre s’impose comme étant un autre pilier de la
prochaine SQRI. Les mesures de la stratégie actuelle en matière de formation sont importantes, mais, là
encore, il faut aller plus loin pour donner de l’oxygène à nos entreprises innovantes. Cela passe par une
hausse du nombre de travailleurs qualifiés autorisés à immigrer au Québec et par une bonification des
programmes pilotes existants pour couvrir l’ensemble des besoins des entreprises innovantes. En toute
logique, une révision des critères d’octroi de l’aide gouvernementale devrait être réalisée afin de s’adapter à un
contexte où la création d’emplois est de moins en moins possible.
La FCCQ recommande également d’inscrire dans la prochaine SQRI une orientation claire en faveur de
l’utilisation responsable des données à des fins de recherche et d’innovation. Le Québec ne doit pas rater
cette occasion de mettre en valeur cet actif précieux et sensible que constituent nos données publiques
anonymisées, conformément au nouveau régime d’encadrement en cours d’élaboration à cet effet et en
cohérence avec la future Stratégie IA.
Enfin, nous réitérons l’importance de rendre nos appels d’offres publics plus intelligents en misant notamment
sur des critères d’innovation, afin de stimuler et de récompenser nos entreprises à la fine pointe de la
technologie. Il n’est pas normal que nos entreprises québécoises remportent des adjudications de contrats
publics à l’extérieur du Québec, car les gouvernements externes ont une ouverture aux nouveaux procédés
innovants, mais pas du côté de leur gouvernement québécois. Dans ce contexte, il n’est pas étonnant
d’entendre des entreprises d’ici mentionner qu’il n’est pas intéressant de soumissionner sur les contrats
publics de l’État québécois. Au lieu de bénéficier de l’expertise et des innovations québécoises dans les
marchés publics québécois, cette situation pénalise non seulement le résultat des projets, mais représente un
frein au développement économique du Québec. Cela nécessite une profonde transformation de la culture
organisationnelle en faveur d’une ouverture pour les innovations d’ici, ce qui viendrait inévitablement favoriser
la commercialisation des produits québécois a posteriori.
Le fil conducteur de notre mémoire est la cohérence : nous demandons au gouvernement d’arrimer la SQRI
aux autres politiques gouvernementales afin de s’assurer que l’ensemble des interventions gouvernementales
en matière d’économie donnent les meilleurs résultats possibles. Nous en sortirions tous gagnants.
16Vous pouvez aussi lire