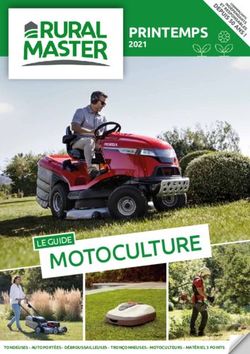Simulation des impacts de la politique d'autosuffisance en riz de l'Afrique de l'ouest
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Simulation des impacts de la politique
d’autosuffisance en riz de l’Afrique de l’ouest
Ismael FOFANA, Anatole GOUNDAN et Léa MAGNE
Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI)
Titre 3396 Lot No2 BP 24063 Dakar-Almadies
Dakar, SénégalTable des matières
Abstract ......................................................................................................................................................... 4
Résumé.......................................................................................................................................................... 5
1. Introduction .......................................................................................................................................... 6
2. Economie du riz en Afrique de l’ouest .................................................................................................. 7
3. Méthodologique ................................................................................................................................. 10
3.1 Projection de la consommation de riz ........................................................................................ 10
3.2 Le modèle de simulation des économies de la CEDEAO (ECOSIM) ............................................ 12
4. Résultats empiriques .......................................................................................................................... 20
4.1 Elasticité estimée ........................................................................................................................ 20
4.2 Analyse prospective de la consommation de riz en Afrique de l’ouest ...................................... 23
4.3 Impact économique et social de l’Offensive Riz en Afrique l’ouest ........................................... 26
5. Sécurité alimentaire en riz dans la CEDEAO : un défi impossible ? .................................................... 31
6. Conclusion ........................................................................................................................................... 33
Bibliographies ............................................................................................................................................. 34
Annexe ........................................................................................................................................................ 36Liste des tableaux et figures Tableau 1: Quelques agrégats de l’économie du riz ..................................................................................... 8 Tableau 2: Résultats des estimations .......................................................................................................... 22 Tableau 3: Mesure des élasticités par groupe de pays ................................................................................ 23 Tableau 4: Consommation de riz en 2012 et 2025 (Million de tonnes) ...................................................... 24 Tableau 5: Variations des importations et des exportations CEDEAO, 2014-2025 (%) ............................ 29 Graphique 1: Structure de la production sectorielle et de l’offre locale de produits................................... 13 Graphique 2: Structure des échanges commerciaux .................................................................................. 16 Graphique 3: Production annuelle de riz attendue, 2011 et 2025 (Millier de tonnes) ................................ 25 Graphique 4: Evolution de la consommation et la production, 2011-2025 (Million de tonnes) ................. 26 Graphique 5: Evolution des importations nettes de la CEDEAO (en million de tonnes) ........................... 27 Graphique 6: Evolution du taux d’autosuffisance CEDEAO ..................................................................... 28 Graphique 7: Croissance agricole et non agricole pour la CEDEAO ......................................................... 28 Graphique 8: Croissance économique CEDEAO ....................................................................................... 30 Graphique 9: Création d’emploi, période 2014-25 ..................................................................................... 30 Graphique 10: Evolution de la consommation de riz et des autres produits alimentaires........................... 31
Abstract Rice is a strategic commodity for West Africa in terms of its contribution to food security strategy. Its consumption has grown over time in the eating habits of West African households. From 32 kg per capita consumed in 1990 in the region, the level of the rice consumption per capita increased to 34 kg in 2000 and got 49 kg in 2012. It’s to note that this consumption is quite heterogeneous among countries. We distinguish some large consumers such as Sierra Leone (97.9 kg/capita), Guinea- Bissau (93.2 kg/capita), Liberia (89 kg/capita) and Guinea (84.2 kg/capita) one hand. On the other hand, we have countries like Ghana (17.5 kg/capita), Benin (15.4 kg/capita), Burkina Faso (13.8 kg/capita) and Niger (10.1 kg/capita) that consume less. Achieving self-sufficiency in rice by 2025 is a priority for the regional authorities. Thus, the contribution of this analysis is to provide a better understanding of the demand for rice for planning self-sufficiency and food security policies. This analysis also seeks to assess the potential impact of the rice self-sufficiency policy. After investigation, the income elasticity of rice consumption is estimated at 0.527 in ECOWAS. This means that a 1% increase in income would cause an increase in demand for rice 0.527 %. The projected demand in the sub-region would be between 20 and 24 million tons in 2025 against a demand of 15.67 million in 2012. Thus, achieving self-sufficiency in rice ECOWAS 2025 will be a major challenge for the authorities in that it implies an average annual production growth of over 8 %. In terms of economic and social impact, the implementation of the Rice Policy would increase GDP by 0.1 percentage point relative to the baseline, create 4.3 million jobs in the agricultural sector and 3.9 million in the non-agricultural sector in 2025. Moreover, food security gradually increase to 4% in 2025 and 14% for rice and all food products. Key words: Rice self-sufficiency, Food security policies, ECOWAS, elasticity, ECOSIM.
Résumé Le riz est un produit stratégique pour l’Afrique de l’ouest au regard de sa contribution dans la stratégie de sécurité alimentaire. Celui-ci s’est établi au fil du temps dans les habitudes alimentaires des ménages ouest-africains. De 32 kg/tête consommé en 1990 dans la région, le niveau de consommation par tête est passé à 34 kg en 2000 pour s’établir à 49 kg en 2012. Le niveau de consommation par tête est assez hétérogène. On distingue quelques gros consommateurs tels que la Sierra Léone (97,9 kg/ habitant), la Guinée-Bissau (93,2 kg/ habitant), le Libéria (89 kg/habitant) et la Guinée (84,2kg/ habitant) d’une part. D’autre part, on a des pays comme le Ghana (17,5 kg/habitant), le Benin (15,4 kg/ habitant), le Burkina Faso (13,8 kg/ habitant) et le Niger (10,1 kg/ habitant) qui consomment moins. L’atteinte de l’autosuffisance en riz d’ici 2025 est une priorité pour les autorités régionales. Ainsi, l’apport de cette analyse est de permettre une meilleure compréhension de la demande de riz pour la planification des politiques d’autosuffisance et de sécurité alimentaire. Cette analyse cherche également à évaluer l’impact potentiel de la politique d’autosuffisance en riz. Au terme des investigations, l’élasticité revenu-consommation du riz est estimée à 0.527 dans la CEDEAO. Ce qui signifie qu’une augmentation de 1% du revenu occasionnerait une hausse de la demande de riz de 0.527%. La projection de la demande dans la sous-région serait comprise entre 20 et 24 millions de tonnes en 2025 contre une demande de 15,67 millions en 2012. Ainsi, l’atteinte de l’autosuffisance de la CEDEAO en riz d’ici 2025 sera un défi important pour les autorités en ce sens qu’elle implique une croissance moyenne annuelle de la production de plus de 8%. En terme d’impact économique et sociale, la mise en place de l’Offensive Riz contribuerait à augmenter le PIB de 0.1 point par relativement à la situation de référence, à créer 4,3 millions d’emplois dans le secteur agricole et 3.9 millions dans le secteur non agricole en 2025. Par ailleurs, la sécurité alimentaire augmenterait progressivement pour atteindre 4% et 14% en 2025 pour le riz et l’ensemble des produits alimentaires. Mots clés : Autosuffisance en riz, Sécurité alimentaire, CEDEAO, élasticité, ECOSIM.
1. Introduction Le riz est un produit stratégique pour l’Afrique de l’ouest au regard de sa contribution dans la stratégie de sécurité alimentaire. En effet, la consommation du riz s’est établie au fil du temps dans les habitudes alimentaires des ménages ouest-africains. De 32 kg/tête consommé en 1990 dans la région, le niveau de consommation par tête est passé à 34 kg en 2000 pour s’établir à 49 kg en 2012. La consommation par tête a connu alors en 2000 et 2012 un accroissement de 44%. Ce qui fait du riz, la céréale la plus consommée dans la CEDEAO (15.7 millions de tonnes) devant le mil (15,5 millions de tonnes), le maïs (15, 2 millions de tonnes) et le sorgho (11,1 millions de tonnes) en 2012 (USDA). Par contre en 1990, le riz (5,2 millions de tonnes) constituait la quatrième céréale derrière le sorgho (6,1 millions de tonnes), le mil (8,1 millions de tonnes) et le maïs (8,2 millions de tonnes). Il apparaît alors clairement la grande mutation réalisée en l’espace de 20 ans. D’ailleurs, tout laisse croire que la prépondérance du riz dans le panier de consommation va perdurer encore longtemps. L’accroissement de la demande de consommation en riz excède largement la production régionale. En effet, en 1990 la consommation de riz blanchi était de 5,7 millions pour une production totale d’environ 3,2 millions, soit une couverture 57%. En 2012, la consommation agrégée et la production régionale s’élevaient respectivement à 15,7 millions et 7,7 millions de tonnes, soit un taux de couverture de 49%. Ainsi, les besoins de la sous-région sont couverts en moyenne à plus de 40% par les importations. La CEDEAO importe d’ailleurs environ 20% de la quantité mondiale de riz commercialisé. Cette dépendance a été à la base des fâcheuses conséquences subies par la région au cours de la crise de 2007/2008. Avec cette crise le prix international du riz a été multiplié par trois en l’espace de quelques mois. Elle a notamment révélé la vulnérabilité des pays en termes de sécurité alimentaire. Selon la FOA, cette crise a entraîné une hausse supplémentaire de 12% de la population sous nourrie en Afrique Sub-saharienne. Dans la seule région ouest-africaine, on dénombre environ 34 millions d’habitants sous-nourris. Vu sa prépondérance dans le panier de consommation et de son rôle en terme de sécurité alimentaire, la filière rizicole dispose de sa propre stratégie dans la majorité des pays de la sous-
région1 en synergie avec celle élaborée pour le secteur agricole tout entier. En outre, le riz est ciblé par les stratégies régionales2 et fait l’objet d’une offensive sous l’initiative de la CEDEAO et de l’UEMOA. L’Offensive régionale sur le riz mobilise les efforts des acteurs de la sous-région autour d’un programme fédérateur pour dynamiser la production du riz et relever le défi de l’autosuffisance en riz blanchi d’ici à 2025. L’élaboration d’un programme cohérent pour la filière riz requiert avant tout la disponibilité d’informations pertinentes sur la demande de cette denrée en vue de la mise en œuvre d’une politique d’offre appropriée. Cette analyse s’inscrit dans cette perspective, en contribuant à une meilleure compréhension de la consommation future de riz en Afrique de l’ouest et des implications de l’atteinte de l’objectif d’autosuffisance en cette denrée sur la croissance économique, l’emploi et la sécurité alimentaire. La suite du document se présente comme suit. La première section sera dédiée à un aperçu général sur la place du riz au sein de la CEDEAO. La deuxième section fera l’objet de la présentation des approches méthodologiques nécessaires pour l’atteinte des divers objectifs. La section suivante expose les résultats. La dernière section présente quelques défis que la CEDEAO devra relever pour convertir l’atteinte de l’autosuffisance en sécurité alimentaire dans la région. Enfin, la conclusion viendra met un terme au document. 2. Economie du riz en Afrique de l’ouest Le riz se révèle être une denrée de première nécessité pour les ménages de la CEDEAO. En effet, elle est passée de la quatrième céréale la plus consommée en 1990 à la première en 2012. Ce qui fait dont du riz un produit stratégique dans les politiques de sécurité alimentaire au niveau de la sous-région. 1 Une Stratégie Nationale de Développement du Riz (SNDR) a été élaborée pour les pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée, Libéria, Mali, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone et Togo. 2 ECOWAP/PDDAA et PRIA de la CEDEAO, et PAU de l’UEMOA.
Tableau 1: Quelques agrégats de l’économie du riz
Conso/tête Taux de couverture Import net
Pays
1980-89 1990-99 2000-12 1980-89 1990-99 2000-12 1980-89 1990-99 2000-12
Benin 7 10 26 19,5 18,8 25,4 25 51 168
Burkina Faso 6 13 21 65,5 32,7 33,7 17 90 196
Côte d’Ivoire 59 55 73 55,8 53,9 35,1 269 387 860
Gambie 104 56 81 31,6 31,2 18,8 55 42 100
Ghana 7 15 28 57,5 44,3 31,1 43 137 436
Guinée 74 77 100 75,6 69,4 73,5 90 184 260
Guinée-
93 88 101 77,8 86,8 52,8 17 17 78
Bissau
Liberia 121 62 89 67,1 61,7 45,8 83 55 171
Mali 24 40 73 76,7 94,1 87,7 41 18 111
Niger 9 6 15 62,3 83,9 32,7 24 10 164
Nigeria 15 23 28 68,0 75,7 55,1 543 487 1916
Sénégal 69 65 95 18,9 21,6 20,8 353 460 886
Sierra Leone 109 78 109 82,9 76,6 73,2 68 71 149
Togo 16 19 30 26,3 36,1 34,0 39 50 114
CEDEAO 27 31 43 60,3 63,8 50,5 1668 2057 5609
Source : calcul des auteurs à partir des données de l’UN-DESA.
Au vu du tableau ci-dessus le riz occupe une place beaucoup plus importante dans un certains
nombres de pays Ouest africain notamment au Liberia, en Gambie, en Sierra Leone, en Guinée, en
Guinée Bissau, en Sénégal où la consommation moyenne annuelle par individu dépasse les 70kg
avec un record de 100kg atteint en Sierra Leone sur la période 1980-2012. Comparativement à ce
dernier groupe de pays la consommation moyenne de riz est faible et inférieure à 23kg/tête au
Niger, au Burkina Faso, au Benin, au Ghana, et au Nigeria.
De façon globale, la consommation moyenne annuelle de riz par habitant en Afrique de l’Ouest a
presque doublé en l’espace de trois décennies. En effet, elle a augmenté respectivement de 15%
entre la première et la deuxième période en passant de de 27kg à 31kg et de 37% entre la deuxième
et la troisième période pour s’établir à 42kg. Cette forte augmentation de la consommation par
habitant est assez générale dans tous les pays. Ce qui pourrait s’expliquer par une modification du
comportement alimentaire dans lequel le riz devient de plus en plus un aliment de base. Cependant,
on constate une diminution du niveau de consommation par habitant entre la première et la dernière
période en Gambie et au Liberia.
Concernant la relation entre la production locale et la consommation de riz en Afrique de l’Ouest,
on assiste depuis les années 1980, à une augmentation régulière du déficit de production dans larégion. Outre, la production de la sous-région ne parvient pas à satisfaire la demande intérieure. En effet, le niveau de production moyen de riz en Afrique de l’Ouest avoisinait 2,4 millions de tonnes par an entre 1980-1989 contre une consommation de 3,9 millions de tonnes par an sur la même période. Ceux-ci ont atteint respectivement 5,6 millions de tonnes par an entre 2000-2012 contre 11 millions tonnes. Ce qui ne couvre que 50,3% des besoins alimentaire en riz de la sous- région. En dépit de l’augmentation de la production locale (qui est passée de 2,4 au cours des années 80 à 3,7 dans les années 90 et à 5,6 entre 2000 et 2012), on constate une diminution du taux de couverture qui passe de 60,3% sur la première période à 50,3% au cours de la période 2000-2012. Cette situation la contraint donc à recourir de plus en plus aux importations massives. La région reste ainsi largement tributaire à hauteur de 49% d’un marché international de plus en plus volatile. Cette dépendance c’est beaucoup amplifié au cours de la dernière décennie. En effet, les importations nettes ont plus que triplées entre 1980 et 2012. Toutefois ces statistiques cachent d’énormes disparités entre les pays. Au Sénégal par exemple, malgré l’augmentation du taux de couverture, le pays reste le plus dépendant (près de 80% de la consommation de riz au Sénégal est importée) dans la sous-région. Par contre, le Mali et la Sierra Leone parviennent à assurer leur besoin alimentaire en riz respectivement à hauteur de 86,1% et 78%. Le Burkina Faso, le Ghana, le Niger et le Benin considérés comme des petits consommateurs ont multiplié leur importation nette respectivement par 11, 10 et 6. Les gros importateurs de la sous-région sont le Nigeria, le Sénégal et la Côte d’ivoire. Les importations moyennes annuelles du Nigéria dépassent 2 millions de tonnes sur la période 2000-2012, celles du Sénégal et de la Côte d’ivoire dépassent les 850 milles tonnes sur la même période. Comparativement à l’évolution rapide de la consommation globale de riz, celle de la production montre une progression lente et est portée par l’augmentation de la production nigériane. Les grands pôles de production de riz en Afrique de l’Ouest sont le Nigéria (avec plus de 40% de la production), la Guinée, le Mali, la Côte d’Ivoire et la Sierra Leone. Les deux premiers pays fournissent ensemble plus de la moitié de la production régionale et couvre une superficie de 3,4 million d’hectares sur les 5,5 million consacrée à cette culture. Toutefois, à l'intérieur de la sous- région, les évolutions sont assez hétérogènes. Malgré son niveau de production assez faible, l’Afrique de l’Ouest reste compétitive en termes de coût de production du riz paddy et revêt ainsi un fort potentiel de croissance de la production si un
certains nombres de contraintes liées à l’agro-écologie, à la transformation (énergies, machines agricoles etc.), à la commercialisation régionale, à l’irrigation et à l’accès aux semences et intrants de qualités sont résolues (CIRAD, 2011)3. La maîtrise de l’eau permet à elle seule une amélioration des performances du riz. En effet, elle ferait passer les rendements du riz de 2 tonnes en moyenne actuellement à plus de 10 tonnes, avec deux cultures par an sur les parcelles (Blein et al., 2008)4. Malgré ces contraintes, le Bénin, le Ghana, le Mali, le Nigeria et le Sénégal se révèlent comme des pays à fort potentiel de production (OCDE, 2011)5. En comparaison avec d’autre pays ouest africain, le Mali dispose d’un potentiel de production de riz assez élevé en raison de la disponibilité de terre irrigable non exploitées (FAO, 2013)6. 3. Méthodologique Cette section présente l’approche méthodologique adoptée pour répondre aux différents objectifs de ce travail. L’estimation du niveau potentiel de la consommation dans la sous-région à l’horizon 2025 est obtenue à travers trois approches afin de comparer les résultats et de dégager aussi une borne inférieure et une borne supérieure à la consommation projetée. (i) La première revient à supposer une consommation par tête qui ne variera pas au cours des prochaines années (scénario de stabilité ou scénario A). (ii) La deuxième approche est une prévision de la consommation par tête basée sur la méthode de lissage exponentiel dans le cadre des modèles espace-état tel développé par Hyndman et al. (2002). (iii) La dernière approche utilise l’élasticité revenu- consommation pour définir le niveau de la consommation de riz. L’analyse de l’impact de la politique d’Offensive Riz se fera à travers un modèle régional d’Equilibre Général Calculable. 3.1 Projection de la consommation de riz Comme précisé un peu plus tôt, trois approches sont utilisées pour apprécier la dynamique future de la consommation de riz au sein de la CEDEAO. Dans cette section, il sera uniquement question 3 http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp234783.pdf 4 http://www.fondation‐farm.org/IMG/pdf/potentialites_etude_mp.pdf 5 http://www.oecd.org/fr/csao/publications/48356991.pdf 6 http://www.fao.org/docrep/018/i3222f/i3222f.pdf
de présenter l’approche basée sur l’estimation des élasticités revenu-consommation. Les autres
seront brièvement présentées en annexe.
Le comportement du consommateur vis-à-vis d’un produit est principalement expliqué par son
budget et le prix de ce produit. Dans ce travail, nous nous inscrivons dans le cadre proposé par
Pesaran & Smith (1995) et Pesaran et al. (1997, 1999) pour modéliser le comportement de la
consommation par un modèle à retards échelonnés ARDL (Autoregressive Distributed Lag). La
formulation de cette approche dans le cas des données de panel s’écrit :
, , , , , , , (1)
Où , représente le logarithme de la consommation de riz par tête dans le pays i, , le
logarithme du revenu par tête, , le taux d’inflation à la date t dans le pays i, l’effet
individuel pays, l’effet temporel et , l’erreur supposée i.i.d.
Dans le modèle (1), l’hétérogénéité des pays est prise en compte. On admet la possibilité que la
dynamique de la consommation de riz puisse différer d’un pays à un autre.
L’existence d’une relation de cointégration conduit à réécrire l’équation (1) sous la forme d’un
modèle à correction d’erreur comme suit :
∆ , , , , ∆ , ∆ , , (2)
Avec
1 , , , , .
Pour estimer l’équation (2), nous utilisons et comparons deux approches alternatives : le Mean
Group (MG) Estimator et le Pooled Mean Group (PMG) Estimator. Le premier est proposé par
Pesaran& Smith (1995) et consiste à calculer la moyenne des estimateurs obtenus à partir de
l’équation (2) pour chaque pays. Le second est proposé par Pesaran, Shin & Smith (1997, 1997)
et combine la régression pooled et la moyenne des estimateurs en supposant l’existence d’une
unique relation de long terme pour tous les individus mais une dynamique de court terme
spécifique à chaque pays. Ces deux estimateurs seront comparés entre eux par l’intermédiaire d’untest de Hausman. Ils seront également comparés à l’estimateur dit Effets Fixes Dynamique (DFE,
Dynamic Fixed Effects) qui contrairement aux autres suppose l’homogénéité entre les individus.
L’élasticité revenu estimée ( ) est utilisée pour dériver le niveau de la consommation par tête et
agrégée à chaque date comme suit :
, 1 ∗∆ , ∗ , (3)
, , ∗ , (4)
Où , représente la consommation agrégée, et , représente la prévision du revenu par tête
obtenue par le lissage exponentiel en espace-état (voir annexe).
3.2 Le modèle de simulation des économies de la CEDEAO (ECOSIM)
ECOSIM7 est un assemblable de quinze modèles de simulation en équilibre général calculable
(Module pays). Il intègre les spécificités macroéconomiques de la zone d’intégration économique
et monétaire que constitue l’UEMOA (Module UEMOA). La prise en compte des échanges
régionaux de produits et de la mobilité des facteurs productifs est également une particularité du
modèle (Module CEDEAO).
Module pays
Les modèles pays suivent la structure standard des modèles EGC basée sur la théorie néoclassique
de l’équilibre général. Ainsi, les producteurs maximisent leur profit selon des technologies et des
prix donnés ; les consommateurs maximisent leur bien-être selon des préférences et des prix
donnés ; les marchés compétitifs déterminent les prix d’échanges qui équilibrent l’offre des
producteurs et la demande des consommateurs. Cette formulation théorique est complétée par une
vision structuraliste qui prend en compte les spécificités des économies de la sous-région.
Les modèles pays se présentent en cinq blocs interdépendants: la production locale; les échanges
extérieurs de produits et l’offre globale nette; la demande globale; les contraintes
macroéconomiques ; et la dynamique économique. Ces blocs sont présentés de manière plus
détaillée dans les prochaines sections.
7 « Economic Community of West African States Simulation Model »o Production et offre de produits locaux
La production sectorielle se présente sous la forme d’une fonction imbriquée à deux niveaux. Au
premier niveau, les facteurs travail LD et capital KD (se présentant sous forme agrégée)8 se
substituent de manière imparfaite dans la valeur ajoutée VA sectorielle.9 Ainsi, la demande dérivée
de travail dépendant de son taux de rémunération w et du taux de rendement du capital r. Au
second niveau, la valeur ajoutée VA et les intrants CI sont combinés selon une proportionnalité
fixe dans la production sectorielle XS. Ainsi, un bien ou service pourrait être offert par plus d’une
branche économique telle que présentée par le schéma ci-dessous (Graphique 1). Une relation à
proportionnalité fixe lie l’offre domestique DD à plusieurs branches économiques.
Graphique 1: Structure de la production sectorielle et de l’offre locale de produits
Demande de travail Demande de capital KD
LD secteur j secteur j
Valeur ajoutée VA Consommation totale
secteur j d’intrants CI secteur j
Production XS
secteur j
Production en produit Production en produit i Production en produit i
ii secteur j secteur j secteur jj
Offre locale
produit i
8 Au besoin et lorsque les données le permettent, les facteurs travail et capital pourraient faire l’objet d’une représentation plus
détaillée.
9 Du terme anglais « Constant Elasticity of Substitution ».o Echanges extérieurs et offre locale de produits
Les économies nationales entretiennent des relations commerciales sous forme d’importations et
d’exportations de biens et services avec trois partenaires économiques : les autres pays de la sous-
région (CEDEAO), l’Union Européenne (UE) et le reste du monde (RDM)10.
Les importations découlent de l’hypothèse de substitution imparfaite entre les produits locaux et
étrangers (hypothèse d’Armington) et les exportations de l’hypothèse de transformation imparfaite
entre les marchés locaux et extérieurs. A chaque niveau, les demandes dérivées de produits locaux
et étrangers (importations) sont étroitement liées à leur prix de base, convertis en prix intérieur par
le taux de change pour les produits importés, auxquels s’ajoutent les taxes intérieurs applicables,
c'est-à-dire les droits de douanes et autres taxes à l’importation.
Importations
La demande globale est satisfaite par les produits locaux et étrangers qui se substituent de manière
imparfaite à travers une relation imbriquée à deux niveaux. Au premier niveau, l’offre domestique
et les importations des autres pays de la CEDEAO se substituent dans l’offre totale de la sous-
région, d’une part. Les importations de l’UE et celles du RDM se substituent de manière imparfaite
dans les importations hors-CEDEAO, d’autre part. Au second niveau, les importations de la
CEDEAO et celles des pays hors-CEDEAO se substituent également de manière imparfaite dans
l’offre globale s’adressant au pays.
A chaque niveau, les demandes dérivées de produits locaux et étrangers (importations) sont
étroitement liées à leur prix de base, convertis en prix intérieur par le taux de change pour les
produits importés, auxquels s’ajoutent les taxes intérieurs applicables, c'est-à-dire les droits de
douanes et autres taxes à l’importation.
Exportations
Alors que les exportations de produits vers l’UE et le RDM font face à une demande parfaitement
élastique à travers des prix extérieurs exogènes, les exportations de produits vers la CEDEAO sont
contraintes par les importations. Ainsi, les importations totales déterminent les exportations totales
10
Les autres économies à l’exception des autres pays de la CEDEAO et de l’EU.des pays de la CEDEAO. La demande d’exportation s’adressant à la sous-région est ensuite
repartie aux pays de la sous-région selon une logique de minimisation des coûts.
Une transformation imparfaite guide les exportations vers les marchés intra- et extra- régionaux.
Au premier niveau, l’arbitrage se passe entre les marchés local et régional d’une part, et les marche
de l’UE et du RDM, de l’autre. Au second niveau, les exportations vers les marchés régional et
extérieur sont définies. Etant donné que les marchés extrarégionaux sont exogènes (hypothèse de
petit pays), les prix offerts sur les marchés domestiques sont des facteurs déterminants pour la
satisfaction de la demande domestique. Ainsi, plus les prix domestiques sont intéressants, plus
l’offre résiduelle est dirigée vers les marchés locaux au détriment de ceux extérieurs, vis-versa.
La spécification des échanges extérieurs permet d’intégrer les réexportations à l’intérieur de
l’espace CEDEAO engendrée par les différentiels de taux de change et de politiques fiscales. Ce
phénomène est, en général, observé entre les pays de l’espace UEMOA (Union Economique et
Monétaire Ouest Africain) et les autres pays de la CEDEAO.
o Demande locale de produits
La demande domestique de produit est une agrégation de la demande finale privée, la demande
finale publique, de la demande de produits pour l’investissement fixe, des modifications de stocks
et de la demande de produits pour la consommation intermédiaire. La consommation publique est,
par hypothèse, exogène au cours d’une période ; alors qu’une fonction à proportionnalité fixe liée
à la demande de produits pour la consommation intermédiaire et l’utilisation totale d’intrants.
La consommation finale privée découle d’un système de demande linéaire, constitué d’une
composante fixe ou non-discrétionnaire liée à une consommation minimale, et d’une composante
variable liée au revenu résiduel (après couverture des besoins minimaux) ou surnuméraire. Ce
dernier est étroitement lié au revenu brut et disponible du ménage. Le revenu brut est la somme du
revenu de travail, du revenu de capital et des revenus de transferts. Le revenu disponible est obtenu
en déduisant la taxe directe et les paiements de transfert du revenu brut.
Alors que les changements de stocks restent fixes au cours d’une période, la demande de produits
pour la formation de capital fixe est étroitement liée au niveau de l’épargne nationale et au prix
des produits d’investissement. L’épargne nationale est formée par l’épargne privée des ménages
et des entreprises, l’épargne publique de l’Etat et l’épargne extérieure. L’épargne privée desménages présente une part autonome : l’épargne transitoire, et une part variable liée au revenu
disponible selon un taux fixe. Les entreprises épargnent le résidu de leur revenu brut net des
paiements de taxes et transferts (dividendes, intérêts, loyers, etc.). Les entreprises disposent d’un
revenu net d’activité, rémunérant entièrement le capital engagé en entreprise, et de revenus de
transfert (dividendes, intérêts, loyers, etc.). L’épargne primaire de l’Etat est également le résidu du
revenu de l’Etat net des dépenses publiques courantes (cout de fonctionnement des administrations
publiques, fourniture de services sociaux et transferts sociaux). Le revenu de l’Etat présente une
composante fiscale (taxe sur les revenus, taxes de production, taxe sur les produits locaux, taxes
sur les produits importés, taxes sur les importations et taxes sur les exportations) et une composante
non-fiscale (transferts incluant les subsides et les revenus de capital).
Graphique 2: Structure des échanges commerciaux
Importations Importations Importations Offre locale,
RDM, pays p UE, pays p CEDEAO, pays p pays p
Importations hors- Offre régionale,
CEDEAO pays p pays p
Offre globale,
pays p
Exportations Offre marche
extrarégionales régional
Exportations Exportations Exportations Offre marché
RDM, pays p UE, pays p CEDEAO, pays p localo Contraintes macroéconomiques Plusieurs contraintes macroéconomiques s’imposent aux agents économiques qui les considèrent comme des données exogènes. Ces contraintes vont de la détermination des prix de base des biens et services, à la politique fiscale de l’Etat, en passant par la contrainte du compte coutant des échanges avec l’extérieur. A travers l’hypothèse de petit pays, les prix extérieurs des échanges avec l’UE et le RDM sont supposés exogènes (Graphique 3). Ils sont convertis en prix intérieurs grâce au taux de change et aux taxes sur les échanges extérieurs. En revanche, les prix des produits échangés dans l’espace CEDEAO sont des agrégations des prix de base des économies constituantes. Les prix de base locaux ou d’équilibre sont ceux qui égalisent simultanément les offres et demandes de produits sur tous les marchés locaux. Le prix régional d’un produit est donc une moyenne pondérée des prix de base, le coefficient de pondération étant la part relative du pays dans les échanges sous-régionaux du produit. Avec le prix de base local, ce prix moyen sous- régional est un élément important de la demande de produits ou exportations s’adressant à un pays. Toutefois, les prix moyens des importations et exportations vers les espaces CEDEAO sont spécifiés pour chaque pays grâce aux informations additionnelles apportées par la « matrice des échanges intra-régionale ». A ce stade, avec l’absence d’informations détaillées sur les pays d’origine et de destination des échanges commerciaux dans la sous-région, la matrice présentée par le tableau 1 postule que le commerce entre deux pays s’explique principalement par le partage d’une frontière terrestre. En d’autres termes, le commerce intra-régional d’un pays est essentiellement affecté par la modification des prix des pays avec qui il partage une frontière terrestre (Tableau 1). Comme exemple, un changement significatif des prix au Nigeria affecterait le prix moyen des produits échangés au sein de la CEDEAO, mais en plus le prix moyen des exportations des pays avoisinants, de telle sorte que la demande d’importations qui en découlerait serait principalement satisfaite par ces derniers. Le prix agrégé de l’offre globale dans un pays est alors une moyenne pondérée du prix des importations et du prix de base local. Ce prix est ajusté du prix des exportations vers la CEDEAO, et ensuite des prix des exportations en direction de l’UE et le RDM pour aboutir au prix d’acquisition dans chaque économie. Le prix au producteur est lié aux prix de base et à la composition des biens et services offert. Le prix au producteur net du coût des intrants productifs rémunère les facteurs productifs ou prix de
la valeur ajoutée. Le travail ne constitue pas un facteur contraignant dans les économies de la sous-
région, son offre est supposée parfaitement élastique ; il est donc contraint par la demande des
entreprises. Par conséquent, les salaires sont fixes et indexés au niveau général des prix
domestiques. Le capital est spécifique à chaque branche productive, sa demande et son offre sont
également exogènes. La valeur ajoutée nette de la charge de travail est ensuite ramenée à l’unité
de capital pour donner le rendement du capital.
Le solde du compte courant des échanges avec l’extérieur est maintenu fixe afin que l’équilibre
soit assuré par le taux de change réel. Avec des dépenses publiques exogènes et des revenus publics
endogènes, le solde budgétaire de l’Etat est financé par l’épargne privée (effet d’éviction).
o La dynamique des économies
La croissance de l’économie est induite par l’accroissement du capital productif KD par
l’investissement IND. L’investissement public couvre la dépréciation du capital public et la
croissance démographique avec l’hypothèse de dépenses publiques per capita constantes.
L’investissement privé suit la spécification néoclassique proposée par Thorbecke et Junk (2001)
pour laquelle la demande d’investissement sectorielle est étroitement liée à son ratio bénéfice-coût.
Le bénéfice généré par l’investissement sectoriel équivaut au rendement sectoriel du capital R. Le
coût de l’investissement combine à la fois ses coûts d’acquisition PK et d’opportunité ; le dernier
équivaut au taux d’intérêt réel IR. Le prix d’acquisition de l’investissement est une moyenne
pondérée des prix des produits entrant dans l’investissement. Le taux de change réel équilibre
l’épargne globale ou offre d’investissement IT des unités institutionnelles et la demande globale
d’investissement des secteurs économiques. Alors que la demande sectorielle d’investissement
reste sensible au taux d’intérêt réel, l’offre d’investissement ou épargne des unités institutionnelles
l’est moins. Au-delà du taux de rendement du capital, les investissements étrangers restent surtout
sensibles à la performance de l’économie toute entière. Il n’existe pas de relation directe entre le
taux de change réel et l’épargne domestique ; les revenus brut et disponible restent les principaux
déterminants de l’épargne des acteurs économiques résidents.
La consommation publique CG est fixe au cours d’une période. En revanche, elle augmente au
rythme de la croissance démographique entre deux périodes, avec l’hypothèse de constance de la
consommation finale publique par habitant. Une hypothèse similaire est émise pour lesconsommations privées minimales des ménages. Les autres variables exogènes telles que les
transferts publics et privés augmentent au rythme de la croissance démographique.
Ainsi, il n’existe pas de traitement spécifique pour les échanges de facteurs entre les pays de la
sous-région. L’hypothèse d’une abondance de facteur travail et par conséquent d’une offre de
travail non contraignante dans tous les pays rend l’analyse de la mobilité infrarégional du travail
peu pertinente. En effet, la migration intra-régionale a bel et bien lieu dans cette analyse ; toutefois,
il est implicitement postulé que les nouveaux arrivants viennent s’ajouter à une masse importante
de travailleurs sous-employés et de chômeurs dans les pays d’accueil, d’une part, et que la
probabilité pour les nouveaux arrivant de trouver du travail est relativement plus faible que celle
des autochtones, de l’autre.
Quant au facteur capital, l’analyse postule que l’épargne endogène des résidents est
essentiellement investie dans le pays d’origine. [Ici, plus d’épargne étrangère doit se refléter en
plus de transfert de revenu vers l’extérieur]. En revanche, la variation de l’épargne étrangère ou
investissement étranger est étroitement liée au taux d’intérêt réel tel que discuté antérieurement.
Les transferts intra-régionaux sont indexés aux taux de croissance des PIB domestiques et sous-
régionaux. En d’autres termes, plus les performances économiques sont bonnes dans un pays, plus
les transferts sont importants entre les unités institutionnelles domestiques. En outre, plus de
richesse économique dans l’espace CEDEAO, se traduirait pas plus les transferts privés entre les
pays de la sous-région. [S’assurer que c’est refléter au niveau des équations].
Les échanges intra-régionaux
Les pays de la CEDEAO entretiennent individuellement des relations avec les autres pays du
monde à travers :
les échanges de biens et services, c'est-à-dire les importations et les exportations ;
les transferts des ressortissants résidents à l’étranger ;
les investissements étrangers ; et
l’aide internationale et l’assistance au développement.
Au terme de cette procédure, les informations citées ci-dessous sont désagrégées en trois blocs de
pays ou régions: CEDEAO, Union européenne et Reste du monde. Le bloc de pays intitulé« CEDEAO » représente les échanges économiques des 12 économies couvertes par cette étude.
Par conséquent, les relations commerciales qu’entretiennent ces pays passent par un seul agent qui
achète les produits des économies de la sous-région (exportations des pays) pour satisfaire la
demande en provenance de ces économies (importations des pays). Par conséquent, nous ne
postulons pas une relation commerciale directe entre pays de l’espace CEDEAO (ou à plusieurs
agents-pays), mais plutôt une relation indirecte passant par un agent-régional.
Les importations et les exportations de biens sont collectées par pays d’origine et de destination.
Ces pays sont ensuite agrégés suivant les trois régions susmentionnées et les 11 produits identifiés
dans les MCS harmonisées. Des parts distributives sont calculées pour chaque région et utilisées
pour décomposer les valeurs des importations et des exportations des biens du compte reste du
monde des MCS harmonisées.
Des parts distributives moyennes sont également calculées pour l’ensemble des biens et utilisées
comme proxy pour repartir les échanges de services, les transferts prives et l’aide internationale.
Pour cette dernière, seuls l’Union européenne et le Reste du monde ont été considérés. Les parts
distributives moyennes des biens importés et exportés sont utilisées respectivement pour les flux
sortants et entrants.
4. Résultats empiriques
Il sera question dans cette section d’abord de présenter très brièvement les élasticités estimées pour
différents regroupements au sein de la CEDEAO. Ensuite, les estimations de consommation dans
les trois scénarii11 seront exposées. Enfin, les résultats de l’évaluation de la politique seront
présentés.
4.1 Elasticité estimée
Trois estimateurs sont utilisés pour l’estimation de l’équation (2). Il s’agit de l’estimateur dit Mean
Group (MG) qui suppose une hétérogénéité de la consommation du riz dans le panel de pays.
11
Ces scénarii seront discutés dans la deuxième sous‐section de cette section.L’estimateur Pooled Mean Group (PMG) qui postule une réponse hétérogène des divers pays à court terme mais une relation de long terme identique. Enfin, le modèle à effets fixes dynamique (DFE) qui fait l’hypothèse d’homogénéité régionale. Ces trois estimations sont comparées grâce à un test de Hausman comme suggéré par Pesaran et al. (1999). Avant ces estimations, le choix de retard optimal a été fait par l’entremise des critères d’information (AIC et BIC). Dans les différents groupements de pays effectués, le choix optimal est le modèle ARDL (1, 1, 1) en niveau. Ce modèle a été alors estimé par les trois estimateurs. Au niveau régional, l’élasticité revenu-consommation obtenu varie entre 0.5 et 0.988 pour les trois estimateurs. Le test de Hausman permet de retenir l’estimateur PMG qui donne une élasticité revenu de 0.527. Ce même estimateur est retenu dans le cas des pays de l’UEMOA et des pays qui ne sont pas membre de l’UEMOA. Pour les pays de l’UEMOA, l’élasticité est égale à 0.521 tandis que pour les autres pays, elle s’élève à 0.73. Lorsque l’on scinde les pays en deux groupes12 (petits consommateurs et gros consommateurs), l’estimateur MG est préféré. On obtient respectivement 0.645 pour les gros consommateurs et 0.306 pour les pays qui consomment moins de riz par habitant. 12 Les petits consommateurs sont formés des pays dans lesquels la consommation par tête est assez faible. Dans ce groupe, la consommation par tête minimale est de 3kg tandis que celle maximale est de 40kg avec une moyenne de 17 kg. Les pays de ce groupe sont : le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, le Niger, le Nigéria et le Togo. Le groupe des gros consommateurs est composés de la Côte d’Ivoire, de la Gambie, de la Guinée, de la Guinée Bissau, du Libéria, du mali, du Sénégal et de ma Sierra Léone. La consommation par tête dans ce groupe varie entre 16 et 192 kg avec une moyenne de 79 kg.
Tableau 2: Résultats des estimations
ECOWAS
MG estimator PMG estimator DFE
0.500 0.527 0.988
Income elasticity
(0.0542) (0.00761) (0.253)
0.00412 0.00340 0.00318
Price elasticity
(0.00517) (0.00329) (0.00237)
-0.584 -0.275 -0.331
Adjustment coefficient
(0.0919) (0.0921) (0.0376)
WAEMU
0.453 0.521 1.039
Income elasticity
(0.0720) (0.00798) (0.296)
0.00618 0.00818 0.00691
Price elasticity
(0.00646) (0.00387) (0.00340)
-0.607 -0.304 -0.378
Adjustment coefficient
(0.135) (0.139) (0.0509)
Non WAEMU
0.562 0.735 1.168
Income elasticity
(0.0822) (0.0220) (0.390)
0.00136 -0.00441 -0.00114
Price elasticity
(0.00905) (0.00317) (0.00318)
-0.552 -0.287 -0.344
Adjustment coefficient
(0.130) (0.0897) (0.0614)
High consumers’ countries
0.645 0.530 1.179
Income elasticity
(0.0384) (0.00762) (0.363)
-0.000722 0.00430 0.000953
Price elasticity
(0.00673) (0.00358) (0.00258)
-0.607 -0.387 -0.356
Adjustment coefficient
(0.149) (0.151) (0.0544)
Lowconsumers’ countries
0.306 0.433 0.634
Income elasticity
(0.0885) (0.0126) (0.329)0.0106 0.00162 0.00261
Price elasticity
(0.00795) (0.00239) (0.00439)
-0.553 -0.306 -0.381
Adjustment coefficient
(0.0970) (0.0971) (0.0586)
Source : calcul des auteurs à partir des données de l’UN-DESA, WDI et FMI
Il importe de remarquer que l’inflation qui augmente toutefois le pouvoir explicatif du modèle
n’est pas significatif dans la plupart des modèles. Son signe d’ailleurs n’est pas stable d’un modèle
à l’autre. Il n’a globalement ni d’impact à court terme ni à long terme.
Le tableau suivant fait ressortir les élasticités revenu-consommation retenues pour chaque
groupe :
Tableau 3: Mesure des élasticités par groupe de pays
Groupe CEDEAO UEMOA CEDEAO Non Gros Petit
UEMOA consommateur consommateur
Elasticité
0.527 0.521 0.735 0.645 0.306
revenu
Source : calcul des auteurs à partir des données de l’UN-DESA, WDI et FMI
4.2 Analyse prospective de la consommation de riz en Afrique de l’ouest
L’objectif des autorités de la CEDEAO est l’atteinte de l’autosuffisance en 2025 dans la région.
Ainsi, cette section présente trois cas de figures possibles du niveau de consommation à cet
horizon. Il s’agit de trois approches de modélisation du niveau de consommation que nous
appelons ici scénario.
Scénario A : ici, on suppose une constance de la consommation par tête (hypothèse de stabilité).
La dynamique de la consommation est uniquement due à celle de la population (projection obtenue
de UN DESA). Compte tenu de la forte variabilité de la consommation par tête au cours de ces dix
dernières années, deux cas sont examinés. Le premier cas prend pour base de la prévision la
consommation par tête de l’année 2012. Le second cas utilise plutôt la médiane des moyennes sur
deux ans, trois, …, neuf ans et dix ans.Vous pouvez aussi lire