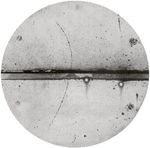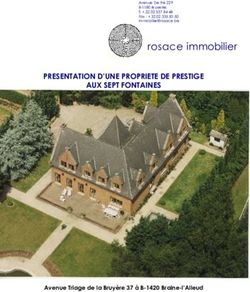Sur particules - Pour la Science
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
À LA RECHERCHE DE NOUVELLES PARTICULES
Si son étude n’avait dépendu
que de nos yeux, le modèle standard
serait bien vide. Heureusement,
les outils de détection, en progrès
croissants depuis un siècle, ont ouvert
une fenêtre sur l’invisible.
Chambres avec vue
sur particules
50
Une pluie de données ⟶
Les données, voilà les amies des physiciens. Cette
photographie, artistiquement colorisée, saisit l’interaction
entre particules dans la grande chambre à bulles
européenne, mise en service en 1973. En onze années
d’exploitation au Cern, cet instrument a enregistré
6,3 millions d’événements. Aujourd’hui, dans ce même
Cern, une expérience au Grand collisionneur de hadrons
(LHC) en capte autant en… moins de deux heures !
Pour la Science Hors-Série n° 114/Février-mars 2022À LA RECHERCHE DE NOUVELLES PARTICULES
⟵ Particule dans la brume
Photo historique ! Ce cliché, que l’on doit au physicien Carl D. Anderson,
montre la trace (flèche) laissée par le premier positron, l’antiparticule
de l’électron, jamais observé. C’était en 1932, à l’institut de technologie
de Californie (Caltech), dans une chambre à brouillard. L’enceinte contient
de la vapeur d’eau sursaturée. Quand des particules chargées la traversent,
elles ionisent la vapeur, qui se condense autour des ions pour former
des traînées de gouttelettes visibles le long de leur trajectoire.
52
Gargamelle et les neutrinos
Les années 1950 voient l’essor des chambres
à bulles, dans lesquelles un liquide surchauffé,
souvent du dihydrogène, est sur le point de
bouillir. Sur le passage d’une particule chargée,
la température d’ébullition est atteinte et des
bulles se forment. De la sorte, la chambre à bulles
Gargamelle, du Cern (ci-dessus), met en évidence
un courant neutre, interaction prédite par la
théorie mais jamais observée, entre un neutrino et
d’autres particules (ci-contre). Limites du procédé :
© Photothèque IN2P3/CNRS
la cadence des photographies est ralentie
par les réglages de température et de pression.
Et une légion de techniciens est nécessaire pour
éplucher les clichés à la recherche des très rares
événements intéressants pour la recherche.
Pour la Science Hors-Série n° 114/Février-mars 2022Chambres avec vue sur particules
53
Mieux que le fil d’Ariane, le multifils de Georges
Pour aller plus loin, la physique des En 1968, il développe la chambre est multipliée par 1 000,
particules exige vitesse et précision. proportionnelle multifils (ci-dessous, les opérations sont automatisables,
La chambre à étincelles est une étape. à gauche), enceinte remplie de gaz et gérables par ordinateur, bientôt
Mais la technologie de rupture arrive tendue de nombreux fils de détection visibles sur écran. En 1983, au Cern,
avec le physicien français Georges parallèles, mis sous tension électrique l’expérience UA1, complétée par UA2,
Charpak (ci-dessous, à droite), et connectés à des amplificateurs détecte les bosons W et Z, vecteurs
prix Nobel de physique en 1992. à transistors. La rapidité de comptage de l’interaction faible (ci-dessus).
© CERN et Photothèque IN2P3/CNRS
Pour la Science Hors-Série n° 114/Février-mars 2022À LA RECHERCHE DE NOUVELLES PARTICULES
54
© Maximilien Brice/CERN
Pour la Science Hors-Série n° 114/Février-mars 2022Chambres avec vue sur particules
Une carte Michelin à l’échelle subatomique
Désormais, des centaines de millions de collisions
proton-proton se produisent en 1 seconde dans le LHC :
impossible de tout enregistrer, les détecteurs géants 55
comme CMS (ci-dessus) n’en conservent que 1 000 par seconde.
Chaque événement est une superposition de dizaines
de collisions simultanées, qu’il faut séparer et trier
par informatique, à la recherche du bon « événement candidat ».
Visualiser ce maelström est aussi devenu un processus
très complexe, nécessitant des logiciels qui convertissent
les données en objets graphiques, eux-mêmes retravaillés grâce
à une application dédiée. Les caractéristiques choisies (angles,
couleurs, événement qui doit apparaître) varient
selon l’utilisation prévue : à gauche, capté par Atlas,
voici l’événement candidat de la désintégration d’un boson
de Higgs en deux taus, eux-mêmes désintégrés en électron
(ligne bleue) et en muon (ligne rouge). Comme une carte
vis-à-vis d’un paysage, ces représentations simplifient
les traits du monde quantique pour le rendre lisible
et permettre de s’y repérer.
© CERN
Pour la Science Hors-Série n° 114/Février-mars 2022Vous pouvez aussi lire