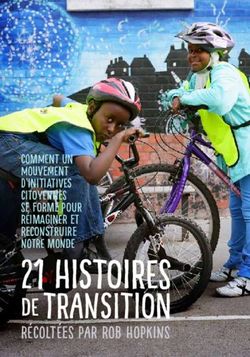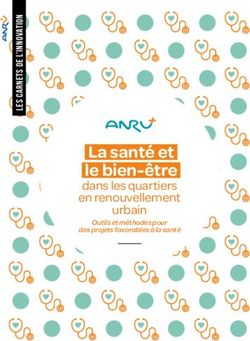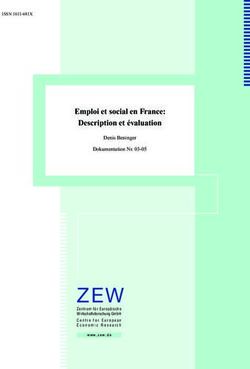Plan directeur de recherche Environnement pour les années 2017-2020 - Axes, domaines et thèmes de recherche prioritaires
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
2016 > Connaissance de l’environnement > Recherche
> Plan directeur de recherche
Environnement pour les années
2017–2020
Axes, domaines et thèmes de recherche prioritaires> Connaissance de l’environnement > Recherche
> Plan directeur de recherche
Environnement pour les années
2017–2020
Axes, domaines et thèmes de recherche prioritaires
Publié par l’Office fédéral de l’environnement OFEV
Berne, 2016> Plan directeur de recherche E nvironnement pour les années 2017– 2020 OFEV 2016 2 Impressum Éditeur Office fédéral de l’environnement (OFEV) L’OFEV est un office du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC). Auteurs Marie-Laure Pesch, Olivier Jacquat, Daniel Zürcher (OFEV) Accompagnement Organe consultatif pour la recherche environnementale ORE en collaboration avec les divisions de l’OFEV Référence bibliographique OFEV (éd.) 2016: Plan directeur de recherche Environnement pour les années 2017–2020. Axes, domaines et thèmes de recherche prioritaires. Office fédéral de l’environnement, Berne. Connaissance de l’environnement n° 1609: 70 p. Traduction Stéphane Cuennet, Fribourg Lectorat Philippe Litz (OFEV) Graphisme, mise en page Magma – die Markengestalter, Berne Photo de couverture Une guide de montagne fixe une bâche réfléchissante au-dessus de la grotte du glacier du Rhône (commune d’Obergoms), le 28 septembre 2014. @ Markus Forte, Ex-Press/OFEV Dépliant graphique Panorama de la recherche environnementale 2017–2020. © Marie Veya Jacquat, Berne Téléchargement au format PDF www.bafu.admin.ch/uw-1609-f Cette publication est également disponible en allemand. © OFEV 2016
> Table des matières 3
Table des matières
Abstracts 5 Biosécurité 38
Avant-propos 7 C hangements climatiques: atténuation et adaptation 39
G estion des dangers naturels et des risques techniques
Résumé 8 (accidents majeurs) 40
3.2 Thèmes de recherche transversaux 41
1 Introduction 9
1.1 La recherche de l’administration fédérale 9 4 Financement pour 2017– 2020 43
1.2 Plan directeur de recherche Environnement 9 4.1 Conséquences de la mise en œuvre des mesures
d’économie du programme CRT 2014 43
2 Aperçu du domaine politique Environnement 10 4.2 Financement de la recherche de l’OFEV en 2017–2020 43
2.1 Orientation stratégique du domaine
politique Environnement 10 5 Acteurs et interactions 45
2.2 Mandat légal de la recherche environnementale 5.1 Description des principaux acteurs dans le domaine des
de l’OFEV 11 universités et des hautes écoles spécialisées 45
2.3 La recherche environnementale de l’OFEV 11 5.2 Interactions avec le Fonds national suisse 46
2.4 Retour sur le plan directeur de recherche Environnement 5.3 Interactions avec la Commission pour la technologie
pour les années 2013–2016 12 et l’innovation 46
2.5 Financement de la recherche environnementale suisse 13 5.4 Interactions avec les académies des sciences 47
2.6 Défis et actions nécessaires pour la politique 5.5 Interactions avec d’autres offices fédéraux 47
et la recherche 16 5.6 Coopération internationale 48
3 Axes, domaines et thèmes de recherche prioritaires 6 Organisation et assurance de la qualité 52
pour la période 2017– 2020 18 6.1 Organisation interne 52
3.1 Aperçu des axes prioritaires et des domaines 6.2 Conseils fournis par l’organe d’accompagnement
de recherche 18 scientifique ORE 52
3.2 Domaines de recherche et thèmes prioritaires de l’OFEV 6.3 Assurance qualité 53
pour la période 2017–2020 18
Économie verte 20 Annexe 54
Communication dans le domaine de l’environnement 21 A1 Recherche de l’administration fédérale:
Éducation à l’environnement 22 informations générales
Affaires internationales 23 A1-1 Définition 54
Observation de l’environnement 24 A1-2 Mandat légal 54
Droit de l’environnement 25 A1-3 Coordination de la recherche de
Technologies environnementales 26 l’administration fédérale 55
Lutte contre le bruit et préservation A1-4 Objectifs de niveau supérieur pour
d’un environnement calme 27 la période 2017– 2020 57
Protection contre le rayonnement non ionisant (RNI) 28
Sites contaminés 29 A2 Projets soutenus par la CTI et liés à l’environnement
Air 30 en 2012 57
Sol 31 A3 Membres de l’organe consultatif pour la recherche
Eau 32 environnementale (ORE) 59
Biodiversité 33
Paysage 34 Bibliographie 60
Forêt et bois 35
Gestion des déchets et des matières premières 36 Répertoires 61
Sécurité des produits chimiques 37> Résumé 5
Abstracts
Environmental research provides an important basis for effective and efficient envi- Keywords:
ronmental and resource policy and contributes to the early identification of envi- environmental research, strategic
ronmental problems and the development of environmental and resource-efficient priorities, areas of research,
technologies. The FOEN’s environmental research focuses on application-oriented research needs, research of the
research, providing results needed by policymakers and the administration to fulfil Federal Administration
their tasks. The Master Plan for Environmental Research 2017–2020 sets out the
FOEN’s four research priorities and 21 areas of research and provides an overview of
the specific research needs in each area of research. It also gives an overview of the
multi-sectoral research topics within the office and the interactions between environ-
mental policy research and the tasks of other institutions and federal agencies.
Umweltforschung bildet eine wichtige Basis für eine wirksame und effiziente Stichwörter:
Umwelt- und Ressourcenpolitik und leistet einen Beitrag bei der Früherkennung Umweltforschung, Schwerpunkte,
von Umweltproblemen sowie bei der Entwicklung von umwelt- und ressourcen Forschungsbereiche, Forschungsbedarf,
schonenden Technologien. Die Umweltforschung des BAFU konzentriert sich auf Ressortforschung
die praxisnahe Forschung, deren Ergebnisse von Politik und Verwaltung direkt für
die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt werden. Das Forschungskonzept Umwelt
2017–2020 zeigt die vier Forschungsschwerpunkte und die 21 Forschungsberei-
che des BAFU auf und gibt einen Überblick über den konkreten Forschungsbe-
darf in den einzelnen Forschungsbereichen. Zudem vermittelt es einen Überblick
über bereichsübergreifende Forschungsfragen innerhalb des Amtes sowie über die
Schnittstellen zwischen der Forschung im Politikbereich Umwelt und Aufgaben
anderer Institutionen und Bundesstellen.
La recherche environnementale est essentielle pour garantir l’efficacité et l’efficience Mots-clés:
de la politique de l’environnement et des ressources. Elle contribue à identifier recherche environnementales,
précocement les problèmes environnementaux, ainsi qu’à développer des technolo- axes prioritaires, domaines
gies innovantes pour préserver l’environnement et les ressources. L’Office fédéral de recherche, besoins de recherche,
de l’environnement (OFEV) concentre ses travaux sur des recherches à caractère recherche de l’administration
pratique dont les résultats sont directement exploitables par les responsables poli- fédérale
tiques et l’administration dans l’accomplissement de leurs tâches. Le plan direc-
teur de recherche Environnement 2017–2020 présente les quatre axes prioritaires
et les 21 domaines de recherche de l’OFEV, avec un aperçu des besoins concrets
de chaque domaine. Il donne une vue d’ensemble des problématiques scientifiques
transversales au sein de l’office, ainsi que des interactions entre la recherche dans
le domaine des politiques environnementales et les tâches d’autres institutions et
services fédéraux.> Plan directeur de recherche E nvironnement pour les années 2017– 2020 OFEV 2016 6 La ricerca nel settore ambientale costituisce una base importante per un’incisiva ed Parole chiave: efficiente politica ambientale e di gestione delle risorse, contribuisce a riconoscere ricerca ambientale, priorità, campi tempestivamente i problemi ambientali come pure a sviluppare tecnologie volte a di ricerca, esigenza di ricerca, preservare l’ambiente e le risorse. La ricerca nel settore ambientale dell’UFAM si ricerca dell'Amministrazione federale focalizza sulla ricerca applicata e i relativi risultati vengono utilizzati dalla poli- tica e dall’amministrazione direttamente nel quadro dell’adempimento dei rispettivi compiti. Il Piano direttore di ricerca Ambiente 2017–2020 illustra le quattro priorità e i 21 campi di ricerca dell’UFAM e fornisce una panoramica dell’esigenza concreta di ricerca nei singoli campi. Inoltre, offre una vista d’insieme su questioni interset- toriali concernenti la ricerca effettuata dall’Ufficio nonché sui punti di convergenza tra la ricerca nell’ambito della politica settoriale nel settore ambientale e i compiti di altre istituzioni e servizi federali.
> Avant-propos 7
Avant-propos
La politique suisse de l’environnement et des ressources contribue à la conservation
à long terme des ressources naturelles et à leur utilisation durable. Elle permet de
préserver notre environnement et notre santé des nuisances et de protéger les per-
sonnes et les biens contre les dangers naturels. Pour accomplir leurs diverses tâches
et faire face aux défis futurs, les responsables politiques et l’administration doivent
disposer de réponses à des questions complexes, que l’on parle de la diminution
de la consommation de ressources, de l’atténuation des changements climatiques
ou de la conservation de la biodiversité. La recherche appliquée, proche de la pra-
tique, y contribue de manière déterminante. Elle fournit en outre des connaissances
importantes sur l’état et l’évolution des ressources naturelles et de l’environnement.
Ces informations sont indispensables pour la rédaction du rapport Environnement
Suisse 2018 du Conseil fédéral et la mise en œuvre des objectifs de développement
durable (Agenda 2030) liés à l’environnement.
Le présent plan directeur décrit les thèmes prioritaires de la recherche de l’Of-
fice fédéral de l’environnement (OFEV) pour les années 2017–2020. Les axes priori-
taires en sont les suivants: préservation et aménagement d’un environnement intact,
protection contre les polluants et les nuisances, protection et utilisation durable des
ressources et des écosystèmes, ainsi que maîtrise des changements climatiques et
prévention des dangers. À l’avenir, deux domaines de recherche renforceront encore
les thèmes transversaux: communication dans le domaine de l’environnement et
affaires internationales.
Il ne suffit plus de développer des mesures et des méthodes spécifiques à un
secteur. De nombreux problèmes environnementaux ne peuvent être résolus qu’à
l’aide d’approches intersectorielles. De plus en plus souvent, les questions aux-
quelles doit répondre la recherche combinent différentes thématiques. Quels effets
les mesures environnementales déploient-elles sur l’ensemble de la chaîne de consé-
quences? Comment formuler des mesures poursuivant plusieurs buts à la fois? Com-
ment informer et sensibiliser divers groupes cibles aux questions environnemen-
tales? Quels sont les effets sanitaires et les conséquences écotoxicologiques d’une
exposition simultanée à plusieurs nuisances environnementales, comme les pertur-
bateurs endocriniens, les polluants atmosphériques, le bruit, le rayonnement non
ionisant? Avec le plan directeur de recherche Environnement 2017–2020, l’OFEV
souhaite inciter les scientifiques à aborder davantage les problématiques intégrant
différentes thématiques et à profiter à cette fin de l’espace européen de la recherche.
L’OFEV remercie toutes les personnes qui ont contribué au plan directeur, en
particulier les membres de l’Organe consultatif pour la recherche environnementale
(ORE), qui ont accompagné ses activités de recherche en tant qu’experts et se sont
impliqués dans l’élaboration du présent document.
Karine Siegwart
Sous-directrice
Office fédéral de l’environnement> Plan directeur de recherche E nvironnement pour les années 2017– 2020 OFEV 2016 8
Résumé
En Suisse, la recherche environnementale est essentielle pour I. Actions pour la préservation et l’aménagement d’un
garantir l’efficacité et l’efficience de la politique de l’environ- environnement intact
nement et des ressources. Elle fournit aux responsables poli- II. Protection contre les polluants et les nuisances
tiques et à l’administration les connaissances qui leur sont III. Protection et utilisation durable des ressources et
nécessaires pour aménager des mesures appropriées en vue des écosystèmes
de protéger l’environnement contre les atteintes et de conser- IV. Maîtrise des changements climatiques et prévention
ver durablement les ressources naturelles telles que l’eau, le des dangers
sol, l’air, la biodiversité, la forêt ou les matières premières
rares. Elle assume encore d’autres tâches essentielles: iden- Ces axes prioritaires regroupent les 21 domaines de recherche
tifier à temps les nouveaux problèmes, évaluer les chances actuels de l’OFEV. Le présent plan directeur donne une vue
et les risques liés aux nouvelles technologies et développer d’ensemble des besoins concrets pour les divers domaines et
des processus et des technologies préservant l’environne- constitue ainsi le fondement de la planification financière et
ment et les ressources. La recherche environnementale suisse de l’attribution annuelle des moyens consacrés à la recherche
apporte des réponses très utiles à des questions importantes et environnementale de l’OFEV.
urgentes. Dans divers domaines, elle se situe à l’avant-garde La plupart des domaines de recherche présentent des
sur le plan international. recoupements thématiques avec d’autres axes prioritaires. Le
Dans le domaine de l’environnement, le paysage scienti- plan directeur actuel clarifie les problématiques scientifiques
fique suisse est très varié et ne cesse de se développer. Ses acti- touchant plusieurs secteurs au sein de l’office. En outre, de
vités couvrent un large éventail de thèmes liés aux sciences nombreuses questions concernent également des domaines de
naturelles, humaines et économiques, ainsi qu’aux sciences compétence d’autres offices fédéraux, notamment en matière
de l’ingénieur. Afin d’en obtenir une vue d’ensemble actuelle d’énergie, de mobilité, d’agriculture, de santé ou de coopé-
exhaustive et d’en faciliter la coordination, l’Office fédéral ration au développement. Il est important que les conflits
de l’environnement (OFEV) exploite une banque de données d’objectifs entre les thèmes environnementaux et les tâches
accessible au public qui inclut déjà plus de 1000 groupes de d’autres services fédéraux donnent lieu à une pesée des inté-
recherche issus d’institutions publiques ou privées. rêts qui repose sur des résultats de recherche actuels tenant
La recherche environnementale de l’OFEV se concentre compte de toutes les dimensions du problème. Le plan direc-
sur des études à caractère pratique dont les résultats sont teur fournit une vue d’ensemble des points de jonction avec
directement exploitables par les responsables politiques et les tâches et les thèmes d’autres institutions et services fédé-
l’administration dans l’accomplissement de leurs tâches, par raux, il identifie en outre les thèmes transversaux à traiter en
exemple pour mettre en œuvre des bases légales ou répondre collaboration avec ces acteurs.
aux demandes issues du Parlement. Elle doit à la fois fournir
les connaissances nécessaires pour faire face à long terme
aux défis qui se présentent dans le domaine environnemen-
tal et identifier des pistes pour résoudre à court terme des
problèmes urgents. Le plan directeur de recherche Environ-
nement 2017–2020 vise à garantir que la Suisse continuera à
disposer de bases scientifiques pour sa politique de l’environ-
nement et des ressources. À cet effet, il définit des objectifs
stratégiques correspondant à quatre axes prioritaires:1 > Introduction 9
1 Introduction
1.1 La recherche de l’administration fédérale Le présent Plan directeur de recherche Environnement pour
les années 2017–2020 se concentre sur les besoins de l’Of-
La recherche de l’administration fédérale se définit par des fice fédéral de l’environnement (OFEV). Il doit garantir que
activités scientifiques dont les résultats sont nécessaires à la Suisse continuera à disposer des bases scientifiques néces-
l’administration ou aux acteurs politiques fédéraux pour saires pour sa politique de l’environnement et des ressources.
accomplir leurs tâches, ou de recherches qui ont été lancées Pour cela, on a analysé les besoins dans tous les domaines
par l’administration parce qu’elles sont d’intérêt public. La spécialisés de l’office et défini les problématiques qui devront
recherche de l’administration fédérale permet par exemple être traitées en priorité pendant la période 2017–2020. Cette
d’élaborer les bases scientifiques nécessaires à la conception analyse sert de fondement à la planification financière et à
et à la mise en place de politiques dans divers domaines, de l’attribution des moyens consacrés à la recherche environ-
procéder à des travaux d’exécution dans le cadre défini par nementale de l’OFEV. Le plan directeur constitue un instru-
la loi ou de traiter et de mettre en œuvre des interventions ment de planification pour les divisions de l’office. Il facilite
parlementaires. Elle peut prendre toutes les formes scienti- la mise en œuvre concrète des activités de recherche et per-
fiques, de la recherche fondamentale à la recherche appliquée, met de contrôler qu’elles ont atteint leur but. Le plan direc-
sans oublier les synthèses et le développement technologique teur 2017–2020 jette par ailleurs un regard rétrospectif sur les
(par exemple dans le domaine des installations pilotes ou de activités de recherche des années 2013–2016 et rend compte
démonstration). Elle se fonde sur des bases légales claires. de l’utilisation des moyens qui leur ont été consacrés durant
D’une part, la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche cette période.
et de l’innovation (LERI) fait office de loi-cadre pour la
recherche de l’administration fédérale dans sa version totale-
ment révisée du 14 décembre 2012. Ces travaux scientifiques
se fondent d’autre part sur des dispositions légales spéciales
et sur les ordonnances qui s’y rapportent (voir 2.2). Enfin, cer-
tains engagements pris dans le cadre de traités internationaux
impliquent eux aussi des activités scientifiques. La recherche
de l’administration fédérale joue donc également un rôle
important sur le plan international.
1.2 Plan directeur de recherche Environnement
En Suisse, la recherche environnementale est essentielle
pour garantir l’efficacité et l’efficience de la politique de l’en-
vironnement et des ressources. Elle fournit des résultats et
des connaissances aux responsables politiques et à l’admi-
nistration, qui leur permettent de définir des objectifs et des
mesures dans le domaine environnemental et de contrôler
l’efficacité des décisions prises. Elle assume encore d’autres
tâches essentielles: identifier à temps les nouveaux problèmes,
évaluer les chances et les risques liés aux nouvelles techno-
logies et développer des processus et des technologies pré-
servant l’environnement et les ressources. La recherche envi-
ronnementale suisse aborde un large éventail de thèmes et
apporte des réponses très utiles à des questions importantes
et urgentes. Dans divers domaines, elle se situe à l’avant-garde
sur le plan international.> Plan directeur de recherche Environnement pour les années 2017– 2020 OFEV 2016 10
2 Aperçu du domaine politique
Environnement
! à protéger la population et les biens de valeur contre
2.1 Orientation stratégique du domaine les dangers naturels;
politique Environnement ! à mettre en œuvre la politique environnementale
internationale de la Suisse.
Préserver durablement les ressources Les thèmes prioritaires de l’OFEV
Les ressources naturelles sont limitées. Nombre d’entre elles À l’heure actuelle, les priorités de l’OFEV portent sur les
sont aujourd’hui surexploitées et leur utilisation continue quatre thèmes suivants:
d’augmenter. La politique environnementale de la Suisse a
pour mandat de pourvoir à ce que l’environnement reste pro- ! Renforcer une économie préservant les ressources:
tégé des atteintes, grâce à des mesures appropriées. Les res- Les technologies, les processus et les produits efficaces
sources naturelles telles que le sol, l’eau, l’air, la forêt ou la doivent permettre de réduire les atteintes à l’environ-
biodiversité ainsi que les matières premières rares et les presta- nement tout en renforçant l’économie suisse. La consom-
tions environnementales doivent être préservées durablement mation de ressources naturelles doit être ramenée à un
afin que les générations futures puissent aussi en disposer. niveau compatible avec le développement durable. Sur
Les modes de vie actuels dans les pays industrialisés et mandat du Conseil fédéral, l’OFEV met en œuvre diverses
les pays émergents ne sont pas durables et induisent une uti- mesures du plan d’action Économie verte, afin de rendre
lisation excessive des ressources naturelles. Si tous les êtres plus efficiente l’utilisation des ressources naturelles par
humains menaient le même train de vie que la population l’économie suisse, par exemple en encourageant la
helvétique actuelle, il nous faudrait disposer de 3,1 planètes consommation responsable et l’économie circulaire.
(Global Footprint Network 2015). En Suisse et dans le monde,
on a pris conscience qu’un mode de production et de consom- ! Contenir et gérer les changements climatiques: L’aug-
mation qui préserve davantage les ressources sera la seule voie mentation de la température au niveau mondial menace
vers une utilisation efficiente de celles-ci et la préservation les écosystèmes, la société et l’économie. Il faut continuer
durable de notre capital naturel. à réduire les émissions de gaz à effet de serre. En tant
que pays alpin exposé, la Suisse doit par ailleurs s’adapter
Les bases de la politique en matière d’environnement aux changements climatiques déjà constatés. Elle s’est
et de ressources fixé pour objectif de réduire ses émissions de gaz à effet
La Constitution fédérale de même que onze lois et 72 ordon- de serre de 20 % par rapport à 1990 d’ici à 2020, voire
nances forment les bases de la politique environnementale de de 30 % si d’autres États en font autant. Chaque année,
la Suisse, dont la mise en œuvre au niveau fédéral incombe à un tiers des recettes de la taxe sur le CO2 (300 millions de
l’OFEV. Ce dernier applique la politique de l’environnement francs au maximum) est alloué à l’assainissement de
et des ressources dans quatre domaines centraux, contribuant bâtiments, tandis qu’environ deux tiers sont reversés à la
ainsi: population et à l’économie. Dans le cadre de sa stratégie
! à préserver et à utiliser durablement les ressources d’adaptation, la Confédération a en outre élaboré un
naturelles (sol, eau, air, forêt, climat, diversité biologique plan d’action contenant les principales mesures. Sur le
et paysagère); plan international, la Suisse s’active afin d’être rattachée
! à préserver l’environnement et la santé humaine des au système européen d’échange de quotas d’émission
nuisances excessives dues au bruit, aux organismes et aux et s’engage aussi pour que les mesures d’adaptation des
substances nuisibles, au rayonnement non ionisant, aux pays en développement soient financées selon le principe
déchets, aux sites contaminés et aux accidents majeurs; du pollueur-payeur. Elle s’est activement engagée pour
que la communauté internationale adopte un traité
qui contraigne tous les États à prendre des mesures de
réduction des gaz à effet de serre.2 > Aperçu du domaine politique Environnement 11
>> Conserver la biodiversité: La biodiversité, c’est-à-dire 2.2 Mandat légal de la recherche
la diversité naturelle des gènes, des espèces et des environnementale de l’OFEV
écosystèmes, est une base naturelle indispensable à la vie,
qui fournit à la société et à l’économie des prestations Un mandat particulier dans le domaine de la recherche envi-
importantes appelés «services écosystémiques». On peut ronnementale découle de la loi fédérale sur la protection de
citer entre autres la fertilité des sols, la pollinisation l’environnement (LPE, art. 49, al. 2 et 3; RS 814.01). De plus,
des plantes domestiques par les insectes, la protection des d’autres lois et ordonnances confient des tâches de recherche
cultures par les espèces utiles, la protection contre les spécifiques à des organes de la Confédération: loi sur les pro-
glissements de terrain ou la mise à disposition de matières duits chimiques (LChim, art. 37; RS 813.1), loi sur le génie
premières pour la fabrication de médicaments. La Suisse génétique (LGG, art. 26; RS 814.91), loi sur la protection
s’est engagée au niveau international à mettre en œuvre des eaux (LEaux, art. 50 et 57; RS 814.20), loi sur la chasse
des mesures pour stopper l’appauvrissement de la biodi- (LChP, art. 14; RS 922.0), loi sur la pêche (LFSP, art. 12; RS
versité. En se fondant sur la Stratégie Biodiversité Suisse, 923.0), loi sur la réduction du bruit émis par les chemins de
adoptée par le Conseil fédéral, l’OFEV élabore actuel fer (LBCF, art. 10a; RS 742.144), loi sur la protection de la
lement un plan d’action en collaboration avec les acteurs nature et du paysage (LPN, art. 14a et 23l; RS 451), loi sur les
de la société civile. Le but est de conserver une biodi forêts (LFo, art. 31; RS 921.0) et loi sur l’aménagement des
versité riche et résiliente aux changements, avec toutes les cours d’eau (art. 13; RS 721.100).
prestations qui lui sont liées.
>> Renforcer la mise en application ainsi que l’observation 2.3 La recherche environnementale de l’OFEV
de l’environnement: Dans de nombreux domaines, la
Suisse dispose d’une législation environnementale déjà L’OFEV se consacre principalement à des travaux de recherche
avancée, si bien qu’à l’avenir l’accent devra porter à caractère pratique, dont les résultats sont directement exploi-
moins sur l’élaboration de lois et d’ordonnances que sur la tables par les responsables politiques et par l’administration
mise en œuvre optimale de celles-ci. L’OFEV veut pour l’accomplissement de leurs tâches. La recherche envi
consolider les instruments d’exécution existants et combler ronnementale de l’OFEV doit à la fois fournir les connais-
les lacunes si nécessaire. Il souhaite aussi soutenir les sances nécessaires pour faire face à long terme aux défis qui
cantons dans leurs travaux d’exécution et renforcer la se présentent dans le domaine de l’environnement et identifier
surveillance. L’observation de l’environnement fournit des des pistes pour résoudre à court terme des problèmes urgents.
informations sur l’état et l’évolution de celui-ci. Les séries Ses travaux sont déterminés d’une part par les mandats
de valeurs mesurées et les données enregistrées sur découlant de la législation et d’autre part par les besoins poli-
plusieurs années permettent d’évaluer l’effet des mesures tiques du moment. La planification des activités de recherche
prises jusqu’ici. Plus ces renseignements sont complets doit donc être suffisamment souple pour autoriser les chan-
et fiables, plus la politique environnementale, les prescrip- gements de priorités et le traitement des questions urgentes.
tions et les mesures adoptées peuvent protéger efficace- En rapport étroit avec la pratique et axée sur la résolution des
ment les bases naturelles de la vie. problèmes, la recherche de l’OFEV est en grande partie inter-
disciplinaire et transdisciplinaire. Il est très important pour
ses responsables d’intégrer tous les acteurs concernés dès le
début de la recherche de solutions.
Contrairement aux services fédéraux œuvrant dans
d’autres domaines politiques, l’OFEV n’est pas doté d’insti-
tuts de recherche. Pour couvrir ses besoins, il doit donc col-
laborer avec des spécialistes extérieurs travaillant dans des
universités, des hautes écoles spécialisées, des établissements
de recherche, des institutions privées et d’autres services fédé-
raux (p. ex. MétéoSuisse). Les projets (mandats ou contribu-
tions de recherche) sont attribués conformément à la loi et
à l’ordonnance fédérales sur les marchés publics (LMP, RS
172.056.1; OMP, RS 172.056.11).> Plan directeur de recherche E nvironnement pour les années 2017– 2020 OFEV 2016 12
2.4 Retour sur le plan directeur de recherche contre le rayonnement non ionisant, ainsi que la lutte contre le
Environnement pour les années 2013 –2016 bruit. Les domaines du sol, de l’eau, de l’air, de la biodiversité,
du paysage, de la forêt et du bois ainsi que de la gestion des
Alors que les plans directeurs précédents étaient axés princi- déchets formaient quant à eux l’axe prioritaire III «Utilisation
palement sur l’ensemble de la recherche environnementale en durable des ressources». Enfin, l’atténuation des changements
Suisse, celui établi pour la période 2013–2016 se concentrait climatiques ainsi que l’adaptation à ceux-ci formaient à elles
davantage sur les besoins de l’OFEV, si bien qu’il pouvait ser- seules l’axe prioritaire IV, alors que la gestion des dangers
vir d’instrument de planification pour les divisions de l’office. naturels et des risques techniques constituait l’axe prioritaire V.
Les axes prioritaires suivants avaient été fixés dans le plan Dans le plan directeur, afin de couvrir les besoins, l’OFEV
directeur de recherche pour la période 2013–2016: prévoyait un total de 40 millions de francs pour la recherche
des années 2013–2016 (fig. 1). Plus de la moitié de ce mon-
I. Actions pour la préservation et l’aménagement d’un tant (52 %) était planifiée pour l’axe prioritaire III. Arrivaient
environnement intact ensuite les axes prioritaires II (19 %) et I (15 %), puis les axes
II. Protection contre les polluants et les nuisances IV et V avec 7 % chacun. La répartition détaillée des moyens
III. Utilisation durable des ressources consacrés à la recherche dans les divers domaines figure dans
IV. Changements climatiques: atténuation et adaptation le Plan directeur de recherche Environnement pour les années
V. Gestion intégrale des risques 2013–2016 (OFEV 2012b).
Pour la période 2013–2016, l’OFEV ne dispose que de
Ces axes prioritaires ont été divisés en 18 domaines de 28.9 millions de francs, qui financent quelque 150 projets de
recherche. Les domaines transversaux que sont le droit de recherche. Les moyens effectifs pour ces années restent donc
l’environnement, l’économie verte, les technologies environ- largement inférieurs aux montants prévus pour la recherche.
nementales, l’observation de l’environnement et l’éducation à La fig. 1 présente leur répartition entre les cinq axes priori-
l’environnement ont été rattachés à l’axe prioritaire I, car ils taires. Malgré les mesures d’économie, des projets ont pu être
sont étroitement liés à des actions transversales en faveur de lancés dans tous les domaines. Cependant, en raison du bud-
l’environnement. Les autres domaines étaient rattachés à l’un get restreint, certains projets n’ont pas pu être réalisés ou ont
ou à l’autre des axes prioritaires II à V. L’axe prioritaire II été retardés.
«Protection contre les polluants et les nuisances» incluait la Les résultats des diverses études sont surtout utiles pour
sécurité des produits chimiques, la biosécurité, la protection les travaux législatifs, les activités d’exécution menées dans le
Axes prioritaires 2013–2016
Planification financière selon le plan Répartition effective
directeur de recherche Environnement des moyens financiers
7% 15 % 7% 15 %
3%
7% AP I Actions pour la préservation
et l’aménagement
d’un environnement intact
AP II Protection contre les polluants
19 % et les nuisances
24 % AP III Utilisation durable des ressources
AP IV Changements climatiques:
atténuation et adaptation
AP V Gestion intégrale des risques
51 %
52 %
Total: 40 millions CHF Total: 28.9 millions CHF
Fig. 1 Comparaison entre les moyens prévus par le Plan directeur de recherche Environnement pour les années 2013–2016 et
la répartition effective des montants consacrés à la recherche selon l’axe prioritaire (AP) pour la période concernée, en %.2 > Aperçu du domaine politique Environnement 13
cadre des lois ainsi que la formulation de stratégies politiques. soutiennent aussi la recherche environnementale dans les
Ils sont mis à la disposition de divers acteurs, qu’il s’agisse des hautes écoles grâce aux contributions octroyées par le Fonds
autorités cantonales d’exécution, des secteurs économiques national suisse (FNS), la Commission pour la technologie et
concernés, d’autres services fédéraux, du Parlement ou du l’innovation (CTI) et la promotion des technologies environ-
grand public. À titre d’exemple, le chapitre 2 décrit dans le nementales ainsi que par l’intermédiaire des mandats de la
détail les résultats obtenus dans le cadre de quatre projets de recherche attribués par l’OFEV.
recherche: «Changement climatique et hydrologie en Suisse», L’économie privée joue par ailleurs un rôle impor-
«Flux d’azote en 2020», «Impact environnemental global de la tant non seulement dans la réalisation de la recherche envi-
consommation suisse» et «Parcs d’éco-innovation». ronnementale mais aussi dans son financement. Alors que
les dépenses liées à la réalisation ont légèrement augmenté
par rapport à 2008, le financement est resté stable. La part
2.5 Financement de la recherche de l’économie privée au financement s’est ainsi légèrement
environnementale suisse réduite, passant de 32 % à 27 %.
Du côté du financement, c’est le FNS qui enregistre
La recherche de l’administration fédérale ne couvre qu’une la plus forte hausse. Alors qu’il avait investi 77 millions de
petite partie du financement de la recherche environne francs dans la recherche environnementale en 2008, ce mon-
mentale en Suisse. Afin d’obtenir un aperçu des principaux tant est déjà passé à 102 millions en 2012, ce qui représente
acteurs, les flux financiers de l’ensemble de la recherche une croissance de 32 %.
environnementale helvétique ont été estimés pour l’année Par ailleurs, les sommes investies par la CTI dans la
de référence 2012 (tableau 1) et comparés à ceux de l’année recherche environnementale liée à l’industrie ont presque
2008 (OFEV 2012b). Les données des budgets des institutions doublé entre 2008 et 2012, passant de 4.3 millions à 7.8 mil-
publiques (tableau 1, colonne «Réalisation») ont été saisies lions de francs. Les programmes-cadres de l’UE, les actions
afin de constituer une vue d’ensemble de tous les groupes de COST et les projets EUREKA restent dans le même ordre
chercheurs du domaine de l’environnement (banque de don- de grandeur qu’en 2008 et les contributions des programmes
nées, voir 5.1). La catégorie «contribution aux hautes écoles» de recherche internationaux ont ainsi légèrement reculé. Le
est déduite de manière indirecte en calculant la différence financement octroyé par la recherche de l’administration
entre les contributions totales du point de vue de la réalisa- fédérale est resté constant.
tion et de celui du financement. Les collectivités publiques
Tableau 1 Financement et réalisation de la recherche dans le domaine de l’environnement en 2012
Financement 2012 millions CHF Réalisation 2012 millions CHF
Acteurs Acteurs
FNS, projets (division I à III) 53.1 EPF de Zurich et de Lausanne 186.1
FNS, programmes (IV) 24.1 Instituts de recherche du domaine EPF 139.5
FNS, autres programmes 25.3 Universités cantonales 152.6
Confédération, recherche de l’administration fédérale 15.9 Hautes écoles spécialisées 78.3
Académies 3.1 Instituts de recherche publics 10.0
UE, programmes-cadres 12.6 Académies 3.1
COST 1.8 Organisations privées à but non lucratif 4.5
EUREKA 0.8 Économie privée 288.9
SEFRI, programme spatial 3.8
CTI 7.8
Contributions aux hautes écoles 481.0
Économie privée 233.7
Total 863.0 Total 863.0
Sources: Office fédéral de la statistique (OFS 2014a, 2014b), Fonds national suisse (FNS 2014), Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI 2014),
Commission pour la technologie et l’innovation (CTI 2014), Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT 2013) et relevés spécifiques> Plan directeur de recherche E nvironnement pour les années 2017– 2020 OFEV 2016 14
Exemple de projet 1
Changement climatique et hydrologie en Suisse régions. En été, les débits reculeront et les périodes d’étiage se feront plus
fréquentes. Au plan local et régional, des pénuries d’eau se manifesteront
Les effets des changements climatiques sur le régime des eaux placent la plus souvent et exigeront que l’on adapte la gestion de cette ressource.
Suisse devant de nouveaux défis, notamment dans les domaines de la pro-
tection contre les crues, de l’agriculture, du tourisme et de la production
d’énergie. Afin de disposer des connaissances hydrologiques nécessaires
à l’élaboration de la stratégie «Adaptation aux changements climatiques
en Suisse», le projet «Changement climatique et hydrologie en Suisse»
(CCHydro) a étudié les effets de l’évolution du climat sur les eaux et les
ressources en eau du pays jusqu’à la fin du siècle (OFEV 2012a).
Au cours des vingt prochaines années, les ressources hydriques annuelles
de la Suisse ne vont guère évoluer, si l’on excepte les bassins versants
comptant de larges surfaces de glaciers, dans lesquels les débits augmen-
teront provisoirement en raison de la fonte de la glace. Comme les chan-
gements climatiques accroissent la température de l’air et élèvent ainsi la
limite des chutes de neige, les masses de neige et de glace stockées dans
les Alpes vont fortement diminuer. En 2100, il ne devrait subsister que
30 % du volume de glace actuel. Avec la nouvelle répartition saisonnière
des précipitations (diminution en été et augmentation en hiver), la distri-
bution annuelle des débits va se modifier. En hiver, les volumes vont aug-
menter et la période de crue potentielle va s’allonger dans de nombreuses
Exemple de projet 2
Flux d’azote en 2020 limite d’immission pour le NO 2 pourra être respectée. Il reste donc indis-
pensable d’agir. Les potentiels de réduction seront toutefois déjà épui-
Accélérée par les activités humaines, la dissémination de composés sés en bonne partie dans le cas des installations de combustion et des
d’azote réactifs (tels que l’ammoniac ou les oxydes d’azote NO x) induit des véhicules. Une marge de manœuvre importante persiste en revanche pour
effets indésirables: surfertilisation d’écosystèmes sensibles, acidification réduire les émissions d’ammoniac du secteur agricole: on peut encore
des sols, formation de poussières fines secondaires ou émissions de gaz obtenir des effets substantiels en mettant en œuvre certaines mesures
à effet de serre. Le projet «Flux d’azote en 2020» a permis de quanti- techniques dans le domaine de l’élevage ainsi que pour le stockage et
fier les flux d’azote (N) influant sur l’environnement pour l’année 2020 et l’épandage des engrais de ferme.
d’analyser les effets des mesures décidées ou planifiées dans le cadre des
politiques de l’énergie, du climat, de l’agriculture et de la protection de l’air
(Heldstab et al. 2013).
Entre 2005 et 2020, on peut s’attendre à ce que les émissions de NO x
reculent de 36 % dans l’ensemble, notamment grâce aux progrès tech-
niques réalisés dans le traitement des gaz d’échappement des véhicules.
Cette évolution provoque une diminution des dépôts d’azote dans les sols
et y réduit donc aussi le lessivage de celui-ci. La charge en azote des eaux
usées continue d’augmenter en raison de la croissance démographique,
mais cette hausse peut être compensée par l’amélioration des techniques
d’épuration. Par rapport à 2005, certains flux d’azote agricoles enre-
gistrent des changements. Dans l’ensemble, les apports (fourrages, en-
grais chimiques, déposition et fixation de l’azote) reculent de quelque 5 %,
alors que les prélèvements (produits végétaux et animaux) augmentent
de 2 %. Sans mesures supplémentaires, les flux d’azote agricoles restent
pratiquement à leur niveau excessif actuel.
À elles seules, les décisions planifiées ou décidées ne permettront pas
d’atteindre les objectifs de réduction contraignants fixés sur le plan na-
tional ou international pour la période allant jusqu’à 2020. Seule la valeur2 > Aperçu du domaine politique Environnement 15
Exemple de projet 3
Impact environnemental de ce qui indique que l’efficacité des ressources s’est accrue. Malgré cela,
l’impact environnemental global doit encore être réduit de moitié pour que
la consommation suisse
la consommation de ressources n’excède plus ce que peut supporter la
La consommation en Suisse a aussi un impact sur l’environnement à nature.
l’étranger. Dans le cadre d’un projet de recherche, l’OFEV a évalué pour la
première fois l’évolution de l’impact environnemental global – en Suisse et
à l’étranger – de la consommation helvétique pour la période 1996–2011.
Pour cela, il a recouru à des données sur les émissions et sur l’utilisation
de ressources, et mis en relation les chiffres des écobilans et des flux
commerciaux (Frischknecht et al. 2014). L’étude a pris en compte tout le
cycle de vie des produits et tous les domaines environnementaux perti-
nents, soit les émissions de gaz à effet de serre, la pollution atmosphé-
rique, l’utilisation du sol, la consommation d’eau, l’azote (eutrophisation)
et la consommation d’énergie primaire.
Les résultats obtenus montrent que les atteintes ont diminué dans le pays
pendant la période examinée, mais qu’elles ont fortement augmenté à
l’étranger. La Suisse délocalise donc de plus en plus ses impacts environ-
nementaux: de 56 % en 1996, la part des atteintes hors du pays est passée
à 73 % en 2011. Durant les années prises en compte, l’impact induit par
la consommation helvétique a progressé moins fortement que l’économie,
Exemple de projet 4
Parcs d’éco-innovation coordination entre les entreprises, la coopération avec les milieux scien-
tifiques et la désignation univoque du site comme parc d’éco-innovation.
De nombreux pays et régions élaborent des stratégies d’éco-innovation Ces résultats fournissent des indications précieuses pour optimiser les
afin de favoriser un développement économique qui respecte les principes initiatives locales suisses du point de vue de la protection de l’environne-
du développement durable et de réduire les atteintes à l’environnement. ment et de la préservation des ressources.
Dans le cadre de l’ERA-Net ECO-INNOVERA, l’OFEV a mené une enquête
internationale sur les parcs industriels qui mettent en œuvre des éco-inno-
vations et des symbioses industrielles (Massard et al. 2014). L’étude décrit
168 parcs d’éco-innovation accueillant des projets industriels ou urbains
durables à l’échelle du parc ou du quartier, dans 27 pays. Se fondant sur
douze critères écologiques, elle a examiné différentes combinaisons de me-
sures environnementales et de modèles d’affaires qui induisent des avan-
tages économiques, écologiques et sociaux pour le parc et ses alentours.
La plupart des parcs d’éco-innovation identifiés mènent des activités
qui remplissent jusqu’à cinq des douze critères définis. Le critère mis en
œuvre le plus souvent concerne la gestion des déchets, suivie de l’effi-
cacité énergétique et de la gestion de l’eau. Rares sont les parcs qui ont
adopté une approche globale respectant au moins huit critères. L’analyse
des pratiques éprouvées et des facteurs de réussite met en évidence trois
éléments contribuant fortement au succès: l’existence d’un service de> Plan directeur de recherche E nvironnement pour les années 2017– 2020 OFEV 2016 16
Pour ce qui est de la réalisation, on constate une augmentation que sont les changements climatiques, la croissance démogra-
des activités de recherche environnementale dans les hautes phique et l’urbanisation, le niveau de vie peut être maintenu
écoles spécialisées. Leurs dépenses en la matière sont passées en utilisant les ressources naturelles disponibles et sans nuire
de 49.1 millions à 78.3 millions de francs, ce qui correspond ni à la diversité des espèces, ni au climat, ni aux écosystèmes
à une hausse de 60 %. Dans le domaine des EPF, ces activi- (WBCSD 2010).
tés ont eu tendance à se déplacer des instituts de recherche Le Programme des Nations Unies pour l’environne-
spécifiques (Eawag, Empa, PSI, WSL) vers les Écoles poly- ment (PNUE) mentionne les thèmes suivants comme priorités
techniques fédérales de Zurich (EPFZ) et de Lausanne actuelles et futures: changements climatiques, catastrophes et
(EPFL): alors que ces hautes écoles ont accru leurs dépenses conflits, gestion des écosystèmes, gouvernance de l’environne-
de recherche environnementale de 46 %, les faisant passer ment, substances nocives et déchets dangereux ainsi qu’utili-
de 127.4 millions à 186 millions de francs, ces montants ont sation efficace des ressources (PNUE 2015). Quant à l’Agence
baissé de 12 % dans les instituts du domaine des EPF (de européenne pour l’environnement (AEE), elle mentionne les
157.9 millions à 139.5 millions). Les dépenses des universités principaux défis suivants: protection, conservation et renfor-
cantonales ont quant à elles augmenté de quelque 20 % entre cement du capital naturel, utilisation efficace des ressources et
2008 et 2012. économie sobre en carbone ainsi que protection des personnes
Au total, les moyens consacrés à la recherche environ- contre les risques environnementaux pour la santé (AEE 2015).
nementale sont passés de 738 millions de francs en 2008 à Pour l’AEE, les défis les plus difficiles proviennent du fait que
862.9 millions en 2012, ce qui correspond à une croissance les facteurs, les tendances et les impacts environnementaux
annuelle d’environ 4 %. se mondialisent de plus en plus et que de grandes tendances à
long terme affectent l’état de l’environnement en Europe. Par
conséquent, les systèmes de production et de consommation
2.6 Défis et actions nécessaires pour la politique devront subir des changements radicaux si l’on souhaite s’atta-
et la recherche quer aux problèmes écologiques à leur source.
En juin 2012, lors de la Conférence des Nations Unies
sur le développement durable, une importante plate-forme de
Dimension internationale recherche internationale a été lancée, en dehors de l’UE, sous
Diverses organisations internationales ont examiné les défis l’appellation Future Earth. Entièrement opérationnelle à partir
auxquels la politique de l’environnement doit actuellement de 2016, elle a pour objectif de fournir des connaissances et un
faire face sur le plan mondial. Elles ont également formulé appui à l’échelle mondiale, nationale, régionale et locale afin
leur vision de l’avenir et identifié des champs d’action prio- d’accélérer le passage à une société durable. La plate-forme,
ritaires. «En 2050, nous vivons bien, dans les limites écolo- qui est ouverte aux scientifiques de toutes les disciplines, sou-
giques de notre planète», indique par exemple l’idée direc- haiterait également garantir que le savoir soit généré en coo-
trice du 7e Programme d’action général pour l’environnement pération avec la société et les utilisateurs de la science. Elle
de l’Union européenne (EC 2015). Comme fondement d’une doit élaborer des stratégies permettant de réduire les risques
société prospère, l’UE vise ainsi une production pauvre en environnementaux et, simultanément, d’atteindre les Objec-
carbone, une économie circulaire préservant l’environnement tifs pour le développement durable (ODD). Les connaissances
et des écosystèmes résistants. La croissance économique doit mises à disposition doivent aider les décideurs et favoriser
être découplée de l’utilisation des ressources. Sur le plan l’évolution de la société dans trois thèmes de recherche prin-
mondial, la communauté internationale a adopté en 2015 cipaux: dynamique planétaire, développement durable mon-
des Objectifs pour le développement durable (ODD). Ils suc- dial et transition vers la durabilité. La plate-forme est portée
cèdent aux Objectifs du Millénaire pour le développement et par une alliance internationale scientifique et technologique
abordent le développement durable et la lutte contre la pau- réunissant notamment le Conseil international pour la science
vreté avec des priorités et des objectifs communs. Dans la (CIUS), le Conseil international des sciences sociales (CISS),
prise de position de la Suisse concernant le développement l’UNESCO, le PNUE et l’Organisation météorologique mon-
durable après 2015, le Conseil fédéral adopte lui aussi pour diale (OMM) (Future Earth 2015).
principe le respect des limites écologiques de la planète (DDC Rockström et al. (2009) ont essayé de quantifier, pour
2014). Quant au Conseil mondial des affaires pour le déve- la planète Terre, les limites («planetary boundaries») à l’inté-
loppement durable (WBCSD), il formule une vision d’avenir rieur desquelles des conditions stables pour le développement
similaire à celle de l’UE: en 2050, quelque neuf milliards de de l’humanité restent garanties. Ils ont calculé des valeurs
personnes doivent bien vivre sur Terre, dans le respect des seuils spécifiques applicables à l’utilisation ou à la détério-
ressources limitées de celle-ci; face aux tendances de fond ration des principaux systèmes et processus (changementsVous pouvez aussi lire