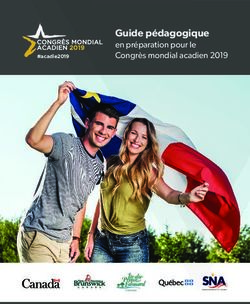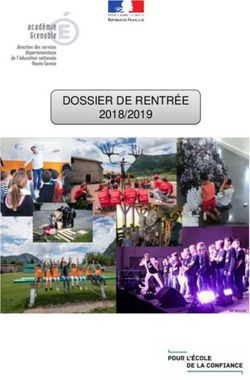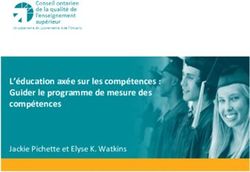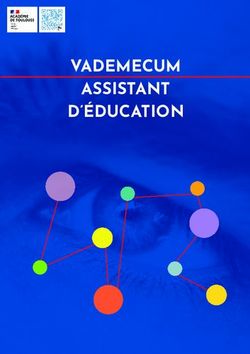CONTRIBUTION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE - CNCDH
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
RAPPORT SUR LA LUTTE CONTRE LE RACISME, L’ANTISEMITISME ET LA XENOPHOBIE 2017 –
CONTRIBUTION DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
CONTRIBUTION DU MINISTERE DE
L’EDUCATION NATIONALE
La présente contribution répond aux souhaits de la Commission nationale consultative des
droits de l’homme (CNCDH) de disposer d’une part d’un état des lieux du racisme dans
l’institution scolaire et de la manière dont il est documenté par des enquêtes statistiques et
d’autres outils de mesure et de pilotage, de savoir d’autre part quelles suites ont été données
aux recommandations formulées dans le rapport établi pour l’année 2016. Le texte qui suit
présente d’abord un bilan chiffré du racisme en milieu scolaire, ensuite un état de la politique
éducative menée en 2017, en lien avec les recommandations de la CNCDH, classées par
thème. La dernière partie du texte répond aux deux questions formulées précisément par la
CNCDH : la première est relative aux nouveaux textes publiés par le ministère ; la seconde
au bilan de l’action du ministère, qui s’inscrit dans la mise en œuvre du plan gouvernemental
2015-2017 « La République mobilisée contre le racisme et l’antisémitisme », en cours
d’évaluation par une mission conjointe des inspections générales de l’administration (IGA) et
de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR).
I - Bilan chiffré du racisme, de l’antisémitisme et de la xénophobie en
milieu scolaire
Les actes à caractère raciste, xénophobe ou antisémite dans l’enquête SIVIS
Menée depuis la rentrée 2007 auprès des chefs d’établissements, l’enquête SIVIS (Système
d’Information et de Vigilance sur la Sécurité scolaire) recueille des données sur les incidents
graves survenus en milieu scolaire, dans une définition plus large que les seuls actes de
violence. Les actes à caractère discriminatoire (raciste, xénophobe ou antisémite) font l’objet
d’un repérage spécifique : la motivation discriminante est considérée comme une
circonstance aggravante qui permet d’enregistrer tout acte de ce type, quelles que soient par
ailleurs ses caractéristiques.
En 2016-2017, les actes à caractère raciste, xénophobe ou antisémite représentent
moins d’un incident pour 1000 élèves
Depuis la mise en place de l’enquête, le nombre d’actes graves à caractère discriminatoire
affiche une relative stabilité. Au titre de l’année scolaire 2016-2017, les incidents motivés par
le racisme, la xénophobie ou l’antisémitisme représentent 0,5 incident pour 1000 élèves. En
proportion, les incidents à caractère discriminatoire comptent pour 3,5 % de l’ensemble des
actes graves, une part comparable à celle observée l’an dernier.
1RAPPORT SUR LA LUTTE CONTRE LE RACISME, L’ANTISEMITISME ET LA XENOPHOBIE 2017 –
CONTRIBUTION DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Tableau 1 - Nombre moyen d'incidents graves pour 1000 élèves
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Incidents graves 11,6 10,5 11,2 12,6 13,6 14,4 13,1 12,4 12,8 13,8
Incidents à caractère
raciste, xénophobe ou 0,6 0,4 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5
antisémite
En proportion des 4,9% 3,9% 5,1% 4,2% 3,5% 2,9% 3,8% 3,8% 3,3% 3,5%
incidents graves
Source : MEN-DEPP, enquête SIVIS
Champ : ensemble des établissements publics du second degré (Métropole et DOM)
Le nombre d’actes à caractère raciste, xénophobe ou antisémite est stable quel que
soit le type d’établissement
La proportion d’actes graves à caractère discriminatoire observés en collège est quasi stable
par rapport à 2015-2016, à 3,8 %. Elle augmente légèrement en LP (3,4 %) et baisse un peu
en LEGT-LPO (2,3 %). En nombre d’incidents, on compte comme l’an dernier 0,5 incident à
caractère discriminatoire pour 1000 élèves en collège. En LP, 0,9 et en LEGT-LPO, 0,1.
Tableau 2 - Nombre et proportion d'incidents à caractère discriminatoire par type
d'établissement
2015-2016 2016-2017
Type
Proportion d'actes à Nombre Proportion d'actes à Nombre
d'établissement
motivation raciste, d'incidents pour motivation raciste, d'incidents pour
xénophobe ou antisémite 1000 élèves xénophobe ou antisémite 1000 élèves
Collèges 3,5% 0,5 3,8% 0,5
LP 2,9% 0,7 3,4% 0,9
LEGT-LPO 3,0% 0,2 2,3% 0,1
Source : MEN-DEPP, enquête SIVIS
Champ : ensemble des établissements publics du second degré (Métropole et DOM)
Les actes à caractère raciste, xénophobe ou antisémite s’expriment majoritairement
par des violences verbales
Les incidents graves à caractère discriminatoire se distinguent par une prépondérance des
violences verbales, dont la proportion s’élève à 65 %. A titre de comparaison les violences
verbales parmi l’ensemble des faits graves représentent 44 % des déclarations.
En second lieu viennent les violences physiques qui représentent 30 % des faits cette
année. Dans l’ensemble des faits recensés, la part des violences physiques s’élève à 32 %.
Depuis l’année dernière, la part des violences physiques liées à une motivation
discriminatoire a augmenté de 9 points et celle des violences verbale a baissé de 10 points.
Ces violences s’exercent principalement entre les élèves
Les auteurs de violence à caractère discriminatoire sont très majoritairement des élèves, à
hauteur de 95 % des incidents. Dans moins de 2 % des cas, ces actes sont le fait de familles
d’élèves, les personnels étant très rarement impliqués.
Les victimes d’élèves sont pour 70 % d’entre elles des élèves ; cette part n’est que de 41 %
pour l’ensemble des incidents graves). Par ailleurs, les personnels représentent 20 % des
victimes d’élèves dans le cas d’une violence à caractère discriminatoire, contre 43% si l’on
considère l’ensemble des incidents. Enfin, 8 % des atteintes à caractère discriminatoire
(contre 14 % de l’ensemble des incidents) ciblent la collectivité.
2RAPPORT SUR LA LUTTE CONTRE LE RACISME, L’ANTISEMITISME ET LA XENOPHOBIE 2017 –
CONTRIBUTION DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Par rapport à l’an dernier, le profil des victimes de violence à caractère discriminatoire
commises par des élèves est le même : parmi ces victimes, la part d’élèves, de personnels
ou de la collectivité est stable.
Près d’un incident à motivation discriminatoire sur quatre survient dans le cadre d’un
harcèlement
Les incidents à caractère raciste, xénophobe ou antisémite s’inscrivent pour 21% d’entre eux
dans le cadre d’une situation de harcèlement. Parmi ces actes, 7 % font suite à une situation
de harcèlement et 17 % sont commis dans le but de harceler (les deux situations pouvant
survenir simultanément).
A titre de comparaison, les faits liés à une situation de harcèlement représentent 15,2 % de
l’ensemble des faits.
32 % des actes discriminatoires sont signalés hors de l’établissement
Les actes graves à motivation antisémite, raciste ou xénophobe font l’objet de signalements
hors de l’établissement dans 32 % des cas (34 % des cas l’an dernier). Ces signalements
relèvent de déclarations auprès de l’inspection académique ou du conseil général ou d’une
mise au courant de la police, de la gendarmerie ou de la justice, voire d’un dépôt de plainte.
3RAPPORT SUR LA LUTTE CONTRE LE RACISME, L’ANTISEMITISME ET LA XENOPHOBIE 2017 –
CONTRIBUTION DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
L’enquête SIVIS
Mise en place à la rentrée 2007, l’enquête SIVIS (Système d’information et de vigilance sur
la sécurité scolaire) permet le recueil de données sur la violence en milieu scolaire.
Protection des données
En 2017, le label de qualité statistique et d’intérêt général a été renouvelé pour l’enquête
SIVIS par le Conseil national de l’information statistique (Cnis). Les données collectées sont
protégées par le secret statistique et ne peuvent être exploitées que dans un but statistique,
ce qui exclut toute comparaison entre des établissements identifiables.
L’échantillon d’établissements
Environ 3 300 établissements publics du second degré sont interrogés, soit un taux de
sondage de 43 % de l’ensemble des EPLE. En 2016-2017, les analyses statistiques
reposent sur 62,5 % des établissements enquêtés. Des efforts de relance téléphonique
auprès des établissements non répondants ont permis d’améliorer le taux de réponse de 1,5
point par rapport à l’année scolaire 2015-2016.
Définition d’un incident grave
La volonté d’homogénéiser au mieux les données a conduit à restreindre les critères
d’appréciation pour l’enregistrement d’un acte donné, notamment pour toutes les violences
entre les élèves. Ainsi, seuls les incidents présentant un caractère de gravité suffisant au
regard des circonstances et des conséquences de l’acte sont enregistrés. Dans cette
optique, une motivation à caractère raciste, xénophobe ou antisémite est une
circonstance aggravante et suffit à retenir l’incident dans le dispositif SIVIS. D’autres
conditions peuvent également s’avérer suffisantes : usage d’une arme ou d’un objet
dangereux, situation de harcèlement, acte commis dans le cadre d’une intrusion, ayant
entraîné des soins pour la victime ou causé un préjudice financier important, ayant donné
lieu à un conseil de discipline, un signalement à la police, la gendarmerie ou la justice, un
dépôt de plainte. En revanche, par l’atteinte grave qu’ils représentent à l’institution scolaire,
tous les incidents impliquant un personnel de l’établissement sont retenus.
La faiblesse du nombre observé d’actes à caractère raciste, xénophobe ou antisémite (une
centaine chaque année dans le second degré) réduit la précision des résultats affichés.
Pour chaque résultat, un intervalle de confiance est estimé afin de tenir compte de la part
d’erreur due à l’échantillonnage. Seuls les résultats statistiquement significatifs au seuil de
95 % sont retenus pour conclure à des différences structurelles ou à des évolutions. Pour
les établissements du premier degré, le très faible nombre d’actes à motivation
discriminante (de l’ordre de 10 par an) ne permet pas de réaliser des exploitations
statistiques pertinentes. C’est pourquoi ils sont exclus de l’analyse.
Les insultes discriminatoires (à caractère raciste, sexiste ou religieux) dans
l’enquête nationale 2017 de climat scolaire et de victimation auprès des collégiens
Au cours du printemps 2017, 21 600 élèves de collèges publics et privés ont été invités à
répondre à un questionnaire sur le climat scolaire et les atteintes dont ils ont pu être
victimes. L’enquête de climat scolaire et de victimation recueille des données sur le ressenti
des élèves concernant le climat scolaire dans leur établissement et sur les violences qu’ils
ont pu subir dans ce même lieu. Le questionnaire distingue les insultes dont sont victimes les
collégiens et plus particulièrement les insultes discriminatoires (à caractère raciste, religieux
ou sexiste) (cf. encadré).
4RAPPORT SUR LA LUTTE CONTRE LE RACISME, L’ANTISEMITISME ET LA XENOPHOBIE 2017 –
CONTRIBUTION DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Entre 2011 et 2017, la proportion d’élèves insultés stagne tandis que la part des
insultes discriminatoires augmente
A l’instar de l’enquête de 2011 et 2013, les insultes constituent l’atteinte la plus souvent citée
par les collégiens. Ils sont 51 % à déclarer s’être fait insulter au moins une fois au cours de
l’année scolaire écoulée (ils étaient 52 % en 2011 et 57 % en 2013). Les insultes liées aux
discriminations (couleur de la peau et origine, religion et sexisme) recensées auprès des
collégiens touchent une minorité d’élèves (respectivement 11 %, 6 % et 10 % pour 2017) ;
elles sont cependant en augmentation. Les insultes liées à l’apparence physique et à la
tenue vestimentaire représentent les parts les plus importantes des insultes au collège avec
respectivement 28 % et 17 % d’élèves touchés (tableau 1).
Tableau 1 : Types d’insultes selon l’année
Enquête Enquête Enquête
2011 2013 2017
Insultes 50,7 49,7 50,5
Par rapport à l'origine et la 8,7 9,4 11,4
couleur de peau
Par rapport à la religion 4,2 4,7 5,9
Sexistes 5,2 5,5 8,3
Source : MEN, DEPP – Enquête nationale de climat scolaire et de victimation auprès des
collégiens 2017, 2013 et 2011
Les insultes par rapport à l’origine et à la religion sont plus fréquentes dans les
établissements REP+
Les résultats de 2017 corroborent ceux de 2011 et 2013 : globalement, la part des insultes
est statistiquement la même dans les établissements quelles que soient leurs
caractéristiques, REP+, urbains hors REP+ ou ruraux hors REP+. Cependant, parmi les
collégiens qui se font insulter les motivations se différencient : elles sont presque deux fois
plus souvent liées à l’origine et à la religion pour les établissements classés en REP+ alors
que les insultes sexistes ne sont pas plus nombreuses que dans les autres établissements.
Tableau 2 : Types d’insultes selon le type d’établissement
Collèges Collèges Collèges
REP+ ruraux Urbains
hors hors
REP+ REP+
Insultes 50,7 49,7 50,5
Insulte par rapport à l'origine 18,1 7,5 11,5
Insulte par rapport à la 11,7 2,9 5,8
religion
insultes sexistes 8,1 6,8 8,7
Source : MEN, DEPP – Enquête nationale de climat scolaire et de victimation auprès des
collégiens 2017
5RAPPORT SUR LA LUTTE CONTRE LE RACISME, L’ANTISEMITISME ET LA XENOPHOBIE 2017 –
CONTRIBUTION DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
La part des insultes par rapport à l’origine et la religion est plus élevée chez les
garçons
En comparaison avec les résultats des autres années (2011 et 2013), les insultes
discriminatoires sont certes un peu plus nombreuses mais leur profil reste le même. Les
garçons se distinguent des filles ; ils subissent proportionnellement plus d’insultes à
caractère raciste : 13 % des garçons contre 10 % des filles. Cependant, ces dernières sont
presque deux fois plus nombreuses à avoir subi des insultes sexistes (11 % contre 6 % pour
les garçons). Ce constat s’observait lors des enquêtes précédentes, mais à un niveau
moindre.
Graphique 1 : types d’insultes selon le sexe
60
50
40
Pourcentages
30
Filles
20 Garçons
10
0
Insulte Insulte par Insulte par Insulte à Insulte à Insulte à
rapport à la rapport à propos de propos du propos de la
tenue l'apparence l'origine sexe religion
vestimentaire physique
Source : MEN, DEPP – Enquête nationale de climat scolaire et de victimation auprès des
collégiens 2017
6RAPPORT SUR LA LUTTE CONTRE LE RACISME, L’ANTISEMITISME ET LA XENOPHOBIE 2017 –
CONTRIBUTION DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Graphique 2 : types d’insultes selon le sexe et l’année
14
12
10
Pourcentages
8
6
Filles
4 Garçons
2
0
Insultes par Insultes par Insultes Insultes par Insultes par Insultes
rapport à rapport à la sexistes rapport à rapport à la sexistes
l'origine religion l'origine religion
2013 2017
Source : MEN, DEPP – Enquête nationale de climat scolaire et de victimation auprès des
collégiens 2017 et 2013
Ces violences s’exercent d’abord entre les élèves, la part des personnels étant minime
Les insultes sont majoritairement proférées par des élèves à l’intérieur du collège (90 % des
élèves insultés l’ont été par un autre élève ou par un groupe d’élèves au sein de
l’établissement). Les cas où l’élève déclare avoir été insulté par un adulte du collège sont
rares (moins de 2 %). Parmi ces insultes, celles à caractère discriminatoire relèvent de
l’exception.
Les modes de diffusion des insultes évoluent avec une part importante d’insultes proférées
par internet ou le téléphone portable (11 % des élèves ont cité ce mode de diffusion quel que
soit le type d’insultes).
7RAPPORT SUR LA LUTTE CONTRE LE RACISME, L’ANTISEMITISME ET LA XENOPHOBIE 2017 –
CONTRIBUTION DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Présentation de l’enquête de climat scolaire et de Victimation
Après deux éditions au collège, en 2011 et 2013 et une au lycée en 2015, l’enquête
nationale de climat scolaire et de victimation a été réalisée de nouveau auprès des
collégiens en 2017. Cette enquête a pour finalité d’étendre les connaissances quant à
l’étendue, la nature et les contextes de la violence en milieu scolaire. Elle cherche à fournir
des indicateurs statistiques sur les actes dont les élèves sont victimes, qu’ils aient fait l’objet
ou non d’un signalement au sein de l’établissement ou auprès des autorités policières ou
judiciaires. C’est un outil de mesure, au niveau national, permettant de déterminer les
phénomènes de violences, de vols, et d’autres atteintes aux personnes qui ont lieu dans les
établissements scolaires en s’adressant directement aux élèves. Elle donne aussi des
informations sur la façon dont les élèves perçoivent le climat scolaire. Le questionnaire se
présente sous format informatisé ou papier et s’articule autour de quatre grands thèmes : le
climat scolaire, l’expérience scolaire, les comportements (insultes, menaces, bousculades),
les vols. Pour chacun des faits remontés, il est demandé sa fréquence, son lieu et la qualité
des auteurs (élèves, groupe d’élèves, professeurs, adultes). Le questionnaire comporte des
questions sur les insultes liées aux discriminations (couleur de la peau, origine, religion et
sexisme). Cette enquête apporte un éclairage complémentaire au dispositif SIVIS en captant
plus spécifiquement le vécu des élèves, et pas seulement les faits dont l’institution scolaire a
eu connaissance.
Le questionnaire est strictement confidentiel et a obtenu le label d’intérêt général et de
qualité statistique de la part du Conseil national de l’information statistique (Cnis) au mois de
décembre 2016. De plus, il a fait l’objet d’une autorisation de la CNIL. Cela implique que les
réponses collectées sont protégées par le secret statistique. Les équipes mobiles de sécurité
de chaque académie ont fait passer les questionnaires et ont veillé au bon déroulement de
l’enquête.
Champ
Cette enquête a été réalisée auprès d’un échantillon de 360 collèges représentatifs au
niveau national (France métropolitaine et DOM), des secteurs public et privé sous contrat.
Les établissements sont tirés selon un plan de sondage aléatoire stratifié distinguant les
collèges qui font partie de l’éducation prioritaire, ceux qui sont situés en zone rurale et ceux
qui sont en zone urbaine (hors éducation prioritaire). Par construction, l’enquête ainsi définie
n’est représentative qu’au niveau national. Aucun résultat ne peut en être extrait au niveau
local, à l’échelle des académies et a fortiori des établissements. Les seules analyses
porteront sur les types d’établissement (REP+, Urbains hors REP+ ou rural hors REP+.
Au cours du printemps 2017, 21 600 collégiens, soit 60 par collège, ont été interrogés. Le
taux de réponse est de 72 %, sensiblement moins bon qu’en 2011 et 2013, en particulier à
cause des refus des établissements de participer à l’enquête. Les données ont été
pondérées et corrigées de la non-réponse par un calage sur marges, garantissant la
représentativité pour un certain nombre de caractéristiques des établissements et des
élèves.
Les données ont été pondérées et corrigées de la non réponse par un calage sur marges se
basant sur les caractéristiques des établissement et des élèves : type d’établissement, sexe
de l’élève, niveau de l’élève, année de naissance de l’élève, appartenance de l’élève à une
classe de SEGPA, proportion d’élèves étrangers dans l’établissement, proportion d’élèves
favorisés dans l’établissement et proportion d’élèves défavorisés dans l’établissement.
Le renouvellement biennal de l’enquête de victimation en milieu scolaire
Le questionnaire élève n’a pas été modifié en 2017, de sorte que nous puissions effectuer
une mesure de l’évolution du phénomène de violence et du climat scolaire. Des questions
ont été ajoutées concernant le climat scolaire, les types d’insultes et la cyber-violence.
8RAPPORT SUR LA LUTTE CONTRE LE RACISME, L’ANTISEMITISME ET LA XENOPHOBIE 2017 –
CONTRIBUTION DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Les actes à caractère raciste et antisémite dans l’application « Faits
établissement »
L’application « Faits établissement » est un outil quotidien de signalement, à la chaîne
hiérarchique, de faits graves dont la transmission est sécurisée et dont la traçabilité et le
suivi sont facilités. Contrairement aux enquêtes déployées par la DEPP (SIVIS et victimation,
cf. supra), les données issues de l’analyse de ces remontées n’ont pas valeur de
statistiques. Elles permettent seulement de dégager de grandes tendances. Les enquêtes
permettent également, au niveau académique, de développer un accompagnement des
écoles et des établissements. A plus fine échelle encore, l’application permet d’établir une
mémoire des faits ayant eu un impact sur le climat de l’école ou l’établissement, soit que ces
faits portent atteinte à la vie scolaire, soit qu’ils portent atteinte aux conditions
d’enseignement, notamment par la remise en cause de certains contenus. L’application est à
ce titre un outil de pilotage local à disposition des directeurs d’écoles et des chefs
d’établissements.
Les éléments qui suivent se fondent sur le nombre de qualifications attribuées aux faits
(qualifications qui peuvent être différentes pour un même fait) et non sur le nombre de faits,
auquel la définition actuelle de l’outil ne permet pas d’accéder.
Dans l’application, les faits graves à caractère raciste et antisémite sont recensés parmi les
« atteintes aux valeurs de la République »1, lesquels n’ont représenté, du 1er janvier au 31
juillet 2017, que 7% des faits signalés, soit un faible volume au regard de la population prise
en compte (élèves et leur famille, personnels des établissements et des écoles et personnes
extérieures à l’établissement). Pour ce qui relève en propre des actes racistes et antisémites,
ils représentent 10,5% de ces 7%, soit 230 actes sur la période considérée.
Ces actes ont lieu à 44% dans les écoles et 56% dans les établissements du second degré.
Dans le premier degré, 30% des auteurs sont des garçons, 38% des familles et 17% des
personnes extérieures. Dans le second degré, 63% des auteurs de ces actes sont des
garçons, et 8,5% des filles. Pour les collèges et les lycées, l’effet de groupe est à prendre en
compte puisque 12,5% des actes sont perpétrés en réunion.
73% de ces actes ont lieu dans la classe de l’école (18%), la cour de récréation et les
espaces de circulation (40%) et à la grille (15%). Dans les collèges et lycées, ces actes se
déroulent à 40% dans la classe et 40% dans la cour de récréation et les espaces de
circulation.
L’enquête locale de climat scolaire : un outil de pilotage au service de la
prévention des violences et de leurs fondements discriminatoires
L’application Enquête Locale Climat Scolaire (ELCS), déployée en 2016-2017 pour les
collèges et étendue depuis la rentrée 2017 dans les écoles et les lycées, permet, sur la base
de questions posées à la fois aux élèves et aux personnels, de dresser un état des lieux de
l’expérience de chacun dans l’école ou l’établissement et du climat qui y règne.
Ces enquêtes sont réalisées sur la base du volontariat et l’initiative en revient aux équipes
de direction, qui en informent préalablement le conseil d’école ou le conseil d’administration.
Il s’agit par conséquent d’une démarche concertée, corrélée à la démarche d’amélioration du
climat scolaire, fondée sur les sept axes suivants : la stratégie d’équipe, la justice scolaire,
1
Les autres grandes rubriques de signalement sont « atteintes aux biens », « atteintes aux
personnes » et « atteintes à la sécurité et au climat de l'établissement »
9RAPPORT SUR LA LUTTE CONTRE LE RACISME, L’ANTISEMITISME ET LA XENOPHOBIE 2017 –
CONTRIBUTION DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
les pédagogies et coopérations, la prévention des violences et du harcèlement, la
coéducation et les pratiques partenariales.
Sur la question en propre du racisme et de l’antisémitisme, des questions portent sur les
insultes. Dans le questionnaire à destination des élèves, les questions sont formulées
comme suit : « si on t’a insulté, était-ce à cause (au choix) de la couleur de ta peau ou de ton
origine, de ta religion » ; dans le questionnaire à destination des personnels, à la question
« Si vous avez été insulté, de quel type d’insultes s’agissait-il ? », on trouve parmi les choix
possibles : insultes racistes / insultes antisémites.
Sur la base des résultats de l’enquête locale de climat scolaire peuvent ensuite être définis
des politiques d’amélioration du climat scolaire au sein de l’école, du collège ou du lycée
concerné, auquel la prévention du racisme et de l’antisémitisme concourt. La mise en œuvre
et l’exploitation des résultats de l’enquête doivent en effet s’inscrire dans une construction
collective (projet école, établissement, plan de prévention des violences, plan de formation)
et prendre appui sur les instances dédiées (conseils d’école, conseil pédagogique, conseils
de la vie collégienne, conseils de la vie lycéenne, comités d’éducation à la santé et à la
citoyenneté). Cette politique mise en place au sein de l’école, du collège ou du lycée peut
être accompagnée par des formateurs ou des référents, selon les besoins.
II - Actions du ministère en 2017 et feuille de route pour les prochaines
années
Suivi des recommandations de la CNCDH
Recommandations relatives à l’éveil des consciences en milieu scolaire
Sur l’apprentissage actif de la citoyenneté
L’année 2017 a vu la poursuite de la mise en œuvre de l’enseignement moral et civique et
du parcours citoyen, qui se fondent à la fois sur des approches pédagogiques dans la
classe, telles que la pratique du débat argumenté, du dilemme moral, ainsi que sur
l’engagement des élèves à l’échelle de l’établissement et le rôle actif que ceux-ci sont invités
à prendre dans leur apprentissage de la citoyenneté. Leur participation aux travaux des
instances consultatives, conseil de la vie collégienne et conseil de la vie lycéenne, en
constitue un levier important.
Afin de pouvoir mener une expérimentation dans le champ de l’apprentissage actif de la
citoyenneté, la France a répondu, avec onze partenaires2 issus de quatre Etats membres de
l’Union européenne, à un appel à projets de la Commission européenne dans le cadre du
programme Erasmus+. Lancé en février 2017, ce projet est mis en œuvre conjointement par
l’Espagne, la Grèce, le Royaume-Uni et la France et se déploiera sur trois ans. L’année
scolaire 2017-2018 est une phase pilote, qui implique quelques établissements de trois
académies, Aix-Marseille, Nancy-Metz et Versailles ; l’année scolaire 2018-2019 sera une
phase de déploiement dans une centaine d’établissements.
2
Outre le ministère de l’éducation nationale, les partenaires français sont l’Ecole d’économie de Paris et l’université de Cergy-
Pontoise. Le protocole d’expérimentation a été bâti conjointement par la DGESCO et le CNESCO, partie prenante du projet.
10RAPPORT SUR LA LUTTE CONTRE LE RACISME, L’ANTISEMITISME ET LA XENOPHOBIE 2017 –
CONTRIBUTION DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
La définition de ce projet, intitulé ACT pour « ACTive citizenship projects to enhance pupils’
social and civic competences » (« projets d’éducation active à la citoyenneté visant à
renforcer les compétences sociales et civiques des élèves »), s’est fondée sur le constat,
établi par diverses recherches menées en Europe, que l’éducation à la citoyenneté se
résume trop souvent à un apprentissage théorique, mettant peu l’accent sur l’acquisition de
capacités et d’aptitudes. Dans cette perspective, le projet ACT poursuit l’objectif d’améliorer
la transmission des valeurs fondamentales à travers l’implication des élèves eux-mêmes –
des collégiens de 13 à 15 ans – dans la définition et la mise en œuvre de projets portant sur
les thèmes de l’inclusion sociale, de la lutte contre les discriminations ou encore de la
diversité culturelle. Outre le fait que la dimension concrète des projets mis en œuvre doit être
avérée, le projet ACT a été conçu pour que différentes activités puissent être menées :
organisation de débats argumentés en classe ; éducation aux médias ; rencontre avec des
partenaires locaux (médias, associations, autorités publiques, etc.) ; échanges entre classes
d’établissements des différents pays partenaires. La mise en œuvre des projets est
précédée d’une formation des enseignants, qui a eu lieu à la rentrée 2017 pour la phase
pilote.
Tout au long de son déroulement, ce projet fera l’objet d’une évaluation indépendante mais
l’une de ses originalités réside dans le fait que les élèves eux-mêmes seront partie prenante
de l’évaluation et disposeront d’outils pour à la fois s’auto évaluer et évaluer leurs pairs
(notamment un portfolio inspiré du modèle de compétences pour une culture de la
démocratie développé par le Conseil de l’Europe3).
Le ministère pourra présenter, dans le rapport pour l’année 2018, un point d’étape de la mise
en œuvre du projet ACT à l’issue de sa phase pilote.
Sur la nécessité d’aborder en classe l’esclavage, les génocides, l’immigration et la diversité
des civilisations
Sans revenir sur le contenu des programmes d’enseignement qui ont fait l’objet d’une
présentation détaillée dans la contribution du ministère au rapport pour l’année 2016, il
convient de rappeler que la lutte contre le racisme et l’antisémitisme y est prise en compte
de manière transversale et pluridisciplinaire et que tant l’esclavage que les génocides,
l’immigration et la diversité des civilisations y sont inclus. De même, l’attention portée au
traitement équilibré des différentes « mémoires » s’illustre dans le travail en cours, au sein
de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur la mémoire de la
guerre d’Algérie.
En complément des enseignements, le ministère apporte son soutien à des actions
éducatives qui prennent le plus souvent la forme de concours ou de prix visant à la
prévention du racisme et de l’antisémitisme. Quelques chiffres illustrent de manière
éloquente l’attrait que ces actions suscitent et le levier important qu’elles représentent pour
éduquer contre le racisme et l’antisémitisme. Ainsi, le Concours national de la résistance et
de la déportation (CNRD), dont le thème était en 2017 « La négation de l’Homme dans
l’univers concentrationnaire nazi », a concerné près de 43 000 élèves, dont près de deux
tiers de collégiens et un tiers de lycéens, et plus de 1800 établissements. 450 travaux ont été
soumis au jury national. Ces chiffres sont stables d’une année sur l’autre.
Par comparaison, la participation à la « Flamme de l’égalité », concours qui sera organisé en
2017-2018 pour la troisième année consécutive par les ministères de l’éducation et des
outre-mer, le Comité national pour la mémoire et l’histoire de l’esclavage (CMNHE) et la
DILCRAH, est moins spectaculaire. Mais ce concours, ouvert de l’élémentaire au lycée et qui
invite à réaliser un projet sur l'histoire des traites et des captures, sur la vie des esclaves et
3
https://www.coe.int/en/web/education/competences-for-democratic-culture
11RAPPORT SUR LA LUTTE CONTRE LE RACISME, L’ANTISEMITISME ET LA XENOPHOBIE 2017 –
CONTRIBUTION DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
les luttes pour l'abolition, sur leurs survivances, leurs effets et leurs héritages contemporains,
n’en est pas moins important. La description des objectifs qu’il poursuit en témoigne : « Par
l’éducation, la recherche, l’enseignement, les patrimoines, la transmission, et en combinant
les disciplines, le concours aspire à conforter la construction d'une mémoire collective
autour de valeurs partagées, afin d'étayer le sentiment d’une appartenance commune
et d’enrichir la mémoire nationale. Au cours de la réalisation de projets dont la mise en
forme finale est libre (recueil de témoignages et entretiens, représentation scénique,
production visuelle, etc.), les élèves approfondiront leur connaissance et leur compréhension
de l’esclavage et de ses effets pour prendre conscience, in fine, de l’importance qu’il y à
préserver la dignité humaine et, pour cela, à agir en citoyens libres et égaux. »
La deuxième édition du prix, en 2016-2017, a vu le nombre d’élèves mobilisés plus que
doubler (de 2200 élèves en 2015-2016 à 5000 élèves l’année suivante), le nombre de
dossiers reçus également augmenter sensiblement (85 en 2015-2016 contre 183 l’année
suivante) et des académies comme la Réunion et la Martinique participer, ce qui porte à 28
le nombre d’académies investies dans ce concours. Il est en outre intéressant de noter que
les académies de Bordeaux, Rennes et Toulouse sont parmi celles qui ont le plus participé.
D’autres actions éducatives méritent d’être mentionnées : le prix « Nous autres » de la
Fondation Lilian Thuram, au jury duquel le ministère participe et qui chaque année permet
d’articuler éducation artistique et culturelle et prévention du racisme (les élèves sont invités à
soumettre des productions artistiques, toutes les formes d’expression artistique étant
acceptées) ; le prix « Ethique et sport » de l’Union nationale du sport scolaire (UNSS), qui a
notamment distingué, en 2017, une enseignante d’EPS et des élèves mahoraises ayant écrit
un spectacle de danse sur l’immigration clandestine et le regard porté sur les migrants
comoriens ; le prix « Non au harcèlement » qui permet d’aborder les fondements
discriminatoires des violences répétées et les représentations stéréotypées qui les
alimentent. Ces quelques exemples ne rendent que partiellement compte de la richesse des
actions éducatives menées, dont certaines, sans être spécifiquement dédiées à la prévention
du racisme et de l’antisémitisme, donnent lieu à des travaux sur le sujet. C’est notamment le
cas des actions éducatives dans le champ de l’éducation à la citoyenneté d’une part, de
l’éducation aux médias et à l’information d’autre part4.
Sur les enjeux du numérique et de ses usages dans le respect des principes moraux et
civiques
Le ministère et ses opérateurs – notamment Réseau-Canopé et le CLEMI, centre de liaison
de l’enseignement et des médias d’information – ont poursuivi l’ensemble des actions
engagées pour renforcer l’éducation aux médias et à l’information, les usages responsables
du numérique et la prévention des effets de la désinformation, nourris de la séduction opérée
notamment par les théories conspirationnistes. Plusieurs publications de la Direction du
numérique pour l’éducation ont ainsi fait le point sur les ressources numériques utiles dans le
champ de la « citoyenneté numérique » (en mars 2017), de l’ « esprit critique » (en octobre
2016) et de l’ « info pollution » (en mars 2016)5, en lien avec des « travaux académiques
mutualisés » dans le champ de l’éducation aux médias et à l’information6.
4
L’ensemble des actions éducatives proposées aux établissements scolaires sont recensées sur la page Eduscol qui leur est
dédiée, consultable à l’adresse suivante :
http://eduscol.education.fr/cid47920/programme-previsionnel-des-actions-educatives.html
5
Les lettres Edu_num sont consultables à l’adresse suivante :
http://eduscol.education.fr/numerique/edunum-thematique/edunum_01
6
Pour une description des travaux académiques mutualisés, on pourra se reporter à la page suivante sur le site Eduscol :
http://eduscol.education.fr/cid122388/traam-emi-2016-2017-synthese-et-analyse.html
12RAPPORT SUR LA LUTTE CONTRE LE RACISME, L’ANTISEMITISME ET LA XENOPHOBIE 2017 –
CONTRIBUTION DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Dans les programmes du cycle 4, qui correspond aux trois dernières années du collège,
vingt-sept compétences en éducation aux médias et à l’information ont par ailleurs été
définies. Celles-ci ont fait l’objet, entre août et septembre 2017, d’une consultation en ligne
qui a permis à l’ensemble de la communauté éducative de contribuer à la définition de ce
que chacune d’entre elles recouvre et à en proposer des exemples de mise en œuvre
pédagogique. Un ensemble de fiches détaillant chacune des compétences sera mis en ligne
au cours du premier semestre 2018.
Pour mémoire, le portail Internet responsable7, qui a pour objet de fournir un
accompagnement pédagogique à l'ensemble de la communauté éducative, propose un
ensemble d’outils et de ressources pédagogiques pour favoriser les usages responsables
d’Internet. Plusieurs ressources s’adressent aux plus jeunes des élèves. Les fiches
juridiques, qui portent à la fois sur la régulation des usages du numérique, la protection des
données personnelles et de la vie privée, enfin sur la consultation, la publication et la
diffusion de contenus en ligne, ont fait l’objet d’une actualisation au cours de l’année 2016-
2017.
Recommandations relatives à la formation et à la production de ressources
Sur la formation des personnels
En 2016-2017, plusieurs formations ont été programmées au plan national de formation,
piloté par la DGESCO et mis en œuvre dans le cadre d’une étroite collaboration avec
l’inspection générale de l’éducation nationale. Ces formations, inscrites dans l’axe « Valeurs
de la République, lutte contre les discriminations, éducation égalité filles-garçons, éducation
aux médias » ont été déclinées en :
- deux séminaires accueillant une centaine de formateurs et d’inspecteurs chacun. Le
premier, intitulé « Education aux médias et à l’information », s’est tenu à Lyon
pendant trois jours en janvier 2017 et a notamment permis à la société civile
d’intervenir dans le cadre d’un « Forum numérique » sur la question des jeunes et de
l’information ; le second, intitulé « Enseignement moral et civique et inscription dans
le parcours citoyen », s’est tenu pendant deux jours à Brive en mars 2017 et était
centré sur les pratiques pédagogiques en classe. Ce séminaire a notamment été
l’occasion de présenter, en atelier, un travail interdisciplinaire – lettres, histoire,
éducation aux médias, pratique artistique – conduit dans un collège autour du projet
Convoi 77, dans le cadre duquel les élèves ont travaillé sur la reconstitution de la
biographie d’un des déportés ;
- deux séminaires organisés en collaboration avec la recherche (« Penser la
Complexité », Paris 8-9 décembre 2017 avec l’UNESCO ; Université d’été de Lyon,
6-7 juillet 2017, dont le thème était « Débattre pour former le citoyen »).
Par ailleurs, dans le cadre de la formation nationale des référents académiques
« harcèlement », à laquelle un séminaire était consacré en juin 2017, la question du lien
entre le racisme et le harcèlement a été abordée à la fois pour établir un état des lieux,
identifier les fondements discriminatoires des violences, faire connaître les leviers pour agir,
interministériels et interinstitutionnels notamment, enfin proposer des pistes pédagogiques et
éducatives. Le rapport annuel de la CNCDH y a été présenté comme un des documents de
référence, en même temps que l’enquête Trajectoires et origines, les enquêtes « Cadre de
vie et sécurité » ou encore les ressources du Défenseur des droits.
7
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/
13RAPPORT SUR LA LUTTE CONTRE LE RACISME, L’ANTISEMITISME ET LA XENOPHOBIE 2017 –
CONTRIBUTION DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Pour l’année scolaire 2017-2018, dans le cadre du même axe de formation que celui
mentionné plus haut, plusieurs séminaires accueillant 150 personnes chacun ont été
programmés :
- « Mesurer, analyser et prévenir les discriminations à Paris », qui s’est tenu le 6
novembre 2017. Ce séminaire a notamment été l’occasion de clarifier la notion
juridique de discrimination et ce qu’elle recouvre dans le domaine scolaire, de fournir
des pistes d’actions pédagogiques pour faire comprendre les discriminations aux
élèves, notamment à partir de la jurisprudence et en lien avec des professionnels du
droit intervenant dans les classes, enfin de donner aux personnels des outils pour
régler des situations potentiellement discriminatoires. Les travaux menés par le
réseau national de lutte contre les discriminations8 ainsi que les nouveaux outils mis
à disposition par le Défenseur des droits y ont été particulièrement présentés, entre
autres ressources ;
- « Enseignement laïque des faits religieux », prévu en avril 2018 ;
- « Valeurs de la République, démocratie, parcours citoyen à Paris », prévu en mai
2018.
La DGESCO contribue aussi financièrement à l’enquête « Religions, discriminations, racisme
en milieu scolaire (REDISCO) » pilotée par Françoise Lantheaume (université de Lyon 2), en
collaboration avec le centre Alain Savary. Ses premiers résultats ont été présentés lors d’un
séminaire le 17 octobre 2017 auquel des formateurs de l’éducation nationale étaient conviés.
En académie, la DGESCO met à disposition des enseignants des premier et second degrés
des parcours M@gistère nationaux, parcours de formation à distance, notamment un
parcours « Laïcité » et un parcours « Enseignement laïque des faits religieux », construit en
étroite collaboration avec l’Institut européen en sciences des religions (IESR). Un
parcours de formation sur la « Culture juridique » est également proposé aux chefs
d’établissement.
Les actions de formation programmées au Plan national de formation s’adressent en
particulier aux cadres de l’éducation nationale, notamment aux inspecteurs et aux
formateurs. L’objectif est de permettre le déploiement des contenus apportés au niveau
national dans les plans académiques de formation. En 2016-2017, 16 540 journées
stagiaires ont ainsi été recensées, qui concernent les personnels du premier degré ayant
participé à des formations sur la priorité nationale « Valeurs de la République, lutte contre les
discriminations, éducation égalité filles-garçons, éducation aux médias » ; les personnels du
second degré ont quant à eux bénéficié de 29 901 journées stagiaires sur les mêmes
thèmes.
En académie, des réseaux de formateurs sont en cours de constitution et d’identification.
Ces réseaux sont l’émanation, en particulier dans le second degré, de la réforme du
CAFIPEMF (certificat d’aptitude aux fonctions de professeurs des écoles maîtres formateurs
dans le premier degré) et de l’introduction du CAFA (certificat d’aptitude aux fonctions de
formateurs académiques dans le second degré) en 2015. L’élaboration des plans de
formation en académie s’appuient désormais davantage sur les besoins identifiés du terrain.
Les évolutions en cours privilégient la mise en avant de l’établissement comme lieu de
formation, afin de permettre une adéquation plus grande entre les besoins des équipes de
terrain et les contenus de formation.
8
http://reseau-lcd-ecole.ens-lyon.fr/
14RAPPORT SUR LA LUTTE CONTRE LE RACISME, L’ANTISEMITISME ET LA XENOPHOBIE 2017 –
CONTRIBUTION DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Sur les ressources
Le ministère, conjointement avec la DILCRAH et Réseau-Canopé, a poursuivi en 2017
l’alimentation de la plate-forme de ressources « Eduquer contre le racisme et
l’antisémitisme »9, incluse dans le portail Valeurs de la République. Le comité éditorial a été
particulièrement attentif à ce que les personnels et les élèves puissent y trouver des
éclairages sur un ensemble de notions-clefs dont le nombre s’élève aujourd’hui à vingt-cinq
et parmi lesquelles le racisme anti-asiatique, peu évoqué mais bien réel, est traité au même
titre que le racisme anti-noirs, anti-arabes ou anti-roms.
A ces notions-clefs s’ajoutent huit « questions vives » : « un ou des racismes », « racisme et
antisémitisme », « législation négationniste : une spécificité française », « le racisme, la
liberté d’expression et la loi », « la ‘concurrence mémorielle’ », « jusqu’où peut-on parler de
racisme ? », « la science et le racisme » et « racisme et religion », qui permettent
précisément d’apporter des réponses aux questions susceptibles d’être posées par les
élèves sur des sujets difficiles qui font débat dans la société.
La rubrique « agir en classe » s’est quant à elle enrichie de documents de méthode
permettant d’exploiter un témoignage historique ou encore de réagir au discours de haine en
ligne. A cet effet, le manuel Connexions10 du Conseil de l’Europe, téléchargeable sur le site,
permet de mener des activités à l’articulation entre l’éducation contre le racisme et
l’éducation à un usage raisonné des médias. Dans cette même rubrique, on trouve une
banque de ressources composée de films d’animation à destination des élèves de
l’enseignement primaire et de témoignages filmés choisis notamment en lien avec
l’association Génériques11, le projet Matrice du Mémorial de Rivesaltes ou encore l’USC
Shoah Foundation, à usage des élèves du secondaire.
Une rubrique intitulée « parcours » propose, autour de questions transversales, des parcours
d’usage de la plate-forme permettant à la fois d’utiliser les notions-clés, les supports
pédagogiques et les ressources partenariales. Un premier parcours a été mis en ligne en
mars 2017 sur « le racisme dans une société diverse », il sera suivi de trois autres parcours
en cours de construction.
Le comité éditorial réfléchit actuellement à l’intégration dans la plate-forme des contenus du
MOOC « Le racisme et l’antisémitisme »12, des portraits d’ « artistes de France »13 dont la
réalisation a été coordonnée par Pascal Blanchard et Lucien Jean-Baptiste, de certains des
contenus de l’exposition « Nous et les autres » présentée au Musée de l’Homme jusqu’en
janvier 2018. Le travail visant à favoriser la visite de lieux de culture et de mémoire pour
prévenir le racisme sera également poursuivi dans ce cadre.
Recommandations relatives aux relations avec la société civile (associations de lutte
contre le racisme, professionnels des médias, éducation populaire)
La politique de partenariat et de soutien fort à la société civile a été poursuivie au cours de
l’année 2017, par la consolidation de liens existants, sous la forme d’agréments, de
conventions de partenariats à vocation pédagogique ou du soutien financier à des projets
menés par des associations œuvrant dans le champ de l’éducation à la citoyenneté, de la
9 https://www.reseau-canope.fr/eduquer-contre-le-racisme-et-lantisemitisme/
10 https://www.reseau-canope.fr/eduquer-contre-le-racisme-et-lantisemitisme/le-mouvement-contre-le-
discours-de-haine.html
11 http://www.generiques.org/
12 https://www.fun-mooc.fr/courses/fmsh/121001/session01/about
13 https://www.serie-artistesdefrance.com/
15Vous pouvez aussi lire