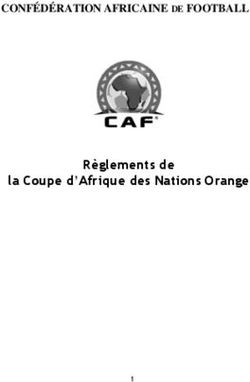Document d'Orientations Générales - Schéma de Cohérence Territoriale du Pays du Vexin Normand
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
SYNDICAT MIXTE DU PAYS
DU VEXIN NORMAND
Schéma de Cohérence
Territoriale du Pays du
Vexin Normand
Projet approuvé par délibération du Comité
Syndical du 16 avril 2009
Document
d’Orientations
D.O.G.
GénéralesSYNDICAT MIXTE DU PAYS DU VEXIN NORMAND
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE - DOG
SOMMAIRE
I. PREAMBULE 3
II. LES ORIENTATIONS RELATIIVES A L’ORGANISATION DE
L’ESPACE 4
II.1. La structuration du territoire 4
II.2. L’organisation des zones d’activités 5
III. LES ORIENTATIONS LIEES A LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT 7
III.1. Le paysage naturel 7
III.2. Le paysage bâti 9
III.3. Les entrées de villes et les axes routiers 12
III.4. La ressource en eau 13
III.5. Les orientations pour les espaces naturels d’intérêt
écologique 16
IV. LES GRANDS EQUILIBRES ENTRE ESPACES URBAINS ET
ESPACES NATURELS 18
IV.1. La gestion du développement urbain 18
IV.2. La maitrise de la consommation de l’espace 20
IV.3. Des formes urbaines adaptées 22
IV.4. Les zones non urbanisables 23
V. LES OBJECTIFS RELATIFS A L’EQUILIBRE SOCIAL DE
L’HABITAT : PRIVILEGIER UNE OFFRE QUALITATIVE 24
VI. LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE DEPLACEMENTS 26
VII. LES OBECTIFS RELATIFS A L’ACTIVITE ECONOMIQUE 29
VII.1. La qualification des zones d’activités 29
VII.2. Le commerce en milieu rural 31
VII.3. Le développement de l’économie touristique 32
VII.4. Les objectifs du développement agricole 33
VII.5. Les objectifs en matière de ressources minérales 34
VIII. LA PREVENTION DES RISQUES ET DES NUISANCES 35
VIII.1. Les objectifs concernant les risques 35
VIII.2. Les objectifs concernant les énergies renouvelables 37
VIII.3. Les objectifs concernant les déchets 38
DOG approuvé le 16 avril 2009 2SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU VEXIN NORMAND
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE - DOG
I. PREAMBULE
La Code de l’Urbanisme énonce dans son article R122-3 :
« Le document d'orientations générales, dans le respect des objectifs et
des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, précise :
1º Les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la
restructuration des espaces urbanisés ;
2º Les espaces et sites naturels ou urbains à protéger dont il peut définir
la localisation ou la délimitation ;
3º Les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les
espaces naturels et agricoles ou forestiers ;
4º Les objectifs relatifs, notamment :
a) A l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements
sociaux ;
b) A la cohérence entre l'urbanisation et la création de dessertes en
transports collectifs ;
c) A l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles
des commerces et aux autres activités économiques ;
d) A la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville ;
e) A la prévention des risques ;
5º Les conditions permettant de favoriser le développement de
l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports
collectifs.
Il peut, le cas échéant, subordonner l'ouverture à l'urbanisation de zones
naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la création de dessertes
en transports collectifs et à l'utilisation préalable de terrains situés en zone
urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l'article L. 421-5.
Il peut, en outre, définir les grands projets d'équipements et de services,
en particulier de transport, nécessaires à la mise en œuvre du schéma.
Lorsque les documents graphiques délimitent des espaces ou sites à
protéger en application du 2º ci-dessus, ils doivent permettre d'identifier les
terrains inscrits dans ces limites. »
Le Document d’Orientations Générales - D.O.G. - est la troisième partie du
SCOT. Il a été rédigé à partir du P.A.D.D. sur lequel le Conseil Syndical a
débattu le 12 avril 2007. Ce P.A.D.D. comporta trois objectifs :
Une ambition de croissance maîtrisée
Une ambition de dynamisme économique
Une ambition de renforcer la qualité du cadre de vie.
Le D.O.G. donne les principes d’aménagement et les modalités
d’application pour les documents d’urbanisme auxquels le SCOT s’impose.
Les documents d’urbanisme qui doivent être compatibles avec le SCOT
sont les suivants :
Les programmes locaux de l’habitat (PLH)
Les plans de déplacements urbains (PDU)
Les schémas de développement commercial et les autorisations
d’équipement commercial
Les plans locaux d’urbanisme (P.L.U.)
Les cartes communales
Les opérations d’aménagement : zone d’aménagement différé (ZAD),
zone d’aménagement concerté (ZAC), les lotissements portant sur une
surface hors œuvre nette supérieure à 5000 m², les réserves foncières
de plus de 5 ha.
DOG approuvé le 16 avril 2009 3SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU VEXIN NORMAND
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE - DOG
II. LES ORIENTATIONS RELATIIVES A L’ORGANISATION DE
L’ESPACE
II.1. LA STRUCTURATION DU TERRITOIRE
Le Pays du Vexin Normand s’appuie sur une architecture du territoire de
proximité avec la présence de pôles urbains en devenir (Gisors, Les
Andelys) et des bassins de vie à fort potentiel (Vallée de l’Andelle, plateau
d’Etrépagny, Vexin Bossu).
Le Scot doit permettre de conforter cette armature urbaine pour renforcer
les dynamiques intercommunales. Ainsi, les pôles urbains doivent jouer un
rôle de centralité dans l’offre d’équipements et de services avec pour
objectif de favoriser leur accessibilité par les transports collectifs et les
modes de circulation douces.
Pour répondre aux besoins et attentes de la population et des nouveaux
arrivants, il convient de renforcer l’offre et la qualité des services du
territoire.
Cette stratégie implique de trouver la solution la plus pertinente possible
dans les coûts financiers les plus équilibrés. Ainsi, le Scot préconise la
réalisation d’équipements structurants en matière culturelle (Médiathèques,
salles de spectacle, …). Il souhaite le développement de la palette des
formules d’accueil des enfants et des politiques d’animations pour les
adolescents. Enfin, il veut pérenniser les équipements de santé de
proximité du territoire (Pôle sanitaire du Vexin, Hôpital des Andelys, Centre
l’Hostréa, maisons de retraite,..) et lutter contre la désertification médicale.
Pour toutes ces ambitions, la construction des équipements publics
structurants doit s’appuyer sur une réflexion intercommunale et prendre en
compte la haute performance énergétique des bâtiments.
L’ensemble des communes du Vexin Normand est amené à accueillir de
nouvelles populations. Toutefois, pour faire face à cet afflux
démographique, la densification des espaces urbanisés devra tendre à la
diversité urbaine, permettre la reconquête d’espaces vacants, assurer
l’harmonie avec le patrimoine urbain local et développer les capacités
d’accueil en termes de logements, d’activités, d’espaces verts ou
d’espaces publics (et notamment de stationnements). Elle devra également
veiller à la création d’un réseau de voirie cohérent et structuré.
Le Scot définit un objectif de production de 5 200 logements à l’horizon
2020 pour l’ensemble du territoire du Scot. A priori, cet objectif devrait être
réparti entre les différents territoires comme suit :
Vallée de l’Andelle : 900 logements
C.C. Epte-Vexin-Seine : 600 logements
C.C. Etrépagny : 600 logements
C.C. Gisors-Epte-Lévrière : 1 800 logements
C.C. Les Andelys : 1 000 logements
C.C. Lyons-la-Forêt : 300 logements.
DOG approuvé le 16 avril 2009 4SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU VEXIN NORMAND
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE - DOG
II.2. L’ORGANISATION DES ZONES D’ACTIVITES
Le Scot du Pays du Vexin Normand doit construire une offre foncière
pertinente pour l’accueil des entreprises venant de l’extérieur et pour la
relocalisation d’entreprises locales. La mise en œuvre de cette offre
foncière doit obligatoirement être réalisée dans un cadre intercommunal. Il
est préconisé :
- La création de nouvelles zones d’activités en lien avec les besoins des
Communautés de Communes
- La définition de zones d’activités prioritaires :
Î ZA de Romilly-sur-Andelle et « Vente Cartier » à Charleval pour la
Communauté de communes de l’Andelle,
Î ZA la Porte Rouge à Etrépagny pour la Communauté de Communes
du Canton d’Etrépagny,
Î ZA du Mont de Magny à Gisors pour la Communauté de Communes
Gisors,
Î ZA de Bouafles pour la Communauté de Communes des Andelys et
de ses environs.
Î Pour les communautés de communes du canton de Lyons et Epte-
Vexin-Seine, les zones d’activités prioritaires seront validées par leur
conseil communautaire.
- Une définition de la vocation de chaque zone,
- Une optimisation des sites existants, avec une recherche de la
réutilisation des capacités foncières et en anticipant leurs besoins
d’extension,
- Une réflexion approfondie sur l’insertion paysagère et architecturale, et
une gestion économe des espaces, en évitant les linéaires le long des
axes routiers,
- Une prise en considération des enjeux environnementaux : la ressource
en eau, les déchets, l’énergie, …
Le Scot répartit les potentiels de nouvelles zones d’activités comme suit :
Vallée de l’Andelle : 20 ha
C.C. Epte-Vexin-Seine : 3 ha
C.C. Etrépagny : 10 ha
C.C. Gisors-Epte-Lévrière : 20 ha
C.C. Les Andelys : 20 ha
C.C. Lyons-la-Forêt : 3 ha.
De plus, des potentiels de requalification de zones d’activités existantes
sont identifiés à Charleval, aux Andelys et à Gisors.
L’aménagement et l’ouverture de nouvelles zones d’activités seront
coordonnés et échelonnés dans le temps selon les besoins réels, de sorte
à disposer à tous les moments d’une offre de terrains prêts à accueillir.
Le regroupement des nouvelles implantations sera favorisé à une
dispersion sur plusieurs zones pour limiter les frais de portage et l’impact
sur le paysage et les milieux naturels.
DOG approuvé le 16 avril 2009 5SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU VEXIN NORMAND
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE - DOG
Le Scot encourage également les démarches de haute qualité
environnementale dans la conception des bâtiments et des
aménagements.
A terme, l’absence de stratégie collective d’accueil d’entreprises est un
risque majeur de perte de compétitivité du territoire et de fragilisation du
tissu d’entreprises.
Pour prendre en compte le contexte économique local de certaines
communes (en particulier les Andelys ou la vallée de l’Andelle), le Scot
n’exclut pas la possibilité de créer ou d’étendre des zones artisanales,
dans le cadre des stratégies intercommunales de développement
économique, selon les besoins locaux.
DOG approuvé le 16 avril 2009 6SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU VEXIN NORMAND
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE - DOG
III. LES ORIENTATIONS LIEES A LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
III.1. LE PAYSAGE NATUREL
A. LA CONSTRUCTION D’UNE IDENTITE PAYSAGERE
La qualité des paysages et du cadre de vie est une composante essentielle
du Vexin Normand. La protection et/ou la préservation des espaces
naturels et des paysages se posent donc avec acuité dans ce territoire
fortement urbanisé et de surcroît soumis à une pression démographique et
économique qui va en s’accroissant.
Les documents d’urbanisme locaux doivent en raison du caractère
remarquable des éléments de paysage concernés :
- Maîtriser l’étalement urbain en privilégiant l’urbanisation des « dents
creuses » ;
- Préserver le paysage non bâti des lignes de crête et des coteaux ou, si la
pesée de intérêts le justifie, assurer l’intégration paysagère des nouvelles
constructions et prévenir aux phénomènes d’érosion par des
aménagements adaptés ;
- Préserver au maximum de l’urbanisation le paysage naturel en
maintenant l’éco-diversité et la richesse des essences locales ;
- Conserver ou recréer une ceinture verte de vergers et de jardins, tout
particulièrement à l’interface des zones urbaines et d’extension avec le
milieu naturel ;
- Préserver les fronts boisés des massifs de l’urbanisation par un recul
approprié ;
- Mettre en valeur les monuments remarquables ;
- Préserver les cortèges végétaux majeurs des rivières par la création
d’une marge de recul appropriée ;
- Préserver les principaux alignements d’arbres ;
- Préserver les corridors écologiques et les cônes de vue, en prenant en
compte les éléments de paysage remarquables et en s’appuyant sur les
contours des lignes de crête ;
- Protéger les lisières des forêts et préserver des espaces de respiration
entre les lisières et l’habitat.
Les documents d’urbanisme locaux doivent en outre :
- Déterminer les conditions d’intégration des opérations d’aménagement
et de constructions dans le paysage notamment aux entrées
d’agglomération, y compris les constructions liées à l’agriculture ;
- Préserver des coupures vertes entre les agglomérations et notamment le
long de la RD 6014 ;
- Protéger les espaces agricoles et déterminer ceux d’entre eux à
l’intérieur desquels sont autorisées les constructions liées et nécessaires
à l’agriculture.
DOG approuvé le 16 avril 2009 7SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU VEXIN NORMAND
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE - DOG
Les conclusions de l’analyse paysagère de la vallée de la Lévrière (étude
réalisée dans le cadre de l’élaboration des PLU en 2006) constituent un
cadre de référence pour les communes concernées.
OUI NON
Les volumes bâtis sont intégrés au paysage et la Implantation en ligne de crête, absence de
végétation participe à cette intégration. végétation aux abords, couleurs des enduits trop
claires.
B. UNE PROTECTION DES BOIS ET DES BOSQUETS
Les boisements existants, en plus des grands massifs forestiers
emblématiques, sont des éléments constitutifs du paysage et contribue à la
richesse écologique d’un territoire. Les boisements sur les pentes, en
amont des bassins versants ont un rôle de régulation des écoulements et
d’épuration des eaux.
Les communes devront veiller à :
- Identifier et protéger les espaces et les linéaires boisés dans les
documents d’urbanisme : zonage N, espaces boisés classés, protection
au titre de l’article L123.1-7
- Prévoir une marge inconstructible où seuls les aménagements légers
sont autorisés, afin de protéger les lisières des forêts et des boisements.
- Préconiser l’utilisation d’essences locales et limiter l’utilisation
d’essences persistantes (thuyas, conifères…)
Protéger les haies et les
bosquets sur les pentes
DOG approuvé le 16 avril 2009 8SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU VEXIN NORMAND
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE - DOG
III.2. LE PAYSAGE BATI
A. MAINTENIR UNE IDENTITE ARCHITECTURALE
L’architecture traditionnelle locale marque l’identité du territoire. Celle-ci doit
être protégée de la banalisation des constructions neuves.
Les règlements des documents d’urbanisme devront comporter des
prescriptions correspondant au caractère des différents secteurs bâtis :
centres anciens, villages, lotissements, etc.…. en matière d’implantation
des constructions, des volumes, des hauteurs et de l’aspect extérieur. Ces
prescriptions veilleront à favoriser l’emploi des matériaux traditionnels et le
respect de la palette des couleurs locales.
Il sera recherché une harmonisation de ces prescriptions par entité
paysagère qu’on peut définir comme suit:
- le plateau du Vexin Normand et les franges du Vexin Français,
- la vallée de la Seine,
- la vallée de l’Andelle et la forêt de Lyons.
Ces recommandations porteront sur l'implantation, le volume, les
matériaux, la palette des couleurs, les clôtures. Pour l’application de ces
recommandations, les communes peuvent être accompagnées par un
architecte conseil du CAUE de l’Eure et s’inspirer des préconisations fixées
par la Charte architecturale du Pays du Vexin Normand.
DOG approuvé le 16 avril 2009 9SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU VEXIN NORMAND
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE - DOG
B. VEILLER A LA QUALITE DES NOUVELLES URBANISATIONS
Les nouvelles constructions seront implantées de préférence soit dans des
groupements existants, villages et hameaux soit dans les agglomérations
ou dans les zones d'urbanisation future de celles-ci.
NON
OUI
Dans les P.L.U., le choix des sites d'urbanisation future doit s'appuyer sur
une analyse du fonctionnement et du paysage bâti et naturel, afin de
sélectionner ceux dont l'intégration paysagère et les coûts de réalisation
seront les plus intéressants.
Ils devront faire l'objet d'orientations d'aménagement comportant les
principales caractéristiques de voies, des espaces publics, du découpage
parcellaire et des principes d'implantation.
DOG approuvé le 16 avril 2009 10SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU VEXIN NORMAND
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE - DOG
C. PROTEGER LE PATRIMOINE BATI
Le SCOT a choisi comme objectif d’agir en complément des protections
existantes sur les bâtiments classés ou inscrits.
Pour mettre en œuvre cette protection, les communes feront le
recensement des éléments ou édifices remarquables au titre de l’article
L123.1-7 : manoirs, fermes, portails, lavoirs, pigeonniers,… pour lesquels
les évolutions possibles seront fixées par le règlement du P.L.U. :
transformation, démolition,…
Conscient de la valeur du patrimoine bâti des exploitations agricoles, le
SCOT prévoit que les communes permettront la restauration, le
changement d’affectation et certaines transformations de ces bâtiments
pour préserver leur intérêt architectural et patrimonial.
DOG approuvé le 16 avril 2009 11SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU VEXIN NORMAND
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE - DOG
III.3. LES ENTREES DE VILLES ET LES AXES ROUTIERS
Les grands axes routiers jouent un rôle stratégique dans la perception du
paysage du Vexin Normand. Cela doit concerner en priorité la RD 6014 et
les entrées de ville de Gisors, Les Andelys, Etrepagny et Fleury-sur-Andelle.
Les abords de la RD 6014 seront préservés de toute nouvelle urbanisation,
en particulier de la création de zone d’activité.
Les entrées de ville devront faire l’objet d’aménagements qualitatifs.
Il est nécessaire d'avoir une politique de qualité qui devra traiter :
- le maintien des vues lointaines sur l'espace naturel,
- les plantations, à créer ou à supprimer,
- la qualité architecturale des bâtiments et de leurs abords.
Les zones qui ne sont pas soumises à l’article L.111-1-4 du Code de
l’Urbanisme (Loi Barnier) seront l'objet d'orientations d'aménagement,
prévoyant les aménagements, les .plantations et les prescriptions
architecturales nécessaires à une qualité paysagère en harmonie avec les
lieux environnants.
NON
Un traitement des abords avec
plantations et clôture contribuerait
à l’attractivité de la zone
DOG approuvé le 16 avril 2009 12SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU VEXIN NORMAND
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE - DOG
III.4. LA RESSOURCE EN EAU
A. POLITIQUE DE L’EAU ET MISE EN PLACE DE SAGE
A l'horizon 2020, la ressource en eau ne pose pas de problème majeur sur
le Vexin Normand. Cependant, la révision du SDAGE Seine-Normandie (en
cours) et la mise en œuvre des SAGE pourraient permettre une politique
globale de gestion des eaux sur ces territoires.
Les orientations du Scot s’inscrivent dans celles du SDAGE approuvé par
arrêté préfectoral du 20 septembre 1996. Il fixe notamment comme
objectifs sur l’ensemble des cours d’eau la préservation des biens et des
personnes du risque d’inondation, le maintien du libre écoulement et de la
capacité d’écoulement des crues. Par ailleurs, les documents d’urbanisme
devront se conformer au nouveau SDAGE.
Les préconisations des SAGE de l’Epte et de l’Andelle devront alors être
reprises au niveau des communes, en veillant à ce que les actions prévues
soient facilitées sur le plan règlementaire et foncier.
B. LES ZONES HUMIDES
Les zones humides sont protégées par le SDAGE et en application des
obligations législatives existantes (convention internationale Ramsar) et à
venir (Grenelle de l’Environnement), en raison de leur fonctionnalité et de
leur rôle fondamental sur le plan de la biodiversité.
Les P.L.U. et les cartes communales doivent prendre en compte les zones
humides nécessaires à la protection de la ressource en eau pour les
préserver.
Les inventaires des zones humides identifieront ces zones et fixeront les
modalités de protection règlementaires, en particulier dans les vallées de
l’Epte, de la Lévrière, de la Bonde, du Cambon, de l’Andelle, de la Lieure et
du Fouillebroc.
L’inventaire et la cartographie des zones humides font également partie
des obligations d’un SAGE. Cela se traduit par des inventaires locaux qui
complètent à une échelle plus fine les inventaires réalisés à une échelle
départementale ou d’un bassin versant. Ceux-ci peuvent être réalisés à
l’échelle communale ou à l’échelle d’un sous-bassin versant, de manière
participative, en associant notamment la profession agricole. L’objectif est
de définir de manière plus précise les contours de zones humides, d’en
décrire la typologie et d’aboutir au choix d’un mode de gestion et
d’entretien. Ce mode de gestion devra être adapté en fonction de l’intérêt
de la zone humide et des contraintes d’entretien.
Les PLU devront identifier les zones humides et les délimiter
cartographiquement, ainsi que définir les modalités de leur préservation,
soit par exemple :
- l’interdiction d'affouillement ou d'exhaussement du sol,
- l’interdiction de dépôts de matériaux,
- l’interdiction de toute construction à l’exception des équipements liés à
la gestion de l’eau.
DOG approuvé le 16 avril 2009 13SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU VEXIN NORMAND
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE - DOG
Le Scot prévoit l’interdiction de toute urbanisation dans les zones humides
qui contribuent à la ressource en eau, à la préservation des corridors
écologiques et à la biodiversité.
Maintenir les zones
humides contribuant à
la ressource en eau, et
à la préservation des
corridors écologiques
et de la biodiversité
C. GARANTIR LA QUALITE DE L'EAU
1) L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET L'ASSAINISSEMENT
L’alimentation en eau potable du Vexin Normand, à la différence d’autre
secteur du département, ne devrait pas poser de problèmes à l’horizon du
SCOT, hormis des périodes de sécheresse. Cependant une gestion
concertée des maîtrises d’ouvrage d’adduction d’eau potable et
d’assainissement peut permettre une amélioration des services. Cette
structuration est en cours de réflexion pour la sécurité de l’alimentation en
eau potable.
Une organisation comparable devrait mener une politique globale de
gestion de l’assainissement, en particulier pour le traitement des sous-
produits de l’assainissement (plan de gestion des boues des stations).
Les communes doivent se doter de schémas d’assainissement afin de ne
pas urbaniser les secteurs où l’assainissement individuel demande des
superficies de terrain incompatibles avec une politique de réduction de
l’étalement urbain.
La protection de la ressource en eau potable passe par la protection des
captages et la gestion des eaux pluviales.
En matière de gestion des eaux pluviales, les projets de développements
urbains (lotissements, ZAC, renforcements des infrastructures routières)
devront intégrer les prescriptions formulées par le service de la police de
l’eau de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt.
DOG approuvé le 16 avril 2009 14SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU VEXIN NORMAND
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE - DOG
2) UNE POLITIQUE DE QUALITE ET D'ECONOMIE D'EAU
Une certaine vigilance est nécessaire vis-à-vis de la nappe souterraine de
la Craie qui alimente le Vexin Normand et dont la ressource pourrait souffrir
de sécheresse répétitive.
Les P.L.U. et les cartes communales doivent définir dans leurs règlements
les mesures permettant d'économiser l'eau dans les procédés de
construction, d'éviter l'imperméabilisation excessive des sols et incitant à la
récupération des eaux pluviales.
Enfin, la localisation des extensions urbaines et les formes d’habitat doivent
permettre d’optimiser les réseaux d'adduction et d'assainissement.
Les documents d’urbanisme locaux doivent :
- Interdire les constructions et l’exploitation de gravières dans les
périmètres de protection rapprochés des captages d’eau protégés ou
non au titre d’un arrêté préfectoral ;
- Déterminer en tant que de besoin les secteurs potentiellement
intéressants pour les captages d’eau potable ;
- Interdire toute construction et installation génératrices de concentration
de polluants à proximité des cours d’eau, dans les espaces agricoles,
naturels et forestiers et en zone inondable ;
- Organiser dans l’ensemble des sites d’extension urbaine les modalités
permettant la rétention des eaux pluviales ou l’infiltration des eaux
pluviales dépolluées.
DOG approuvé le 16 avril 2009 15SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU VEXIN NORMAND
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE - DOG
III.5. LES ORIENTATIONS POUR LES ESPACES
NATURELS D’INTERET ECOLOGIQUE
Des espaces riches de milieux biologiques intéressants et/ou exceptionnels
sont situés dans le Vexin Normand.
La qualité des espaces naturels et du cadre de vie impose aux communes
de prendre en compte toutes les protections juridiques imposées par les
normes internationales, européennes ou nationales. Dans les sites
protégés, l’urbanisation sera strictement limitée et veillera à son intégration
optimale dans son environnement. Au regard des mesures prévues par le
Grenelle de l’environnement, le Scot promeut la biodiversité et la
préservation des sites naturels.
Les documents d'urbanisme devront intégrés ces sites en reprenant les
limites définies par les textes réglementaires.
Les communes concernées devront prendre en compte les objectifs de
protection liés aux différentes espaces naturels :
- les zones Natura 2000,
- les zones humides mentionnées au paragraphe ll 4B,
- les espaces boisés mentionnés au paragraphe lll.1B,
- les ZNIEFF de type 1 devront être strictement protégées, et dans les
ZNIEFF de type 2 les aménagements et les constructions autorisés ne
devront pas modifier le fonctionnement de l’écosystème, notamment des
corridors écologiques.
La vocation d'espaces naturels de l’ensemble de ces sites est affirmée par
le SCOT.
DOG approuvé le 16 avril 2009 16SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU VEXIN NORMAND
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE - DOG
A. LA PRESERVATION DES CORRIDORS ECOLOGIQUES PAR
L’IDENTIFICATION DE LA TRAME VERTE ET BLEUE
La trame verte et bleue est constituée par le réseau hydrographique, les
zones humides, le bocage et les espaces boisés, les espaces naturels
protégés, et plus largement les espaces non bâti. Une importance majeure
revient aux connexions entre les sites Natura 2000, les ZNIEFF de type 1 et
les zones humides avérées.
A l’échelle du Scot, cette trame est définie notamment par les principaux
cours d’eau, les espaces naturels sensibles, les espaces protégés et les
zones non bâties. Cette trame générale, ainsi que les principales barrières
écologiques (urbanisation, infrastructures) sont présentées sur la carte ci-
après.
Les communes détermineront à une échelle plus fine la trame verte et bleue
de leur territoire, au travers des PLU, des inventaires des zones humides et
des schémas bocagers, tout en considérant les continuités sur les
territoires limitrophes.
Elles assureront ainsi le maintien d’une trame continue de milieux
interstitiels de qualité (haies, mares, talus, bosquets, alignements d’arbres,
prairies, zones humides, éléments végétaux de nature ordinaire) entre les
espaces naturels protégés.
Dans le cadre de l’aménagement de nouveaux quartiers ou du
réaménagement des principales infrastructures de transport, la continuité
des corridors biologiques les plus importants sera assurée par des
aménagements adaptés (espaces verts, passage à faune).
DOG approuvé le 16 avril 2009 17SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU VEXIN NORMAND
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE - DOG
IV. LES GRANDS EQUILIBRES ENTRE ESPACES URBAINS ET
ESPACES NATURELS
IV.1. LA GESTION DU DEVELOPPEMENT URBAIN
A. SE DONNER LES OUTILS POUR UNE GESTION DE L'ESPACE
Le Plan Local d’Urbanisme, et a minima la carte communale donnent les
moyens à la commune de gérer son développement spatial. Le Scot
promeut, donc, la réalisation d’un P.L.U pour assurer la maîtrise de
l’étalement urbain. Le Syndicat Mixte peut accompagner les communes
dans l’élaboration de ces documents d’urbanisme.
La généralisation des P.L.U. sur l'ensemble des communes peut leur
permettre de constituer des réserves foncières pour assurer la réalisation
d’opérations en cohérence avec leur politique d’habitat. Les outils sont la
mise en place du droit de préemption urbain pour réaliser du logement
social et la majoration de l’imposition des terrains nus en secteur
constructible pour décourager la rétention foncière.
Des secteurs des P.L.U. pourront être réservés à la construction d’un
minimum de logements sociaux dans toute nouvelle opération. Des
moyens plus directement opérationnels comme la ZAD, la ZAC ou
l'emplacement réservé peuvent être utilisés.
B. DES FORMES D'HABITAT MOINS CONSOMMATRICES D'ESPACES
La maîtrise de la consommation de l’espace sera le résultat des règles de
construction dans les documents d’urbanisme des communes. La densité
moyenne de 12 logements à l’hectare doit se moduler en fonction du
contexte. Cette moyenne est à apprécier au niveau communal entre les
différentes zones urbaines et d'urbanisation future.
L’objectif de densité moyenne de 12 logements à l’hectare correspond à un
ratio minimum pour l’ensemble du territoire. Il concerne plus précisément
les espaces situés en périphérie des bourgs et des villes. Il sera modulé en
fonction de la typologie des communes, des formes urbaines et des
densités existantes sur leur territoire. Les communes devront appliquer un
ratio de densité moyenne plus élevé aux zones de leur territoire situées
dans des espaces déjà fortement urbanisés (bourgs, centres ville).
Les pôles urbains peuvent accueillir des opérations de logements collectifs
ou d’habitat groupé. Selon le contexte urbain existant, des densités de 60
logements à l’hectare sont envisageables.
Pour les lotissements plus périphériques, la densité moyenne ne pourra
être inférieure à 12 logements à l’hectare. Mais une densité inférieure
pourra être admise pour l’habitat individuel en fonction du contexte
spécifique.
DOG approuvé le 16 avril 2009 18SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU VEXIN NORMAND
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE - DOG
C. LA GESTION ENVIRONNEMENTALE
Les communes sont incitées à avoir un développement urbain inscrit dans
le développement durable.
Pour une prise en compte globale des problématiques environnementales,
elles intègreront dans la démarche de leur P.L.U. une approche
environnementale globale, type A.E.U. qui propose une réflexion globale et
transversale autour de cinq thèmes principaux : énergie, déplacements,
eau, déchets et environnement sonore. Cette approche peut s’appliquer
également à toutes les étapes d’un projet urbain : état des lieux,
orientations et principes d’aménagement, transcription dans les documents
d’urbanisme, suivi en phase opérationnelle.
Au regard des mesures issues du Grenelle de l’environnement, le Scot
promeut tous les dispositifs contribuant à la réduction de la consommation
d’énergie (biomasse, géothermie, solaire, bois, …). Il valorise également
tous les modes de déplacements doux (liaisons pédestres ou cyclables
entre les zones urbaines, aménagement de sentiers,…).
DOG approuvé le 16 avril 2009 19SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU VEXIN NORMAND
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE - DOG
IV.2. LA MAITRISE DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE
Ce qu’on appelle l’étalement urbain, c'est-à-dire la consommation de
l’espace naturel pour des installations et des constructions neuves doit être
limitée. On privilégiera les implantations dans les zones déjà équipées et
viabilisées, et ceci pour répondre à deux objectifs : la maîtrise des coûts de
raccordement aux réseaux et la réduction de l’artificialisation des sols.
CAUE 76
DOG approuvé le 16 avril 2009 20SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU VEXIN NORMAND
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE - DOG
Les documents d’urbanisme devront :
- Limiter les zones à urbaniser à court terme aux surfaces nécessaires
pour atteindre les objectifs de croissance retenus dans le P.A.D.D.,
- Construire en priorité dans les espaces disponibles à l’intérieur du
périmètre urbanisé, avec éventuellement des opérations de
renouvellement urbain (réhabilitation, changement de vocation) et
remplissages des cœurs d'îlots,
- Favoriser les opérations d’ensemble intégrées à l’urbanisation existante,
- Définir les limites de l’urbanisation par une coupure verte pour une limite
avec l'espace agricole,
- Eviter les urbanisations linéaires le long des axes routiers.
Les P.L.U. devront comporter des orientations d’aménagement des zones
AU indiquant les zones d’habitat et les densités de logements, les principes
de voirie et les espaces verts, dans une recherche d’optimisation de la
consommation de l’espace.
DOG approuvé le 16 avril 2009 21SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU VEXIN NORMAND
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE - DOG
IV.3. DES FORMES URBAINES ADAPTEES
La diversification de l’habitat doit favoriser des formes urbaines moins
consommatrices d’espaces, en harmonie avec le patrimoine urbain
existant :
- l’habitat intermédiaire et les maisons de ville,
- les maisons accolées ou individuel groupé,
- les petits collectifs,
- la réhabilitation des logements anciens,
- la transformation de certains bâtiments (activité, grange,…) en plusieurs
logements si les obligations de stationnement sont remplies.
Pour cela, les P.L.U. devront mentionner des règles d’implantation des
constructions, de hauteur, de coefficient d’occupation des sols qui favorise
ces densités et ces opérations.
Les règlements devront favoriser les implantations des constructions en
contiguïté, accolées, en limite de parcelle, etc.…, dans un souci de gestion
économe de l’espace.
La construction d'habitat isolé est interdite en dehors de tout groupement
d'au moins 4 habitations.
DOG approuvé le 16 avril 2009 22SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU VEXIN NORMAND
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE - DOG
IV.4. LES ZONES NON URBANISABLES
Dans la recherche de l’équilibre du territoire entre les espaces urbanisés et
les espaces naturels, certaines zones ne sont pas urbanisables.
- Les espaces naturels et agricoles qui valorisent le cadre de vie et le
paysage seront inscrits en zone N ou A des P.L.U. et en zone
inconstructible dans les cartes communales.
- Les espaces reconnus de valeur agronomique et destinés durablement
à l’activité agricole seront protégés de toute urbanisation. Ils devront
figurer en zone A dans les P.L.U.
- Dans les zones de risques l’urbanisation sera interdite, limitée ou
sujette à des conditions d’aménagement particulières en adéquation
avec le degré d’aléa.
- Les zones inondables et les zones d’expansion des crues seront
préservées de toute urbanisation.
DOG approuvé le 16 avril 2009 23SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU VEXIN NORMAND
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE - DOG
V. LES OBJECTIFS RELATIFS A L’EQUILIBRE SOCIAL DE
L’HABITAT : PRIVILEGIER UNE OFFRE QUALITATIVE
A. RURALISER LE LOGEMENT LOCATIF
Le Scot du Pays du Vexin Normand se fixe un objectif de diversification du
parc de logements pour assurer la mixité sociale en l’adaptant aux
itinéraires résidentiels. Ainsi, chaque catégorie de la population doit trouver
sur le territoire une offre adaptée à ses besoins.
Pour concrétiser cette ambition, le ou les Programmes Locaux de l’Habitat
(P.L.H.) :
- mettent en œuvre les conditions permettant de réaliser dans chaque
commune, l’équilibre social de l’habitat notamment sous la forme de
logements locatifs aidés attribués sous condition de ressources ;
- ont pour priorité la réalisation de logements adaptés aux besoins des
jeunes ménages et des personnes âgées.
Les opérations d’aménagement d’au moins 4 logements :
- Visent à la réalisation d’un objectif d’environ 1/4 de logements sous
forme de logements aidés. Cette règle ne s’applique pas aux opérations
d’aménagement intégrées dans un quartier où cette proportion est déjà
atteinte.
- Recherchent la construction de bâtiments à haute performance
énergétique.
Enfin, les nouvelles opérations d’habitat devront proposer une offre
équilibrée en termes de taille de logements, en privilégiant des
architectures plus compactes, économes en foncier et respectueuses des
échelles urbaines et villageoises. Les documents d’urbanisme locaux
doivent mettre en œuvre les conditions permettant de concilier la diversité
des fonctions urbaines avec l’objectif de mixité sociale, dans le respect de
la qualité du bâti.
De plus, la localisation des nouveaux logements se fera en lien avec
l’accessibilité aux services et aux transports en commun pour éviter l’usage
de la voiture.
B. LA RENOVATION DU PARC ANCIEN
Le diagnostic a pointé un parc vacant encore important malgré les
différentes opérations de réhabilitation qui ont été menées sur le Pays.
Ces opérations de réhabilitation doivent se poursuivre afin de permettre la
mise aux normes d’une habitabilité correspondant aux modes de vie
actuelles, pour éviter que le parc ancien soit abandonné au profit de
constructions neuves.
Pour développer les capacités d’accueil dans les secteurs urbanisés en
utilisant au mieux les parties bâties, les documents locaux d’urbanisme
définissent les modalités permettant l’urbanisation des dents creuses et la
mutation du bâti existant, dans le respect de la morphologie urbaine et du
patrimoine existant.
DOG approuvé le 16 avril 2009 24SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU VEXIN NORMAND
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE - DOG
Ils devront faciliter la réalisation d’opérations de requalification/
restructuration urbaine, ainsi que la reconstruction ou la réhabilitation
d’immeubles vétustes ou inadaptés. Ces opérations doivent en particulier
favoriser l’agrandissement des logements et organiser des solutions de
stationnement dans les centres anciens.
Pour protéger le bâti ancien de qualité, les communes instaurent le permis
de démolir lorsqu'elles se dotent d'un P.L.U.
DOG approuvé le 16 avril 2009 25SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU VEXIN NORMAND
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE - DOG
VI. LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE DEPLACEMENTS
A. L’ACCESSIBILITE DU TERRITOIRE
L’amélioration de l’accessibilité du Vexin Normand passe par le
renforcement de la RD 6014 (ancienne RN 14) et par le contournement est
de l’agglomération de Rouen.
Les documents d’urbanisme locaux des communes concernées devront
non seulement prendre en considération les emplacements réservés
nécessaires à la réalisation de ces infrastructures, mais anticiper les
modifications du fonctionnement des zones urbanisées concernées :
paysagement, écrans phoniques,…
Les relations internes au territoire doivent être améliorées, en prenant en
considération les circulations de tous les types de véhicules y compris les
engins agricoles, en particulier les accès aux sites de collecte et de
transformation de la production : silos, I.A.A., …
La localisation des futures zones d’activités dans les documents
d’urbanisme devront être prévues à proximité immédiate d’axes de
desserte structurants, afin d’éviter l’augmentation du trafic des poids lourds
sur les routes de desserte interne du Pays du Vexin Normand.
B. LES TRANSPORTS COLLECTIFS
Les transports collectifs ont été définis dans le Scot du Pays du Vexin
Normand comme un enjeu en termes de services et d’équipements. Les
infrastructures routières sont nombreuses sur le territoire (RD 6014, RN15,
RN31, RD 181). Cependant, le réseau de transports en commun est peu
développé, que ce soit par la route (fréquence et lignes) ou par le rail (la
gare de Gisors est le seul point d’arrêt SNCF du territoire).
En outre, le diagnostic du SCOT met en évidence un territoire polycentré,
dépendant de l’agglomération parisienne, de l’agglomération rouennaise et
de l’utilisation d’infrastructures de transport en commun des territoires
limitrophes (gares de Val de Reuil, de Gaillon, Bonnières et de Vernon).
Ce caractère périurbain du Vexin Normand et sa dépendance vis-à-vis des
agglomérations voisines mettent en évidence la nécessité de s’orienter vers
des démarches de rabattement et d’intermodalité des transports afin de
limiter l’utilisation de la voiture personnelle et ses conséquences en termes
d’investissements à prévoir pour la sécurisation de multiples voies de
communication face à l’accroissement du trafic automobile.
Ainsi, afin de faire face, à terme, à la saturation du réseau routier mais aussi
de favoriser l’accès de l’ensemble de la population aux transports en
commun, le Scot met en œuvre les objectifs prioritaires suivants :
DOG approuvé le 16 avril 2009 26SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU VEXIN NORMAND
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE - DOG
- Renforcer la desserte ferroviaire du territoire,
- Favoriser l’inter modalité de la Gare de Gisors et son rôle de pôle
d’échanges,
- Mettre en place un dispositif de rabattement depuis chaque
agglomération vers la gare de Gisors et les gares à l’extérieur du
territoire (Vernon, Gaillon-Aubevoye, Bonnières,…),
- Demander aux collectivités publiques et aux Autorités Organisatrices des
Transports d’assurer la diversification des dispositifs de rabattement
depuis chaque agglomération vers les gares (transports collectifs par
bus, transport à la demande, itinéraires de circulation douce),
- Mutualiser des aires de stationnement pour différents usages
(commerces, équipements publics, transports, …) dans l’optique d’une
utilisation fonctionnelle et économe de l’espace.
C. LES LAISONS DOUCES
L’objectif est d’offrir des alternatives à la voiture individuelle par des
cheminements piétonniers et des pistes cyclables.
Le Scot préconise que des itinéraires cyclables et pédestres performants et
continus soient intégrés dans les projets d’aménagement des espaces
publics. Ainsi, le Scot promeut une approche de la voirie publique comme
un espace public « civilisé », lieu de circulations apaisées et composante
qualitative du paysage urbain.
Les documents d’urbanisme doivent prévoir un maillage de cheminements
pour les piétons et les vélos, avec éventuellement les emplacements
réservés nécessaires à leur réalisation. Dans la mesure du possible ces
itinéraires devront être conçus avec une continuité intercommunale.
A l'intérieur du tissu urbain, on cherchera à développer les relations
piétonnes ou cyclables entre les quartiers et à favoriser l'accès aux pôles
d'échanges (arrêts de car).
La stratégie de développement des circulations douces peut s’appuyer sur
le réseau des voies vertes / véloroutes mis en place par le Conseil général
de l’Eure. Les derniers travaux en date ont permis la mise en service en
janvier 2008 de la voie verte de la vallée d’Epte pour offrir un itinéraire de
26 km de Gasny à Gisors (cf. carte ci-après).
DOG approuvé le 16 avril 2009 27SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU VEXIN NORMAND
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE - DOG
Extrait de la carte « Schéma Départemental des véloroutes et des voies
vertes de l’Eure – CG de l’Eure
DOG approuvé le 16 avril 2009 28SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU VEXIN NORMAND
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE - DOG
VII. LES OBECTIFS RELATIFS A L’ACTIVITE ECONOMIQUE
VII.1. LA QUALIFICATION DES ZONES D’ACTIVITES
A. STRUCTURER LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
Le Pays du Vexin Normand doit conserver un équilibre entre la population
résidente et les emplois offerts sur le territoire. A cette fin, il doit être attractif
pour de nouvelles entreprises et permettre à celles qui sont déjà là de se
moderniser et de se développer. L’objectif du Scot est de préserver
l’identité du territoire et de ne pas faire du Pays une « banlieue dortoir » de
l’agglomération rouennaise ou de la région parisienne. Ainsi, il est prévu
une offre foncière importante pour assurer une dynamique économique
locale. Cette offre foncière est fondée sur les besoins des Communautés
de communes.
Afin de mettre en place les conditions de ce développement, les
intercommunalités doivent mutualiser leurs moyens pour un nombre limité
d’espaces à vocation économique.
Pour réaliser ces objectifs, il est nécessaire que les documents d'urbanisme
favorisent cette politique.
La définition des zonages et les règlements concernant ces zones se feront
en prenant en considération la nature des activités afin d'assurer une
intégration au contexte : implantations, volumétrie, aspect extérieur,
plantations, stationnement pour produire ou aménager des zones de
qualité.
Les installations générant des risques et des nuisances doivent être
implantées dans des zones adaptées.
L’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones n’est pas autorisée en cas
de concurrence avec l’offre de terrains libres existants à moins de 10 km.
Les P.L.U. devront identifier les zones en déshérence ou en mutation pour
définir les orientations contribuant à leur réhabilitation.
Une architecture de
qualité, le respect
des arbres existants,
des aménagements
simples.
DOG approuvé le 16 avril 2009 29SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU VEXIN NORMAND
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE - DOG
Une organisation qui
respecte la végétation
existante et qui prévoit
une zone verte pour
intégrer la zone dans le
site.
B. DEVELOPPER LES SITES A VOCATION ARTISANALES DANS LES POLES
DE PROXIMITE
Les installations d'entreprises artisanales et commerciales dont les activités
ne génèrent pas de nuisances pour le fonctionnement du quartier seront
autorisées en milieu urbain, en particulier dans un souci de pérenniser les
entreprises artisanales existantes.
la création de zones à vocation artisanale doit se faire à proximité des
zones d’habitat afin de limiter les déplacements domicile-travail et pour
répondre à un objectif de gestion économe de l’espace et à la demande de
services des habitants.
DOG approuvé le 16 avril 2009 30Vous pouvez aussi lire