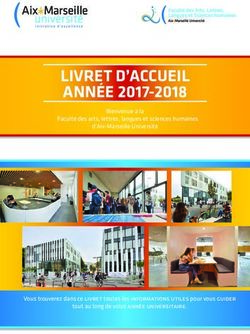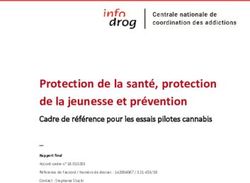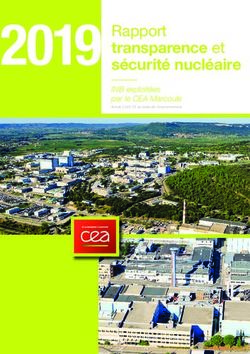FORMATION INGENIEUR AGRONOME PROGRAMME DE DEUXIEME ANNEE SEMESTRE S8 ANNEE UNIVERSITAIRE 2018 2019 - ENSAT
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
FORMATION INGENIEUR AGRONOME
PROGRAMME DE DEUXIEME ANNEE
SEMESTRE S8
ANNEE UNIVERSITAIRE 2018 - 2019
Document édité par la direction des études le 12/12/2018 2ème année / Semestre 8 1SEMESTRE S8
Le contenu pédagogique du semestre est composé de deux types d’unités d’enseignement (UE) :
- les UE du tronc commun, obligatoires pour tous les élèves-ingénieurs, et donnant des outils indispensables pour
un futur ingénieur agronome;
- les UE de pré-spécialisation permettant à chacun d'élaborer un parcours personnalisé en fonction de son projet
professionnel et en prenant en compte les modules pré-requis nécessaires pour entrer dans une spécialisation.
Volume
Intitulés des Unités d’enseignement Cours TP-TD ECTS
horaire
Management 3 : échanges internationaux, droit
52h 40h 12h 3
des affaires, qualité dans l’agro-alimentaire
Langues et sports 60h 0h 60h 2
UE de pré-spécialisation série 1 60h 5
UE de pré-spécialisation série 2 60h 5
UE de pré-spécialisation série 3 60h 5
UE de pré-spécialisation série 4 60h 5
UE de pré-spécialisation série 5 60h 5
Document édité par la direction des études le 12/12/2018 2ème année / Semestre 8 2UNITES D’ENSEIGNEMENT DU TRONC COMMUN
(UE obligatoires pour tous les étudiants – 120h)
UE MANAGEMENT 3 : ECHANGES INTERNATIONAUX, DROIT DES AFFAIRES, QUALITE DANS L’AGRO-
ALIMENTAIRE – 52h – 3 ECTS
Responsable : G. Nguyen nguyen@ensat.fr
Objectifs
Cette UE complète les apports en sciences sociales (économie, gestion, droit) proposés au cours de semestres
précédents (S5 à S7). Elle vise à proposer aux élèves des nouvelles connaissances, et des compétences de base
de l'ingénieur agronome dans les domaines de l'économie internationale, du droit des affaires et du management de
la qualité. Ces éléments cimentent la culture économique, juridique et en qualité, que doit posséder un ingénieur
agronome, quelque soit le métier exercé. Elle est composée des 3 modules présentés ci-dessous.
Contrôle des connaissances
La note finale de l’UE Management 3 est la moyenne des notes obtenues aux 3 modules, affectées du même
coefficient.
Module 1 – Economie internationale – cours : 13h – TD: 4h
Intervenant : G. Nguyen
Objectifs
Ce module vise à introduire les étudiants aux concepts et grilles d’analyse économique nécessaires à la lecture
critique de l’actualité et à la compréhension des enjeux concernant les problèmes contemporains :
(1) de croissance et de développement économique dans un cadre européen et international. Il s’agira ici
d’approfondir les définitions de la croissance et du développement vues dans le cadre de l’UE « Introduction
au développement durable » en S7, en posant les questions suivantes : Quels sont les modèles de
croissance ? Dans une perspective de transition (démographique, énergétique, écologique et alimentaire),
quels sont aujourd’hui les enjeux de croissance économique ? Qu’est-ce qui est nouveau avec les pays
émergents ?
(2) de commerce international et globalisation économique : Quel intérêt à échanger avec d’autres pays, pour les
entreprises, les consommateurs, les Etats ? Comment se structurent aujourd’hui les échanges
internationaux et quels en sont les déterminants ? Qu’est-ce que la globalisation des échanges ? Pourquoi et
comment réguler ces échanges ? Comment peut-on analyser les nombreux conflits sur le plan des échanges
internationaux ?
(3) de finance internationale : Comment fonctionne le système monétaire international ? Qu’entend-on par
« financiarisation » de l’économie ? Qu’est-ce qu’une crise économique ? Pourquoi les crises reviennent-elles
toujours ? Quel rôle pour les Etats ?
Programme
1- Croissance et développement économique : modèles de croissance et durabilité, économies émergentes,
croissance verte
2- Echanges internationaux et globalisation économique : éléments théoriques et d’analyse historique, stratégies
d’internationalisation des firmes, structuration et régulation des échanges (négociations internationales à l’OMC et
bilatérales comme le Traité Transatlantique)
3- Finance internationale : de la création de la monnaie au système monétaire internationale, crises financières
4- Selon l’actualité du moment, d’autres thèmes sont abordés comme : la crise alimentaire de 2008 et ses
conséquences, la géopolitique des stratégies de sécurité alimentaire et de développement agricole, etc.
Méthodes pédagogiques
Cours magistraux, conférences, projets individuels ou par groupe (revue de presse, etc.), jeux de simulation
(négociations sur réechelonnement des dettes d’un pays, négociations autour de traités commerciaux multilatéraux ou
bilatéraux)
Contrôle de connaissances
2 TD notés - 30%
Examen écrit (QCM et questions ouvertes) – 70%
Bibliographie :
Ouvrages en économie contemporaine et macroéconomie (Stiglitz ; Blanchard et Cohen ; Burda et Wyplosz ; Mankin)
Ouvrages en économie du développement et économie internationale (Abdelmalki ; Gillis ; Giraud ; Krugman ; North ;
Treillet ; Sen)
Lecture de la presse nationale et internationale fortement recommandée
Document édité par la direction des études le 12/12/2018 2ème année / Semestre 8 3Module 2 – Droit de l'entreprise et éthique – cours: 13h – TD: 4h
Responsable : G. Nguyen nguyen@ensat.fr
Intervenante : S. Ruccella
Objectifs
L'objectif de ce module vise à donner une culture juridique de base dans quelques champs importants pour un
agronome. Plusieurs thèmes seront abordés: généralités sur le droit, l'organisation des tribunaux en France, éléments
du droit du travail, de droit commercial. Dans ce module seront abordées les notions d'éthique de l'entreprise.
Programme
Généralités sur le droit : sources du droit, le système de la preuve
Organisation des tribunaux en France
Droit du travail : la formation, l'exécution et la rupture du contrat de travail
Droit commercial, droit des brevets
Ethique de l'entreprise
Méthodes pédagogiques
Cours magistraux, conférences, Travaux dirigés sur des cas pratiques, et travaux personnels.
Contrôle des connaissances
Examen écrit
Bibliographie :
J. PELISSIER, A. SUPIOT, A. JEAMMAUD, Droit du travail, précis Dalloz, 28e éd. 2014.
E. DOCKES, Droit du travail, Relations individuelles, Hypercours, Dalloz, 2005.
J.-P. CLAVIER, F.-X. LUCAS, Droit commercial, Champ U, Flammarion, 2003.
R. ENCINAS DE MUNAGORRI, G. LHUILIER, Introduction au droit, Champ U, Flammarion, 2011.
Module 3 – Management de la qualité – cours: 13h – TD: 4h
Intervenants : O. Delahaye, V.Olivier Salvagnac delahaye@ensat.fr
olivier@ensat.fr
Objectifs
Acquérir les connaissances de base sur l’économie et le management de la qualité dans les secteurs
agroalimentaires.
S’initier à la réglementation et aux normes servant à réguler et à gérer les systèmes de qualité alimentaire dans un
cadre mondialisé.
Programme
Partie I : Economie et management de la qualité dans les systèmes agro-alimentaires (3CM+ 1 TD) V.Olivier
Salvagnac
1. Introduction à l’économie de la qualité des systèmes agro-alimentaires
2. Modes de valorisation de la qualité des produits (SIQO et marques)
3. Management de la qualité, l’exemple de l’ISO (TD ISO 9001)
Partie II : Réglementation et Systèmes de management de la qualité sanitaire des aliments (4CM + 1 TD) O.
Delahaye
1. La réglementation européenne et nationale en matière d'hygiène alimentaire.
2. Le système HACCP : principe, mise en œuvre et limites. (TD)
3. La traçabilité: obligations et limites
4. Entre réglementation et marché : des référentiels de distributeurs
Méthodes pédagogiques
Cours, TD, étude de cas et travaux de groupe
Contrôle des connaissances (1ere session et rattrapage)
Examen de connaissances sur table
Bibliographie (plus de références données en cours)
- Chemineau (dir) 2012, Comportements alimentaires, Choix des consommateurs et politiques nutritionnelles,
Editions QUAE, 87 p.
- Economie agro-alimentaire : une économie de la qualité, Nicolas F. Valceschini E. eds. INRA Economica
1995
- La grande transformation de l’agriculture : lectures conventionnalistes et régulationnistes G. Allaire,
R.Boyereds, 1995
- Le système alimentaire mondialisé, J L Rastoin, G Ghersi, 2010, éditions Quae, coll. Synthèse.
- Agroalimentaire et Risques sanitaires, Retour sur un demi-siècle de défis et de progrè, s, L. Rosso, 2012,
L’Harmattan
- sites Internet d’information sur la réglementation et les normes, exemples : Codex Alimentarius, Europa Eur-
lex, Legifrance…ISO/Afnor, FAO, OMPI, INAO …+ via biblio INPT accès au bouquet de normes
« sagaweb » rassemblant plusieurs milliers de référentiels.
Document édité par la direction des études le 12/12/2018 2ème année / Semestre 8 4UE LANGUES ET SPORTS
Module 1- Anglais – 22h de TD
Responsable : A Alibert aliberta@ensat.fr
Objectifs
Permettre l’activation et le développement des acquis par la sélection de domaines d’acquisitions spécifiques liés à
l’analyse des besoins professionnels de l’ingénieur agronome d’aujourd’hui. On recherchera (1A) l’élargissement et
perfectionnement des champs linguistiques à couvrir (langue technique, scientifique et de communication), (1B) la
meilleure utilisation interactive possible de l’outil linguistique scientifique dans le cadre de présentations orales, (2)
une ouverture et un enrichissement culturels des pays anglophones .
Programme
Approfondissement de la langue anglaise et des outils scientifiques. La compréhension écrite, l’esprit de synthèse et
l’expression orale. Pour couvrir ce programme, 2 modules sont proposés : (1A) Applied scientific communication, (1B)
Scientific Presentation, (2) Project work.
Méthodes pédagogiques
Les groupes sont formés pour respecter le rythme de progression le mieux adapté aux étudiants. Le cours est destiné
à l’approfondissement et à l’élucidation du matériel linguistique et/ou culturel (enregistrements audio, vidéo, films,
documents écrits) ainsi qu’à la validation du travail de préparation personnel ou de groupe. Afin de favoriser la prise
en charge par l’élève de sa propre progression (enrichissement lexical, approfondissement de compétences
acquises), des documents de référence, des romans contemporains et des enregistrements sonores sont à la
disposition des étudiants à la bibliothèque.
Contrôle des connaissances
En deuxième année il n’y a pas d’examen final. Trois notes sont attribuées : une dans le cadre de la présentation
orale scientifique et pour la présentation, une concernant la synthèse et débat liés à la lecture de livres en anglais et
une troisième est donnée concernant la participation en cours. Chaque note a le même coefficient (1) et la moyenne
est calculée sur ces trois notes.
Module 2- Langue vivante 2: espagnol/allemand – 20h TD
Responsable : Carmen Lorente
Objectifs
Permettre à chacun de développer ses acquis et de communiquer socialement dans les situations de la vie courante
plus ou moins complexes, selon son niveau.
Programme
Remise à niveau grammatical et approfondissement lexical (écrit et orale). Communication dans les actes sociaux de
la vie quotidienne. Sensibilisation à la langue scientifique générale.
Méthodes pédagogiques
Exercices sur les structures essentielles de la langue espagnole. Lecture et exploitation d’articles de presse actuelle.
Ecoute intensive (vidéo, films, Radio Nacional de Espana). Débats.
Contrôle des connaissances
Contrôle continu oral et écrit.
Module 3 - Education Physique et Sportive – 20h
Responsable : Jean-Louis Dessacs dessacs@ensat.fr
Objectifs
Les activités physiques et sportives proposées à l'E.N.S.A.T. sont :
L'EDUCATION PHYSIQUE
Deux heures de cours obligatoires, donnant lieu à la délivrance d'une note prise en compte dans la moyenne
générale. Ces deux heures se décomposent en cours d'Education Physique généralisée, et en initiation ou
perfectionnement aux différents sports collectifs et individuels (escrime, athlétisme, judo, tennis, golf, etc.).
LES ACTIVITES PHYSIQUES
Proprement dites, elles se pratiquent au sein de l'Association Sportive.
• La compétition FNSU : Elle concerne les élèves-ingénieurs qui désirent pratiquer le sport en compétition. Les
équipes "E.N.S.A.T." (J. Gens et J. Filles) représentent l'école dans les rencontres inter-universitaires ; de même pour
les différents sports individuels : athlétisme, aviron, escrime, judo, golf, tennis, natation, etc. Les compétitions ont lieu
le jeudi après-midi ou en nocturne les différents soirs de la semaine.
• Les activités "E.N.S.A.T." : Elles permettent de participer à des entraînements hebdomadaires aux différents sports
collectifs ou individuels : natation, danse, équitation, golf, tennis, randonnée en montagne, à un stage de ski d'une
semaine dans les Alpes, aux rencontres traditionnelles en sports collectifs contre l'E.N.S.A. Montpellier, l'E.N.I.T.A.
Bordeaux et l'E.N.S.A. Rennes, et bien sûr aux "Inter-Agros" (manifestation nationale).
• Les activités "I.N.P.T." : Participation des étudiants aux animations proposées par le D-APS de l'I.N.P.T., "I N P I A
D E S", tournois inter-école, sorties de ski hebdomadaires, nuit du volley, etc.
Document édité par la direction des études le 12/12/2018 2ème année / Semestre 8 5LA PRE-SPECIALISATION Objectifs Les enseignements de pré-spécialisation ont pour but de permettre aux élèves ingénieurs d’approfondir un champ disciplinaire et de personnaliser leur parcours de formation en fonction de leur projet professionnel. Ce parcours, débouchant sur une spécialisation, doit être établi en fonction des UE exigées (pré-requis) pour entrer dans une spécialisation (cf guide des modalités d’orientation). Certaines de ces UE sont proposées en langue anglaise, partiellement ou en totalité. L’objectif est double : être plus attractif pour l’accueil d’étudiants internationaux et permettre aux étudiants français d’intégrer progressivement l’anglais comme langue de travail. Procédure de choix et d’inscription pour les élèves-ingénieurs : cf guide des modalités d’orientation Une organisation par UE, par série et par filières de pré-spécialisation Chaque UE de pré-spécialisation a une durée totale de 60h (cours, TD, TP, Travail Personnel). Chaque enseignant responsable fixe les modalités du contrôle de connaissances. En cas de contrôle final, l’examen a lieu à la fin de l’UE de pré-spécialisation dans le cadre des horaires impartis à chaque UE. Les UE sont réparties en 5 séries consécutives, approximativement de 3 semaines chacune. Enfin les UE sont réparties, dans la mesure du possible, par filières de pré-spécialisation. C’est ainsi que, pour chaque série, 6 UE sont proposées correspondant en général aux 6 grandes filières de pré-spécialisation, conduisant aux spécialisations proposées à l’ENSAT. Bien évidemment, cette structuration n’est pas systématique et certaines UE peuvent intéresser plusieurs filières de pré-spécialisation. Les UE transversales, susceptibles d’intéresser les étudiants quelque soit leur projet de spécialisation, apparaissent dans la dernière ligne. Organisation générale des UE 2018-2019 Document édité par la direction des études le 12/12/2018 2ème année / Semestre 8 6
Les UE du S8 sont organisées en 6 filières(lignes du tableau) autour des thématiques de la formation d’ingénieur et
pour préparer aux spécialisations de l’Ensat. La dernière ligne du tableau est constituée d’unités dites transversales et
qui intègrent plusieurs de ces thématiques de formation.
I- AGROMANAGEMENT
Objectifs
-Préparer les étudiants à accéder à des métiers nécessitant une double compétence, technique et managériale :
- métiers transversaux nécessitant des compétences en gestion, économie et sociologie : management
de projet, conduite du changement, chargé de mission
- métiers opérationnels : marketing, commercial, comptabilité-finance
Les métiers visés sont essentiellement situés au sein des entreprises du secteur agroalimentaire ou encore
cosmétique, d'organisations professionnelles agricoles, de banques, de bureaux d'études, de cabinets de
consultants…
-Préparer l’accès à la spécialisation Agromanagement
Il s’agit d’apporter des bases conceptuelles et méthodologiques en sciences de gestion, économiques et sociales, que
les étudiants sont susceptibles de mobiliser dans leur projet professionnel. Les enseignements retenus sont ceux qui
présentent un intérêt pour les deux types de métiers visés.
Analyser et cartographier des controverses sociotechniques et environnementales
Economie sociale et solidaire et développement durable des territoires
Gestion des flux et maîtrise des coûts
Observer et éclairer un fait social en entreprise
Marketing et techniques de vente
II- SCIENCES ET INDUSTRIES ALIMENTAIRES
Objectifs
Proposer aux étudiants qui souhaitent s'orienter vers des spécialisations dans le domaine agro-alimentaire une
formation dans divers domaines allant des sciences alimentaires, de la toxicologie alimentaire, de la qualité des
aliments, de la microbiologie alimentaire, du génie des procédés alimentaires.
Cette pré-spécialisation conduit à la spécialisation Industries Agro-alimentaires:
Elle pourra également déboucher sur le Master "Bio-Ingénierie" de l’école doctorale SEVAB.
Elle est aussi prévue pour les étudiants qui souhaitent faire la troisième année dans des domaines de l'agro-
alimentaire plus spécialisé à l'ENSAIA ou dans des universités étrangères.
Cette filière peut aussi intéresser les étudiants qui s’orientent vers la valorisation non alimentaire des agroressources
car les fondements scientifiques et certaines technologies peuvent y trouver des applications.
Organisation
Cinq UE sont proposées dans le domaine agro-alimentaire
Food Science (obligatoire)
Processing of animal products
Bilans, rhéologie et réacteurs
Procédés enzymatiques et fermentaires
Qualité des produits alimentaires et santé
III- ENVIRONNEMENT
Objectifs
Offrir aux étudiants une formation dans le domaine de l'environnement nécessaire à l’accès aux spécialisations :
- Qualité de l’environnement et gestion des ressources
- Génie de l’environnement (en lien avec l’ENSEEIHT et l’ENSIACET)
- Agrogéomatique
- à un Master en lien avec la spécialisation QeGr: Ecosystèmes et Anthropisation (EA)
- à un Master en lien avec la spécialisation Agrogéomatique : SIGMA
Organisation
Biogéochimie, environnement et santé
Télédétection et SIG
Eau et Environnement
Sol et Environnement
Biodiversité et gestion de l’espace rural
Document édité par la direction des études le 12/12/2018 2ème année / Semestre 8 7IV- SCIENCES ET PRODUCTIONS ANIMALES
Objectifs
Les quatre UE proposées par le département de Sciences et Productions Animales ont comme finalité :
1- de faire acquérir aux étudiants désirant suivre la spécialisation « Systèmes et Produits de l'Elevage », les bases
physiologiques et technologiques des productions, ce qui doit leur permettre d’aborder les différents aspects de la
maîtrise des productions et des produits au sein des diverses filières animales. Cette acquisition se fera
essentiellement au travers des UE : « Sciences Animales: fonctions de production et de reproduction » et "Des
matières premières végétales aux systèmes d'alimentation".
2- de développer, au travers des deux autres modules que sont « Systèmes Fourragers : approche agronomique et
zootechnique » et « L'animal dans son environnement», une approche plus intégrative des productions, pouvant aussi
intéresser des étudiants se destinant à d’autres spécialisations orientées vers le végétal et/ou l’environnement.
3- Enfin, d’aborder le secteur de la transformation des produits animaux dans l'UE « Technologie des produits
d’origine animale », assurée par les enseignants du Département de Sciences Animales mais proposée dans le cadre
de la pré-spécialisation "Sciences et Industries Alimentaires".
Organisation : 4 UE de 60 heures chacune
Sciences Animales : fonctions de production et de reproduction
Systèmes fourragers : approche agronomique et zootechnique
Systèmes d'alimentation des monogastriqques
L'animal dans son environnement
V- BIOSCIENCES VEGETALES
Objectifs
La concentration par de grands groupes internationaux, des activités phytosanitaires et semencières, ainsi que le
développement de la génomique végétale, créent une demande d’ingénieurs agronomes capables d’animer et de
coordonner des activités de recherche, d’expérimentation et de développement dans les domaines conjoints de la
bioanalyse, de l’amélioration et de la protection des espèces cultivées.
La filière "Biosciences végétales" permet aux étudiants de s’orienter vers les métiers de la recherche, de
l’expérimentation, des études ou du conseil, au sein de groupes industriels ou d’organismes publics ou
professionnels.
La formation pourra être finalisée par l’accession aux spécialisations suivantes :
- Agrobiosciences végétales
- Biologie Computationnelle pour les Biotechnologies
- Master Adaptations, Développement, Amélioration des Plantes, en association avec des Microorganismes (ADAM)
Organisation
La formation est organisée pour permettre aux étudiants d'appréhender les avancées conceptuelles et technologiques
les plus récentes des sciences du végétal.
Biotechnologies et applications
Génomique
Semences et amélioration des plantes
Bio-informatique
Protection des cultures
VI- AGRONOMIE
Objectifs
Offrir aux étudiants la possibilité d’approfondir leurs connaissances agronomiques tant dans une perspective
d’approche système que pour certaines productions ou techniques.
Cette filière conduit aux spécialisations
- Agro écologie : du système de production au territoire - AGREST
- Agrogéomatique
- Et à un Master en lien avec la spécialisation Agrogéomatique : SIGMA
Organisation
Un certain nombre d’UE proposées dans les flilières Environnement et biosciences végétales intéressent aussi cette
filière. Voici les UE plus spécifiques aux objectifs poursuivis.
Systèmes de cultures
Agriculture biologique et composts
Télédétection et SIG
Agriculture de conservation des sols
Gestion de l’eau en agriculture
Document édité par la direction des études le 12/12/2018 2ème année / Semestre 8 8VII- UNITES D’ENSEIGNEMENT TRANSVERSALES
En complément des unités d’enseignement proposées par « filières » de formation, ces UE sont susceptibles
d’intéresser les étudiants quel que soit leur projet de spécialisation. Ce sont en 2018-2019 :
Agricultures Urbaines
CAS PARTICULIERS DES SPECIALISATIONS DES ECOLES PARTENAIRES
Ces spécialisations ne s’inscrivent pas au sens strict dans une filière de pré-spécialisation. Elles sont en partie
transversales à ces filières. A ce titre, les pré-requis sont réduits et le choix est très ouvert, selon le projet
professionnel de l’étudiant. Voici cependant quelques conseils.
Spécialisation Chimie verte et Biosourcée
Le choix des UE doit se faire en fonction des domaines d’application envisagés :.
- les aspects transformation : nous conseillons alors les étudiants de choisir des UE se rapprochant de celles de
la filière IAA ;
- les aspects production de plantes à des fins de valorisation non alimentaire : nous conseillons alors les
étudiants de choisir des UE de la filière biosciences végétales :
- les aspects gestion des flux et organisation : nous conseillons alors de choisisr des UE de la filière
agromanagement.
Spécialisation Procédés pour la Chimie Fine et Bioprocédés
Une seule UE spécifique est proposée et est obligatoire, celle de « génie des procédés : Bilans, rhéologie et
réacteurs »
Le choix des autres UE peut se faire dans le domaine de l’agromanagement avec l’UE « Gestion des flux et maîtrise
des coûts », des IAA avec « Sciences des aliments » et également dans les biosciences avec l’UE
« biotechnologies ».
Spécialisation Eco-énergies
Pas d’UE obligatoire mais un certain nombre d’UE conseillées relatifs à certaines méthodologies : « SIG et
télédetection », « Modélisation » et « génie des procédés : Bilans, rhéologie et réacteurs »
Document édité par la direction des études le 12/12/2018 2ème année / Semestre 8 9UNITES DE PRE-SPECIALISATION
SERIE 1
1.1 – Analyse et cartographie des controverses sociotechniques
Durée totale : 60h dont cours/conférences : 20h – TD : 20h – Travaux personnels : 20h
Responsable : F. Purseigle
Intervenants principaux : Antoine Doré (CR INRA UMR AGIR), Geneviève Nguyen, François Purseigle, J. Brailly,
Julien Weisbein (MCF Sciences-Po Toulouse)
Contact : purseigle@ensat.fr
Objectifs
L’objectif pédagogique général est de fournir aux étudiants les bases théoriques, méthodologiques et techniques
nécessaires à l’analyse de questions sociales et politiques qui sont l’objet d’une expertise technique et scientifique
forte et qui traversent l’espace public sous la forme d’affaires complexes où se croisent des questions juridiques,
économiques, morales, symboliques et sociales.
Il s’agit d’un cours orienté essentiellement vers l’étude sociale des sciences et des techniques et qui vise à initier les
étudiants à un panel d’approches (sociologiques, anthropologiques, historiques et politiques) et d’outils (notamment
d’analyse de réseaux sociaux, de scientométrie et de lexicométrie) permettant de décrire et d’analyser la dynamique
des technosciences et des projets d’aménagement, des laboratoires jusqu’à l’espace public en passant par les
bureaux d’études, les organisations non gouvernementales, etc. Un tel cours permet de familiariser les étudiants à
des approches aussi variées que la sociologie des connaissances, des professions, des organisations, de
l’environnement, des questions sanitaires ou encore des institutions scientifiques et techniques.
L’enjeu pédagogique principal de ce cours est d’apprendre aux étudiants à réagir dans les situations d’incertitude et
de controverses qu’ils seront amenés à rencontrer dans la vie professionnelle. L’un des principaux défis consiste à
établir des ponts entre les sciences sociales et sciences exactes. En focalisant sur les controverses, ce cours se
présente comme une initiation à l’histoire des sciences modernes, à la sociologie, à l’anthropologie et à la science
politique. Le but est d’apprendre aux étudiants à s’orienter et à naviguer dans des situations complexes et troubles
face auxquelles l’état des connaissances scientifiques et techniques ne fournit pas toujours les appuis suffisants pour
la décision et l’action en situation professionnelle. Ainsi, ce cours développe des aptitudes à l'enquête qualitative et
apporte aux étudiants ingénieurs ou en IEP un complément indispensable à leurs capacités d’expertise technique ou
à leur formation de cadre de l’action publique.
Programme
Cet enseignement comprend trois types de séances :
Des séances consacrées à un enseignement magistral sur les thèmes suivants (20h) :
1) Les fondamentaux de l’analyse des controverses (A. Doré) – 10h
2) Controverses, mondes agricoles et environnement (F. Purseigle) – 4h
3) Controverses économique (G. Nguyen) – 4h
4) La place des sciences et des techniques dans l’espace public : médiation scientifique, délibération et organisation
du débat publique (Quai des savoirs) – 2h
Des séances consacrées aux ateliers techniques (soient 20h au total) :
1) Atelier Lexicométrie (Gaël Plumecqoq) – 4h
2) Atelier Analyse de réseaux (Julien Brailly) – 4h
3) Atelier Web Design (Pierre Vincenot)– 8h
4) Atelier Écriture (Hélène Bustos) – 4h
Des séances consacrées au suivi des travaux des étudiants à travers 10h de TD, animées par un enseignant et 14h
de TD en autonomie.
Le cours sera organisé en trois temps :
• Semaine 1, acquisition des fondamentaux de l’analyse de controverses et choix de la controverse :
Enseignements des fondamentaux de l’analyse des controverses + Une séance d’introduction aux modules
« agriculture/environnement » et « économie » + Choix des controverses (tout au long de la semaine, les
étudiants travaillent sur le choix d’une controverse et justifier de ce choix dans un court rapport rendu en fin
de semaine).
Document édité par la direction des études le 12/12/2018 2ème année / Semestre 8 10• Semaine 2, acquisition des compétences thématiques et techniques, et travail d’enquête : Ateliers techniques
(lexicométrie, réseaux, enquête) + Enseignement magistral « agriculture/environnement » et « santé » + TD
de suivi des projets collectifs d’analyse des controverses.
• Semaine 3, analyse et restitution : Ateliers techniques (Web Design, Ecriture) + TD de suivi des projets
collectifs d’analyse des controverse
Méthodes pédagogiques
Cours, TD, ateliers méthodologiques.
Contrôle des connaissances
L’évaluation de la première partie du cours se fait en deux temps :
• un dossier dans lequel les étudiant exposent et justifient le choix de la controverse qu’ils envisagent
d’analyser au second semestre ;
• l’exposé et la discussion des textes de l’anthologie du cours ;
L’évaluation de la deuxièmepartie du cours se fait également en deux temps :
• exercice d’atelier ;
• présentation de l’avancement intermédiaire du projet cartographique par l’esquisse du site (partie projet) ;
L’évaluation de la troisième partie du cours se fait en deux temps :
• une présentation finale du site de controverse ;
• l’examen écrit sur les notions apprises dans le cours magistral.
Liens vers les sites crées par les étudiants en 2017 :
Sivens : https://controversesivens.wixsite.com/sivens
Numérisation de l’agriculture : https://ensatnum31.wixsite.com/numerisationagricole
Grippe aviaire : https://vickylouis.wixsite.com/grippeavcontroverse
Indemnisation loups : https://pastoralismeloupin.wixsite.com/monsite
Bibliographie
Michel CALLON, Pierre LASCOUMES, Yannick BARTHE, 2001, Agir dans un monde incertain, Edition du Seuil.
Pierre LASCOUMES, 1994, L’écopouvoir. Environnements et politiques, Editions la Découverte, 1994, 318p.
Geneviève NGUYEN, François PURSEIGLE, 2013 « Chimie et environnement : comprendre les controverses socio-
technologiques et environnementales » dans Philippe BEHRA (dir.), Chimie et environnement, Dunod.
Document édité par la direction des études le 12/12/2018 2ème année / Semestre 8 111.2 – Food science - lectures : 24h – practicals : 20h - personal work : 16h
Prof in charge : C. Chervin chervin@ensat.fr
Objectives
Knowledge of the composition of food, biochemical and nutritional aspects, in relation to consumer demands.
The module aims to provide students with a personal work with a refund in the form of written and oral report. It will,
through a case study (1) to make an inventory of ingredients and additives, (2) identify the functions of different
classes of components, and (3 ) provide for each of the elements regulatory and toxicological risks . This work
requires an investigation into the composition of food, a brief study of the manufacturing process and consultation of
books and websites.
Program
* Knowledge of food products (C Chervin , B van der Rest , T Liboz ) : 14h
- Introduction to molecular cuisine (Practical works ) and sensory analysis (Tutorials)
- Example of some products: wine , beer, bread products (lectures , visits)
* Composition of foods :
- Functional aspects (14h , B. van der Rest , T Liboz) : case study of certain foods (TD), study of food spoilage
(practical work)
- Nutritional aspects (6h , MC Rossi)
* Flavourings and food dyes (2h, G. de Billerbeck, 2h T. Talou, ENSIACET)
Teaching methods
Lectures, practicals and personal work, handouts, slideshows, visits
Knowledge assessment
Written report and oral presentations.
Students can choose the language of assessment, French or English.
Literature
http://www.codexalimentarius.org/codex-home/en/
« Sensory evaluation techniques », Meilgaard et al., CRC Press
« Sécurité alimentaire du consommateur » de Moll & Moll, Tech & Doc, Lavoisier.
« Additifs et auxiliaires de fabrication des les IAA », de J.L. Multon, Ed. Tech et Doc, Lavoisier
« Evaluation sensorielle », de Depledt, Tech & Doc, Lavoisier
Document édité par la direction des études le 12/12/2018 2ème année / Semestre 8 121.3 – Biogéochimie, Environnement et Santé - 60h
Responsable : C Dumat camille.dumat@ensat.fr
Objectif
Dans un contexte de développement durable, l’étude et la gestion de l’environnement doivent être abordés de façon
globale. Il y a en effet des transferts d’eau, de différentes matières (solubles ou solides, riches en polluants ou en
nutriments…) et d’énergie et des transformations qui se font de l’échelle de la molécule à l’échelle du globe. Le
module « Biogéochimie de l’Environnement » a pour objectif d’aborder au travers de quelques exemples contrastés
les mécanismes biogéochimiques et les bilans qui contrôlent à différentes échelles (molécules, sols, bassin versant,
globe terrestre) ces transferts de substances nutritives ou polluantes dans l’environnement et vers la biosphère en
focalisant en particulier sur les interactions et les méthodes mises en œuvre pour révéler les mécanismes en jeu. Les
conséquences des réactions biogéochimiques sur la « qualité des écosystèmes » et sur la santé seront abordées
grâce à des études de cas. L’influence des facteurs abiotiques et biotiques (vers de terre, microorganismes) sur la
dynamique des cycles biogéochimiques de divers éléments nutritifs et polluants seront également expliquées.
Programme
Comme développé ci-dessous, ce module de 60 heures est organisé en 2 sous-modules.
1- Mécanismes Biogéochimiques aux interfaces dans divers écosystèmes.
Une particule riche en plomb émise par une activité anthropique dans l’atmosphère, peut retomber sur un sol
cultivé. Le devenir du plomb de cette particule va alors dépendre en particulier des caractéristiques de la particule
(taille, forme, nature et concentrations des constituants, etc.), des caractéristiques du sol (texture, pH, CEC, etc..), du
climat, de l’activité rhizosphérique, de la bioturbation des vers de terre…Pour imaginer à priori quel sera l’impact du
plomb de cette particule sur l’environnement, il faudra se baser sur l’ensemble des connaissances disponibles et des
données mesurables par les techniques actuelles. Cette particule riche en plomb peut également être interceptée par
les parties aériennes des plantes et évoluer sous l’action des phénomènes biochimiques impliqués en surface des
feuilles…Pour cet exemple comme pour beaucoup d’autres, la compréhension des mécanismes
d’adsorption/désorption, complexation, précipitation-dissolution, réactions redox et acido-basiques et fonctionnement
des organismes vivants qui peuvent modifier leur milieu est donc nécessaire dans une optique de gestion et
modélisation des transferts.
Dans les divers écosystèmes, l’ensemble des organismes vivants (microorganismes, vers de terre, plantes,
etc.) modifient leur environnement (notions de rhizosphère, drilosphère…) et sont influencés par la « qualité de
l’environnement » en termes de biomasse, activité, reproduction…Il est désormais admis par la communauté
scientifique que la mesure des concentrations totales en substance chimiques doit systématiquement être complétée
par des mesures de paramètres tels que le pH, le potentiel redox, l’humidité, la température, les concentrations en
divers ligands inorganiques et organiques (dont l’origine peut être abiotique ou biotique) et d’études de
compartimentation et spéciation. La biodisponibilité et l’(éco)toxicité des substances dépend en effet de leur solubilité,
de leur charge et de leur taille.
Cet enseignement a donc pour objectif de décrire de façon systémique les phénomènes biogéochimiques qui
se déroulent aux différentes interfaces et dans les milieux naturels durant le cycle de vie d’une substance nutritive ou
polluante afin de mieux gérer et prévoir l’impact de cette substance sur les écosystèmes et l’homme.
2- Biogéochimie des bassins versants : Échange atmosphère, biosphère, hydrosphère : cycle des éléments et
perturbations anthropiques.
L’étude à l’échelle des bassins versants permet une analyse intégrée des différents cycles biogéochimiques.
Cette séquence d’enseignement a pour objectif d’apporter des connaissances sur les cycles de l’eau, du carbone, de
l’azote et des contaminants (métaux, pesticides) dans les écosystèmes terrestres (incluant le couplage atmosphère-
sol-eau). Une sortie terrain permettra d’aborder plus concrètement les stratégies d’observation des écosystèmes
forestiers et plus particulièrement la mesure des dépôts atmosphériques actuels au niveau des écosystèmes
forestiers (placette forestière) et la reconstitution des dépôts passés au niveau d’une tourbière. Elle permettra
également d’aborder les questions de production et de transfert de la matière organique terrestre. Quelques exemples
des différentes approches isotopiques (stables et radiogéniques) que l’on peut utiliser dans le domaine de
l’environnement, notamment sur les sols, les eaux à l’échelle des bassins versants, pour tracer les sources des
différents éléments concernés, les vitesses de transferts et l’intensité des différents processus.
Document édité par la direction des études le 12/12/2018 2ème année / Semestre 8 13Les intervenants et volumes horaires sont les suivants :
Intervenant Thèmes t (h)
C. Dumat, Biophysicochimie aux interfaces: implications dans le devenir des éléments 12h cours
INP-ENSAT inorganiques (éléments nutritifs et polluants) et substances organiques dans + 8h TD
Responsable l’environnement (adsorption, complexation, redox, spéciation…). Initiation aux
études « environnement-santé »
D. Baque, Techniques analytiques: théorie et « pratique ». 4h cours
CNRS + 2h TD
JL. Rols, Réactions microbiologiques et cycles biogéochimiques : divers échelles, 7h de
UPS écosystèmes, enjeux et applications. cours et
1h de TD
R. Teisserenc, Flux à l’échelle de la planète. MOS 8h
INP-ENSAT
J. Sanchez, Cycles biogéochimiques. N, P; 4h cours
CNRS zones tampons.
B. Pey, Influence des vers de terre sur le devenir des éléments inorganiques 2h de
INP-ENSAT dans les sols. cours +
2h TD
I. Moussa, Traçage des isotopes Pb, Cs. 4h cours
CNRS + 2H TD
Sortie terrain Ecosystèmes jardins ou forestiers 8h
Travail - Examen / cours Divers
étudiants - Petit exposé sur sujets à discuter créneaux
Evaluation
Contrôle des connaissances:
-EXAMEN écrit sur les différentes interventions du module.
-Compte rendu de visite de terrain.
-EXPOSES
Au premier cours, 5-6 groupes de 3-4 étudiants seront constitués et chaque groupe traitera un sujet choisi au premier
cours. Une publication scientifique servira de fil conducteur (proposée par les enseignants) et sera complétée par des
recherches bibliographiques (publications scientifiques et documents complémentaires), les cours et discussions avec
les enseignants.
Les exposés d’environ 10 transparents (contexte, objectif, mise en œuvre, résultats et discussion…) seront présentés
par les groupes, ils seront notés et permettront des échanges avec l’équipe enseignante et les autres étudiants
(questions et compléments de cours).
Suite aux remarques des enseignants sur le fond et la forme, ces exposés finalisés seront mis en ligne sur la plate-
forme « Réseau-Agriville » pour début mars 2017
Quelques sujets proposés :
- En quoi la compréhension des mécanismes biogéochimiques favorise-elle des activités d’agricultures
durables en milieu urbain ?
- Pourquoi la taille des particules (de sol ou présentes dans l’atmosphère ou dans les eaux) enrichies en
métaux est-elle un paramètre influant pour discuter du devenir des métaux dans l’environnement ?
- Pourquoi les analyses isotopiques sont parfois très pertinentes pour expliciter les mécanismes de transfert
dans l’environnement et parfois pas du tout adaptées ?
- Y a-t-il une relation simple entre la réactivité des matières organiques naturelles et leur réactivité ?
Document édité par la direction des études le 12/12/2018 2ème année / Semestre 8 141.4 – Sciences animales : fonction de production et de reproduction – cours : 30h TD/TP : 30h
Responsable : H. Rémignon remignon@ensat.fr
Autres intervenants: K. Massip katia.massip@gmail.com
Objectifs
Acquérir les bases scientifiques nécessaires pour aborder la maîtrise des productions et la logique des systèmes de
production.
Programme
Volet 1 : La lactation (20h) -
- Particularités anatomiques de la mamelle
- Mécanismes cellulaires de l’élaboration du lait
- Biosynthèse des constituants du lait
- Contrôle hormonal de la lactation
Volet 2 : Croissance et développement (20h) -
- Physiologie de la croissance et du développement
Courbes de croissance et allométrie de la croissance
Croissance embryonnaire et post embryonnaire
Facteurs de croissance
Croissances musculaires, osseuse, du tissu adipeux
- Nutrition et croissance
Besoins nutritionnels et efficacité alimentaire
Croissance compensatrice restriction alimentaire
- Influence des facteurs environnementaux (température, programme lumineux, qualité de l’air)
- Génétique de la croissance et du développement
Volet 3 : La reproduction des mammifères d’élevage (20h) -
- Anatomie des appareils reproducteurs.
- Hormones et corrélations hormonales intervenant dans la régulation de la sexualité et de la reproduction.
- Principales étapes de la reproduction chez les mammifères (Fonction germinales mâle et femelle, Fécondation,
Gestation
- Comportement reproducteur.
- Relations entre l'environnement et la reproduction.
- Induction et synchronisation de l’œstrus, Insémination artificielle, Fécondation in vitro et transfert embryonnaire,
Induction ou blocage de la parturition.
Méthodes pédagogiques
Cours – TP- Conférences – Travail Personnel : recherche bibliographique et exposé oral.
Contrôle des connaissances
Examen écrit (75% de la note finale) et exposé oral (25% de la note finale) individuels
Bibliographie:
- Revue « Elevage et Insémination » (UNCEIA)
- Reproduction des Mammifères d’élevage (INRAP, 1988)
- Reproduction des Mammifères et de l’homme (2001, INRA Ellipse)
- Croissance et développement des animaux (Ed. Lavoisier)
- Control and manipulation of animal growth (Ed. Lavoisier)
- Biologie de la lactation (Ed. INRA/INSERM)
Document édité par la direction des études le 12/12/2018 2ème année / Semestre 8 151.5 – Biotechnology for Sustainable Agriculture (60H: in English)
- Lectures : 20 h ; Tutorials : 14 h ; Practical work : 8H ; Group project : 16 h - Seminars : 6H ; Written
assessment :2H
Faculty in charge : J. Kallerhoff Jean.kallerhoff@ensat.fr
Other Faculty :
M. Rickauer Martina.rickauer@ensat.fr>
C. Bayourthe Corine.Bayourthe@ensat.fr
P. Bogdanowicz (Institut Pierre Fabre) Patrick.bogdanowicz@pierre-fabre.com
M. Zouine mohamed.zouine@ensat.fr
Objectives
The objective of this module is to cover different fields of crop improvement and protection, biodiversity conservation,
food, environment, health and animal sciences, metagenomics, where biotechnology has emerged to be a
complementary tool in matter of sustainable agriculture.
Program
A- Plant biotechnology : Germplasm conservation, crop improvement and protection (M.Rickauer and J. Kallerhoff)
Applications of in vitro culture towards the improvement and conservation of plant species will be declined.
Conventional and novel technologies involving recombinant DNA technology aiming at reducing the use of agricultural
intrants will be studied. Model plants used to decipher gene isolation and functional analysis will be studied. Altogether
taken, these will be explored within the international legal framework of the International Biodiversity Convention and
Biosafety Carthagena Protocol. Finally, the European and French legal framework dedicated to Crop Improvement,
Crop Protection, Food and Feed safety will be summarised.
B- Introduction to Metagenomics (M. Zouine)
Metagenomics is the study of the genetic material recovered directly from environmental samples. This new field of
research enables studies of microbial communities that are not easily cultured in laboratory conditions under
conditions of clonal cultures. This has led to the discovery of new genes that code for novel enzymes capable of
producing molecules of industrial potential.
C- Microbial Biotechnology : The role of microbes in sustainable agriculture, human and environmental health (C.
Verheecke and J. Kallerhoff)
Lectures will focus on the use of lab-cultured microorganisms to produce new biofertilisers, biopesticides, novel
agents for biocontrol of plant diseases. The presence of diverse microorganisms in food will be illustrated within the
legal context of the European Food Safety Authority.
D- Animal biotechnology
Methodologies and case studies in animal biotechnology will be declined with respect to the resulting diverse
applications.
E- Biotechnology and dermo-cosmetics
Dr Patrick Bogdanowicz, from Pierre Fabre Cosmétiques will explain how a flourishing local industry makes use of
Biotechnology, cellular imagery during the process of developing new products in the dermo-cosmetics industry.
Educational methods
Lectures, Practical works and tutorials will all be dealt in English. Hand-outs as well as power-point presentations will
be available on the “Moodle” platform of the ENSAT. A tutored group project will involve students into the art of
scientific communication.
Assessment (Students can choose the language of assessment, French or English):
Table examination: 60% of the grading
Practicals: 10% of the grading
Group project: 30% of the grading
Document édité par la direction des études le 12/12/2018 2ème année / Semestre 8 161.6 – Systèmes de cultures : concepts agronomiques, outils et méthodes pour l'analyse et la conduite de
systèmes de cultures - 60h - Cours 32h – TD/TP : 14h – Travail personnel encadré : 14h
Responsable : P. Maury maury@ensat.fr
Intervenants : Georges Bertoni, Philippe Grieu, Julie Ryschawy, Pierre Maury, Jean-Pierre Sarthou, Jérôme Silvestre
Objectifs
- Connaissances de systèmes de culture et de production
- Analyse de la différenciation des systèmes de culture (intensif/extensif)
- Méthodes et outils de conception/conduite des systèmes de culture
Programme
Système de grande culture (20h)
Définitions, concepts, système de culture et changement d’échelle (parcelle-territoire)
Evolution des systèmes de culture au cours du temps
Diversification des systèmes de culture (productif, extensif, rustique, systèmes à cahier des charges ; clés de
raisonnement du système de culture ; techniques culturales simplifiées)
Outils de conception/d’évaluation des systèmes de cultures (intérêt et limites des modèles de culture, présentation du
modèle de culture « STICS »)
Visite exploitation
Système intensif : cultures en serre, sous abri (18h)
Présentation des systèmes de cultures en serre et sous abri (grandes productions – intérêts – limites)
L'outil serre - fonctionnement
Les cultures hors sol (principaux systèmes de culture hors sol, formulation des solutions nutritives, substrats,
fabrication et contrôle de solutions nutritives, recyclage des solutions nutritives - logiciel « Végénut»)
Visite exploitation
Systèmes polyculture-élevage, herbagers et Agroforestiers (8h)
Les systèmes polyculture-élevage et herbagers dans les territoires (état des lieux, évolution et prospective, cas
d’études)
Agroforesterie : association cultures pérennes/annuelles (présentation générale - Intérêt et limites - cas d’étude :
dispositif expérimental de Grasac : noyer/trêfle)
Projets thématiques (14h)
Projet « système »
Ce projet thématique consiste à réaliser un approfondissement bibliographique sur une innovation technique ou sur
un système de culture d’intérêt (1 sujet par binôme ou trinôme). Le travail bibliographique, basé sur des références
scientifiques et techniques, mais également sur des articles à destination des professionnels de l’agriculture, donne
lieu à la réalisation d’une présentation sous forme d’exposé oral.
Projet « fiche »
Une fiche de synthèse biotechnique sur une culture sera également réalisée dans le cadre du projet (1 fiche par
étudiant).
Ce travail personnel encadré (TPE) comprend des séances avec l’enseignant et du travail personnel programmé à
l’emploi du temps.
Les projets les plus récents sont consultables sur la plateforme pédagogique de l’ENSAT (http://moodle-ensat.inp-
toulouse.fr/).
Méthodes pédagogiques
Cours, travaux dirigés, travail personnel encadré (recherche bibliographique) et visite
Contrôle des connaissances
Projet « système » : document écrit accompagné d’un exposé oral noté (30% de la note de l’UE)
Projet « fiche » : document écrit accompagné d’un exposé oral noté – individuel - (20% de la note de l’UE)
Examen écrit individuel (50% de la note de l’UE).
Pour des raisons d’économie, il est recommandé de remettre les documents en noir et blanc et de n’y inclure des
pages couleur que si cela s’avère nécessaire pour permettre la lecture des informations, notamment pour certains
graphiques, cartes, exceptionnellement des photos.
Document édité par la direction des études le 12/12/2018 2ème année / Semestre 8 17Vous pouvez aussi lire