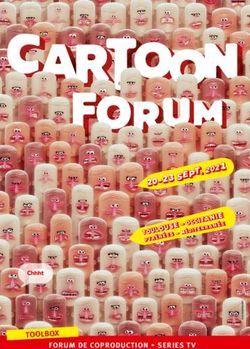Hommes-femmes : mode d'emploi
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Hommes-femmes : mode d’emploi
« Suivait, juste après, un autre film qui, lui, a très mal
vieilli : Les Galettes de Pont-Aven (1975), avec Jean-Pierre
Marielle dans le rôle de Jean-Pierre Marielle, c’est-à-dire du
mâle franchouillard moustachu en détresse millésime seventies,
mais des seventies ni joyeuses ni libertaires ni gauchistes ni
surtout féministes, non : les seventies bien rances, réactives,
réactionnelles, réactionnaires, celles de Bertrand Blier, celles
des faussement rebelles Valseuses, du pathétique Calmos (avec
Marielle, encore, justement), celles aussi du grotesque Sex shop
de Claude Berri (avec Marielle, toujours !). »*
Si Pierre Tevanian n’évoque que de manière indirecte le
cinéma de Bertrand Blier, ce petit extrait donne la mesure d’une
tendance de plus en plus prégnante dans la critique d’aujourd’hui
consistant à juger les œuvres du passé à l’aune de nos critères
idéologiques actuels. Par ailleurs, il s’agit dans la lignée des cultural
studies américaines** et plus particulièrement des gender studies de
« déconstruire » un regard prétendument « dominant » au sein de
la culture (au choix, celui des blancs, des hommes ou encore des
hétérosexuels). Sans entrer dans des détails qui nous entraîneraient
fort loin de l’objet de notre étude, une théoricienne comme
* tevanian, Pierre. « De quoi Pierre Richard est-il le nom ? » Op. cit.
** Voir da silva, David. Cultural Studies et Hollywood : le passé remanié. Éditions
Lettmotif, 2020288 vincent roussel
Geneviève Sellier souligne que les « gender studies prennent pour
objet les identités et les rapports de sexe en tant que constructions
socioculturelles » puis, s’appuyant sur les recherches de Laura
Mulvey dans le domaine du cinéma, reprend à son compte l’idée
d’« une critique du cinéma hollywoodien comme instrument
de la domination patriarcale, à travers l’analyse des codes du
cinéma narratif classique. À partir des concepts de fétichisme et
de voyeurisme dans leur acception freudienne, Mulvey analysait
le cinéma dominant comme un dispositif construit sur et par un
regard masculin — celui du cinéaste derrière la caméra, relayé par
celui des personnages masculins dans la fiction — transformant
le corps féminin en objet morcelé. »*
Certaines vont plus loin, faisant du cinéma un véhicule
privilégié pour une présumée « culture du viol » : « de tous
les arts qui ont illustré cette culture du viol impliquant la
subordination des femmes à l’ordre patriarcal, le cinéma offre
l’exemple le plus spectaculaire — à tous les sens du terme.
[…] Et il ne s’agit pas seulement du machisme de Rhett
Butler, de James Bond, d’Indiana Jones ou de n’importe quel
super-héros, mais bien du cinéma dit d’auteur. De Blow-
Up (Michelangelo Antonioni, 1969) à Elle (Paul Verhoeven,
2016) en passant par Orange mécanique (Stanley Kubrick,
1971), Le Dernier Tango à Paris (Bernardo Bertolucci, 1972),
Les Valseuses (Bertrand Blier, 1974), Breaking the Waves (Lars
von Trier, 1996), Irréversible (Gaspard [sic] Noé, 2002) ou
Parle avec elle (Pedro Almodóvar, 2002), d’Alfred Hitchcock
à Woody Allen et de Jean-Luc Godard à Federico Fellini, le
* sellier, Geneviève. « Gender Studies et études filmiques. » Les mots sont
importants, 23/09/2005. [en ligne]Hommes-femmes : mode d’emploi 289
canon du cinéma occidental offre une remarquable continuité
dans sa vision des femmes et son impuissance à leur accorder
une place en tant que sujets actifs. »*
Même si son œuvre échappe encore plus ou moins aux fourches
caudines de cette nouvelle manière d’appréhender la question
du « genre » au cinéma, le regard porté sur la gent féminine par
Blier fut vivement critiqué dès ses débuts. Avec Les Valseuses, il
acquiert la réputation de cinéaste misogyne et la virulente charge
anti-mlf (Mouvement de Libération des Femmes) qu’est Calmos
n’arrange pas les choses, contrairement à ce que peut en dire
Anne Diatkine qui se désole qu’aucune voix discordante ne se
soit élevée dans le concert de louanges qui a accueilli Les Valseuses
(parlant d’une critique plus hostile, elle écrit : « Elle ne dit pas
que le film est raté, elle explique pourquoi il est difficile à voir.
Pourquoi les traces de cette dissension face à l’unanimité sont-elles
recouvertes ? Est-ce parce qu’à l’époque, les voix de l’opinion sont
essentiellement masculines ? »**). Or nous l’avons vu, si le film a été
un triomphe public, la critique fut beaucoup plus mitigée et Blier
essuya de nombreuses critiques (son film fut même, rappelons-le,
qualifié de « décharge publique » et « d’authentiquement nazi »),
notamment celle relative à la misogynie***. Depuis, l’épithète lui
* murat, Laure. Une révolution sexuelle ? Réflexions sur l’après-Weinstein. Stock,
Puissance des femmes, 2018
** diatkine, Anne. « Les Valseuses échappe à la censure. » Libération, 9/07/2013.
[en ligne]
*** « Non, non, tout a commencé avec Les Valseuses, en 1974. On était en plein mlf
et il y a eu des manifestations devant les cinémas. Des banderoles… La cinéaste
Chantal Akerman allait de salle en salle en apostrophant les futurs spectateurs :
“N’allez pas voir cette merde, c’est une insulte envers les femmes.” Et, dans Le
Figaro — Le Figaro de l’époque, le vrai, le pur, le dur —, le professeur Debray-
Ritzen demandait carrément l’interdiction du film. C’était extravagant… »
Bertrand Blier : « Pour moi, il n’y a plus de cinéma ». Op. cit.290 vincent roussel
colle à la peau il est régulièrement utilisé à la sortie de chacun de ses
films. Est-ce à dire que le cinéma de Blier est devenu aujourd’hui
anachronique, « inacceptable » (pour reprendre le terme utilisé
par Laure Murat dans une tribune consacrée à Blow-Up*) et qu’il
a définitivement réalisé des films « comme on n’en fera plus »** ?
Avant de répondre à cette question et d’analyser le rapport
aux femmes qu’entretient le cinéma de Blier, il convient de faire
quelques remarques préliminaires sur ce que j’appelle cette
vision idéologique du cinéma et sur la confusion qu’elle draine.
À titre d’exemple, il faut citer cette ahurissante tribune de
Daniel Schneidermann dénonçant dans un même mouvement
les agissements d’Harvey Weinstein, les défenseurs de Roman
Polanski et de pures œuvres de fiction : « Et s’il n’y avait que
les blockbusters hollywoodiens. Mais cette insupportable
esthétisation d’un viol, chez Almodóvar (Parle avec elle) ; mais
Bébel harcelant Jean Seberg chez Godard (À bout de souffle) ;
mais cette solidarité de mecs autour de Polanski ; et les petites
starlettes de Cannes, cette vieille mythologie française. Tout
le cinéma sent la testostérone. Le cinéma, depuis sa création ?
Des hommes qui regardent des femmes, fantasment sur
elles, les vénèrent, les subliment, les posent sur l’étagère, les
maltraitent, les jettent, les chosifient. Passons en revue nos
* murat, Laure. « Blow Up, revu et inacceptable. » Libération, 12/12/2017. [en ligne]
** Allusion à un texte consacré par Daoud Boughezala à Beau-père sur le site
Causeur. Il convient néanmoins de mettre un bémol à cette idée récurrente qui
voudrait qu’« on ne pourrait plus faire un film comme ça aujourd’hui » et qui
s’apparente un peu trop au bon vieux « c’était mieux avant ». S’il est évident que
les mœurs ont évolué et que certains sujets apparaissent plus délicats à traiter, cela
n’empêche pas des films audacieux et singuliers d’éclore et je ne suis pas certain,
par exemple, qu’un film comme L’Inconnu du lac (Alain Guiraudie, 2012) eût pu
être tourné dans les années 1970.Hommes-femmes : mode d’emploi 291 films cultes. Peu échappent à cette lecture ravageuse. »* Si l’on résume schématiquement, ce sont Godard ou Almodóvar qui, par leur promotion d’une certaine « culture du viol » (auxquels on pourrait adjoindre, selon Laure Murat, Antonioni, Hitchcock, Kubrick et Blier), auraient participé à l’éclosion d’affaires de mœurs sordides dont Weinstein et Polanski furent les exemples les plus polémiques. Dans ce cas, il est permis de s’étonner qu’il existe encore une seule personne vivante sur cette planète alors que le cinéma, par l’intermédiaire du western, du film noir et d’action, ne cesse de promouvoir les as de la gâchette et les tireurs justiciers ! Plus sérieusement, on s’étonnera de trouver chez des intellectuels, journalistes ou universitaires censément progressistes une rhétorique qui rappelle celle de l’office catholique d’autrefois mettant en garde les fidèles contre les dépravations et idées dangereuses véhiculées et exaltées par le cinéma, notamment lorsqu’il s’agissait d’œuvres fantastiques ou « sexy »**. Là encore, un long développement nous mènerait trop loin de notre sujet mais ce regard moralisateur, expression parfaite d’un certain puritanisme anglo-saxon, ne fait que remettre au goût du jour cette vieille antienne sur les répercussions néfastes des images sur les esprits, que ça soit celles du cinéma et de ces films qui inciteraient à la violence (comme le Tueurs-nés d’Oliver Stone), de l’animation * schneidermann, Daniel. « Harvey Weinstein en surimpression. » Libération, 29/10/2017. [en ligne] ** Citons pour la bonne bouche le fameux jugement de Gilbert Salachas sur Le Cauchemar de Dracula de Terence Fisher : « Le cinéma qui est un art noble, est aussi, hélas une école de perversion : un moyen d’expression privilégié pour entretenir ou même créer une génération de détraqués et d’obsédés. »
292 vincent roussel
(se souvenir des diatribes séniles de Ségolène Royal contre les
dessins animés japonais) ou encore des jeux vidéo.
D’autre part, cette approche par le biais de la question
du genre me paraît tendancieuse dans la mesure où il s’agit
d’apposer des grilles préétablies sur des œuvres en mettant
en exergue tout ce qui fait la complexité, l’ambiguïté et la
singularité de celles-ci. On peut bien sûr s’offusquer que des
films comme Le Livre d’image de Godard ou Duel dans le
Pacifique de John Boorman échouent au « test de Bechdel »* mais
cela n’a aucun sens puisque l’enjeu de ces films n’a strictement
rien à voir avec les questions de genre. Pointer à tout prix le
sexisme de certains longs métrages, c’est aussi une manière
de faire l’impasse sur leur contexte. Je ne parle même pas du
contexte historique dans lequel ils furent tournés mais de la
diégèse de l’œuvre. Prenons un exemple pour être plus concret.
Dans une émission de télévision consacrée aux femmes dans
le cinéma**, un reportage tentait de définir la manière dont les
personnages féminins furent regardés par le septième art et des
cinéastes homme. Une universitaire était invitée à analyser la
fameuse scène de mambo dans Et Dieu créa la femme (1956) de
Roger Vadim. L’examen de l’enchaînement des plans était assez
* « Le test de Bechdel vise à mettre en évidence l’éventuelle surreprésentation
des protagonistes masculins ou la sous-représentation de personnages féminins
dans une œuvre de fiction […] Le test repose sur trois critères : 1- Il doit y avoir
au moins deux femmes nommées (nom/prénom) dans l’œuvre ; 2- qui parlent
ensemble ; 3- et qui parlent de quelque chose qui est sans rapport avec un
homme. » Définition selon l’encyclopédie en ligne Wikipédia.
** L’auteur de ces lignes n’est pas parvenu à retrouver le reportage en question.
A priori, il faisait partie de l’épisode 4 de la deuxième saison du magazine
Stupéfiant ! présenté par Léa Salamé et diffusé le 6 novembre 2017 sur France 2.
On voudra bien lui pardonner cette analyse faite « de mémoire » et d’avoir oublié
le nom de l’universitaire en question.Hommes-femmes : mode d’emploi 293 brillant, permettant à la jeune femme de prouver que Vadim se contente de montrer le désir masculin (le regard concupiscent de Trintignant) et que Bardot, en contrechamp, est considérée seulement comme un objet de désir morcelé et érotisé, la caméra cadrant uniquement ses jambes et remontant très lentement le long de son corps jusqu’à l’instant où la sensuelle comédienne se passe langoureusement les mains sur la poitrine. S’il est difficile de nier que Vadim joue alors les pygmalions pour magnifier sa « créature », les choses ne sont pas aussi univoques — un simple regard masculin sur un objet féminin — et dans le contexte du film, l’analyse est même un parfait contresens. En effet, cette scène apparaît vers la fin du récit, alors que Juliette (Brigitte Bardot) échappe à son mari Michel (Jean-Louis Trintignant). Le regard que ce dernier lui lance n’est pas un regard de désir mais un regard de jalousie. À partir de ce moment, toute la scène peut être relue d’un point de vue diamétralement opposé : par cette danse endiablée, Juliette s’émancipe et affirme sa liberté à l’encontre des lois du mariage et des institutions. Liberté de son corps (sa jupe s’ouvre au rythme de ses mouvements) et liberté de ses désirs puisqu’elle n’appartient qu’à elle-même. Il est d’ailleurs notable que si le film est resté, ce n’est pas tant pour ses qualités propres (il est, au fond, assez banal) que pour le souffle d’air frais et le naturel qu’introduisait Brigitte Bardot dans le cadre sclérosé du cinéma français d’alors. Et comme le soulignait Serge Daney, toutes les jeunes filles de l’époque voulurent alors lui ressembler, annonçant en cela une certaine libéralisation des mœurs et le désir d’émancipation des femmes.
294 vincent roussel
Une autre erreur fréquente de cette démarche consiste à
entretenir une confusion entre le regard de l’auteur et les actions
effectuées par les personnages. Peut-être faut-il rappeler que
filmer un viol, ce n’est ni le cautionner, ni même minimiser ses
répercussions. Un personnage peut tenir des propos misogynes
ou agir en parfait phallocrate sans que le metteur en scène qui le
filme y adhère. Puisque Daniel Schneidermann évoque À bout
de souffle (1960) de Jean-Luc Godard et « Bébel harcelant Jean
Seberg », il suffira de se souvenir de quelques séquences de ce
film pour contredire le journaliste. En effet, À bout de souffle
est l’exemple typique du film où la mise en scène ne cesse de
contredire systématiquement ce qu’assène avec une certaine
fatuité le personnage hâbleur incarné par Belmondo. Lorsqu’il
peste contre les automobilistes qui n’avancent pas assez vite,
c’est pour constater immédiatement qu’ils étaient empêchés
par des travaux. Alors qu’il pérore contre les « femmes », on
constate que Patricia (Jean Seberg) a souvent le dernier mot. Et
si le regard adopté par le film semble exclusivement masculin,
c’est par un subtil glissement que Godard parvient à renverser
la relation sujet-objet. Dans une scène célèbre, Patricia utilise
une affiche qu’elle a roulée comme une longue-vue pour
regarder Michel. Le passage est une relecture d’une scène
similaire de Quarante tueurs de Samuel Fuller où le visage
de Barbara Stanwyick était vu à travers l’œilleton d’un fusil.
Godard renverse la perspective et c’est l’homme qui devient ici
l’objet de désir pour la femme (à l’instar de Bardot, Belmondo
fera partie de ces corps nouveaux qui susciteront désirs et
fantasmes chez les spectateurs). Lorsque meurt Michel à laHommes-femmes : mode d’emploi 295
fin du film et que Patricia reprend son geste familier (passer
le pouce sur ses lèvres), on comprend que le point de vue a
basculé du côté des femmes et que c’est elle la véritable héroïne.
Ce qu’oublient sans arrêt les adeptes des « études de
genre », c’est une notion certes tombée en désuétude mais
qui fait pourtant la richesse des œuvres d’art en général et
cinématographiques en particulier : la dialectique. À vouloir
réduire lesdites œuvres à une dimension univoque, on risque
de passer totalement à côté de leur essence et de promouvoir
des films aseptisés, aux messages parfaitement lisses et
compréhensibles comme une publicité Benetton. Certes, les
actrices ont été et sont encore souvent considérées comme des
« objets » (de désir, de dévotion) mais la force du cinéma est
justement de parvenir à montrer que ce statut ne les empêche en
aucun cas d’être « sujets » à leur tour. On pourrait longuement
développer, par exemple, autour de la figure de la « femme
fatale », femme-objet (tous les regards se posent sur elle) par
excellence mais qui est, dans le même mouvement, une figure
forte, libre et émancipée qui fait ce qu’elle veut des hommes.
Mais avant de nous perdre dans les multiples digressions
qu’autorise un tel sujet, je souhaite revenir à Bertrand Blier et
à son regard de « mâle dominant ».
***
Si l’on plaque artificiellement sur son œuvre la grille
prédéfinie de la misogynie et du sexisme, on trouve assurément
dans ses films des preuves qui apportent de l’eau au moulin
du spectateur ou du critique en herbe soupçonneux. Car des296 vincent roussel femmes réifiées et érotisées, on en trouve dans le cinéma de Blier. Et c’est peu dire qu’elles sont souvent malmenées : assassinées (Buffet froid), battues (Merci la vie, Les Côtelettes), violées (Un, deux, trois, soleil, Les Côtelettes), giflées (Les Valseuses, Tenue de soirée, Mon homme) ou traitées comme des moins que rien (« rien qu’un trou avec du poil autour » comme le proclame Jean-Claude dans Les Valseuses). Une vision superficielle des films pourrait aussi nous laisser entendre que les personnages féminins de Blier peinent à sortir du classique diptyque « maman » et « putain ». Mère comme celle que veut devenir Carole Laure dans Préparez vos mouchoirs, mère délaissée au profit d’une secrétaire beaucoup plus ordinaire qu’elle dans Trop belle pour toi ou les mères que devient Anouk Grinberg lorsque ses illusions se sont dissipées dans Un, deux, trois, soleil et Mon homme. Quant aux prostituées, elles sont innombrables dans le cinéma de Blier, qu’elles le soient vraiment par « profession » (Mon homme, Combien tu m’aimes ?) ou qu’elles s’y livrent de manière plus occasionnelle (Les Valseuses, La Femme de mon pote, Notre histoire, Tenue de soirée, Merci la vie). Frigides (Les Valseuses, Préparez vos mouchoirs) ou nymphomanes (Calmos), elles sont soit érotisées sous forme d’objets sublimes (Trop belle pour toi, Mon homme, Combien tu m’aimes ?, la jeune russe du Bruit des glaçons), soit considérées comme des incarnations de la mort (Carole Bouquet dans Buffet froid, Catherine Hiegel dans Les Côtelettes). Et dans un film comme Les Acteurs où elles sont quasiment absentes, Josiane Balasko incarne un homme ! Pourtant, à y regarder de plus près, la misogynie de Bertrand Blier relève davantage d’une vue de l’esprit que d’une réalité
Hommes-femmes : mode d’emploi 297 tangible. Certes, il est difficile de nier une certaine misanthropie chez le cinéaste et il est tout à fait vrai que les individus (hommes ou femmes) ne sont pas toujours présentés sous leur meilleur profil. Mais en creusant un peu, on constate que son regard est beaucoup plus cruel pour les hommes et qu’il témoigne d’une infinie tendresse pour les femmes. Revenons aux Valseuses qui ont valu à Bertrand Blier cette mauvaise réputation et où les femmes se trouvent souvent malmenées. La première scène nous montre Jean-Claude et Pierrot en train de suivre puis d’agresser une passante. Par la suite, dans un train, ils contraignent une jeune mère (Brigitte Fossey) à dévoiler ses seins pour que Pierrot puisse téter. Quant à Marie-Ange (Miou-Miou), elle est considérée dans un premier temps comme « un bout de mou » (« j’ai jamais vu un tas pareil ! »), prend une gifle et une balle de revolver avant d’être balancée dans un canal (« Ça va te calmer les muqueuses ! »). Peut-on pour autant dire que Blier adhère à cette vision de la femme que véhiculent ces deux petits voyous machos ? Qu’il ait une certaine tendresse pour eux, c’est évident mais d’une manière générale, il les montre sous un aspect qui confine au ridicule. Comme le dit l’une des jeunes femmes qu’ils tentent de draguer dans un bowling, ce ne sont que des « paysans » qui veulent endosser des habits trop grands pour eux (« Vous n’avez même pas enlevé les étiquettes de vos chemises ! »). Derrière leurs allures de fiers-à-bras, ce ne sont que des enfants qui recherchent une mère. Nous avons déjà détaillé cet aspect en analysant précédemment le film mais rappelons que la scène de la tétée est hautement signifiante
298 vincent roussel et qu’elle annonce la longue et bouleversante séquence avec Jeanne Moreau. En s’intéressant à cette femme plus âgée, les deux galopins renifleurs de petites culottes cherchent à retrouver une mère symbolique. Lorsque celle-ci se suicide, ils reviennent vite dans le giron de Marie-Ange qui les console comme s’il s’agissait de ses enfants (ils sont en larmes). Tout l’enjeu du film est de montrer les profondes mutations d’une certaine masculinité. Tandis que le titre et l’attitude des deux larrons annoncent des excès de testostérone et un culte de la virilité, Blier procède de manière dialectique et en montre la vanité. Dès le début du film, Pierrot prend une balle dans le haut de la cuisse qui l’empêche de bander. Alors qu’il semble avoir retrouvé sa virilité, il est incapable — à l’instar de son compère — de faire jouir Marie-Ange. Jamais le film ne laisse entendre que cette absence de plaisir vient de la femme mais se rit, au contraire, des leçons prodiguées en toute immodestie par Jean-Claude (« Tu sais que tu as affaire à un cador ? »). La force et la brutalité sont ridiculisées tandis que c’est le jeune homme fragile, timide et attentionné (Marie-Ange a enfin été embrassée) qui parvient à lui faire atteindre l’orgasme. Il suffit de voir la bouille boudeuse des deux amis pour saisir à quel point ce sont deux enfants immatures. Même leurs actes les plus graves (l’agression et le vol qui ouvrent le film) ne peuvent être considérés que comme des bêtises de garnements indisciplinés. Il est d’ailleurs notable qu’il n’y a pas de viol à proprement parler dans Les Valseuses (contrairement à ce qui est parfois écrit) si ce n’est celui de Pierrot… par Jean-Claude. Mais, là encore, la scène (hors-champ) vaut plutôt comme
Hommes-femmes : mode d’emploi 299
symbole que comme action réaliste. Il s’agit de montrer la
puérilité des personnages, leur côté Laurel et Hardy (avec
cette même homosexualité refoulée sous-jacente) qui évacue
la violence vers une dimension plus burlesque et enfantine
(« Entre copains, c’est normal ! »).
Si l’on décèle de la misogynie dans Les Valseuses parce que
Jean-Claude et Pierrot considèrent les femmes comme des
objets, elle n’est pas dans le regard de Blier qui, au contraire, ne
cesse de contredire ses personnages par sa mise en scène et de
souligner leur puérilité. Ce qu’expriment ces hommes, c’est un
profond désarroi face à des femmes beaucoup plus matures et
riches qu’eux. Ce désarroi, on le retrouve sous une forme outrée
dans Calmos et de manière beaucoup plus sensible dans Préparez
vos mouchoirs où, encore une fois, les deux comparses du film ne
comprennent rien aux désirs féminins (qu’ils soient sexuels ou à
l’envie de devenir mère). Raoul et Stéphane sont aussi puérils que
Jean-Claude et Pierrot avec leurs pulls en laine identiques et leur
manière de se mêler aux autres gamins au moment de la grande
bataille de petits suisses dans le réfectoire. Là encore, l’approche
de Blier est dialectique : si Solange peut donner le sentiment d’être
une potiche boudeuse (« Elle serait pas un peu con ? » demande
Stéphane) sans profondeur ni désir, le cinéaste montre avant
tout le côté étriqué des deux lascars, l’un collectionnant Le Livre
de poche en classant les 5000 volumes par ordre alphabétique
tandis que l’autre n’a d’autres ambitions que de passer des soirées
devant la cheminée de son petit pavillon de banlieue qui ne voit
quasiment jamais le soleil. Face à cette femme qui étouffe et qu’ils
ne comprennent pas, les hommes sont totalement désarçonnés.300 vincent roussel
C’est paradoxalement un jeune garçon précoce de 13 ans qui
parvient à comprendre Solange. Dans une scène fameuse, il dénude
la jeune femme qui dort à côté de lui. Toute la « masculinité » selon
Blier tient dans cette scène : les hommes ne sont que de petits
garçons qui ne comprennent rien aux femmes, alors ils cherchent
à voir ce qu’elles ont entre les jambes. Dans ses premiers films, il
y a constamment ce désir de revenir à la matrice originelle : les
seins gorgés de lait de Brigitte Fossey dans Les Valseuses, le vagin
gigantesque où atterrissent les deux compères à la fin de Calmos,
les regards de Christian sous la chemise de nuit de Solange dans
Préparez vos mouchoirs. La fameuse « scène de l’œil » de Merci la
vie synthétise plus tard cette pulsion scopique que l’on retrouve
chez ces hommes cherchant à appréhender « l’origine du monde ».
En se présentant d’emblée comme une charge violemment
antiféministe, Calmos a fini par asseoir définitivement la
réputation de misogynie de Blier. Pourtant, comment est-il
possible d’avoir pris au premier degré cette fable foutraque et
délirante ? Comment imaginer que le cinéaste puisse adhérer
une seconde aux propos de ses personnages ? Comme nous
l’avons déjà dit, en inversant les rôles et en attribuant aux
femmes tous les critères de la masculinité dans ce qu’elle peut
avoir de pire (l’obsession sexuelle, le culte de la force et du pas
de l’oie, le côté grande gueule), Blier met à nu les mécanismes
de la virilité et brosse le portrait d’hommes ridicules et
grotesques dans leur désir de manger de la charcuterie
autour d’une bouteille. Si les femmes sont présentées sous un
angle grimaçant et bouffon, c’est qu’elles incarnent tous les
attributs de la masculinité traditionnelle. Ce ne sont donc pasHommes-femmes : mode d’emploi 301
elles qui sont fustigées mais davantage les codes des sociétés
patriarcales. Nous n’irons pas jusqu’à faire de Calmos un film
féministe dans la mesure où Blier s’en prend quand même à
celles (particulièrement le mlf) qui voudraient ressembler aux
hommes mais l’outrance du projet peut difficilement laisser
croire à une charge au premier degré.
Blier n’est pas misogyne et lorsqu’on le lui reproche, il s’en
défend avec véhémence : « Mais c’est un reproche totalement
idiot ! Dans mes films, ce sont les hommes qui ont toujours le
sale rôle. Je n’ai filmé que des crétins. Des lâches. Aucun n’a la
clé du monde féminin : ils ne savent pas comment ça marche.
Soit parce qu’ils sont très machos, comme dans Les Valseuses.
Soit parce qu’ils sont trop amoureux, comme dans Préparez
vos mouchoirs. Même dans Beau-père, Patrick Dewaere est un
loser consternant… De fait, tous les hommes de ma génération
ont démarré macho. Moi comme les autres. Mais être macho,
aujourd’hui, c’est être demeuré… »* Plus que l’éventuel
« macho » qu’il aurait été, le cinéaste paraît venir d’un monde
désormais lointain où « l’ensemble des processus tendant
à imposer une indifférenciation de fer dans la plupart des
domaines »** n’était pas encore de rigueur. Blier filme les hommes
et les femmes comme des êtres foncièrement dissemblables,
non pas tant pour accabler un sexe en particulier (comme il le
dit, il est beaucoup plus cruel avec la gent masculine) que pour
creuser cette différence et l’interroger. Si Calmos a pu être pris
pour une charge misogyne, c’est parce que le cinéaste montre
l’horreur d’un monde où les femmes seraient devenues comme
* Blier, Bertrand. « Pour moi, il n’y a plus de cinéma. » Op. cit.
** muray, Philippe. Après l’ histoire. Les Belles Lettres, 1999.302 vincent roussel
les hommes. Il ne s’agit en aucun cas de leur refuser d’avoir
les mêmes droits mais de souligner le caractère misérable du
modèle qu’elles cherchent à imiter. Chez Blier, le mâle est
profondément immature, benêt, lâche et désarçonné. Face
à lui, la femme est mystérieuse, imprévisible mais beaucoup
plus courageuse, déterminée et lucide. À ce titre, Beau-père est
exemplaire puisque les rôles sont intervertis : l’adulte (Patrick
Dewaere) est un gamin en pleine déroute, incapable d’aimer et
de s’engager tandis que l’adolescente a la tête sur les épaules et
prouve qu’elle peut tout donner par amour, en dépit du « joug
vermoulu de la morale imbécile » comme l’écrit Georges
Darien. Jusqu’à Merci la vie, Bertrand Blier épouse un point
de vue masculin mais pour montrer des héros totalement
désemparés devant le monde féminin. Les duos machos sont
infantilisés (Les Valseuses, Préparez vos mouchoirs ou encore
La Femme de mon pote lorsque Coluche se retrouve malade
et au lit) jusqu’à un retour à la matrice originelle (Calmos).
Quand ils sont solitaires, ils sont totalement paumés (Beau-
père), alcooliques (Notre histoire) ou abandonnés en pleine nuit
au milieu de la rue (Trop belle pour toi).
La rencontre avec Anouk Grinberg est déterminante et à
partir de Merci la vie, le metteur en scène s’intéresse à des
héroïnes féminines pendant une décennie (les années 1990).
Pourtant, d’aucuns y décèleront toujours sa proverbiale
« misogynie » puisque ses personnages sont pérpétuellement
malmenés (l’ouverture de Merci la vie, le viol d’Un, deux, trois,
soleil) et que Mon homme contient l’une des scènes les plus
violentes (et les plus éprouvantes) de toute son œuvre lorsqueHommes-femmes : mode d’emploi 303
Gérard Lanvin, devenu proxénète, gifle violemment Marie
qui l’a recueilli le temps d’une démonstration totalement
oiseuse (« Un mac, ça donne des baffes, sinon c’est pas un
mac. »). La scène est d’un tel réalisme qu’elle est insoutenable.
Mais encore une fois, jamais le cinéaste ne nous place du
côté de l’homme et toute sa compassion va vers la jeune
femme. Si certains ont estimé que Blier peinait à sortir du
schéma traditionnel de la « maman » et la « putain » (que
la prostituée jouée par Anouk Grinberg s’appelle Marie est
assez symptomatique), il est évident qu’il s’intéresse avant
tout à la manière dont ses personnages féminins parviennent
à se mouvoir dans ces limites édictées par le regard masculin.
Mais qu’il s’agisse de l’ignoble médecin de Merci la vie, des
beaufs (Bouchitey et surtout Brasseur) d’Un, deux, trois, soleil
ou du mac de Mon homme, tous les hommes ou presque sont
des êtres misérables et pitoyables, incapables de donner le
centième de ce que peuvent offrir les femmes. Ce n’est sans
doute pas un hasard si Mon homme se termine par le visage
déconfit de Gérard Lanvin en gros plan qui n’a plus qu’une
chose à faire : demander pardon aux femmes en général et à
Marie en particulier.
Après sa rupture, Blier renoue avec un univers presque
exclusivement masculin. Même un film comme Combien tu
m’aimes ? qui reprend le schéma de Mon homme en offrant
un beau rôle à Monica Bellucci inverse les points de vue et
s’intéresse avant tout à celui du personnage incarné par
Bernard Campan. Malgré cela, la mise en scène trahit
constamment ce que le récit semble avancer. Ainsi, Les Acteursne s’intéresse certes qu’à des comédiens mais ce sont tous des fantômes tandis que la scène avec Maria Schneider apparaît comme une véritable résurrection. Les duos bravaches des Côtelettes, du Bruit des glaçons ou de Convoi exceptionnel sont également constitués de pantins terrorisés par l’idée de la mort qui approche et qui ne savent pas dans quelle histoire ils sont embarqués. Ce sont les femmes qui leur redonnent espoir et qui incarnent, au fond, une certaine sagesse, une stabilité et — surtout — une immense générosité dont sont dépourvus des hommes égoïstes. À travers les relations hommes-femmes que mettent en scène ses films se dessine en filigrane la question — primordiale — du rapport au père et à la paternité chez Blier.
Vous pouvez aussi lire