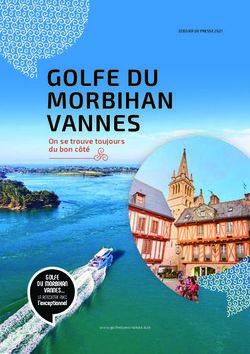L'Holocauste dans les romans de Sylvie Germain: allusions, hallucinations, méditations - Johns ...
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
L'Holocauste dans les romans de Sylvie Germain: allusions,
hallucinations, méditations
Marie-Hélène Boblet
L'Esprit Créateur, Volume 50, Number 4, Winter 2010, pp. 67-80 (Article)
Published by Johns Hopkins University Press
For additional information about this article
https://muse.jhu.edu/article/407016
[ This content has been declared free to read by the pubisher during the COVID-19 pandemic. ]L’Holocauste dans les romans de Sylvie Germain :
allusions, hallucinations, méditations
Marie-Hélène Boblet
L
A LITTÉRATURE FRANÇAISE depuis la Deuxième Guerre mon-
diale entretient des rapports d’une redoutable complexité avec la
mémoire et avec l’Histoire. À l’aube du vingtième siècle déjà la lit-
térature se faisait l’écho du « désenchantement du monde » dont parle Max
Weber, induit par l’étouffement de la rationalité technique et bureaucratique.
Mais cette rationalité n’avait pas encore collaboré à enfanter les monstres du
nazisme ni ne s’était mise au service de l’extermination de masse. Et la France
de Vichy n’avait pas encore collaboré avec Hitler. Le désenchantement qui
s’aggrave dans le second demi-siècle d’effroi et de culpabilité s’exprime par
des symptômes littéraires successifs : d’abord l’aphasie, le refoulement de la
mémoire collective et même de toute affectivité dans les premiers temps du
Nouveau Roman, qui déserte les événements de l’Histoire et de la pensée.
Puis, à partir des années 80, les phénomènes de désintégration, de déliaison,
d’esseulement consécutifs au traumatisme historique et idéologique inter-
pellent thématiquement les écrivains, voire assignent l’écriture narrative à
trouver une langue qui s’ajuste à la mémoire, à tresser la fable romanesque
avec l’Histoire. Le matériau du passé, sans doute conservé dans sa vivacité
agissante par le refoulement même, nourrit une inspiration romanesque qui ne
rechigne pas au roman historique, et mêle à l’invention de l’histoire en minus-
cules l’inscription de l’Histoire en majuscules. Cette imbrication repose sur le
présupposé selon lequel nous sommes, comme disait Husserl, des « co-
porteurs » de l’Histoire, nous en portons le fardeau passé, la trace et la charge
à venir. Nous sommes, comme enfants d’après-guerre et d’après l’Holocauste,
déterminés par et dépositaires de cette Histoire catastrophée qui nous affecte.
Le genre « roman », dont on s’était détourné comme du passé, se retrouve lui
aussi, et transforme lui-même l’écriture en « travail de mémoire ». Ainsi en
va-t-il pour Sylvie Germain : « Parler de l’histoire quand on n’est pas his-
torien », dit-elle au moment du Livre des Nuits, « c’est fatalement un peu une
fable [...]. Les mots amènent une levée d’images en même temps que la
mémoire s’éveille. Je suis alors pétrie d’une mémoire collective »1.
Sylvie Germain, née en 1954, est « pétrie d’une mémoire collective » qui
intègre la Shoah et la France de Vichy. Loin de se couler dans les traces des
archivistes ou des chroniqueurs, elle use de l’Histoire pour « ré-enchanter » le
© L’Esprit Créateur, Vol. 50, No. 4 (2010), pp. 67–80L’ESPRIT CRÉATEUR
monde. Non qu’elle en nie la barbarie qui défie l’imagination. Justement, elle
exploite l’imagination pour en rappeler la valeur anthropogène, et propose
une refondation d’un monde commun, d’une vie en commun, sur la subjec-
tivité et l’affectivité dont la modernité a cru bon de se passer. En ce sens, la
convocation germanienne de l’Histoire relève d’un questionnement à la fois
politique, éthique et philosophique.
Sur le double plan de l’anthropologie et de l’histoire, la matière de tous
ces romans confirme les hypothèses freudiennes de Malaise dans la civilisa-
tion, ou de L’Avenir d’une illusion. Il n’y a d’héroïque que la fiction de la
civilisation2. Norbert Elias et Max Weber ont souligné que dès que la paix
cesse d’être l’enjeu et la finalité dernière de l’État, les démons s’en donnent à
cœur joie, et défoulent la violence collective refoulée par le monopole de la
violence légitime concédé à l’État. George Mosse a montré que le premier
conflit mondial démocratique de masse a produit une brutalisation pérenne
des mœurs, qui prouve à quel point la civilisation n’est qu’un vernis superfi-
ciel. La déshumanisation culmine avec la Seconde Guerre mondiale, où se
désinhibe radicalement la pulsion archaïque de la destructivité au point de
rendre possible l’extermination de masse3. « Qui ne voit d’ailleurs aujourd’hui,
écrit Bataille, que le mal est donné d’une façon fondamentale dans la bestialité
servant la raison d’état : Buchenwald ne serait pas sans ce caractère le signe
décisif, indiscuté, irréductible du mal »4. Dans les romans germaniens des
années 80 ou 90, aucun discours didactique sur le nazisme, aucune qualifica-
tion de la France de Pétain autrement qu’en termes cosmiques : « Une petite
ville que nul ne connaissait en dehors des malades du foie fut soudain
propulsée au premier rang de cette géographie catastrophée »5. Mais la
Seconde Guerre mondiale et l’Holocauste amènent une réflexion éthique
inspirée par l’herméneutique lévinassienne et l’audace d’un « Humanisme de
l’autre homme6 ». Le lien entre les œuvres des deux décennies s’élabore à la
faveur de la question du Mal et de la déstructuration affective dont l’Histoire
fut la scène et le signe.
Présence de l’Histoire et pression de l’éthique
Les premiers romans de Sylvie Germain accueillent un siècle d’histoire
française, de 1870 à 1968, au long des sept cents pages du Livre des Nuits
(1985) et de Nuit d’Ambre (1987). La visée et la vision initiales de la roman-
cière se concentraient autour de la guerre d’Algérie. Mais la présence de
l’Histoire précipite la pression de l’éthique qui opère le rejointoiement de la
fable avec la lutte mythique de Jacob avec l’ange. À ce moment de l’œuvre
romanesque, le génocide nazi est présent mais de biais, estompé, sur le mode
68 WINTER 2010MARIE-HÉLÈNE BOBLET
hallucinatoire de la vision ou du rêve. Les séquences du Livre des Nuits scan-
dent la fureur de la destructivité, elles épousent le mouvement révolutionnaire
qui défait le livre à mesure qu’il progresse : « Le livre se retournait. Il allait
s’effeuiller à rebours, se désoeuvrer » (Livre des Nuits 337). Nuit d’Ambre
répète cette antienne : « Le livre se défeuillait, se désœuvrait complètement.
[…] Il s’effaçait, faisait place à la nuit. […] Détruit, le livre, radicalement
détruit ; en perte totale de mots. Seule demeurait la nuit »7. Le syntagme
articulé, le livre entendu comme fruit de la symbolisation ne s’accordent pas
à la stridence pulsionnelle de la violence qui appelle pour se dire soit la sidéra-
tion du cri, soit la figuration par les images. La barbarie nazie et la Solution
finale ne sont dicibles que par le détour, la métaphore et l’allusion. Les qua-
trième et cinquième sections du Livre des Nuits, respectivement « Nuit du
sang » et « Nuit des cendres », accueillent par exemple la vision onirique de
Nuit-d’Or-Gueule-de-Loup ou les images peintes par sa femme juive, Ruth.
C’est comme si les images germaient sous la pression d’une clairvoyance
médusante, même si pour le rêveur ou la peintre elles n’ont pas plus de
référence que de sens. Géographiquement situées, elles sont à la fois étranges
pour le personnage qui les rêve et familières au lecteur qui les lit et les lie à
sa connaissance de l’Holocauste.
Nuit-d’Or-Gueule-de-Loup dans son rêve ne reconnaît que la Meuse. « Le
fleuve est surplombé de hauts remblais de terre caillouteuse hérissée de fils
barbelés. Il entr’aperçoit, mais cela reste très indistinct, des silhouettes
d’hommes se profiler derrière les barbelés, et plus loin encore des toits de
baraques en bois dont les cheminées ne cessent de cracher des jets de fumées
noires. Les silhouettes gesticulent de façon très désarticulée. » (Livre des
Nuits 233) « S’il parvenait à peu près à imaginer ce que devait être un camp
de prisonniers ou de travailleurs forcés, il ne pouvait par contre nullement se
représenter ce qu’étaient ces camps où l’on conduisait les Juifs. Il n’avait
d’ailleurs jamais vraiment compris ce que signifiait être juif et la propagande
antisémite répandue par l’ennemi ne lui avait rien appris sur cette question
qu’il ne s’était jamais posée. » (Livre des Nuits 295) Faute de pouvoir se
représenter ces camps, Nuit-d’Or-Gueule-de-Loup les rêve obscurément.
Ruth, elle, est le corps et l’âme d’un peuple tout entier à qui elle donne
figure : « elle appartenait au pouvoir d’un songe immense peuplé d’images
humaines hautes en couleur et en violence. Et ce songe l’avait investie, elle,
la fille unique et dernière-née du pieux marchand de gants, chapeaux et man-
chons en tous genres Joseph Aschenfeld, d’un corps tutélaire, tenant sous sa
protection et son inspiration ces tribus d’hommes et de femmes aux corps
sauvages, aux faces tourmentées » (Livre des Nuits 253).
VOL. 50, NO. 4 69L’ESPRIT CRÉATEUR
Le lecteur, contrairement à Nuit-d’Or-Gueule-de-Loup, identifie imagi-
nairement, dans l’indistinction et la désagrégation des formes, l’épreuve et
l’horizon concentrationnaires. La construction du référent et l’évaluation
axiologique appartiennent à celui qui, par sa propre connaissance et par sa
propre mémoire, reconnaît le méconnaissable : un homme déshumanisé
réduit à une forme désarticulée. La suggestion, l’analogie approximative qui
maintient la différence dans la comparaison, l’énonciation indirecte sont les
seules justes figures de la catastrophe infigurable du génocide. L’allusion dit
aussi l’impossibilité d’éluder, car ces « choses qui ne doivent pas être vues »
(Nuit d’Ambre 270) ne doivent pas être non plus occultées et frappent instam-
ment à la vitre de la psyché.
La cinquième nuit du Livre des Nuits, « Nuit des cendres », offre au
lecteur une image de la place et de la fonction qui lui sont affectées : celles de
la mémoration et de la compassion qui inspireront en 1992 La Pleurante des
rues de Prague. Le visage de Violette du Saint Suaire porte les stigmates des
victimes de l’Histoire. Son visage « ruisselle sans fin, continuellement baigné
de sang. […] Elle répète des mots, toujours les mêmes, comme “mal, Dieu,
monde, ruines, cendres, agonie”. […] Elle a le regard de quelqu’un qui voit
des choses effroyables, des choses qui ne peuvent ni ne doivent être vues »
(Livre des Nuits 270). Dans l’univers germanien, les traces mnésiques de
l’Histoire collective sont déposées en chacun, dans l’inconscient de Nuit-
d’Or-Gueule-de-Loup comme de Ruth, sur le visage-suaire de Violette. Le
roman ne raconte ni les rafles ni les tris ni les exécutions ni les crémations. Il
indique que dans son inconscient chacun connaît l’inattestable. Que la psyché,
traversée d’images inactuelles et pourtant réelles, insituables et pourtant
localisables, en porte la trace, en est investie. Le contournement, la réticence
et la périphrase disent que l’Holocauste ne peut s’articuler en récit, que le
traumatisme qui saisit l’esprit sans assimilation possible l’interdit.
À ce mode poétique, allusif et métaphorique de l’estompe, se substitue
dans les années quatre-vingt-dix une présence plus prégnante des camps de
l’Holocauste. L’auteur déplace les lieux et les temps de la fiction en Europe de
l’Est, après la chute du mur de Berlin, la révolution de velours en Tchécoslo-
vaquie, et la décomposition de l’URSS. Mais là encore, l’évocation de l’His-
toire est englobée dans un questionnement spirituel qui l’emporte sur les faits.
Elle est recontextualisée dans l’Histoire élargie de l’Europe judéo-chrétienne.
En lieu et place d’un impossible récit, Éclats de sel (1996) comprend une
description des peupliers d’Auschwitz-Birkenau. Cette évocation évidemment
vaut pour la déploration de ce dont Auschwitz fut le lieu, mais au-delà c’est
70 WINTER 2010MARIE-HÉLÈNE BOBLET l’exclusion du peuple juif, les exils successifs hors des communautés nationales de l’Europe moderne qui est en cause. L’Histoire du vingtième siècle déborde vers le passé, et la description des peupliers ouvre sur l’évoca- tion de la tentative de l’alliance entre communautés chrétienne et juive au XVIème siècle. La rencontre de Rabbi Yehouda Ben Betsael dit le Maharal de Prague et de Rodolphe II est la toile de fond spirituelle sur laquelle se détachent les peupliers d’Auschwitz-Birkenau8. Sylvie Germain, des romans Nuit d’Am- bre, Éclats de sel à l’essai Céphalophores (1997), questionne inlassablement les relations des communautés chrétienne et juive et la trahison de l’alliance. Elle le fait dans des termes éthiques plus que théologiques. Dans Nuit d’Am- bre, alors que Noé témoigne de la continuité de l’espèce et en assure le devenir, Nuit d’Ambre et ses pairs incarnent la destructivité déchaînée des « enfants de l’après-guerre ». « Ils avaient quitté leur terre et traversé la mer comme la faune embarquée par Noé. Mais à l’inverse de Noé, qui avait fui la violence pour renouer par-delà le déluge l’alliance entre Dieu et toute chair qui est sur la terre, eux s’en venaient pour s’affronter à d’autres. Ils s’en venaient, sans même l’avoir voulu, sans même s’en rendre compte, refaire l’épreuve de l’oubli de l’alliance, et de la perte de l’absolu de la fraternité »9. Dans Chanson des mal-aimants (2003), le personnage, sans identité ni généalogie, abandonné naissant à la porte d’un couvent, naît en 1939. « Enfant du malheur, de la honte et de la disgrâce », elle est baptisée Laudes-Marie Neigedaoût par la religieuse qui la recueille, au moment même où la guerre est déclarée. Le 24 décembre 1944, du haut de ses cinq ans, l’enfant fête la Nativité en voulant sauver Jésus de l’enfer qui le menace puisqu’il est Juif. Elle vole le bébé de la Crèche et pour l’acheminer jusqu’à Dieu le père, le confie aux bons soins de la dépouille d’une supérieure défunte. Elle place Jésus dans le cercueil, et se verra exclure du couvent pour ce geste iconoclaste. Pourtant, ce geste est le paradigme de l’assistance que les Chrétiens eussent dû réserver aux Juifs. Le récit de Chan- son des mal-aimants, à la première personne, raconte un trajet subjectif, com- passionnel, une traversée de l’abandon qui convertit la déréliction de la mal- aimance en apologie de la philia. À sa façon, il oppose à l’ambiguïté du Vatican et de l’Église catholique que dénonce le film de Costa Gavras, Amen, réalisé en 2001, la réaction de Laudes-Marie, lorsque, expulsée du couvent, elle côtoie le sort d’enfants cachés, dans un village proche de Gurs. Léontine la « Juste » y recueille enfants de résistants et enfants juifs. Parmi eux, Esther, qui ne reverra jamais ses parents : Un matin, je l’ai vue sortir de la maison, son visage était défiguré […] elle a émis un cri éton- namment rauque. […] VOL. 50, NO. 4 71
L’ESPRIT CRÉATEUR
Le mugissement d’Esther, si brutal et désespéré fût-il, ne m’était pas étranger ; il y avait,
enfouie dans un recoin de mon être, une ouïe capable de l’écouter. Et une phrase que j’avais
entendue au couvent m’est revenue à la bouche. À la bouche, oui, court-circuitant la mémoire, la
conscience. À la bouche, comme un caillot de sang et de larmes.
Mane nobiscum, Domine, advesperacit.
Reste avec nous, Seigneur, le soir tombe. (Chanson des mal-aimants 28)
Pour la première fois dans le roman apparaît le leitmotiv qui en a déclenché
l’écriture. Mane nobiscum, Domine, advesperacit scande la complainte de
l’abandon qui donne à la narration un tour lyrique et pathétique, accordé à
l’itinéraire compassionnel de la narratrice.
La mal-aimance et la banalité du mal
Le roman suivant, Magnus, couronné du Prix Goncourt des Lycéens, est
éclaté, comme désarticulé par le traumatisme du personnage éponyme,
Magnus, victime d’un choc qui le rend amnésique et aphasique. Les chapitres
du roman s’intitulent « fragments » comme pour dire l’histoire en lambeaux
de vies dévastées. Entre ces fragments, faute de liant chronologique, des
« séquences, résonances, échos », tentent des liens métaphoriques et
analogiques tandis que « notules » et « éphémérides » insèrent des éléments
d’information historique. Curieusement, le fragment de l’incipit porte le
numéro 2, et lance un personnage dont on ignore nom et identité : le lecteur
est face à Magnus comme Magnus est face à lui-même, comme à un étranger
dont il ne se rappelle rien, mort à sa mémoire comme à sa langue et à son
nom. La composition poétique est ajustée au bombardement de Hambourg
par l’opération Gomorrah et à l’amnésie du héros. Or ce traumatisme initial
ne sera découvert qu’au centre du livre, dans le fragment 1, placé entre les
fragments 11 et 12, comme si l’ensemble s’organisait par explosion rayon-
nante et irradiante autour de ce choc. En outre, ce trauma psychique qui rend
l’enfant orphelin de mère et de mémoire est doublé par la perversion de
l’éducation qu’il reçoit dans sa famille adoptive. Magnus en effet grandit
dans une enfance trafiquée par une famille de militants SS en manque de
descendance : puisque l’enfant n’est personne, ils l’appelleront Franz Georg,
nom composé commémoratif des deux « oncles » hitlériens morts à Stalin-
grad. La narratrice souligne qu’il a certes reçu de ses parents adoptifs une
éducation, « Mais de structuration affective aucune » (74). Or le titre du
roman précédent, Chanson des mal-aimants, pointant comme un doigt sur
une plaie la pathologie de la mal-aimance, invite à mesurer la place et le sens
de l’affectivité, de la philia, condition de possibilité transcendantale de toute
refondation de l’humanité.
72 WINTER 2010MARIE-HÉLÈNE BOBLET
Pour Aristote, le sentir était à l’origine du vivre ensemble dans la com-
munauté. Hannah Arendt, auquel Magnus fait explicitement référence et
allégeance, s’en souvint au moment du procès d’Eichmann à Jérusalem10. Le
manque de sensibilité, et en amont d’imagination fait d’un homme ordinaire
un tortionnaire. La structuration affective, celle dont justement Magnus est
privé, permet de disposer de la faculté de jugement dont manquait Eichmann,
incapable d’être affecté par la souffrance de l’autre parce qu’incapable de
penser l’homme dans l’autre, de s’imaginer l’autre comme alter ego, autre
que soi et autre soi en même temps. L’indifférence, l’absence de compassion
s’enracinent dans l’infirmité de l’imagination.
Un reportage consacré au procès du criminel nazi fait scandale, celui effectué par la philosophe
Hannah Arendt pour l’hebdomadaire New Yorker. On lui reproche son ton, ressenti comme dés-
involte, arrogant, et surtout ses analyses et ses jugements. Magnus lit le reportage incriminé, et
loin de s’en offusquer, il fait sienne l’idée de « banalité du mal ». Pour lui, ce n’est pas un con-
cept lancé de façon téméraire, c’est plutôt un doigt qu’on pose sur une plaie qu’on préfère ne pas
voir tant elle est laide, honteuse. Tout en lisant le texte de Hannah Arendt, il ne peut s’empêcher
d’entendre en fond sonore les voix de ces autres pourvoyeurs de désastres qu’il a connus, intime-
ment côtoyés. […] Des voix qui assurément auraient répondu, à l’instar d’Eichmann, d’un ton sec
et monocorde, dénué de tout remords, « non coupable » à chaque chef d’accusation prononcé
contre eux par un tribunal s’ils avaient été capturés et jugés11.
Cette « banalité du mal », loin de diminuer la responsabilité humaine,
repose sur l’anthropologie kantienne de l’indétermination. La thèse du Mal
radical concerne l’espèce humaine, en tant qu’elle est libre de choisir la voie
du Bien ou celle du Mal. C’est l’énigme insondable et radicale de la liberté
laissée à l’homme qui rend possible le Mal. Or la disposition au Bien a des
chances de l’emporter sur le penchant au Mal si justement l’affectivité n’est
sacrifiée ni à la rationalité ni à la technicité. Dans Magnus, les noms de
Hannah Arendt et d’Eichmann n’ancrent pas seulement la fiction dans la bar-
barie contemporaine pour la tirer vers le roman historique. L’Histoire et la
mémoire sont l’occasion pour l’écrivain de réfléchir à l’impératif éthique, à
son universalité comme à sa fragilité. Le souci moral justifie la déconstruction
de la narration : seule la déstructuration narrative s’ajuste à la déstructuration
affective, et rend justice de l’expérience du Mal. L’interruption du récit par les
informations factuelles et par la méditation spirituelle tisse une œuvre où
s’entrelacent Monde de l’Histoire et Vie de l’Esprit.
L’Église confessante face à l’Holocauste
Dans la fable romanesque, au moment de la débâcle du Reich, Franz
Georg (alias Magnus) est envoyé par sa mère adoptive chez son frère Lothar,
VOL. 50, NO. 4 73L’ESPRIT CRÉATEUR
un pasteur luthérien. Époux d’une juive, il s’est exilé depuis 1938 en Grande
Bretagne avec sa famille. Le personnage fictif de Lothar permet d’introduire
dans la fable l’aventure historiquement réelle de l’Église confessante. La
romancière fait de Lothar un proche des pasteurs Martin Niemöller et Dietrich
Bonhoeffer, dont une « éphéméride » rappelle la bio- et la bibliographie.
Auteur des thèses de la Ligue d’urgence pastorale, Dietrich Bonhoeffer
dirigea un des séminaires pastoraux créés par l’Église confessante (die Beken-
nende Kirche) qui protesta contre l’Église luthérienne officielle, totalement
corrompue par sa collaboration avec le pouvoir nazi. Dietrich Bonhoeffer
dénonça dès août 1933 la haine raciale et la persécution des Juifs dans un tract
cité par le roman :
L’exclusion des judéo-chrétiens hors de la communauté détruit la substance de l’Église du Christ.
[…] L’Église n’est pas la communauté de ceux qui sont de la même espèce, mais elle est celle
des étrangers qui ont été appelés par la Parole. Le peuple de Dieu est un ordre au-delà de tous les
autres. […] Le « paragraphe sur les Aryens » [promulgué le 7 avril 1933] est une hérésie et détruit
la substance de l’Église. (Magnus 188)
Revenu en 1939 de New-York par le dernier bateau transatlantique, Bon-
hoeffer fut dès 1940 interdit d’enseignement et de publication. Il participa à
la conjuration de von Stauffenberg du 20 juillet 1944. Emprisonné à la prison
Tegel à Berlin, il fut transféré à Buchenwald puis exécuté sur l’ordre person-
nel de Hitler en avril 194512.
Mais dans la prison berlinoise, Bonhoeffer écrivit un roman fragmentaire,
Fragmente aus Tegel. Ce roman avoue et déplore le double échec de la com-
munication intergénérationnelle et de la transmission de valeurs, et fonde
l’espérance sur la mémoire. Sans mémoire, ni temporalité ni communauté.
Les résonances de Fragmente aus Tegel se devinent en creux dans Magnus,
d’autant que Sylvie Germain met en abîme une expérience d’écriture. Car
Magnus est habité, comme « occupé » par un autre roman, Pedro Paramo de
Juan Rulfo, « livre en creux, en douve, en abîme, où une nuée d’échos se sera
mise à chuchoter » (Magnus 108). « Étrange polyphonie funèbre où des
ombres entretissent leurs voix errantes et lancinantes » (Magnus 85), ressas-
santes et ré-sonnantes, Pedro Paramo offre la polyphonie des âmes des
défuntes victimes de cette incarnation du Mal qu’est Pedro Paramo. Ces voix
exigent mémoration et réparation pour qu’une chance soit donnée à l’avenir
de relancer l’histoire. Une notule, entre deux chapitres narratifs de Magnus,
cite un extrait d’Échos de Paramo, de Fabienne Bradu : « Le futur de l’écho
est un mur, un butoir, une condamnation ; l’écho percute quelque chose qui le
renvoie vers le passé. L’écho est un son mobile, mais qui va à rebours, sans
74 WINTER 2010MARIE-HÉLÈNE BOBLET
espoir de jamais devenir autre, différent » (Magnus 95). L’écho fait indéfini-
ment re-sonner la compulsion répétitive imposée par l’impossibilité de
dépasser l’expérience traumatique, de penser, d’articuler, de symboliser et de
métaboliser l’épreuve. Dans la fiction, c’est le choc de la lecture de Pedro
Paramo qui suscite un précipité de mémoire en Magnus et lui rend sa vérita-
ble identité. Il perd conscience pour renaître à sa véritable enfance, au langage
de la vérité. Une hypermnésie de mots étrangers et d’images étranges ressus-
cite la présence spectrale du père tortionnaire, fait sortir du refoulement et de
l’oubli la mystification et la barbarie nazie. Il lui faudra retrouver et découvrir
ce faux père SS travesti en chanteur de cabaret pour se libérer de ce passé et
recouvrer son identité. Magnus peut donc se lire comme un roman de l’im-
prescriptibilité, concept audacieux qui recouvre le principe grec de l’amnistie
et le principe chrétien du pardon, en faisant coïncider temps de l’Histoire et
temps de la justice. Le régime d’imprescriptibilité rend en effet Magnus con-
temporain des crimes passés de l’Histoire dont les coupables, dont son père
adoptif, sont en vie.
La construction poétique de Magnus est dictée par l’amnésie et l’anam-
nèse du « héros ». La dislocation du récit épouse la perturbation de la mémoire
et le « retour du refoulé ». Ainsi le fragment 1 qui délivre la clé du trauma-
tisme initial situe l’infirmité de l’enfant, « page gommée prête à être réécrite »
(Magnus 101), juste après une « séquence » constituée de citations de Pedro
Paramo, roman que le personnage est en train de lire. Si « écrire provoque un
précipité de mémoire », comme le dit Sylvie Germain, le précipité de
mémoire ici est bel et bien effet de lecture…
L’Épreuve de mémoire
Dans la perspective de la phénoménologie de Husserl, le passé ne se
découple pas de l’avenir, la mémoire ne se dissocie pas du souci du monde à
venir. Parce que nous sommes temporellement orientés, ouverts sur le passé
et sur le futur, nous sommes membres de communautés sociales et his-
toriques. L’oubli, l’indifférence sont donc démission par rapport à la com-
munauté, dés-intéressement, perte du sentiment du monde commun. À ce
titre, ils voisinent dangereusement avec le Mal radical.
Récurrente, cette « épreuve » de mémoire obsède, à côté des romans, les
essais que sont Les Échos du silence (1996), Céphalophores (1997) ou la fable
allégorique La Pleurante des rues de Prague (1992). Les apparitions de la
mémoire souffrante et pleurante, mais qui jamais ne renonce, n’abandonne son
peuple, de « cette pitié manante qui traverse l’histoire en boitant » (La Pleurante
des rues de Prague 61), sont incarnées par une géante qui surgit au hasard des
VOL. 50, NO. 4 75L’ESPRIT CRÉATEUR
rues de Prague. Mémoire de la ville, des pauvres et des petits, de « ces Très-Bas
anonymes qui ont enduré, pâti l’Histoire », elle est « corps lourd de la
mémoire des hommes» (La Pleurante des rues de Prague 71, 103). Cette
parabole rappelle, dans une prose incantatoire qui met au service de la mémoire
collective, historique les procédés de la mémoire rythmique, l’assassinat de
Bruno Schulz, le meurtre programmé des enfants de Terezin. De même que
Magnus consiste en une explosion de bris de roman, de même La Pleurante
n’est pas un livre, « mais un ressassement d’appels et d’échos. Une claudication
d’écriture, un balbutiement d’encre » (La Pleurante des rues de Prague 128),
seul ajusté à la douleur et à la commémoration. La mémoire à transmettre est un
enjeu éthique qui assigne l’écrivain à une exigence esthétique.
Au moment où le siècle s’achevait, Sylvie Germain, enfin, écrivit Etty
Hillesum (1999). Ce texte in memoriam est écrit en écho au journal tenu par
Etty Hillesum, Une vie bouleversée, Journal 1941-194313 dont Sylvie Ger-
main prit connaissance à travers Le Concept de Dieu après Auschwitz de Hans
Jonas (1987). À la lecture du journal d’Etty Hillesum, s’imposa à Sylvie Ger-
main l’urgence de composer une « “bio-résonance” pour faire tinter la voix si
singulière, exceptionnelle de cette jeune femme qui a accompli une seconde
naissance à l’approche de la mort » (Etty Hillesum 15). Etty Hillesum,
citoyenne des Pays-Bas, fit partie des 104 000 Juifs (sur 140 000) qui furent
assassinés par le nazisme. Son journal reconstitue leur ghettoïsation puis leur
relégation, et parallèlement sa propre aventure spirituelle. Le quinze juillet
1942, elle entre au service culturel du Conseil Juif étroitement surveillé par
les autorités allemandes. D’abord moins menacés que leurs congénères, les
membres du Conseil Juif à partir de juillet 1943 perdent leur statut particulier.
Lorsque le commandement du Conseil Juif devient nazi, Etty Hillesum est
déplacée au camp de transit de Westerbork, et mourra à Auschwitz le 30
novembre 1943. Tout en consentant absolument au « destin de masse » qui les
attend tous, elle écrit pour témoigner de cette exception :
Est-ce bien important que ce soit moi ou un autre, tel ou tel autre ? C’est devenu un destin de
masse, commun à tous, et on doit le savoir […]. On n’avait jamais vu de persécution sous cette
forme totalitaire, organisée à l’échelle des masses, englobant toute l’Europe. Il faudra tout de
même quelques survivants pour se faire un jour les chroniqueurs de cette époque. (Une vie
bouleversée 159-60)
Etty Hillesum lutta contre cette « maladie de l’âme », le racisme ou la
germanophobie, dans des termes très proches de ceux d’Hélène Berr dont
l’expérience à l’UGIF est comparable14. Écartelée entre « [ses] instincts
vitaux de Juive menacée de destruction et [s]es idées acquises, rationnelles, de
76 WINTER 2010MARIE-HÉLÈNE BOBLET
socialiste », elle est moralement sauvée de la haine par « cette pensée libéra-
trice qui a levé comme un jeune brin d’herbe encore hésitant au milieu d’une
jungle de chiendent : n’y aurait-il plus qu’un seul Allemand respectable, qu’il
serait digne d’être défendu contre toute la horde des barbares, et que son exis-
tence vous enlèverait le droit de déverser votre haine sur son peuple entier »
(Une vie bouleversée 25). La logique de l’excès qui caractérise l’Holocauste
implique la logique de la surabondance que choisit Etty Hillesum : « Mon
acceptation n’est ni résignation ni abdication de la volonté. Il y a toujours
place pour la plus élémentaire indignation morale devant un régime qui traite
ainsi des êtres humains. Mais les événements ont pris à mes yeux des propor-
tions trop énormes, trop démoniaques pour qu’on puisse y réagir par une ran-
cune personnelle ou par une hostilité exacerbée » (Une vie bouleversée 164).
Dans Face à l’extrême (1992), Tzvetan Todorov rend évidemment hom-
mage à la hauteur spirituelle d’Etty Hillesum, en soulignant son caractère
d’exemplarité et d’exceptionnalité. Mais le plan auquel se situe Etty, celui de
La Pesanteur et la grâce, ne vaut pas selon lui au niveau politique, car la lutte
intérieure contre le Mal prend le pas sur la lutte contre le mal extérieur et lui
soustrait des forces15. Répondant à Todorov, Sylvie Germain veut croire, elle,
que la profondeur et l’antériorité du travail spirituel préparent la voie à la
civilisation et à la refondation politique. La Cité bénéficierait de « la com-
munion des Justes » contre la corruption des esprits induite par la Terreur
nazie. La logique du surcroît, du « combien plus » n’est pas exclusivement
propre à Etty Hillesum. C’est celle de Hannah Arendt : il suffirait d’un seul
homme digne de ce nom pour que l’on puisse croire en l’homme, en l’humanité.
C’est aussi celle de Paul Ricœur, ou de Jonas commentant Le Livre de Job.
Dans Le Concept de Dieu après Auschwitz : une voix juive, Hans Jonas
s’interroge sur la possibilité de penser Dieu après l’expérience des camps
d’extermination en détachant les uns des autres ses attributs théologiques.
Poser l’infinie bonté de Dieu et son intelligibilité demande que soit sacrifié le
troisième de ses attributs, l’omnipotence. La pensée de Jonas est influencée
par la cabbale de Gershom Scholem : Dieu, affecté par le souci du monde, par
ce qui se passe dans l’ordre du temps, a pris le risque de laisser advenir l’His-
toire, le risque de souffrir de ce que font les hommes du don de la liberté. Dieu
laissant devenir le monde s’est dépouillé de ses prérogatives. Il faut donc
choisir d’imaginer comme un risque enduré le retrait de Dieu, son renonce-
ment à la toute-puissance. La culture judaïque n’est pas la culture d’apparte-
nance de Sylvie Germain, mais elle est devenue pour elle une culture de
référence qu’elle fait résonner et dialoguer avec d’autres propositions issues
VOL. 50, NO. 4 77L’ESPRIT CRÉATEUR
du Christianisme, justement au nom de l’Alliance16. La présence de l’Holo-
causte dans son œuvre convoque « les échos du silence » de Dieu, issu des
théories judaïques de la cabbale dont s’inspire Hans Jonas. Dans tous les cas
revient à nos oreilles le double sens de l’abandon de Dieu. Le leitmotiv de
Chanson des mal-aimants, « Mane nobiscum, Domine, advesperacit », n’exclut
pas la plainte de Dieu délaissé par ses créatures. Ainsi les vers de Johanes
Scheffler, dit Angelus Silesius, sont cités dans le roman : « Seul l’abandon
saisit Dieu mais délaisser Dieu même est un autre abandon que peu savent
concevoir »17. Etty Hillesum elle-même, au comble de la détresse, promet à
Dieu de veiller sur lui : « Ce sont des temps d’effroi, mon Dieu. Cette nuit
pour la première fois, je suis restée éveillée dans le noir les yeux brûlants, des
images de souffrance humaine défilant sans arrêt devant moi. […] Je vais te
promettre une chose, mon Dieu. […] Je vais t’aider, mon Dieu, à ne pas
t’éteindre en moi, mais je ne puis rien garantir d’avance. Une chose cependant
me paraît de plus en plus claire : ce n’est pas toi qui peux nous aider, mais
nous qui pouvons t’aider—et ce faisant nous nous aidons nous-mêmes » (Une
vie bouleversée 166).
Sylvie Germain nourrit une dette à l’égard de l’Histoire passée qui l’in-
spire, notamment de l’Histoire la plus traumatisante, et un devoir à l’égard de
l’Histoire à construire. La présence de la mémoire, la pression de l’éthique et
la question du Mal radical de la liberté préparent, plutôt que le pari sur le
Bien, le « pari sur le Sens » (Ricœur), qui explique la sympathie de la roman-
cière pour la démarche épistémologique de la philosophie herméneutique. En
écrivant, elle est fidèle au projet des Anciens dans les pas desquels s’in-
scrivent Walter Benjamin et Hannah Arendt : le récit offre une forme prépoli-
tique de survie, immortalise ce qui serait oublié sans lui, assure la mémoire
des disparus. Laissant dans le matériau diégétique une place croissante et de
plus en plus frappante à la Shoah, Sylvie Germain rémunère la richesse
sémantique du mot hébreu : la catastrophe ne désigne pas une destruction
politico-militaire, mais renvoie à la singularité d’un événement de pensée
auquel il faut faire face. En écrivain, elle travaille à une élaboration textuelle
qui soit « juste » et l’intègre dans une réflexion éthique sur l’Alliance et sur
la trahison. Les fictions de la romancière espèrent ainsi rendre l’Histoire non
encore écrite redevable à la littérature d’un rappel de la communauté, d’un
élargissement de la pensée par un supplément d’âme. Car « si toute cette
souffrance n’amène pas un élargissement de l’horizon, une plus grande
humanité, par la chute de toutes les mesquineries et petitesses de cette vie—
alors tout aura été vain » (Une vie bouleversée 180).
78 WINTER 2010MARIE-HÉLÈNE BOBLET
S’il incombe aux survivants de chroniquer et de témoigner, il appartient
aux écrivains de faire fructifier la mémoire et ses prolongements, des archives
aux avertissements, de faire circuler le passé et l’avenir par le carrefour du
présent. Histoire et fiction collaborent au questionnement sur la responsa-
bilité collective et participent de ce que Jean-Marc Ferry appelle une « éthique
reconstructive »18. Faire place à la nuit, c’est porter au jour les faits et les
fautes, pour révéler de quoi préserver l’avenir des hommes. « La nuit dictait
obstinément aux hommes les dits de la mémoire, de leur propre mémoire,
qu’ils tentaient cependant toujours de fuir, de faire taire, de renier. La nuit,
tenace, forçait les hommes à faire mémoire. À faire mémoire jusque dans les
déserts de l’oubli » (Nuit d’Ambre 347).
Université Paris III–Sorbonne Nouvelle
Notes
1. « L’Obsession du mal », propos recueillis par P. Tizon, Le Magazine littéraire, 286 (mars
1991): 64-66. À un récit linéaire, parfaitement serti dans le temps et l’espace, tend en effet
à se substituer une forme fantaisiste et bigarrée qui mélange avec désinvolture prose narra-
tive, prose poétique et réflexion.
2. Le déchaînement particulièrement sanglant en Allemagne s’explique par le fait que le pays
n’a pas connu d’accompagnement collectif du deuil et de la défaite en 1918, ce qui accrut
l’irrationalité mythique de l’expansion du Volksgeist.
3. Voir Sigmund Freud, Considérations actuelles sur la guerre (1915) ; Max Weber, Le Savant
et le politique (1918) ; Georges Mosse, Fallen Soldiers : Reshaping the Memory of the
World Wars (Oxford: Oxford U P, 1990), trad., De la grande guerre au totalitarisme : la
brutalisation des sociétés européennes (Paris: Hachette, 1999).
4. Georges Bataille, « Du rapport entre le divin et le mal », Critique (mars 1947), Œuvres com-
plètes (Paris: Gallimard, 1988), 11:206.
5. Le Livre des Nuits (Paris: Gallimard, 1985), 276.
6. Sylvie Germain, docteur en philosophie, a consacré sa thèse au concept de « visagéité »
dans la philosophie d’Emmanuel Levinas.
7. Nuit d’Ambre (Paris: Gallimard, 1987), 361.
8. Cette rencontre est imaginée aussi dans Céphalophores (Paris: Gallimard, 1997).
9. Nuit d’Ambre, 122. Le personnage de Nuit d’Ambre inaugurait une lignée de malheureux
marqués par les conditions historiques de leur apparition dans le monde. « Nuit d’Ambre,
s’il est un enfant de l’après-guerre, a un entourage affectif détruit par les guerres qui ont
précédé sa naissance. Alors que les autres sont confrontés contre leur gré au problème des
guerres et des deuils, lui, parce qu’il est un enfant malheureux, est subjugué par le mal gra-
tuit et va éprouver le besoin d’aller jusqu’au bout du mal » (« L’Obsession du mal », 66).
10. Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem : rapport sur la banalité du mal (1963), Anne
Guérin, trad. (Paris: Gallimard, 1966).
11. Magnus (Paris: Albin Michel, 2005), 126-27.
12. Au printemps 1938, Martin Niemöller fut arrêté par la Gestapo puis déporté jusqu’en 1945,
successivement à Sachsenhausen et Dachau. Pour avoir protesté contre cette arrestation
illégale, Ernst Wiechert passera lui-même l’été 38 au camp de Buchenwald, qui lui inspire
Der Totenwald en 1939.
13. Het verstoorde leven, dagboek van Etty Hillesum, 1941-1943 (Bussum: de Han/Unieboek,
1982), trad., Une vie bouleversée, journal 1941-1943 (Paris: Seuil, 1985).
VOL. 50, NO. 4 79L’ESPRIT CRÉATEUR
14. Voir Hélène Berr, Journal, préface de Patrick Modiano (Paris: Tallandier, 2008).
15. La lecture effleure le faux sens, car pour Etty « cet abandon n’équivaut pas à la résignation,
à une mort lente, il consiste à continuer à apporter tout le soutien que je pourrai là où il
plaira à Dieu de me placer » (Une vie bouleversée 153).
16. Celle du Dieu en attente de François Bouillon, par exemple, ou du Dieu mendiant de
Zendel. Une autre théorie juive, la théorie du tsimtsoum que Rabbi Isaac Louria échafauda
au moment où les Juifs furent expulsés d’Espagne est mentionnée dans Éclats de sel (1993)
et Céphaphores (1997). Dieu se contractant laisse le vide où puisse se créer le monde. Ce
retrait de Dieu est le double paradigme de l’exil des Juifs et de l’humilité de Dieu qui a
besoin du souci des hommes. L’involution de l’un image le bannissement des autres.
17. Un autre vers de ce même poète est cité dans Etty Hillesum et dans Songes du temps (2003),
accompagné du commentaire qu’en fit Heidegger dans Le Principe de raison.
18. Jean-Marc Ferry, L’Éthique reconstructive (Paris: Éditions du Cerf, 1996).
80 WINTER 2010Vous pouvez aussi lire