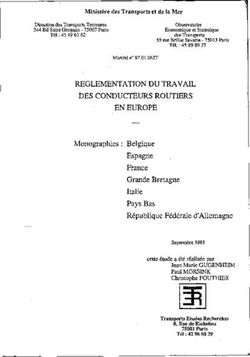LA RESPONSABILITÉ DES FOURNISSEURS DE MOYENS FACE À LA CONTREFAÇON SUR INTERNET1 - Revue Internationale du Droit d'Auteur
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
LA RESPONSABILITÉ DES FOURNISSEURS DE MOYENS FACE
À LA CONTREFAÇON SUR INTERNET1
LÉA THORAVAL
Docteur en Droit
La sanction, réparatrice ou punitive2, constitue la solution classique
contre la contrefaçon. Face aux nouvelles formes de contrefaçon sur Internet,
le législateur recourt également aux réponses correctives mais celles-ci ne
suivent pas toutes la même logique. Des textes anciens ont été adaptés et
des textes nouveaux adoptés. Ainsi le législateur ne fait pas le choix d’une
réponse unique face à la contrefaçon. Les sanctions s’adressent non seulement
aux fournisseurs et « consommateurs » de contenus illicites sur Internet, mais
1. Cet article est la reprise de quelques thèmes largement développés dans une thèse de
doctorat intitulée « La protection de la propriété littéraire et artistique contre la contrefaçon
sur Internet », soutenue le 6 décembre 2017 à l’Université de Caen et dirigée par M. le
Professeur Christophe Alleaume. Le jury était composé de MM. les Professeurs Tristan Azzi,
Alexandra Bensamoun, Nicolas Binctin et Célia Zolynski.
2. V. G. Cornu (dir.), association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, 11e éd., PUF, coll.
Quadrige, 2016, v° « sanction » et « sanctionner » qui incluent la réparation dans la notion
de sanction.
45revue internationale du droit d’auteur
également aux fournisseurs de moyens. Si les premières personnes concernées
sont évidemment celles à l’origine de l’infraction, les titulaires de droits
doivent toutefois faire face à de nombreuses difficultés pour engager leur
responsabilité. Se posent des questions de localisation, d’identification, de
solvabilité de ces contrefacteurs, mais aussi d’acceptabilité par la société lorsque
l’action concerne des particuliers. Cela pousse dans une certaine mesure,
notamment pour des considérations d’opportunité tenant à la notoriété
et à la solvabilité3, à se tourner vers les fournisseurs de moyens, comme les
éditeurs de logiciels destinés au partage, les fournisseurs d’accès à Internet
(FAI) ou les hébergeurs. La place tenue par ces acteurs du numérique dans le
« processus » de contrefaçon sur Internet invite en effet à s’interroger sur la
possibilité d’engager leur responsabilité, précisément pour leur rôle dans cette
contrefaçon. Le régime des intermédiaires techniques leur étant actuellement
très favorable, sont soulevés, en amont de son application, des problèmes de
qualifications pour en bénéficier (I). En effet, le législateur a préféré adopter
des régimes de responsabilité dérogatoires, spécifiques à ces intervenants (II),
pas toujours avantageux pour la protection contre la contrefaçon sur Internet,
plutôt qu’utiliser des régimes de responsabilité existants (III).
I. LA QUALIFICATION D’INTERMÉDIAIRES TECHNIQUES
La qualification d’éditeurs de logiciels destinés à la mise à disposition
d’œuvres ne posant a priori pas de difficultés, il convient de nous concentrer
3. L. Marino, « Responsabilités civile et pénale des fournisseurs d’accès et d’hébergement »,
J.-Cl. Comm., fasc. 670, 2017, n° 1 : « la tentation est grande de rechercher leur responsabilité en
raison de leur rôle dans la communication au public, d’autant que ces intermédiaires pourraient
tenir lieu de coupables idéaux, plus faciles à identifier que les fournisseurs de contenu, et aussi plus
solvables ».
46la responsabilité des fournisseurs de moyens
face à la contrefaçon sur internet
sur celle d’intermédiaires techniques4. Si l’ensemble des textes n’envisage
clairement que deux types d’intermédiaires (A), il faut s’interroger sur la
possibilité d’étendre la notion au-delà (B).
A. Les intermédiaires techniques identifiés par la loi
La directive du 8 juin 2000 relative au commerce électronique5 et la
loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique6 limitent
les « dérogations en matière de responsabilité »7 à deux types de prestataires.
Bien qu’ils ne soient pas nommément désignés ainsi, il s’agit des fournisseurs
d’accès à Internet (FAI) et des hébergeurs. Le texte européen affirme pour
les premiers qu’il s’agit de « transmettre, sur un réseau de communication, des
informations fournies par le destinataire du service ou à fournir un accès au
réseau de communication »8. Pour les seconds, la directive a intitulé l’article 14
4. Notons qu’aux qualifications issues de la directive 2000/31 du 8 juin 2000, s’ajoute celle
de « plateforme » issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République
numérique, JORF n° 0235 du 8 octobre 2016 (v. notamment C. Zolynski, « Loyauté des
plateformes. De la réglementation à l’inter-régulation », Cah. dr. entr. 2017, n° 3, p. 41). Cette
qualification ne fera pas l’objet de développements puisqu’actuellement elle n’a pas d’incidences
en termes de protection contre la contrefaçon sur Internet. Sur l’articulation du texte français
avec la directive, v. J. Rochfeld et C. Zolynski, « La « loyauté » des « plateformes ». Quelles
plateformes ? Quelle loyauté ? », Dalloz IP/IT 2016, p. 520. Adde L. Grynbaum, « Loyauté
des plateformes : un champ d’application à redéfinir dans les limites du droit européen – À
propos de la loi pour une République numérique », JCP G 2016, 456, p. 778, qui expose une
« conformité incertaine au droit européen du commerce électronique ».
5. Directive n° 2000/31 du 8 juin 2000, JOCE n° L 178 du 17 juillet 2000 p. 0001-0016,
relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment
du commerce électronique, dite « directive commerce électronique », Comm. com. électr. 2000,
comm. 94, p. 22, obs. G. Decocq ; Comm. com. électr. 2001, chron. 18, obs. L. Grynbaum.
6. Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, JORF n° 0143 du 22 juin 2004 p. 11168, dite « loi
LCEN ». V. notamment numéro spécial consacré à loi pour la confiance dans l’économie
numérique dans Comm. com. électr. 2004, n° 9.
7. Considérant 42 de la directive préc.
8. Article 12 intitulé « Simple transport ». L’article 6, I, 1 de la loi LCEN du 21 juin
2004 préc. les définit comme « les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services
de communication au public en ligne ».V. également la définition proposée par W. Duhen,
47revue internationale du droit d’auteur
« Hébergement » et défini leur activité comme la « fourniture d’un service de
la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un
destinataire du service »9. Ces deux prestataires de service sont aujourd’hui
incontournables pour la circulation des œuvres sur Internet10. Grossièrement,
le FAI donne accès au réseau Internet et indirectement aux œuvres qui s’y
trouvent et l’hébergeur offre un espace de stockage qui peut permettre la mise
à disposition d’œuvres sur Internet.
Au regard des incertitudes que peut laisser planer la rédaction des
textes, mais aussi de l’apparition de nouveaux prestataires avec le Web 2.0,
les titulaires de droits ne se sont pas privés de faire valoir que certains ne
relevaient pas de la qualification d’hébergeur et de son régime dérogatoire.
Ainsi les juges se sont vus confrontés à cette question de la qualification
d’hébergeur pour les sites contributifs qui permettent aux internautes de
poster des contenus « par l’intermédiaire d’une structure d’accueil »11. Deux
solutions doivent retenir particulièrement notre attention. La première est
celle de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 23 mars 201012
La responsabilité extracontractuelle du fournisseur d’accès à Internet, PUAM, coll. Droit de
l’information et de la communication, 2013, n° 23, p. 53 : « toute personne physique ou morale
qui fournit techniquement un accès à des services de communication au public en ligne, que cette
activité soit principale ou accessoire, gratuite ou payante ».
9. L’article 6, I, 2 de la loi LCEN du 21 juin 2004 les présente comme « les personnes physiques
ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de
communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons, ou de messages
de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».
10. V. M. Vivant, « La responsabilité des intermédiaires de l’Internet », JCP G 1999, I, 180,
p. 2021 : « Ne participent-ils pas au grand jeu planétaire… pour le meilleur et pour le pire ? ».
11. P. Sirinelli, « La responsabilité des prestataires de l’internet : l’exemple des sites
contributifs », RLDI 2009, supplément au n° 49, p. 78.
12. CJUE, 23 mars 2010, aff. C-236/08, Google c/LVM, Comm. com. électr. 2010, étude 12,
p. 7, obs. G. Bonet ; Comm. com. électr. 2010, comm. 70, p. 23, obs. Ch. Caron ; RLDI 2010,
n° 61, actu. 1999, p. 9, obs. C. Castets-Renard ; D. 2011, p. 908, obs. S. Durrande ; RLDI
2010, n° 60, étude 1994, p. 63, obs. F. Glaize et B. Pautrot ; RLDI 2010, n° 60, étude 1980,
48la responsabilité des fournisseurs de moyens
face à la contrefaçon sur internet
relative au service Google AdWords. Dans cette affaire, la CJUE a été amenée
à expliciter la notion de prestataires intermédiaires prévue à l’article 14 de la
directive 2000/31 (soit la notion d’hébergeur). Ainsi dans son point 114, la
Cour affirme qu’« il convient d’examiner si le rôle exercé par ledit prestataire est
neutre, en ce que son comportement est purement technique, automatique et passif,
impliquant l’absence de connaissance ou de contrôle des données qu’il stocke ». Elle
se réfère ici aux termes choisis par la directive dans son considérant 4213 et
en déduit l’exigence de neutralité technique du prestataire. Il doit demeurer
un prestataire « technique » dont l’action ne doit pas avoir d’incidence sur le
contenu stocké. La Cour de cassation s’est également prononcée sur la question
dans deux arrêts du 17 février 2011 à propos du site contributif Dailymotion14.
Comme la CJUE, la première chambre civile se réfère au caractère technique
des opérations mises en œuvre par les prestataires. Elle précise aussi que le
prestataire ne doit pas avoir un « rôle actif », elle exige qu’il n’y ait pas « une
p. 38, note L. Grynbaum ; EDPI 2010, n° 4, p. 1, obs. A. Lucas-Schloetter ; Comm. com.
électr. 2010, comm. 132, p. 27 obs. M. Malaurie-Vignal ; D. 2010, p. 885, obs. C. Manara ;
JCP G 2010, 642, p. 1190, note L. Marino ; Propr. intell. 2010, n° 36, p. 823, obs. F. Pollaud-
Dulian ; Comm. com. électr. 2010, comm. 88, p. 40, obs. Ph. Stoffel-Munck ; D. 2010, Pan.,
p. 1966, obs. P. Tréfigny-Goy ; RTD eur. 2010, p. 939, obs. E. Treppoz.
13. Considérant 42 de la directive 2000/31 préc. : « Les dérogations en matière de responsabilité
prévues par la présente directive ne couvrent que les cas où l’activité du prestataire de services dans le
cadre de la société de l’information est limitée au processus technique d’exploitation et de fourniture
d’un accès à un réseau de communication sur lequel les informations fournies par des tiers sont
transmises ou stockées temporairement, dans le seul but d’améliorer l’efficacité de la transmission.
Cette activité revêt un caractère purement technique, automatique et passif, qui implique que
le prestataire de services de la société de l’information n’a pas la connaissance ni le contrôle des
informations transmises ou stockées ».
14. Cass. 1re civ., 17 février 2011, n° 09-67.896, Sté Nord-Ouest c/Dailymotion, RLDI 2011,
n° 71, actu. 2351, p. 37, note M. Barbier et V. Geeraert ; Comm. com électr. 2011, comm. 32,
p. 27, note Ch. Caron ; RLDI 2011, n° 69, actu. 2258, p. 10, note C. Castets-Renard ; JCP
G 2011, p. 520, note A. Debet ; D. 2011, p. 1113, note L. Grynbaum ; Propr. intell. 2011,
n° 39, p. 197, obs. A. Lucas ; D. 2011, actu. p. 668, obs. C. Manara ; Gaz. Pal. 22 juin 2011,
n° 174, p. 20, note L. Marino ; RTD com. 2011, p. 351, obs. F. Pollaud-Dulian ; RIDA 2011,
n° 228, p. 411, note. P. Sirinelli ; Légipresse 2011, n° 283, p. 297, note V. Varet.
Cass. 1re civ., 17 février 2011, n° 09-13.202, Fuzz, Comm. com. électr. 2011, comm. 32, p. 27,
note Ch. Caron.
49revue internationale du droit d’auteur
capacité d’action du service sur les contenus mis en ligne ». Autrement dit, le
prestataire de services ne doit pouvoir intervenir sur les contenus mis en ligne
qu’à titre purement technique pour permettre le bon usage de son service
(« compatibilité de la vidéo », « formatage », « taille des fichiers postés »)15, mais
il ne doit en aucun cas toucher à la substance du contenu. Ce dernier est
fourni par les utilisateurs du service16 et ne doit pas dépendre de la volonté du
prestataire. Selon le professeur Laure Marino, « l’indice clé est celui de l’absence
de contrôle intellectuel »17. Dans ces décisions la Cour de cassation admet donc
que le régime dérogatoire de responsabilité soit appliqué à un site contributif,
c’est-à-dire à un prestataire dont l’activité n’avait a priori pas été envisagé par
la directive ou la loi LCEN.
Les juges ont donné les clés pour qualifier les prestataires et ont
ainsi insisté sur l’exigence de neutralité technique, ce caractère justifiant
le régime de faveur qui leur est accordé. Cependant, les difficultés
15. Notons que la Proposition de directive sur le droit d’auteur dans le marché unique
européen, COM (2016) 593 final du 14 septembre 2016 (V. C. Castets-Renard, « Vers
une réforme du droit d’auteur pour un marché unique numérique : faire face aux GAFA ! »,
D. 2016, p. 2172) – avec laquelle il faut être prudent, le texte n’étant pas définitif – propose
de redéfinir le « rôle actif » des intermédiaires dans son considérant 38, lequel affirme dans sa
version initiale qu’« il y a lieu de vérifier si le prestataire de services joue un rôle actif, notamment
en optimisant la présentation des œuvres ou autres objets protégés mis en ligne ou en assurant
leur promotion, indépendamment de la nature des moyens employés à cet effet ». Dans le même
sens, le texte révisé et adopté par le Parlement européen le 12 septembre 2018 retient que « les
prestataires de services de la société de l’information dont l’un des objectifs principaux consiste à
stocker, à mettre à la disposition du public ou à diffuser un grand nombre de contenus protégés par
le droit d’auteur chargés ou rendus publics par leurs utilisateurs, et qui optimisent les contenus
et font la promotion dans un but lucratif des œuvres et autres objets chargés, notamment en les
affichant, en les affectant de balises, en les gérant et en les séquençant, indépendamment des moyens
utilisés à cette fin, et jouent donc un rôle actif ». Par la même, la proposition s’écarte de la
jurisprudence française.
16. La loi LCEN du 21 juin 2004 le précise dans son article 6 : les signaux, écrits, images, sons
ou messages stockés par l’hébergeur sont « fournis par les destinataires de ces services ».
17. V. L. Marino, Droit de la propriété intellectuelle, 1re éd., PUF, coll. « Thémis », 2013,
p. 138, n° 61.
50la responsabilité des fournisseurs de moyens
face à la contrefaçon sur internet
sont toujours aussi grandes pour déterminer la qualité des prestataires,
notamment face à la multiplication de leurs services. Par exemple, la
société exploitant Google, originairement simple moteur de recherche,
propose aujourd’hui d’autres services : Google Images, Google Vidéo, Google
Suggest, YouTube (racheté par la société Google), etc. Face à cette situation,
les juges ne font pas le choix d’une réponse définitive. Ils opèrent leur
qualification au cas par cas, service par service. Ainsi, la CJUE a dû se
prononcer sur la société exploitant eBay qui est désigné comme une « place
de marché en ligne sur laquelle sont présentées des annonces pour des produits
mis en vente par des personnes inscrites à cette fin ». Dans cette décision du
12 juillet 201118, la Cour de justice refuse d’appliquer une qualification
unitaire à la société eBay. Elle se penche sur les différents rôles joués par la
plateforme. Elle considère, d’une part, que le stockage des offres de vente
relève bien de l’article 14 de la directive, mais que, d’autre part, ce n’est
pas le cas lorsque la société eBay apporte son assistance pour optimiser
la présentation des offres puisqu’il y a alors un rôle actif19. Ce choix
d’une qualification distributive est également applicable aux autres sites
contributifs tels que ceux exploités par les sociétés Facebook ou Google.
Ces problèmes de qualification se posent également à propos des sociétés
exploitant des moteurs de recherche.
18. CJUE, 12 juillet 2011, aff. C-324/09, eBay c/L’Oréal, JCP E 2011, actu. 509, obs. Ch.
Caron ; Comm. com. électr. 2011, comm. 99, p. 33, note Ch. Caron ; Gaz. Pal. 27 octobre
2011, n° 300, p. 19, obs. L. Marino ; JCP G 2011, actu. 875, p. 1441, obs. F. Picod ; JCP G
2011, étude 1175, p. 1943, obs. F. Terré.
19. Points 114, 115, 116, 117.
51revue internationale du droit d’auteur
B. Les intermédiaires techniques identifiés par le juge : les sociétés
exploitant des moteurs de recherche
S’il n’est pas contestable que la directive du 8 juin 2000 s’applique
aux FAI et aux hébergeurs, l’affirmation est plus discutable pour les autres
intermédiaires d’Internet tels que les sociétés exploitant des moteurs de
recherche20. Ces derniers se présentent comme un outil de recherche
fonctionnant avec des mots-clés. Ce service de référencement en ligne utilise
un algorithme pour déterminer les résultats les plus pertinents. Sa neutralité
technique le rapproche des deux intermédiaires techniques « classiques ».
Ni la directive, ni la loi n’utilisent la notion de moteur de recherche.
Faut-il en déduire que ces textes ne lui sont pas applicables ? Cette solution,
a priori contraire à l’objectif de la directive du 8 juin 2000 de développer le
commerce électronique, ne semble pas être celle retenue par les juges. Deux
raisonnements sont envisageables pour retenir la qualification d’intermédiaire
technique à l’égard des exploitants de moteur de recherche. Soit adopter
une lecture extensive de la directive et considérer que la société exploitant
le moteur de recherche est bien un « prestataire de services agissant en qualité
d’intermédiaires »21 et peu importe qu’elle ne soit ni FAI, ni hébergeur. Soit
appliquer à la société exploitant le moteur de recherche la qualification
d’hébergeur. La CJUE semble avoir optée pour la seconde possibilité dans sa
décision du 23 mars 201022. Cette affaire concernait le service Google AdWords
qui est un service payant de référencement (contrairement au « classique »
20. V. Th. Maillard, « Le(s) statut(s) des moteurs de recherche », Dalloz IP/IT 2016, p. 177.
21. Considérant 40 de la directive 2000/31 préc.
22. Décision Google c/LVM préc.
52la responsabilité des fournisseurs de moyens
face à la contrefaçon sur internet
Google qui utilise le référencement dit « naturel » et non payant23). La
dernière question préjudicielle posée à la CJUE porte ainsi sur l’application
de l’article 14 de la directive du 8 juin 2000 à un service de référencement sur
Internet. La CJUE affirme dans son point 110 que le service de référencement
en ligne correspond à la définition d’un « service de la société de l’information »24
et dans son point 111 qu’il répond aux exigences formulées à l’article 14 de
la directive, à savoir la « fourniture d’un service […] consistant à stocker des
informations fournies par un destinataire du service ». Elle ajoute qu’« il ne
saurait en outre être contesté que le prestataire d’un service de référencement
transmet des informations du destinataire dudit service, à savoir l’annonceur, sur
un réseau de communication ouvert aux internautes et stocke, c’est-à-dire met
en mémoire sur son serveur, certaines données, telles que les mots-clés sélectionnés
par l’annonceur, le lien promotionnel et le message commercial accompagnant
celui-ci, ainsi que l’adresse du site de l’annonceur ». La Cour admet donc de
qualifier un service de référencement sur Internet de service d’hébergement
et de lui appliquer son régime favorable. Cependant, c’est également dans cet
arrêt que la CJUE exige la neutralité technique du service pour que celui-ci
bénéficie de l’irresponsabilité conditionnelle des intermédiaires techniques.
Ainsi elle renvoie aux juridictions nationales pour décider si le service en
question, Google AdWords, a ou non un rôle actif et profite ou non de ce
régime d’irresponsabilité.
23. V. les points 22 à 29. Ce service permet à un site internet de faire apparaître sur les pages
de résultats un lien promotionnel vers ledit site en cas de concordance entre les mots-clés qu’il
a sélectionné et les mots-clés utilisés par les internautes pour leur recherche.
24. V. l’article 14 de la directive.
53revue internationale du droit d’auteur
Malgré cette décision, la société Google ne cesse de soulever de nouveaux
questionnements. En effet, la multiplication de ses services représente autant
d’occasions de s’interroger sur la qualification et le régime applicables. Le juge
français est ainsi intervenu à propos des services Google Vidéo et Google Images
dans plusieurs arrêts du 12 juillet 201225. Les deux services sont présentés
par leur propriétaire comme des moteurs de recherche. Si dans le « Google
classique », le mot-clé renvoie directement à des liens hypertextes « textuels »,
dans Google Vidéo et Google Images le mot-clé permet l’affichage d’une page
de résultats sous la forme de vignettes dotées d’une fonction hypertexte.
Autrement dit, l’internaute qui souhaite trouver la photographie, par exemple
d’un acteur, entre le nom de ce dernier dans le moteur de recherche Google
Images et celui-ci lui propose une liste de résultats sous la forme non pas
d’un « lien textuel » mais d’un « lien visuel » : l’ensemble des photographies
de l’acteur indexées par le moteur vont apparaître. Si l’utilisateur clique sur la
vignette, une nouvelle page apparaît avec l’image réduite et des indications sur
celle-ci. En cliquant à nouveau sur l’image, il se retrouve sur la page internet
la publiant à l’origine. Pour Google Vidéo, l’idée est la même. L’internaute tape
l’objet de sa recherche et le moteur lui fournit une liste de résultats sous forme
de vignettes (qui correspondent le plus souvent à une image de la vidéo).
Lorsqu’il clique sur la vignette, il arrive sur le site internet proposant la vidéo.
25. Cass. 1re civ., 12 juillet 2012, n° 11-13.666, Google c/Bac films, Légipresse 2012, n° 298,
p. 566, comm. Ph. Allaeys ; D. 2012, p. 2071, obs. C. Petit ; RTD com. 2012, p. 780, obs.
F. Pollaud-Dulian – Cass. 1re civ., 12 juillet 2012, n° 11-13.669, Google c/Bac films, D. 2012,
p. 2075, obs. C. Manara ; D. 2012, p. 2071, obs. C. Petit – Cass. 1re civ., 12 juillet 2012,
n° 11-15.165 et 11-15.188, Google c/Aufeminin.com, Comm. com. électr. 2013, chron. 1, p. 16,
obs. M.-E. Ancel ; D. 2012, p. 2331, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; JDI 2013, p. 147, note
T. Azzi ; JCP G 2012, 1007, p. 34, note J.-M. Bruguière ; RLDI 2012, n° 85, actu 2866,
p. 77, obs. L. Costes ; RLDI 2012, n° 86, actu 2889, p. 42, note Ch. Gateau et Ch. Coslin ;
D. 2013, Pan., p. 1503, obs. F. Jault-Seseke ; D. 2012, p. 2075, obs. C. Manara ; D. 2012,
p. 2071, obs. C. Petit ; RTD com. 2012, p. 780, obs. F. Pollaud-Dulian ; D. 2012, p. 2836,
obs. P. Sirinelli ; Rev. crit. DIP 2013, p. 607, note L. Usunier.
54la responsabilité des fournisseurs de moyens
face à la contrefaçon sur internet
Au moment des faits de l’espèce, le service Google Vidéo présentait une
particularité. En effet, en cliquant sur certaines vignettes, l’utilisateur pouvait
visionner la vidéo dans une fenêtre réduite et ce en demeurant sur le site
Google Vidéo. C’est cette spécificité qui va conduire le juge à ne pas appliquer
uniquement l’irresponsabilité conditionnelle des intermédiaires techniques.
Il va distinguer l’activité de pur référencement de la mise à disposition du
visionnage. Pour ce qui est de la première, la Cour de cassation va lui appliquer
la loi LCEN du 21 juin 200426, c’est-à-dire l’irresponsabilité conditionnelle
des prestataires techniques. Elle admet donc d’appliquer ce régime à une
société exploitant un moteur de recherche et considère que celle-ci ne joue pas
de rôle actif. La Cour ne précise pas explicitement la qualification du service,
elle ne dit pas qu’il s’agit d’un service d’hébergement, elle se contente de lui
appliquer son régime. Cependant, l’attendu de principe utilise la formule
« images qu’elles stockent » qui tend à considérer la société exploitant le moteur
de recherche comme un hébergeur (au moins en partie). Pour ce qui est de
la seconde activité, le service Google Vidéo est condamné pour contrefaçon
par représentation. Les juges estiment que le service va au-delà du simple
référencement. Il ne s’agit pas de proposer des résultats qui renvoient à un
contenu mais de proposer directement un contenu. En présentant ce contenu,
le site présente une œuvre, la communique au public et ce, en l’espèce, sans
avoir l’autorisation des titulaires de droits. La Cour en déduit qu’il s’agit
d’actes de contrefaçon.
26. V. son visa : « Vu l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 en ses dispositions I. 2,
I. 5 et I. 7 ».
55revue internationale du droit d’auteur
L’arrêt du 12 juillet 2012 relatif au service Google Images, bien que rendu
le même jour que ceux relatifs au service Google Vidéo, s’en distingue en deux
points. D’abord, la Cour de cassation n’opère pas de distinction à propos du
service et seul le régime favorable des intermédiaires techniques est appliqué.
Ainsi, aucun acte de contrefaçon n’est retenu à l’encontre du service Google
Images. Pourtant n’était-il pas possible de voir dans l’affichage des vignettes
une reproduction et une représentation des images sans l’autorisation des
titulaires de droits ? La cour d’appel de Paris a estimé qu’il s’agissait d’une
« prestation technique adaptée à la fonctionnalité attendue d’un moteur de
recherche d’images, tant il est vrai qu’une présentation de résultats sous la seule
forme de références textuelles ne répondrait pas à la fonction même d’un tel
service »27. Autrement dit, les juges considèrent qu’un moteur de recherche
d’images a pour objet de trouver des images et que l’affichage des résultats
sous forme d’images est incontournable, il est nécessaire au service28.
Mais l’argument ne convainc pas. Comme le souligne le professeur André
Lucas, « l’affirmation est évidemment fondée en fait, mais elle ne répond pas
à la question posée, qui est de savoir si, en droit, l’exploitant d’un moteur de
recherche peut, dans l’exercice de son activité, accomplir un acte de reproduction
ou de communication au public sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur
27. CA Paris, pôle 5, 2e ch., 4 février 2011, Google c/Auféminin.com, Comm. com. électr. 2012,
chron. 1, n° 13, p. 26, obs. M.-E. Ancel ; Propr. intell. 2011, n° 39, chron. 7, p. 201, obs.
A. Lucas.
28. Pour une solution comparable, v. Cass. 1re civ., 30 mai 2012, n° 10-17.780, D. 2012,
p. 1798, note Ch. Alleaume, à propos de la commercialisation de photographies sur Internet
par une agence de presse. Le photographe reprochait à l’agence de presse un acte de contrefaçon
pour la numérisation et la mise en ligne des photographies. Si la cour d’appel accueille la
demande, la Cour de cassation lui reproche de ne pas avoir recherché si la numérisation et la
mise en ligne « n’étaient pas impliquées […] par le mandat reçu de commercialiser ces images
et le besoin d’en permettre la visualisation par les acheteurs potentiels » et casse l’arrêt sur ce
point : la reproduction et la représentation étaient nécessaires au service.
56la responsabilité des fournisseurs de moyens
face à la contrefaçon sur internet
sur l’image »29. La réponse devrait être négative. Une telle solution aurait pu
conduire à la fermeture des moteurs de recherche d’images qui se seraient
abstenus d’obtenir les autorisations, or les juges de la cour d’appel dans cette
affaire affirment que « la nécessité [d’un tel service] ne fait pas débat ». Il s’agit
donc d’une solution d’opportunité qui s’explique par la volonté, exprimée
dans la directive, de promouvoir le développement des services de la société de
l’information30. La Cour de cassation utilise le même visa que pour ses arrêts
Google Vidéo, à savoir l’article 6 I. 2, I. 5, I. 7 de la loi LCEN. Elle accepte
donc aussi d’appliquer le régime de l’irresponsabilité conditionnelle à une
société exploitant un moteur de recherche. Mais si la Cour choisit également
la formule « images qu’elles stockent », elle ne semble pas vouloir qualifier le
service Google Images de service d’hébergement. En effet, dans son attendu de
principe, elle désigne bien l’autre société en cause31 comme un hébergeur mais
n’en fait pas autant pour la société Google32. Cette dernière est qualifiée de
« prestataire de services de référencement ». La qualité de « prestataire de services »
renvoie aux considérants 40 et suivants de la directive. La Cour de cassation
29. A. Lucas, « Responsabilité des intermédiaires techniques sur Internet – Moteurs de
recherche – Google Images », Propr. intell. 2011, n° 39, chron. 7, p. 203.
30. Le législateur est toutefois intervenu sur le sujet avec la loi n° 2016-925 du 7 juillet
2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine (dite « loi Liberté de
création »), JORF n° 1058 du 8 juillet 2016. Elle « insère dans le CPI un nouveau chapitre
relatif aux dispositions applicables à la recherche et au référencement des œuvres d’art plastiques,
graphiques ou photographiques, aux articles L. 136-1 et suivants. On peut y voir un mécanisme
de licence, un modèle de gestion collective obligatoire, voire une adaptation des logiques de la copie
privée. L’objectif de ce nouveau chapitre est de mettre en place un partage de la chaîne de valeur
entre les opérateurs du Net, essentiellement les GAFA, et les auteurs d’œuvres graphiques en raison
du très grand nombre d’œuvres reproduites et circulant sur les réseaux, identifiées par les moteurs
de recherche, sans qu’il y ait de contrepartie pour les auteurs » (N. Binctin, « Lettre de France »,
RIDA avril 2017, n° 252, p. 233-235).
31. L’affaire portait sur une photographie diffusée sur le site Aufeminin.com sans l’autorisation
du photographe et accessible sur Google Images.
32. « Qu’en se prononçant ainsi, quand la prévention et l’interdiction imposées à la société
Aufeminin.com, en tant qu’hébergeur, et aux sociétés Google, en tant que prestataires de services de
référencement […] ».
57revue internationale du droit d’auteur
adopte-t-elle ainsi une lecture extensive de la directive pour appliquer le
régime d’irresponsabilité à la société exploitant le moteur de recherche, bien
que cette dernière ne soit pas un hébergeur ? Rien n’est moins sûr puisque
les juges n’opèrent pas cette distinction dans les autres arrêts Google rendus
pourtant le même jour.
Dans les différentes décisions Google, la Cour de justice et la Cour de
cassation ont donc qualifié les sociétés exploitant un moteur de recherche
de prestataires techniques. Il est toutefois possible de s’interroger quant
à l’incidence sur ces décisions, de la jurisprudence postérieure de la Cour
de justice portant sur les hyperliens. Un moteur de recherche, comme celui
exploité par la société Google par exemple, fonctionne bien à partir de mots-clés
et d’hyperliens. Les jurisprudences Svensson33 et GS Media34 sur les hyperliens
remettent-elles en cause la jurisprudence antérieure Google Adwords35 sur
les moteurs de recherche ? Il faut souligner que ces différentes décisions ne
portent pas sur l’interprétation des mêmes directives. Les deux premières
interprètent l’article 3 de la directive 2001/29 du 22 mai 2001, spécifique
au droit d’auteur et aux droits voisins, alors que la dernière se prononce sur
33. CJUE, 13 février 2014, aff. C-466/12, Légipresse 2014, n° 322 p. 698, obs. Ch. Alleaume ;
RLDI 2014, n° 102, p. 9, note C.-E. Armingaud et O. Roche ; Comm. com. électr. 2014, comm.
34, p. 30, note Ch. Caron ; RLDI 2014, n° 102, 3371, p. 9, note E. Derieux ; Propr. intell.
2014, n° 52, p. 234, note S. Dormont ; D. 2014, Pan., p. 2317, obs. J. Larrieu ; Propr. intell.
2014, n° 51, p. 165, obs. A. Lucas ; EDPI 2014, n° 4, p. 1, obs. A. Lucas-Schloetter ; Gaz.
Pal. 17 juillet 2014, n° 187, p. 17, note L. Marino ; RTD com. 2014, p. 600, obs. F. Pollaud-
Dulian ; JCP E 2014, 1444, n° 11, p. 47, obs. F. Sardain ; D. 2014, p. 480 et p. 2078, obs.
P. Sirinelli ; RTD eur. 2014, p. 965, obs. E. Treppoz ; Légipresse 2014, n° 391, p. 183, note
V. Varet.
34. CJUE, 8 septembre 2016, aff. C-160/15, Légipresse 2016, n° 344, p. 695, obs.
Ch. Alleaume ; Propr. intell. 2016, n° 61, p. 436, note J.-M. Bruguière ; Comm. com. électr.
2016, comm. 78, p. 26, obs. Ch. Caron ; RLDI 2016, n° 130, p. 12, obs. L. Costes ; JCP G
2016, p. 2090, note L. Marino ; D. 2016, p. 1905, note F. Pollaud-Dulian ; Dalloz IP/IT 2016,
p. 543, note P. Sirinelli ; Légipresse 2016, n° 343, p. 601, note V. Varet.
35. CJUE, 23 mars 2010, aff. C-236/08, préc.
58la responsabilité des fournisseurs de moyens
face à la contrefaçon sur internet
la directive 2000/31 du 8 juin 2000, qui ne l’est pas (celle-ci s’intéresse « aux
services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique »).
Les deux interprétations sont, à notre sens, compatibles. Dans ses décisions
Svensson et GS Media, la CJUE estime, globalement, que les liens hypertextes
donnent accès à l’œuvre et donc constituent des actes de communication. La
communication de l’œuvre par le biais des hyperliens remet-elle pour autant
en cause la neutralité de l’exploitant du moteur de recherche (nécessaire à
la qualification d’intermédiaire technique) ? La situation d’un moteur de
recherche, comme celui proposé par la société Google, « créateur automatique
d’hyperliens »36, peut être distinguée de celle des annuaires de liens hypertextes,
« créateurs manuels »37, qui paraissent davantage visés par les dernières décisions
de la CJUE. Le premier est a priori neutre contrairement aux seconds. Dans
la première hypothèse, les liens résultent d’un algorithme alors que dans la
seconde ils sont le résultat de choix opérés par le gestionnaire de l’annuaire.
Aujourd’hui, la société exploitant un « créateur automatique d’hyperliens » peut
donc, selon nous, bénéficier de la qualification de prestataires techniques et du
régime d’irresponsabilité choisi par le législateur.
II. LES RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ DES FOURNISSEURS
DE MOYENS CHOISIS
Le législateur a fait le choix de régimes spéciaux de responsabilité pour
les fournisseurs de moyens. Alors qu’il recourt à des dispositions de droit
36. Forum des droits sur Internet, Quelle responsabilité pour les créateurs d’hyperliens vers des
contenus illicites ?, 23 octobre 2003.
37. Notion utilisée dans A. Lucas, H.-J. Lucas et A. Lucas-Schloetter, Traité de la propriété
littéraire et artistique, 4e éd., LexisNexis, 2012, n° 1111, p. 910.
59revue internationale du droit d’auteur
d’auteur et de droits voisins pour les éditeurs de logiciels de partage (A), il
ne le fait pas pour les intermédiaires techniques (B). Les régimes, à défaut
de tous les deux prévoir une responsabilité favorable à la protection contre la
contrefaçon, sont guidés par une même logique de responsabilisation38 des
fournisseurs de moyens sur Internet.
A. La responsabilité des éditeurs de logiciels de partage
La loi DADVSI du 1er août 2006 a inséré deux nouveaux articles relatifs
aux éditeurs de logiciels au sein du Code de la propriété intellectuelle. Il s’agit
des articles L. 335-2-1 et L. 336-1. Ils sont « destinés à prévenir directement
les effets néfastes du peer-to-peer ou P2P sur la diffusion illégale des œuvres ; ils
concernent les logiciels utilisés »39. En effet, généralement en matière de peer to
peer illégal40, les sites ne proposent pas les contenus illicites ou les liens, mais
des logiciels permettant le peer to peer. L’article L. 335-2-1 du Code de la
propriété intellectuelle dispose qu’« est puni de trois ans d’emprisonnement et
de 300 000 euros d’amende le fait : 1° d’éditer, de mettre à disposition du public
ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un
logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée
d’œuvres ou d’objets protégés ; 2° d’inciter sciemment, y compris à travers une
annonce publicitaire, à l’usage d’un logiciel mentionné au 1° ». La responsabilité
des éditeurs de logiciels destinés au partage est ainsi expressément consacrée.
Constatons que l’article est placé au cœur des articles relatifs à la contrefaçon
38. Notion utilisée à propos des intermédiaires techniques par L. Marino, op. cit., p. 139.
39. Y. Gaubiac, « La responsabilité des fournisseurs de logiciels dans la diffusion illégale des
œuvres et autres prestations protégées », Comm. com. électr. 2006, étude 34, p. 41.
40. Rappelons que le peer to peer n’est pas illégal en soit, c’est l’usage qui en est fait qui peut
le devenir.
60la responsabilité des fournisseurs de moyens
face à la contrefaçon sur internet
dans le Code de la propriété intellectuelle (L. 335-2 définit la contrefaçon et
les peines qui s’y rattachent ; L. 335-3 définit également la contrefaçon) et qu’il
prévoit la même sanction que la contrefaçon, à savoir 3 ans d’emprisonnement
et 300 000 euros d’amende. Que leur est-il reproché ? Un acte de contrefaçon
ou la seule fourniture de moyens ? Il s’agit bien de sanctionner la mise
à disposition des logiciels, mais celle-ci semble être assimilée à un acte de
contrefaçon. L’article consacre à notre sens une contrefaçon par fourniture
de moyens : « seul compte le but de cette mise sur le marché du logiciel,
indépendamment de l’utilisation qui en sera faite par les internautes. C’est parce
que cette fourniture est en elle-même un acte illicite que l’éditeur commet un délit
de contrefaçon par fourniture de moyens »41.
Si le texte a le mérite de prévoir la responsabilité de ces éditeurs de logiciels,
sa rédaction manque de clarté. Il exige ainsi que le logiciel soit « manifestement
destiné à la mise à disposition du public non autorisée d’œuvres ». Selon les
travaux parlementaires, « la vocation coupable du logiciel »42 est désignée par
cette expression. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs été saisi à ce sujet. Si la
disposition a été déclarée constitutionnelle43, la décision apparaît critiquable.
En effet, le terme « manifestement destiné » n’est à notre sens pas suffisamment
clair et précis. Il faut souligner que le législateur ne s’est pas contenté de viser
« un logiciel destiné à la mise à disposition du public non autorisée d’œuvres ».
41. B. Gorchs, « Vers un référé de l’Internet autonome », Comm. com. électr. 2007, étude 31,
p. 13.
42. Rapport n° 308 (2005-2006) M. Thiollière, fait au nom de la Commission des affaires
culturelles, déposé le 12 avril 2006.
43. Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, considérant 56 : « Considérant que les termes
“manifestement destinés” et “sciemment” sont suffisamment clairs et précis pour que les dispositions
de caractère pénal qui s’y réfèrent ne méconnaissent pas le principe constitutionnel de légalité des
délits et des peines ».
61revue internationale du droit d’auteur Dans ce cas, le logiciel aurait dû être conçu uniquement pour faciliter ou commettre des contrefaçons. L’adjonction de l’adverbe « manifestement » pousse donc à considérer que ce n’est pas l’hypothèse retenue en l’espèce. Mais alors que devons-nous comprendre par « manifestement » ? Selon Monsieur Yves Gaubiac, cela signifie « visiblement – ou évidemment »44. Mais comment affirmer que le logiciel est visiblement destiné à la contrefaçon45 ? Le professeur Christophe Caron propose de « produire une étude qui évalue le pourcentage d’actes de contrefaçon qui sont favorisés par le logiciel concerné »46. Il faudrait donc admettre que ce caractère manifeste soit apprécié postérieurement à la mise à disposition du logiciel, ce qui ne convainc pas. Le texte impose également, avec l’utilisation de l’adverbe « sciemment », que l’intention délictuelle du fournisseur du logiciel soit caractérisée. Il doit agir en connaissance de cause, il doit savoir que le logiciel est utilisé pour commettre des infractions. Mais si le logiciel est « manifestement destiné » à la contrefaçon, son éditeur n’a-t-il pas nécessairement agi sciemment ? En toute hypothèse, la difficulté réside ici dans la preuve de la connaissance. Il est d’ailleurs remarquable que la connaissance doit être prouvée pour l’éditeur de logiciels, alors que l’élément intentionnel de la contrefaçon est présumé au pénal. Finalement, les exigences posées par ces deux adverbes (« manifestement » et « sciemment ») reflètent la perte de 44. Y. Gaubiac, « La responsabilité des fournisseurs de logiciels dans la diffusion illégale des œuvres et autres prestations protégées », art. préc., p. 41. 45. Nous pouvons renvoyer aux éléments utilisés dans les affaires Grokster et Kazaa. Dans ces affaires, les juges américains, puis australiens, retiennent les mêmes éléments : « 1) le défendeur a vanté les vertus de son dispositif pour violer le droit d’auteur ; 2) le défendeur s’est abstenu d’empêcher les utilisations contrefaisantes en les filtrant ; 3) le business plan du défendeur dépendait d’un volume important d’utilisations contrefaisantes » : J. C. Ginsburg et Y. Gaubiac, « Contrefaçon, fournitures de moyens et faute : perspectives dans les systèmes de common law et civilistes à la suite des arrêts Grokster et Kazaa », RIDA 2006, n° 207, p. 15. V. aussi V.-L. Benabou, « À quoi sert l’arrêt Grokster ? », Légipresse 2005, n° 224, Tribune, p. 131. 46. Ch. Caron, Droit d’auteur et droits voisins, 5e éd., LexisNexis, 2017, n° 558, p. 547. 62
la responsabilité des fournisseurs de moyens
face à la contrefaçon sur internet
neutralité du fournisseur de moyens. C’est parce qu’il renonce à sa neutralité
technique que l’éditeur de logiciels voit sa responsabilité pénale engagée.
L’adoption de l’article L. 335-2-2 du Code de la propriété intellectuelle
doit être saluée dans la mesure où elle consacre la responsabilité d’« acteurs qui
contribuent à la contrefaçon – sans commettre eux-mêmes l’acte de reproduire ou
représenter illégalement une œuvre – en en fournissant des moyens »47. Se pose
toutefois le problème de l’élément intentionnel de l’infraction. Il est même
doublé de la compréhension difficile des adverbes « manifestement » et
« sciemment ». La responsabilité de ces acteurs dépend donc de l’interprétation
qu’en feront les magistrats.
Quant au texte civil, c’est-à-dire l’article L. 336-1 du Code de la propriété
intellectuelle, il dispose que « lorsqu’un logiciel est principalement utilisé pour
la mise à disposition illicite d’œuvres ou d’objets protégés par un droit de propriété
littéraire et artistique, le président du tribunal de grande instance, statuant en
référé, peut ordonner sous astreinte toutes mesures nécessaires à la protection de
ce droit et conformes à l’état de l’art ». Il ne vise pas à engager la responsabilité
de l’éditeur de logiciels mais plutôt à le responsabiliser. Le texte utilise ici
l’adverbe « principalement ». Il est possible de s’interroger à nouveau sur
le sens à lui donner. Se distingue-t-il de l’adverbe « manifestement » utilisé
au pénal ? Le caractère d’évidence n’est pas en jeu en l’espèce. Le juge doit
apprécier l’usage qui est fait du logiciel. L’usage est le fait des internautes,
c’est pourquoi la responsabilité de l’éditeur ne peut pas être engagée sur ce
47. Y. Gaubiac, « La responsabilité des fournisseurs de logiciels dans la diffusion illégale des
œuvres et autres prestations protégées », art. préc., p. 41.
63revue internationale du droit d’auteur
fondement. En revanche, le juge des référés peut lui ordonner de prendre des
mesures pour limiter ou empêcher les atteintes : « le législateur, sans freiner
l’industrie du logiciel, incite indirectement les éditeurs à mettre en place des mesures
techniques afin de prévenir ou de limiter l’activité de contrefaçon réalisée grâce à
leurs logiciels »48. Le législateur fait donc le choix de la responsabilisation en
matière civile. Il adopte la même logique pour les intermédiaires techniques.
B. L’irresponsabilité conditionnelle des intermédiaires techniques
Les législateurs européen et français ont écarté la logique du tout ou rien
dénoncée par le professeur Michel Vivant49, en adoptant un régime spécial de
responsabilité consacré aux intermédiaires techniques. La directive du 8 juin
2000 et la loi du 21 juin 2004 la transposant ne sont pourtant pas dédiées à
régir des questions de droit d’auteur et de droits voisins. La première est relative
au commerce électronique50 et la seconde à l’économie numérique51. Ainsi
la question de la responsabilité des intermédiaires est envisagée de manière
« transversale »52, elle ne traite pas uniquement des atteintes aux droits de
propriété littéraire et artistique, mais de toutes celles susceptibles d’intervenir
par le biais de ces services. La particularité du régime des intermédiaires
techniques tient dans son appréhension négative, c’est-à-dire que, par principe,
48. B. Gorchs, « Vers un référé de l’Internet autonome », art. préc., n° 16.
49. M. Vivant, « La responsabilité des intermédiaires de l’Internet », art. préc., p. 2021 :
« l’irresponsabilité de principe est inadmissible non seulement d’un point de vue juridique mais
encore d’un point de vue éthique comme sociétale. Mais la responsabilité “mécanique”, “par défaut”,
pour la raison qu’il faut bien trouver un responsable, et lors même que le présumé responsable n’en
pourrait mais, l’est tout autant. Il faut rechercher, non point un improbable juste milieu, mais une
réponse “de raison” ».
50. Directive commerce électronique du 8 juin 2000, préc.
51. Loi LCEN du 21 juin 2004 préc.
52. L. Marino, op. cit., n° 60, p. 134.
64Vous pouvez aussi lire