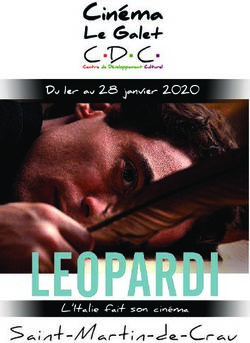LE DIABLE AU CINÉMA Richard Millet - S atan hante la pellicule comme il règne sur ce monde - Revue Des Deux Mondes
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
LE DIABLE AU CINÉMA
› Richard Millet
S atan hante la pellicule comme il règne sur ce monde.
Les titres parlent d’eux-mêmes ; mais que nomment-
ils, ces mots de diable, démon, prince des ténèbres,
ou encore Satan, à une époque où les langues perdent
le sens du réel ? Eh bien le diable en personne. Le
cinéma est avant tout un art du temps ; en cela il est aussi bien placé
que le roman pour évoquer le démon, jouer avec le système d’illusions
que ce dernier met en place, et atteindre ainsi la vérité du mal.
J’évoquerai ici une quinzaine de films dans lesquels le diable est
présent, directement ou en miroir. Il est vrai que c’est un bon client
cinématographique et qu’il suscite autant de vocations que de films
médiocres, « sataniques », qu’on s’empressera d’oublier. À trop jouer
sur les mots, on risque de se laisser prendre au piège, oubliant que
Satan gît dans les détails et que sa ruse suprême est de nous persua-
der qu’il n’existe pas, ou n’est jamais où on l’attend, ni tel qu’on se le
représente. Précisons que l’auteur de ces lignes, catholique, croit fer-
mement à son existence, en dépit du ton qu’il emprunte ici.
Commençons par deux films qui, annonçant la couleur, montrent
le diable en chair et en os : Sous le soleil de Satan, de Maurice Pia-
lat (1987), d’après Georges Bernanos, le fait apparaître sous les traits
88 JUIN 2018quoi de neuf ? le diable !
d’un maquignon qui rencontre, dans une campagne nocturne, l’abbé
Donissan en train de traverser, lui, une nuit de Gethsémani : scène
saisissante, sans doute la plus admirable de la représentation cinéma-
tographique du démon. Comment, après ce combat entre le démon et
le saint, prendre au sérieux un film tel que l’Associé du diable, tourné
en 1997 par Taylor Hackford, et dans lequel Al Pacino, patron d’un
puissant cabinet d’avocats, pourrait bien être le diable en personne,
et tourmente une jeune et brillante recrue
Richard Millet est écrivain et
(Keanu Reeves) ? Ce film obéit autant au éditeur. Derniers ouvrages publiés :
fantastique qu’à une allégorie faustienne Déchristianisation de la littérature
– le drame de Goethe ayant déjà été revisité et Journal (1971-1994) (Léo Scheer,
par René Clair, en 1950, dans la Beauté du 2018).
diable, où Gérard Philipe prête ses traits à Méphistophélès, Faust étant
incarné par Michel Simon. Dans l’Œil du diable d’Ingmar Bergman
(1960), c’est Don Juan que Satan va chercher en enfer pour l’envoyer
séduire sur terre une belle jeune fille : une comédie que Bergman
détestait et sans grand intérêt, en effet, après laquelle celui qui avait
fait dialoguer le chevalier et la Mort, dans le Septième Sceau, tournera
la Source qui interroge radicalement l’innocence et le mal. On peut
aussi mettre dans le même sac les Visiteurs du soir, film médiéval de
Marcel Carné (1942), et parabole de l’Occupation allemande bien
plus qu’interrogation sur le mal à l’état pur : le diable y a les traits du
génial Jules Berry qui, à cause du brillant scénario de l’athée Prévert,
semble un docteur Knock de la maladie d’amour.
Rien de bien neuf, donc, sous le soleil satanique, avec ces trois der-
niers films : le diable est séduisant, ou inquiétant, toujours suggestif,
allant même jusqu’à s’habiller en Prada, selon le titre d’une comédie
qui n’a rien de diabolique ; seule sa banalité, chez Pialat, touche vrai-
ment à la question du mal, que Joseph de Maistre appelait une « héré-
sie de l’Être ». C’est que le diable, au cinéma comme en littérature,
et même en peinture, est une affaire avant tout catholique. Le mal est
en l’homme même, par le péché originel, ce qui empêche le diable
d’être une affaire allégorique ou psychologique ; il n’est pas non plus
soluble dans les neuroleptiques ni dans les bons sentiments – ces der-
niers étant une autre ruse de Satan.
JUIN 2018 89quoi de neuf ? le diable !
Est-il plus redoutable, lorsqu’il fait vraiment peur, au cinéma ? Il
faut en revenir à Hollywood, où se fabrique la version spectaculaire,
donc la plus admissible, du démoniaque. Comment accepter le cliché ?
Celui-ci n’est-il pas encore une ruse du démon ? On ne s’attardera pas à
ces fourriers du diable que sont les vampires : Friedrich Wilhelm Mur-
nau avait génialement donné le ton, en 1922, dans son Nosferatu, muet
mais terriblement éloquent – et auquel tous les autres films de vampires
rendront hommage, parfois magnifiquement, depuis Carl Theodor
Dreyer (Vampyr, 1932) jusqu’à Werner Herzog (Nosferatu, le fantôme
de la nuit, 1979), de Tod Browning (Dracula, 1931) au médiocre Dra-
cula de Francis Ford Coppola (1992) et à l’inquiétant Entretien avec un
vampire de Neil Jordan (1994). Les vampires, Dracula en tête, sont trop
enfermés dans leur mythe pour ne pas voler la vedette à Satan, qui ne
peut les considérer que d’un mauvais œil. Quant aux sous-genres du
film d’épouvante et du film d’horreur, ils ne nous concernent pas, car
relevant du divertissement à bas prix, en dépit de réussites telles que
Carrie (Brian DePalma, 1976), Silent Hill (Christophe Gans, 2006) ou
l’Orphelinat (Juan Antonio Bayona, 2007).
C’est au prince de ce monde qu’on voudrait aller directement ;
il ne se laisse pas approcher : c’est lui qui vient, surtout si on ne s’y
attend pas. Aussi ne s’attardera-t-on pas davantage aux histoires de
fantômes, de morts-vivants, de sorcières, bien que les âmes en peine
soient souvent la proie du démon. Certains films de sorcières sont
cependant exemplaires comme la Sorcellerie à travers les âges, du Danois
Benjamin Christensen (1922), ou l’angoissant Projet Blair Witch de
Daniel Myrick et Eduardo Sanchez (1999). Les morts-vivants et les
zombis constituent, eux, la version « moderne », et souvent gore, des
fantômes, sauf si on les considère comme des symboles déchus de
la société de consommation, comme dans la Nuit des morts-vivants
(1968) ou Dawn of the Dead (1978) de George A. Romero. Les purs
fantômes nous en disent davantage, parce qu’ils restent le plus souvent
invisibles, comme dans la Maison du diable, beau film de Robert Wise
(1963), dont le titre original est, plus justement, The Haunting : il met
en scène un savant qui réunit quelques témoins pour passer quelques
jours dans une maison réputée hantée. Les certitudes rationalistes
90 JUIN 2018le diable au cinéma
seront bientôt battues en brèche, le film montrant la dimension pos-
sessive non seulement de l’esprit qui hante, mais aussi de la maison,
personnage à part entière, tout comme l’hôtel solitaire de Shining
(Stanley Kubrick, 1980) – ce que retiendront, en 1979, l’excessif Ami-
tyville de Stuart Rosenberg et ses suites ; et il faudra attendre les Autres
(Alejandro Amenábar, 2001) et Paranormal activity (Oren Peli, 2007)
pour que les maisons soient vraiment rendues à l’inquiétante étrangeté
du surnaturel.
Les certitudes de la société de consommation et du progrès volent
en éclats. Et si Roman Polanski parodie, en 1967, le mythe de Dracula
avec le Bal des vampires, où joue sa jeune épouse, Sharon Tate, celle-ci
sera assassinée, deux ans plus tard, par les séides de Charles Man-
son, vrai suppôt de Satan. Un hasard ? Nullement : l’année suivante
sort Rosemary’s Baby, du même Polanski, récit de l’insémination d’une
jeune femme par le démon lui-même, avec l’aide de son propre mari
et d’affidés à Satan, en plein New York. Film admirable, qui en dit
long sur l’envoûtement des sociétés modernes, et la fin des illusions
amoureuses.
Cinq ans plus tard, il s’agit d’exorciser le démon. On en revient
au catholicisme, avec l’Exorciste, pour lequel William Friedkin
convoque notamment Max von Sydow, vieux routier des hantises
bergmaniennes, et ici prêtre exorciste, qui déloge l’affaire du plan
psychiatrique où l’Église elle-même a installé Satan, comme pour le
mettre sous le tapis. Il est bel et bien question de possession, dans
ce film outrancier, spectaculaire, mais qui a le mérite d’en revenir à
l’abjection du mal, au pouvoir d’envoûtement et de dé-spiritualisa-
tion que les sociétés modernes exercent sur l’homme, selon Antonin
Artaud et Georges Bernanos. Tout se passe comme si le cinéma nous
rappelait ce que l’Église rechigne à nommer. Pourtant, le diable ne
se chasse pas aisément : le Prince des ténèbres de John Carpenter
convoque, en 1987, les puissances de l’Église et de la science, en
envoyant des scientifiques et un prêtre examiner, dans une église
abandonnée de Los Angeles, un cylindre contenant un liquide plein
de semence satanique… Satan apparaît ici en ombre terrifiante, bou-
leversant l’ordre même du temps. Satan et sa progéniture hantent
JUIN 2018 91quoi de neuf ? le diable !
donc le monde, tout comme l’antéchrist, nous rappelle aussi la
Malédiction de Richard Donner, sorti en 1976, et qui reprend le
thème de l’innocence enfantine investie par le démon.
Qu’as-tu fait de ton âme ? Pourras-tu te laisser intoxiquer jusqu’à
ta mort ? Ne veux-tu pas jeter aux orties la notion de bien et nous
rejoindre dans la jouissance du présent ?, semblent murmurer tous ces
films, même lorsque le diable n’est qu’un nom dans le titre. Dans le
Diable probablement (1977), Robert Bresson met en scène un groupe
de jeunes gens révoltés par le monde contemporain, notamment par
le désastre écologique ; le monde est l’envers fangeux du paradis, et
l’homme s’y damne sans que l’Église (qui joue ici un rôle impor-
tant) affronte sérieusement le mal, suggère le janséniste Bresson en
conduisant un de ses personnages à la mort. « Qui nous manœuvre en
douce ? », demande l’un d’eux, dans un autobus. « Le diable, proba-
blement », répond un passager ; probabilité qui a valeur de certitude
plus que d’hypothèse, dans ce film qui se moque de la psychiatrie et de
la psychanalyse : le diable est ce qui surgit quand toutes les solutions
ont été épuisées ; qu’on lui cède est une autre affaire.
Autre film remarquable : le Tango de Satan, du Hongrois Béla Tarr,
sorti en 1994. Tourné en noir et blanc, ce film-fleuve (450 minutes) met
en scène un groupe de gens survivant dans une ferme perdue de Hon-
grie. Ils attendent la venue d’on ne sait quoi : Messie ou Satan – plus
vraisemblablement Satan. Allégorie de la fin du communisme, et de
l’entrée dans le faux paradis capitaliste ? Sans doute ; mais surtout
méditation sur ce que Pierre-Jean Jouve appelait « le monde désert » :
la catastrophe écologique se double d’une catastrophe spirituelle et
intellectuelle qui pourrait bien préfigurer la fin de l’espèce humaine,
comme le suggèrent aussi les films de Lars von Trier, Antichrist (2009)
et Melancholia (2011), qui, comme les autres, nous montrent l’état de
notre âme en un monde où Satan ne cesse d’étendre ses sortilèges et
son ombre.
92 JUIN 2018Vous pouvez aussi lire