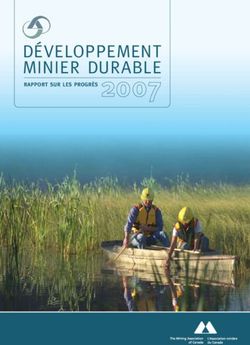" le dieu mourant revient pour son vendredi saint " : la dialectique du Vivant et du Mourant dans le discours poétique des chansons de H.F. Thiéfaine
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
“ le dieu mourant revient pour son vendredi saint ” : la
dialectique du Vivant et du Mourant dans le discours
poétique des chansons de H.F. Thiéfaine
Françoise Salvan-Renucci
To cite this version:
Françoise Salvan-Renucci. “ le dieu mourant revient pour son vendredi saint ” : la dialectique du
Vivant et du Mourant dans le discours poétique des chansons de H.F. Thiéfaine. Le Vivant-Mourant,
A paraître. �hal-03834644�
HAL Id: hal-03834644
https://hal.science/hal-03834644
Submitted on 30 Oct 2022
HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents
entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de
teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires
abroad, or from public or private research centers. publics ou privés.
Copyright« le dieu mourant revient pour son vendredi saint » : la dialectique du Vivant et du Mourant
dans le discours poétique des chansons de H.F. Thiéfaine
Françoise Salvan-Renucci, CTEL, Université Côte d’Azur
« sur le marché des morts-vivants »
Le « vive la mort ! » par lequel se clôt le texte de « alligators 427 » pourrait à maints égards
servir d’exergue symbolique à l’ensemble des textes de H.F. Thiéfaine – à condition toutefois
qu’en soient pleinement appréhendées la complexité polysémique et la richesse de connotations
dont la perception est souvent obérée par la dimension de provocation spectaculaire qui émane
tant de la formule elle-même que de son arrière-plan historico-politique. Abstraction faite de
l’approfondissement et/ou de l’élargissement remarquable de la notion de « mort » apportée par
l’identification des strates implicites d’un tel énoncé, sa fonction centrale réside dans sa valeur
signalétique d’indicateur d’une prééminence quasi absolue de la mort, telle qu’elle s’installe
précisément au niveau des processus discursifs indépendamment des démentis ou
infléchissements sémantiques qui s’y superposent de façon incessante au gré des entrelacements
sous-jacents mis en place par la dynamique de l’expression multivoque.
Inverser un tel postulat discursif relève ici de l’impossibilité pure – si l’on s’en tient du moins
comme précisé auparavant à l’examen des textes ainsi qu’au prolongement de ce dernier qu’est
l’établissement de la « cartographie » de ce que Henry Miller nomme le « paysage intime1 »
d’un auteur –, ce qui ne signifie nullement que la sphère de la vie n’a pas sa place dans le corpus
thiéfainien ou que celle de la mort vient systématiquement la réduire à néant. Sans préjudice
des diverses possibilités de réaccentuation déductibles de la sollicitation du halo associatif tant
dans sa composante intertextuelle que dans celle relevant du plurilinguisme ou de l’histoire de
la langue, il s’agit d’abord de constater que le discours explicite des chansons, à travers les
choix lexicaux qu’il opère, place la vie en net retrait par rapport à la mort, le Vivant en
infériorité quantitative par rapport au Mourant. Le « Vivant » en tant que tel – en tant qu’entité
autonome dégagée de la référence au statut complémentaire et antagoniste du Mourant ou du
mort – est d’ailleurs totalement absent du corpus des chansons où il ne se présente qu’en
association avec le mort, pour ne pas dire en coexistence permanente et indépassable ainsi que
l’établissent de manière emblématique les variations finales du refrain de « 24 heures dans la
nuit d’un faune » ajoutant à la version initiale « si les morts s’amusaient autant que les vivants »
les déclinaisons successives « si les morts s’ennuyaient autant que les vivants » et enfin « si les
morts se sentaient aussi seuls que les vvants ». On complétera cet inventaire inaugural – et
délibérément axé sur le seul discours de surface – par la mention de l’alliance étroite entre les
deux modes de « présence » ou d’« existence » représentée par les notions binaires de « morts-
vivants » ou de « morts-nés », telles qu’elles apparaissent respectivement dans « petit matin
4.10 heure d’été » avec le double recours aux termes composés offert par la strophe « je n’ai
plus rien à exposer / dans la galerie des sentiments / je laisse ma place aux nouveaux-nés / sur
le marché des morts-vivants » ou dans « exil sur planète-fantôme » avec l’aveu rétrospectif
« nous étions les danseurs d’un monde à l’agonie / en même temps que fantômes conscients
d’être morts-nés ».
« regarde maman, je vole ! »
Le fonctionnement spécifique du discours thiéfainien et la simultanéité d’appartenance aux
deux univers de la mort et de la vie qu’il expose dictent ainsi d’emblée les modalités d’analyse
de la dialectique du Vivant et du Mourant telle qu’elle fait l’objet des présentes réflexions :
davantage qu’une succession temporelle opposant à une montée couronnée par une akmè une
1
Henry Miller, Le temps des assassins. Essai sur Rimbaud, traduit de l’américain par F.J. Temple, Paris, P.J.
Oswald, 1971, p. 139.descente menant à l’équivalent d’une agonie, c’est l’intrication étroite et constante des deux
mouvements contradictoires qui s’accomplit en permanence au sein de l’écriture multivoque,
invitant à une retranscription au plus près des mouvements ascendants et descendants ainsi que
de leurs conséquences respectives. Dans la mesure où l’élan ascensionnel caractéristique de
« mes envolées d’atlante » a cependant toute sa place dans le corpus des chansons en dépit de
la complexité née de sa faculté de « métamorphose » constante, il semble indiqué de le choisir
pour point de départ du parcours proposé ici précisément parce que l’évidence explicite de la
verbalisation semble a priori faire obstacle à toute diversification voire inversion sémantique,
dont l’appréhension relève pourtant de la même immédiateté une fois identifiés les présupposés
de réaccentuation. S’il faut signaler au préalable l’existence de très rares configurations basées
sur une véritable succession de l’élan ascensionnel et de la retombée inéluctable – plutôt que
sur la simultanéité multidirectionnelle qui prévaut dans la quasi-totalité des évocations relevant
de la double accentuation qui nous occupe –, il est tout aussi impératif de préciser d’emblée que
les courbes temporelles correspondant à un tel cas enferment les deux étapes dans un arc étroit
où l’acheminement vers la mort voire la survenue sans délai de celle-ci vient immédiatement
relayer l’amorce initiale d’affirmation de la vie. Alors que le seul titre des « variations autour
du complexe d’icare » laisse d’emblée pressentir l’issue fatale qui fait suite aux exclamations
extasiées « le tapis s’envole » et « regarde maman, je vole » avant d’être résumée par les mots
« adieu maman », le processus discursif du texte – qui prend racine dans le vécu « tristement
quotidien » – pour reprendre la formule de « crépuscule-transfert » – d’un enfant maltraité à
l’école et incorpore au passage un renvoi direct au Complexe d’Icare d’Erica Jong – s’élève
pour sa part à un niveau d’évocation d’abord insoupçonné en renouvelant point par point la
constellation finale de l’acte III du Second Faust où Euphorion, l’enfant issu de l’union de Faust
et Hélène, trouve le même type de mort prématurée après son envol enthousiaste où il incite ses
parents à admirer son audace, sa chute étant ensuite ponctuée par la plainte horrifiée « Ikarus !
Ikarus ! Jammer genug !2 » (« Icare ! Icare ! Quel malheur ! ») qui s’échappe des lèvres de
Faust et rompt définitivement l’enchantement de l’excursion dans l’Antiquité. La brève
élévation censée exprimer le triomphe d’un élan vital juvénile trouve une fin brutale et mortelle
calquée dans les deux cas sur le modèle du mythe d’Icare, dont la tradition retient précisément
avant tout la chute du haut du firmament et souligne avant tout l’imprudence qui le porte à
négliger les avertissements de son père. L’échec programmé de la tentative initiée par le
protagoniste de la chanson – et dans laquelle le tapis volant des Mille et Une Nuits remplace les
ailes fixées par de la cire du récit antique – est par ailleurs inscrit à l’avance dans la dimension
fantasmée des événements telle qu’elle est établie par le seul enchaînement discursif, qui fait
littéralement surgir le tapis du glissement acoustico-sémantique « ils m’ont encore battu » / « tu
bats le tapis » / « je suis sur le tapis », le voyage dans les airs dévoilant ainsi sa fonction
première de fuite ou de recherche d’un refuge face aux « violents tourments » subis par le
personnage. L’élément relevant du Vivant bascule ainsi brutalement dans la dimension opposée
sans avoir pu réellement s’épanouir comme tel, la double voire triple réappropriation
mythologico-littéraire soulignant de son côté l’inéluctabilité de l’anéantissement et le primat
incontesté de la mort.
La présence récurrente du Mourant dans le processus de l’envol trouve également une
traduction spécifique dans le recours à l’évocation d’un trajet en avion en tant qu’expression de
l’expérience de mort, ainsi que le donne à lire le texte de « sentiments numériques revisités » à
travers l’énumération de sites archéologiques opérée dans la séquence « quand les théâtres
antiques recèlent nos orgies / çatal hoyük airport manco capac city » : la nécropole de Çatal
Hoyük, qui doit d’abord sa célébrité à la position semblant simuler un envol dans laquelle sont
placés les défunts, se voit non seulement assimilée à un aéroport, mais littéralement intégrée
2
Johann Wolfgang von Goethe, Faust. Der Tragödie zweiter Teil, Stuttgart, Cotta, 1832, p. 242.dans le trafic international actuel à travers le choix de la désignation anglaise, dans un raccourci historique qui ramène au schéma commun de l’aspiration à une verticalité transcendante l’attitude de l’humain face à la mort telle qu’elle s’est manifestée de l’époque archaïque à nos jours. Dans une double inversion des modalités qui régissent la présentation habituelle du passage du Vivant au Mourant, l’envol incarne à la fois la signature visuelle du Mourant et le désir d’une élévation devenant synonyme de l’accession à un niveau supérieur d’existence, la focalisation exclusive sur la dimension funéraire ou l’adhésion à l’image d’une réhabilitation in extremis du Vivant étant laissées à la libre appréciation du lecteur. La situation du voyageur aérien sert également de support à la description des instants ultimes du protagoniste de « 542 lunes & 7 jours environ » anticipant sa fin dans les vers « & je me vois déjà guignol au p’tit matin / traînant mon vieux flightcase dans le cimetière des chiens ». Le seul terme de « flightcase » – l’anglicisme en tant qu’emprunt à la koinè de l’époque actuelle témoignant à nouveau de l’universalité de l’expérience – suffit à créer le décor d’un aéroport accueillant le passager en partance, le dévoilement immédiat de la véritable nature du lieu de départ créant une désillusion brutale que vient cependant tempérer la reconnaissance de la fonction symbolique du « cimetière des chiens ». Si le lieu de sépulture choisi par le protagoniste semble tout d’abord le réduire au statut d’un animal, il est également le signe de son affinité avec Diogène – précisément nommé le Cynique en écho à sa référence récurrente au chien comme modèle de son comportement – dont le souhait d’être enterré dans le cimetière des chiens reflète la cohérence intransigeante de son parcours philosophique. C’est donc bien en tant que nouvel avatar de Diogène – tel qu’il apparaît déjà dans Meteo für nada avec l’hommage multivoque que rend au philosophe le texte de « diogène série 87 » – que le personnage achève son itinéraire terrestre, sans préjudice de la continuation qu’il peut trouver grâce au « flightcase » susceptible de devenir l’instrument de son envol, dont la nature reste encore à préciser du fait qu’elle dépend directement de la lecture alternative que l’on peut faire du « cimetière », entraînant alors ipso facto la réévaluation radicale du motif des « chiens ». (Rappelons que le tout premier spectacle de l’auteur avait pour intitulé Comme un chien dans un cimetière – titre qui est aussi celui d’une chanson de l’album de 1980 De l’amour, de l’art ou du cochon ? –, révélant l’importance dévolue depuis toujours au « cimetière » dans l’organisation du discours polysémique.) Le recours au sens étymologique dicté par le terme grec – lui- même dérivé de , « sommeil profond », qui prend ensuite un sens étroit et spécifique dans le français « coma » – fait d’abord du « cimetière » un « lieu où l’on dort », le rendant ainsi propre à être utilisé comme lieu du rapprochement sexuel, auquel les « chiens » s’adonnent par définition sans retenue. L’élévation à laquelle accède ainsi le « guignol » est ainsi susceptible de relever de l’élan vital par excellence qu’est l’hommage physique rendu à l’Éros, introduisant l’expression achevée du Vivant dans ce qui est supposé être le domaine exclusif de la mort. Sans déboucher pour autant sur une véritable « annihilation » du protagoniste, la spectaculaire dynamique ascensionnelle de « nyctalopus airline », rythmée au plan du texte par la répétition incantatoire de « je flye » et magnifiée au niveau musical par la montée à l’intensité saisissante conçue sur le modèle du prélude de Lohengrin, est elle aussi doublement contrecarrée tant au niveau des processus verbaux que par le déroulement musical, instaurant un statu quo créateur d’un équilibre à la fois précaire et sans cesse renouvelé entre la tendance ascendante et la plongée dans les profondeurs. 3 En ce qui concerne l’agencement discursif, l’équivoque entre les deux orientations opposées – soit la culmination jubilatoire in excelsis et l’immersion au plus profond d’un inconnu éventuellement mortel – imprègne la totalité des constituants verbaux de bout en bout des deux strophes, qu’il s’agisse du « scaphandre » qui peut aussi bien équiper le « cosmonaute en transfert » que le plongeur qui a « coulé dans [s]on bathyscaphe » 3 cf. Françoise Salvan-Renucci, « “quand la fée aux yeux de lézard" : l’absinthe et ses équivalents dans le discours poétique des chansons de H.F. Thiéfaine », L ‘Actualité Verlaine, Metz, 2018.
ou de la redéfinition de la quête de l’Atlantide que la séquence « je flye vers la doulce atlantide / allumée dans mes courants d’air » transpose dans des hauteurs éthérées. La disposition musicale comme calquée sur celle de la composition wagnérienne fait suivre l’apogée atteinte à la fin de chaque strophe par une « redescente » qui constitue le symétrique inversé de la montée initiale, les deux processus concernant aussi bien le champ de l’ambitus – allant du grave à l’aigu puis à nouveau de l’aigu au grave – que celui de la dynamique, qui met en place un crescendo ininterrompu à partir d’un pianissimo à peine inaudible avant de retourner par paliers à celui-ci à partir du fortissimo atteint en fin de strophe. L’intégration de séquences de bruitage inspirées des théories de John Cage – et placées respectivement au tout début et à la toute fin du texte – encadre la succession du crescendo et du decrescendo en soulignant l’ancrage de l’expérience initiatique – et/ou hallucinatoire – dans la trivialité des conversations de bar, tandis que le retour final à cette dernière réduit a posteriori le déploiement intensif de l’expressivité musicale – et avec lui le foisonnement visionnaire qui lui correspond – à une parenthèse dénuée d’importance voire de toute réalité tangible. Les autres déclinaisons du « je flye » rencontrées dans le corpus des chansons sont dotées d’une ambivalence d’autant plus prégnante qu’à la différence tant du trop bref envol icarien que de la révélation vécue « dans la nuit des villes sans lumière », elles reposent sur l’intégration plus ou moins explicite de la composante mortifère au cœur même de la formulation renvoyant au processus d’ascension. L’intrication des accentuations antagonistes s’effectue par ailleurs sur le mode complexe d’une affirmation-invalidation dans laquelle le constat de surface – et donc la base du processus de redéfinition sous-jacente – installe alternativement la vie ou la mort au centre de l’évocation, tandis que la dimension contraire reçoit alors en partage le niveau des possibilités exégétiques latentes, telles qu’elle viennent modifier et/ou inverser la perception première de la situation. L’occultation du Vivant au profit manifeste du Mourant semble ainsi relever de l’évidence immédiate dans le distique « y’a toujours un pigeon qui s’envole en fumée / dans les couloirs visqueux d’un vieux rêve-agonie » évocateur de l’atmosphère délétère du « cabaret sainte lilith ». La lecture familière et argotique du « pigeon » – telle qu’elle réapparaît dans la « méthode de dissection du pigeon à zone-la-ville » sur laquelle on reviendra dans le cours ultérieur de ces lignes et dont la séquence citée constitue en quelque sorte le noyau de départ –, jointe à l’emploi figuré du verbe au sein de l’expression imagée suscite d’emblée la représentation d’une reductio ad nihilum également confirmée par la mention finale du « rêve- agonie », l’épithète « visqueux » – a priori négative et peu engageante – renforçant le caractère sordide de la situation alors même que l’anéantissement peut aussi bien être appréhendé comme réel que comme symbolique, recouvrant alors l’idée du « pigeon plumé » dans le local interlope. L’éventualité complémentaire d’une relecture sous le signe du Vivant est cependant tout aussi incontestable que l’imbrication étroite de celle-ci dans le processus même de l’« agonie » dont la mention au plan explicite déclenche le basculement vers un domaine dont la sollicitation s’avère d’autant plus évidente qu’il appartient par définition au monde du « cabaret sainte lilith », à savoir celui de l’Éros considéré d’abord sous l’angle de ses manifestations physiques. Tant le sens étymologique renvoyant au grec – et à travers ce dernier à un combat ou une lutte – que la localisation du combat en question « dans les couloirs visqueux » font ici surgir l’image d’un corps-à-corps sexuel et plus précisément des processus impliquant la pénétration du corps de la femme, générant ainsi une lecture alternative de l’« agonie » dont la cohérence du discours thiéfainien autorise voire impose l’application à l’ensemble des occurrences du terme ou de ses dérivés présentes dans le corpus des chansons, ainsi qu’on se propose d’en apporter la démonstration dans la suite immédiate de ces lignes (notons au préalable que si le postulat d’une lecture multiple a valeur d’axiome exégétique aussi absolu qu’incontournable pour l’approche phénoménologique du discours thiéfainien développée par nos soins depuis dix ans, c’est précisément parce qu’il permet seul de couvrir le spectre entier des accentuations repérables dans telle ou telle séquence, rien n’obligeant par contre l’auditeur-lecteur à trancher
entre les différentes options même si l’on ne saurait dénier l’intérêt de leur perception et
l’enrichissement notable qu’elle apporte à l’appréhension du texte). Signe de la complexité
redoublée de l’écriture multivoque et de la permanence des oscillations sémantiques qui en
découle, créant un va-et-vient sans fin entre les deux pôles exégétiques, la réhabilitation du
Vivant apportée par la redéfinition érotico-sexuelle de l’« agonie » va immédiatement de pair
avec un nouveau déplacement du curseur en direction du domaine du Mourant, dans la mesure
où – sur le modèle de l’expression familière assimilant l’accomplissement sexuel à une « petite
mort » – le relâchement corporel qui suit le moment de la culmination touche ne fût-ce que de
façon symbolique aux frontières de la mort. Ajoutons que l’élargissement du halo associatif à
l’univers de l’onirisme et du fantasme, tel que l’apporte la formulation composée « rêve-
agonie », est aussi susceptible d’être rapporté aux expressions de la vie qu’à leurs corollaires
associés à la mort, tandis que l’épithète « vieux » témoigne à la fois du caractère atavico-
archétypique du phénomène et de la tension sémantique sous-jacente qui se dessine entre les
connotations opposées évocatrices aussi bien d’un caractère obsolète ou périmé – et donc
tendant irrévocablement vers la mort – que d’une permanence touchant à l’éternel – et donc
rejoignant les incarnations de la vie. S’agissant là aussi d’une constante du discours poétique
de l’auteur, on tient à signaler que la polysémie de l’adjectif « vieux » est à considérer comme
partie intégrante de chacun des énoncés où il figure, bien qu’à la différence de celle concernant
l’« agonie » il ne puisse être envisageable de la détailler dans le cadre de la présente
contribution.
« sur l’autel des agonisants »
Avant d’aller plus avant dans l’exploration du sens multiple de l’envol et de son appartenance
simultanée au Vivant et au Mourant, on profite de l’occasion offerte par l’analyse des vers de
« cabaret sainte lilith » pour intercaler ici un regard sur la polysémie de l’agonie qui constitue
à plus d’un titre le symétrique inversé de l’envol, dans la mesure où sa proximité évidente avec
le Mourant semble exclure a priori toute possibilité de rattachement au domaine du Vivant. On
constate cependant qu’ainsi qu’on l’a indiqué sur le mode de la généralisation, la réaccentuation
décrite précédemment est applicable dans son principe à toute séquence faisant intervenir le
vocable « agonie », dont la relation latente mais incessante avec le Vivant vient contrebalancer
son identification première en tant que réalisation privilégiée du Mourant. Les vers « l’ange a
léché le chimpanzé / sur l’autel des agonisants » installent ainsi le discours explicite de « exit
to chatagoune-goune » dans un cadre d’appréhension métaphysico-eschatologique que que ne
renierait sans doute pas Pascal, et à travers lequel la perception de la nature hybride de l’humain
– identifiée comme relevant à la fois de l’animal et du divin quelle que soit la répartition des
rôles entre les figures concernées – coïncide de façon naturelle avec l’accomplissement d’un
rituel dont le lieu apparaît lui-même évocateur d’un sacrifice. La formule verbale « a léché »
devient alors de par son caractère inattendu – qui en fait pratiquement un corps étranger dans
le contexte soutenu du discours explicite – le support initial de la redéfinition sous-jacente qui
met d’abord en pleine lumière la dimension à la fois sexuelle et animale du rapprochement entre
« ange » et « chimpanzé » – qu’on peut définir comme la belle et la bête – avant d’apporter une
élucidation du même ordre à la seconde partie du vers, dans laquelle la connotation religieuse
qui caractérise « l’autel des agonisants » laisse la place à l’évocation du corps-à-corps sexuel à
travers le recours au sens le plus général de l’original grec , tandis que « l’autel » qui les
accueille à la façon d’un lit rejoint le « catalogue » de « errer humanum est » – derrière lequel
se dessine le sens premier du verbe grec , soit « (se) coucher » – ou la substitution
homophonique du détournement nervalien « mais le dieu manque à cet hôtel / où je dois jouer
les victimes 4 ». La relecture concrète et imagée de « l’autel » n’occulte cependant nullement
4
Gérard de Nerval, « le dieux manque à l’autel, où je suis la victime… », Le Christ aux Oliviers, in Les Chimèresson acception usuelle qui témoigne alors de la sacralité inhérente à l’Éros jusque dans sa dimension physique, la scène prenant alors les dimensions d’une hiérogamie symbolique destinée à célébrer la plénitude du Vivant. La double inversion s’établit ainsi comme norme structurelle de l’écriture multivoque, la crudité ou l’obscénité devenant l’expression de la révélation divine tandis que la formulation d’inspiration religieuse s’inverse sur le mode de la parodia sacra. La double lecture de l’agonie est tout aussi fructueuse dans « alligators 427 où le vers « je sais que vos mâchoires distillent l’agonie » se révèle tour à tour porteur de deux accentuations opposées ancrées respectivement dans la sphère du Mourant et dans celle du Vivant, l’alternance des options exégétiques relevant en réalité non d’une succession temporelle telle qu’elle est nécessaire à l’exposition des deux offres exégétiques, mais d’une oscillation simultanée qu’il importe de percevoir comme on le ferait d’une polyphonie musicale. Le soulignement de la cruauté propre aux « alligators » concorde en tout point avec leur présentation explicite en tant qu’agents destructeurs, tels que les salue le « moi je vous dis bravo & vive la mort » scandé à la fin de chaque strophe et ainsi que le laisse supposer l’énumération de leurs attributs corporels, des « crocs venimeux & gluants » aux « griffes d’or & de diamants ». La redéfinition érotico-sexuelle de « l’agonie » – que ce soit sous la forme déjà évoquée de l’étreinte physique ou sous celle de la « petite mort » telle qu’elle se révèle sans doute plus appropriée à la constellation du texte – entraîne celle des « mâchoires » devenues au choix l’instrument d’un contact bucco-génital ou le symbole archétypique de la vagina dentata, la jouissance suprême et raffinée – ainsi que l’indique le choix du verbe « distillent » – s’élevant au rang d’expression privilégiée du Vivant dans une inversion radicale du présupposé mortifère établi par le discours explicite. La même double accentuation est décelable dans la séquence « y’aura jamais assez de morphine pour tout le monde / surtout qu’à ce qu’on dit vous aimez faire durer », où le sadisme imputé aux « alligators » tortionnaires se transforme inopinément en stratégie d’étirement temporel destinée à accroître le degré du plaisir, tandis que la « morphine » censée adoucir les douleurs des victimes et/ou amener un décès sans souffrances prend la valeur d’une substance susceptible de générer la vie – renforçant du même coup la dimension sexuelle du processus – à travers le renvoi au dieu grec Morphée, dont la fonction de dieu du sommeil et des songes dérive du sens littéral de son nom signifiant « celui qui crée des formes » (). De même, le « reviens jouir mon amour dans ma bouche-agonie » prononcé par la figure féminine de « lorelei sebasto cha » englobe dans un raccourci synthétique la culmination de l’énergie vitale telle qu’elle caractérise le rapprochement sexuel – incluant là aussi la « petite mort » sur laquelle débouche le contact bucco-génital – et l’intensification de la dynamique de mort qu’incarne par définition la figure de la Lorelei menant à leur perte ses « amants perdus dans la tempête ». L’évocation « des mondes agonisants, des déserts corrompus » dans la deuxième strophe de « Karaganda. Camp 99 » oscille de façon analogue entre évocation apocalyptico-nietzschéenne des « brumes noires sur l’occident, barbares au cœur fondu » et réinterprétation sous l’angle d’un déferlement de la vie et de la sexualité porté par « la chair fétide » – et donc également « féconde » par contamination latente des deux racines latines foet- évoquant la mauvaise odeur (cf. foeteo = sentir mauvais ou foetidus = fétide) et fet- renvoyant au processus de génération (cf. feto = pondre ou fetus = enfantement) – et le « rat décérébré » chez lequel l’exigence de satisfaction physique – le rat endossant son rôle traditionnel et/ou freudien de symbole du pénis – a pris le pas sur le potentiel de réflexion. Le portrait du « matou sénile & pelé » de « villes natales & frenchitude » inclut un regard sur « son agonie si tranquille » dont l’évidence immédiate se voit menacée par la prise en compte du sens figuré et/ou argotique du terme « matou » désignant au choix un homme ardent en amour ou un [1854], Œuvres complètes III, édition publiée sous la direction de Jean Guillaume et Claude Pichois, Paris, Gallimard, 1993, p. 649.
homme entretenu par une femme, le caractère « tranquille » de l’« agonie » renvoyant alors à l’appréhension détendue ete délibérément non problématique de l’existence qui est le fait du personnage en question. Si la formulation « nous étions les danseurs d’un monde à l’agonie » de « exil sur planète-fantôme » – dont on peut noter la parenté avec la séquence de « Karaganda » – accentue la proximité avec le Mourant dans la mesure où elle se poursuit par la précision « en même temps que fantômes conscients d’être morts-nés », elle supporte tout autant une appréhension sous le signe du Vivant précisément à travers la mise en exergue de la thématique de la danse, régulièrement porteuse d’un élan vital d’inspiration nietzschéenne chaque fois qu’elle est sollicitée dans le corpus des chansons. (On choisit ici de ne pas prolonger l’examen de cette thématique, qui a fait l’objet d’une contribution spécifique dans le cadre d’une précédente manifestation scientifique 5). « parfois tu rêves de t’envoler » Le visage de l’envol que présente « crépuscule-transfert » dans la séquence « parfois tu rêves de t’envoler / de mourir par inadvertance » s’articule au plan explicite autour de la confrontation directe d’un constat révélant a priori une aspiration libératrice qu’il est tentant de rattacher aux émanations de la dynamique du Vivant et de la rectification brutale apportée par le second vers par le biais de la substitution de « mourir » à « t’envoler ». Alors que la disposition syntaxique invite à considérer le premier vers et donc le désir d’envol qui s’y exprime comme une simple approximation voire une erreur qu’il convient d’éliminer au plus vite – conception que vient renforcer le contexte général évocateur du siège de Sarajevo –, le plan sous-jacent du discours abandonne la présentation antagoniste et s’élabore au contraire sur la base d’une équivalence voire d’une permutabilité absolue des deux infinitifs, « mourir » devenant non pas le correctif de « s’envoler » mais bel et bien son synonyme en tant qu’expression suprême de l’aspiration à l’élévation dont « s’envoler » représente en ce sens le stade initial et préliminaire. La mort ainsi assimilée à un accomplissement sans égal peut aussi bien conserver sa signification usuelle de terme ultime de la vie – que l’on peut alors s’imaginer suivi de ou coïncidant avec l’accession à une nouvelle dimension de l’existence – que faire l’objet d’une redéfinition sur le mode de l’Éros analogue à celle que l’on vient de réaliser pour les occurrences de l’« agonie » – et donc incluant également l’élément renvoyant à la « petite mort » – et s’effectuant dans le cadre d’une réaccentuation point par point – pour ne pas dire mot à mot – de l’ensemble des constituants énonciatifs, qui se chargent d’une suggestivité nouvelle en tant qu’instruments du rapprochement sexuel ou éléments du décor de celui-ci. La position adoptée par le personnage central, que décrivent avec une précision extrême les vers « tu t’blottis comme un animal / sous les tôles rouillées d’une chrysler », prend une tout autre signification à travers sa métamorphose inattendue en évocation de la dimension animale inhérente à la sexualité – au sens où l’« ombre animale » ou encore la « tristesse animale » post-coitum sont mentionnées à d’autres endroits du corpus des chansons – dans laquelle le corps de la figure masculine se retrouve sous les draps tachés de rouge d’une certaine Chris, ainsi que le dévoile la lecture alternative obtenue par le triple biais de l’activation du sens étymologique renvoyant au latin tabula – pris ici dans son sens dérivé de « plis d’un vêtement (drapé) » –, du rétablissement du terme latin rubigo – qui désigne la couleur rouge et dont dérivent le vocable et le verbe français – et du dévoilement du prénom – devenu lui-même un nom de famille – à l’origine de la marque américaine de voiture. En ajoutant le sens premier de « blottir » reconstitué grâce au rapprochement avec l’allemand médiéval blotzen = « écraser », on parvient à élaborer une représentation exacte de la scène localisée de surcroît « entre une laverie automatique / en train 5 cf. Françoise Salvan-Renucci, « “nous étions les danseurs d’un monde à l’agonie” : la danse comme métaphore de l’existence dans le discours poétique des chansons de H.F. Thiéfaine », in Articuler danse et poème. Enjeux contemporains, textes réunis par Béatrice Bonhomme, Alice Godfroy, Régis Lefort, Joëlle Vellet, Paris, L’Harmattan, 2018, « Thyrse » n° 13.
d’cramer et un bunker », soit respectivement un bordel – utilisé à des fins de décrassage
physiologique – et le sexe d’une femme – couramment appelé « bunker » en mat, l’argot russe –
, tandis que le verbe « cramer » doit sa redéfinition sexuelle au rapprochement avec
« cramouille » que seul légitime la phonétique, l’étymologie étant elle aussi mobilisable en tant
que renvoi aux « feux de l’amour » tels que peut les désigner le latin cremo = « brûler ». Il n'est
pas jusqu’au refrain « l’horreur est humaine, clinique & banale » qui ne confonde dans un même
processus de verbalisation le verdict à la fois cinglant et désabusé formulé au plan explicite à
propos de la folie meurtrière qui se déchaîne autour du protagoniste – scellant ainsi la
dominance sans partage de la dynamique de mort – et son complément sous-jacent qui remet à
l’honneur l’élan vital de l’Éros à travers le retour au vocable latin horror désignant les
« frissons » qui font se dresser les cheveux sur la tête ou les poils sur le corps – signalant ainsi
un profond bouleversement psycho-affectif sans pour autant préjuger du caractère positif ou
négatif de celui-ci –, et dont Goethe fait significativement dire à Faust à propos de leur
équivalent allemand qu’ils sont « la meilleure part de l’humanité » (« Das Schaudern ist der
Menschheit bestes Teil6 »). On assiste également par le même biais de la lecture étymologique
à la réapparition du « lit » obtenue par la substitution à « clinique » de l’adjectif grec
lui-même dérivé du substantif v = « lit », tandis que « banal » retrouve son sens originel
de « commun à tous » – soit à tous les membres de la communauté de vie qu’est le ban
germanique –, tel qu’il est par exemple conservé dans l’appellation de « fours banaux ». Bien
que la place manque pour détailler ici le parallèle aussi serré que constant entre le tableau d’une
désolation-déréliction apparemment sans remède et le puissant contre-chant apporté de bout en
bout de « crépuscule-transfert » par le rappel incessant du Eros über alles qui donne son titre à
l’album de 1988 – détournant le rappel historique du Deutschland über alles et ses connotations
négatives au profit d’une célébration de l’Éros placée entre autres références sous le double
patronage de Goethe et Lucrèce –, il importe au plus haut degré de souligner que chacun des
termes de la chanson – comme cela se vérifie en fait dans pratiquement n’importe quel texte de
l’auteur – supporte une redéfinition analogue à celles dont on vient de donner quelques
exemples, voire invite avec insistance à procéder à celle-ci afin de mettre en lumière l’action
permanente de la dynamique du Vivant – telle qu’elle s’incarne dans le rapport étroit entre
inconscient, langage et sexualité diagnostiqué par Lacan et placé par Thiéfaine au cœur même
de son discours poétique. On ne saurait par ailleurs oublier que l’ambiguïté persistante qui régit
les rapports d’Éros et de Thanatos entre également en œuvre tant dans « crépuscule-transfert »
que dans le reste de la création de l’auteur, la réaccentuation érotico-sexuelle pouvant aisément
dépouiller son caractère d’expression suprême du Vivant pour s’infléchir au contraire en
direction du Mourant dont l’accomplissement de l’Éros représente alors la culmination ultime,
la coexistence simultanée des deux offres exégétiques ne se démentant par ailleurs en aucune
occasion quelle que soit la séquence objet de l’analyse contradictoire.
La supplique à l’adresse des « infinitives voiles qui bercez mes doux rêves » place également
le motif de l’envol au centre des attentes du protagoniste, telles qu’elles se font jour dans le
distique « laissez-moi décharger mes cargos migrateurs / & m’envoler là-bas vers les premières
lueurs ». Dans la mesure où la situation initiale – telle qu’on peut la déduire de la séquence « je
m’en vais ce matin recueillir votre sève / dans l’ambulance tiède qui m’arrache à l’horreur / des
troubles de mon double ivre & blasphémateur » semble placer le texte – notamment à travers
les deux termes-clés « sève » et « ambulance » sous le signe d’un retour à la vie après le danger
mortel représenté par les « troubles », il semble indiqué de reconnaître dans l’envol « vers les
premières lueurs » un signal d’espoir certes encore faible, mais destiné à s’épanouir et à garantir
ainsi le succès promis à la dynamique ascendante du Vivant. Le fait que celle-ci s’enracine dans
l’attraction du Mourant à laquelle elle ne s’« arrache » que de justesse en souligne d’autant plus
6
Johann Wolfgang von Goethe, Faust. Der Tragödie erster Teil, Stuttgart, Cotta, 1808, p. 76.efficacement l’expansion proprement miraculeuse, telle que la signale de façon explicite le « je marcherai sur l’eau » de la dernière strophe. Une telle univocité de façade est cependant loin de faire obstacle au déploiement de la réaccentuation polysémique, à laquelle elle offre tout au contraire un terrain d’action privilégié : alors même qu’elle semble s’amorcer sous les meilleurs auspices, la revalorisation du Vivant contient en effet en elle-même sa propre invalidation, dont les indices sont précisément identiques avec ceux qui confèrent une évidence indéniable à sa constatation initiale. Ce sont d’abord les « premières lueurs » dont il convient de différencier l’appréhension voire de carrément relativiser l’impact libérateur à travers le rétablissement de leur acception latine, les lumina prima désignant pour Horace ou Pline non pas l’aube mais la tombée de la nuit. Parallèlement à l’obscurcissement inattendu qui s’installe au plan implicite, un autre élément du décor apparaît susceptible de donner lieu à deux exégèses antagonistes dont la première accroît l’impact dynamique qui se dessine en faveur du Vivant, tandis que la seconde suscite à elle seule un basculement marqué vers la sphère de la mort. Dans le vers « laissez-moi lâcher prise dans le vent qui se lève » qui précède immédiatement l’expression du désir d’envol, l’oscillation sémantique est aussi évidente qu’indépassable entre la lecture littérale qui fait la part belle à la dimension transcendante voire pneumatique du phénomène – élargissant ainsi le halo associatif d’inspiration métaphysique qui vient nimber tant le souhait de « m’envoler là-bas » que la mention des « premières lueurs » – et la redéfinition implicite qui s’inscrit en faux contre l’hypothèse d’une inspiration salvatrice née d’une manière de Creator spiritus et met au contraire en exergue le potentiel profondément mortifère de l’expérience à laquelle aspire le protagoniste. L’assimilation du « vent qui se lève » à l’action d’un spiritum vivificantem est par contre manifeste dans « villes natales & frenchitude » où la remarque « un camion passe sur la rocade / & le vent du nord se réveille » renouvelle le pressentiment des « orages désirés » tels que les appelle de ses vœux le René de Chateaubriand – avant de se voir démenti par le constat désabusé « mais faut pas rêver d’une tornade / ici les jours sont tous pareils » qui scelle de façon définitive la permanence inébranlable de l’enlisement mortifère. « le vent se lève » Conformément à la cohérence organisationnelle qui régit le discours poétique totalement construit qui est la marque de fabrique de l’écriture thiéfainienne, ce sont ensuite les parallèles contenus dans le corpus des chansons qui témoignent de l’importance voire du primat du Mourant tel qu’il se révèle intrinsèquement lié à la formulation « le vent se lève ». Le premier – et sans doute le plus significatif – rapprochement qui s’impose ici est celui avec « animal en quarantaine » dont l’incipit « le vent se lève / au large des galaxies / & je dérêve / dérive à l’infini » voit son aura connotative a priori diffuse – et semblant en premier lieu axée sur la possibilité d’abolition ou de transcendement des frontières de l’expérience – se préciser de façon irrévocable dès la strophe suivante « je m’imagine / en ombre vaporeuse / âme anonyme / errante & silencieuse », qui se révèle outre sa suggestivité immédiate comme un reflet direct de l’épitaphe d’Hadrien déplorant le sort de son animula blandula. La réinterprétation du motif du vol ou plus exactement de la « dérive » – clin d’œil à la théorisation de la notion en question effectuée par Guy Debord dont Thiéfaine renouvelle régulièrement le postulat du détournement sans limite – à travers « le vide infini » se place enfin sans équivoque possible sous les auspices de la mort à travers la conclusion « exigeons l’immortalité / & refusons de retourner / peu à peu vers la face cachée / de la nuit ! », qui réunit la conscience de l’inéluctabilité de la mort et le refus acharné de celle-ci dans un appel à la révolte qui revendique délibérément sa filiation avec les positions de Camus – et dans lequel il n’est pas jusqu’au remplacement final du participe « exigeant » de la formulation première par l’impératif de la première personne du pluriel qui ne se dévoile comme une variation remarquablement pertinente du « Je me révolte, donc nous
Vous pouvez aussi lire