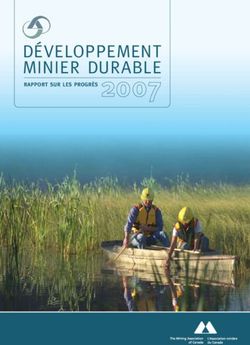Médecine, santé et sciences humaines Manuel
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Médecine, santé
et sciences humaines
Manuel
Ouvrage du Collège des enseignants
de sciences humaines et sociales
en médecine et santé sous la direction de :
Christian Bonah, professeur d’histoire des sciences,
faculté de médecine de Strasbourg
Claudie Haxaire, maître de conférences d’anthropologie,
faculté de médecine de Brest
Jean-Marc Mouillie, maître de conférences de philosophie,
faculté de médecine d’Angers
Anne-Laurence Penchaud, maître de conférences de sociologie,
faculté de médecine d’Angers
Laurent Visier, professeur de sociologie,
faculté de médecine de Montpellier
Préface
de
Tzvetan Todorov
Cet ouvrage a bénéficié de la relecture
des étudiants de médecine d’Angers :
Estelle Allard, Claire Fessard, Élisabeth Gaye, Tudi Gozé,
Clément Guineberteau, Coralie Mallebranche et Quentin Vieille.
Deuxième tirage
Les Belles Lettres
2012Préface
Médecine et sciences humaines
Les sciences humaines peuvent-elles aider les futurs médecins dans l’exer-
cice de leur métier ?
Nous sommes habitués à diviser l’être humain en corps et esprit, le pre-
mier participant du monde physique et chimique, le second se manifestant
sur les plans psychique et social. Nous savons pourtant aussi que cet être
est tout un, que corps et esprit agissent l’un sur l’autre, parfois de manière
tyrannique. L’une de ces intrusions, l’action physique-chimique sur les pro-
priétés de l’esprit, a trouvé depuis fort longtemps sa place légitime à l’in-
térieur de la médecine : on soulage la détresse des patients angoissés et
déprimés en leur administrant des médicaments, on circonscrit manies et
folies en faisant absorber aux malades comprimés et gouttes. L’autre forme
d’intervention, celle qui part de la connaissance de l’esprit pour atteindre
la santé du corps, n’est pas moins répandue dans la pratique mais elle n’a
pas encore acquis ses lettres de noblesse ; et c’est à elle qu’est consacré le
présent ouvrage.
Le médecin profitera de sa connaissance du monde humain en toutes
sortes de circonstances. Prenons le cas de base, celui où il cherche à guérir
un malade. Pour commencer, il doit établir un diagnostic, identifier le mal
dont souffre le patient. Agira-t-il à la manière d’un vétérinaire soignant un
cheval ou une vache, s’en tenant donc à la seule observation des symptô-
mes apparents ? Il est vrai qu’à la différence des médecins de l’Antiquité, les
praticiens d’aujourd’hui disposent d’instruments performants, qu’ils peu-
vent faire pratiquer des analyses des tissus, du sang ou des urines, regarder
à l’intérieur du corps grâce à la radiographie et à l’échographie. Pourtant,
les instruments les plus évolués ne suffiront jamais pour produire mécani-
quement le jugement du médecin, et pour cause : il a affaire à la fois à des
maladies génériques, comme le chercheur en laboratoire, et à des indivi-
dus malades, tous différents les uns des autres. Il n’y a donc aucune raison
de se priver de cette autre source irremplaçable d’informations sur l’indi-
vidu : la parole et les gestes du malade.
Celui-ci a une expérience unique de sa souffrance et il cherche à la com-
muniquer ; pourtant, il ne maîtrise probablement pas le vocabulaire tech-
nique. De plus, il est des douleurs qu’on préfère cacher, d’autres qu’on
atténue ou qu’on exagère, ou qu’on n’exprime que par une image. Les
mots révèlent parfois plus par ce qu’ils taisent que par ce qu’ils disent. Le
soignant ne peut donc se contenter de comprendre les paroles du soigné,
il doit les interpréter. Or l’interprétation des discours, à son tour, exige
une connaissance approfondie et nuancée du monde humain, des mobi-
les déclarés ou inavouables des actes, des mécanismes de la honte et de
5Préface
la peur, de l’appartenance sociale et du contexte du moment. Le méde-
cin doit comprendre l’être entier, et non pas seulement les symptômes
qu’il a sous les yeux.
Une fois le mal identifié, on cherche à le vaincre. De nouveau, médica-
ments et instruments viennent en aide au médecin, mais sans suffire ; la
coopération du patient est, elle aussi, nécessaire. Le traitement sera d’autant
plus efficace que le malade croira en sa force et qu’il voudra se soigner ; or
cette croyance et cette volonté dépendent de l’attitude du médecin, qui
peut aller de l’indifférence et la condescendance à la chaleur communica-
tive et à l’optimisme contagieux. Les mots aident à guérir aussi : autrement
que ne le font les comprimés, mais incontestablement. Le médecin doit se
faire, ici, auteur et acteur. Le traitement une fois décidé et lancé, le méde-
cin l’accompagne en continuant d’interpréter les discours et les attitudes
du patient pour s’assurer que les deux partenaires ne font pas fausse route.
Pourtant, l’attention au malade ne remplace pas la compétence sur la mala-
die. Pour être un bon médecin, il ne suffit pas d’être prévenant ou de paraî-
tre sympathique ; les sentiments que l’on éprouve ne doivent pas empêcher
la lucidité du regard. L’exigence adressée au médecin est bien double, telle
est la difficulté, mais aussi la richesse de cette profession.
La situation fondamentale, celle de la prise en charge du malade, exige
déjà une solide préparation psychique et morale. D’autres situations ren-
dent cette exigence plus forte encore. Un enfant handicapé ne sera peut-
être jamais « guéri », mais il peut être soigné et aidé avec plus ou moins de
compréhension, pour lui comme pour sa famille qui en assume la charge
quotidienne. L’effet de ce « plus ou moins » est immense. Les vieilles per-
sonnes, si nombreuses dans notre société, ne peuvent pas non plus être
« guéries » de leurs handicaps, et pourtant elles demandent à leur tour l’aide
du médecin. Celui-ci se trouve confronté à des problèmes particulièrement
redoutables en proximité de la mort. Comment accompagner le malade (et
sa famille) quand on le sait incurable ? Que dire à l’un et aux autres ? Quels
soins choisir ? Lesquels écarter ? Faut-il pratiquer ou non l’euthanasie ? Le
progrès des techniques de réanimation fait naître des dilemmes nouveaux :
faut-il maintenir en vie une personne en état de mort cérébrale ? Pendant
combien de temps ? De préférence à quel autre patient qui aurait besoin
du même lit ? Faut-il ou non imposer le prélèvement d’organes ?
Le médecin est également sollicité par la société dont il fait partie pour
donner son opinion sur toute une série de questions qui débordent le champ
de la guérison et qui lui imposent de faire des choix politiques et éthiques.
Il se fait expert auprès des tribunaux, intervient comme médecin du travail
dans l’entreprise, assiste en témoin à la vie des prisonniers. Il est des pays
où il se fait auxiliaire de la police : au camp américain de Guantanamo, ins-
tallé à Cuba, il participa aux interrogatoires pour garantir que la torture à
laquelle sont soumis les prisonniers ne menace pas leur vie. Conseiller du
gouvernement, il organise des campagnes de prévention, impose un cadre
hygiénique, contribue à la médicalisation systématique de la vie, conseille
6Médecine et sciences humaines
ou fait interdire les manipulations génétiques, s’avance plus ou moins loin
dans la voie de l’eugénisme. Les comités d’éthique, qui émettent des avis
autorisés sur les questions de société, comportent toujours aussi des mem-
bres médicaux.
Des difficultés supplémentaires naissent des différences culturelles entre
populations. Comment réagir au refus d’une femme musulmane d’être exa-
minée par un médecin homme ? De nos jours, la médecine se fait interna-
tionale, or les différentes cultures ne construisent pas la même image du
corps, n’attribuent pas la même signification à ses différents membres, ne
favorisent pas les mêmes groupes au sein de la population. Un ami anthro-
pologue revenu d’Afrique du Sud racontait les obstacles imprévus auxquels
se heurtaient les efforts pour endiguer le sida : on donnait les médicaments
à un malade, mais lui, obéissant à la règle de partage en vigueur dans sa
société, se voyait obligé de les répartir également entre tous les membres
malades de sa famille élargie ; du coup, les médicaments perdaient toute
efficacité. L’on sait aussi que les interventions humanitaires médicales auprès
de certaines populations entraînent des conséquences politiques graves que
l’on n’a pas le droit d’ignorer.
Dans toutes ces situations, et dans d’innombrables autres, la compré-
hension de l’individu comme de la collectivité est indispensable au méde-
cin pour lui permettre de trouver la réaction appropriée. Il est trop risqué
de lui demander de compter sur sa seule intuition. Il a tout intérêt à pro-
fiter de l’immense savoir accumulé au cours des siècles, portant sur la vie
psychique et sociale des êtres humains, sur les principes qui président aux
actions de connaissance et de jugement.
Dans le passé plus lointain, ce savoir était contenu dans les ouvrages de
philosophie et de morale, d’histoire et de politique ; ceux-ci restent tou-
jours une source vive de lumière. Une place particulière doit être réservée
ici aux arts et à la littérature : les images et, plus encore, les œuvres littérai-
res constituent la première science humaine. Leur mode d’exposition est
différent : la poésie et le roman ne formulent pas des thèses que l’on peut
réfuter ou confirmer, ils agissent par le récit, l’exemple, le symbole, la sugges-
tion indirecte ; néanmoins, ils ouvrent une voie royale pour la connaissance
des passions et des actions des hommes et des femmes, de leurs besoins
comme de leurs pulsions. La littérature a traité abondamment des mala-
dies, de Molière à Hervé Guibert, en passant par Tolstoï et Thomas Mann ;
mais elle a surtout représenté l’être humain dans sa globalité.
Sans renoncer à ces sources anciennes de savoir sur les conduites humai-
nes, le médecin de demain trouve aussi à sa disposition un discours consti-
tué depuis deux siècles, celui des sciences humaines et sociales. Tout en
continuant de lire poèmes et romans, de regarder tableaux et films, il peut
aussi étudier les écrits de ceux qui ont voulu analyser le psychisme humain
et les structures de la société, qu’ils soient des spécialistes en psychologie
ou en psychanalyse, en sociologie ou en ethnologie, en droit ou en scien-
ces politiques, en philosophie ou en morale, en théorie de l’image ou du
7Préface
langage. Le savoir qu’il y trouvera ne sera pas immédiatement convertible
en recettes pour l’action, mais il transformera de l’intérieur son être ; or, en
médecine, la frontière n’est pas étanche qui sépare être et faire.
Dans notre monde où certains rêvent de transformer les spécialistes de
la santé en « ingénieurs du corps », comme dit Rony Brauman, il est indis-
pensable de toujours garder présente à l’esprit cette double vocation du
médecin, de maintenir son intérêt pour le monde et pour les hommes.
Tzvetan Todorov
8Introduction
Soin et sens
Une double identité
Le médecin pourrait bien avoir deux têtes comme le suggère Michel
Serres : l’une d’intelligence scientifique soucieuse de compétence, focalisée
sur un problème technique à résoudre (le diagnostic, la thérapie, la com-
préhension d’un mécanisme biologique, telle interprétation de données,
etc.), et l’autre préoccupée de sollicitude et de responsabilité, attentive à
la finalité de la médecine, au contexte de son travail, à la situation singu-
lière du patient : « l’une reste dans la science, l’autre plonge dans le pay-
sage »1. Et en effet, ces deux orientations de la pensée, qui ont leur ordre
et leur rigueur propres, sont chacune indispensable à la médecine, qui
exige leur complémentarité ou leur union. Pour que cette dualité devienne
source non de tension, de déchirement, mais de justification, il faut que
la médecine pense son originalité et se garde notamment de ne vouloir se
dévisager que dans le miroir de la science. La science médicale, source d’ef-
ficacité, vise à terme le soin d’une personne malade, souffrante, dans une
relation qui met en jeu et configure le lien social. Elle s’associe nécessaire-
ment à une réflexion sur ce qu’il convient de faire ou de ne pas faire, à une
compréhension des enjeux et des limites de l’agir médical, à une présence
respectueuse et bénéfique auprès d’autrui et à la conscience d’une respon-
sabilité envers la société.
La vie humaine est essentiellement ouverture au sens. C’est bien pour-
quoi troubles, maladies et blessures nous inquiètent, appellent une « prise
en charge » 2 lorsqu’ils surviennent. La médecine est d’abord une réponse :
une réponse à la souffrance et à l’angoisse du sujet se sachant en dan-
ger, fragile et mortel, menacé de solitude, d’abandon, appelant solidarité
et soulagement. Au delà d’une réponse individualisée, lorsque notam-
ment elle s’aventure dans les « bonnes intentions » de la prévention, elle
court le risque de substituer au soin de personnes singulières un objec-
tif idéologique collectif : « la santé », au prix d’une normalisation des
conduites, d’une médicalisation de l’existence servant des intérêts cor-
poratistes, industriels, ou encore d’un assujettissement de la vie privée à
la cause dite publique, et au risque d’entretenir un imaginaire de maîtrise
et d’immortalité. La distinction se brouille alors parfois entre la responsa-
bilité médicale ayant à promouvoir une culture de la prévention fondée
1. « L’éducation médicale vue par un philosophe », Pédagogie médicale, 7, 2006, p. 135-
141.
2. Cette expression, pour usuelle qu’elle demeure, porte la marque d’une médecine qui
fait du patient son fardeau. Entre le patient ou son représentant légal et le médecin, il faudrait
bien plutôt parler de projet thérapeutique partagé.
9Introduction
sur l’information, respectueuse des choix individuels, et la mise en œuvre
d’une idéologie préventive reconduisant, sous les avatars du néo-hygié-
nisme et du moralisme contemporains, aux figures totalitaires de l’État
sanitaire. Si la médecine est un devoir avant d’être un savoir et un pou-
voir, dessiner les limites légitimes de ce devoir est devenu un problème
éthique, social, politique. Au vrai, la double tête évoquée par M. Serres
– ce corps somme toute monstrueux condamné à penser son unité à par-
tir d’une division – doit n’en faire qu’une : la rationalité instrumentale et
technicienne se justifie de s’inscrire dans l’horizon d’une pensée plus large
qui fait droit à une compréhension de l’existence humaine orientée par
le respect de toute personne en sa dignité, en ses droits, en son histoire
singulière. La signification humaine, éthique, de la médecine est essen-
tielle. Toute orientation unilatérale qui la perd de vue, cas d’une médecine
scientiste, objectiviste, productiviste, est dès lors violence, aveuglement,
contresens, et entraîne à terme la désaffection des sujets, soignants comme
patients, à son égard.
L’existence d’une médecine authentiquement soignante malgré son
impuissance thérapeutique a d’ailleurs précédé de manière immémoriale
notre médecine. Alors que cette dernière est celle qui a contribué à rendre
depuis moins d’un siècle la santé plus normale que la maladie, du moins
dans les pays économiquement favorisés, la figure et le rôle du médecin
sont des institutions sociales très anciennes. Or, cette médecine présente
au cœur des sociétés humaines depuis la nuit des temps culturels n’est pas
que l’ancêtre désuet et la figure embryonnaire de la médecine moderne. Elle
révèle la fonction symbolique essentielle du médecin et suggère que toute
médecine répond à des exigences qui sont pour partie non scientifiques. La
médecine qui pense son efficacité à partir des savoirs techno-scientifiques
modernes, dite parfois « biomédecine », doit ainsi encore faire la preuve
quotidienne, auprès des patients, de sa pertinence : du sens positif qu’elle
possède pour ces derniers. Si la médecine contemporaine est un exemple
rebattu du progrès scientifique, il n’est pas dit que le progrès scientifique
signifie toujours une meilleure médecine, accordée aux désirs et aux besoins
des sujets. Dans l’histoire des cultures, de nombreuses médecines ont, du
fait de leur existence même, et de leur fonction sociale, donné satisfaction
sans disposer de l’arsenal technique qui enrichit de manière spectaculaire
et précieuse la nôtre. Il y a là comme la mise à nu d’une fonction essentielle
de la médecine : porter secours sous forme d‘une présence active et soli-
daire – affirmation du lien social – et délivrer un discours reconnaissant le
mal d’autrui – affiliation de l’événement de ce mal à la sphère d’existence
sociale et culturelle – constituent le fondement du soin. Sans doute cette
fonction est-elle intacte. Mais l’évidence du sens s’est fragilisée face à l’em-
pire des techniques.
La quête d’efficacité qui a permis à la médecine de sortir de sa longue
nuit d’impuissance thérapeutique, mais l’a aussi exposée à des demandes
de rentabilité, de productivité, ne l’a-t-elle pas fait plonger dans une autre
10Soin et sens
obscurité, celle d’une absence d’attention suffisante aux personnes au-delà
de ses seules performances ? La question est de savoir si la médecine peut se
pratiquer indépendamment d’une réflexion dont la nature n’est pas scienti-
fique. La poser, c’est y répondre : réduire la médecine à un travail scientifi-
que, à une prestation technique, c’est réduire l’autre à un objet manipulé,
l’occulter en tant que sujet, ignorer la signification possible de ses troubles
et de sa demande, oublier que la pratique médicale s’accomplit dans un
milieu social qui a des attentes envers elle, nier le caractère normatif de ses
choix, la limiter à l’action curative où le corps d’autrui risque de n’être plus
qu’un moyen au service des objectifs médicaux. Si la médecine utilise les
sciences, et si l’efficacité qu’elle y puise possède une signification éthique
versus le charlatanisme et l’impuissance, ou l’inaction, c’est précisément
parce que la volonté de soigner qui la gouverne en droit relève de devoirs
envers autrui pour ne pas le laisser souffrir et ne pas lui nuire. La compé-
tence scientifique appartient à la responsabilité médicale, mais cette res-
ponsabilité exige du soin qu’il soit justifié auprès d’autrui sous peine d’en
compromettre la pertinence. Clinique, expérimentale ou de santé publi-
que, la médecine doit construire sa légitimité face à autrui et face à la col-
lectivité – ou mieux : avec eux.
Les sciences humaines et l’idée de pluridisciplinarité
La médecine contemporaine – complexe, riche de possibilités techni-
ques, engagée sur la voie de la maîtrise croissante des processus du corps,
multipliant les offres thérapeutiques, coûteuse, assignée à des choix qui
engagent des valeurs – exige donc aujourd’hui d’être accompagnée d’une
réflexion sur ses orientations, ses finalités et ses responsabilités. Cette exi-
gence de pensée, les sciences humaines n’en sont aucunement les déposi-
taires exclusives. Il y a une pensée affective, il y a une pensée spirituelle, il
y a une pensée esthétique, il y a une pensée quotidienne (alimentée par le
questionnement individuel, les conversations, les débats, les médias, etc.).
D’autres encore. Et il y a une réflexion des professionnels sur les modalités
éthiques, scientifiques et sociales d’exercice de leur métier en général, de
leur spécialité en particulier. Chacune est source possible d’éclairement.
Mais la pratique médicale contemporaine ne peut ignorer les savoirs par-
ticuliers que désignent les sciences humaines sans manquer pour partie
une compréhension de l’activité médicale elle-même, sans se couper du
monde culturel où elle évolue, où ces savoirs s’adressent à elle, sans risquer
de réduire la médecine à une prestation technique qui en trahit le sens
essentiel, et sans s’exposer à rester prisonnière de l’arbitraire des opinions
et des présuppositions non interrogées, en particulier lorsqu’il s’agit de
s’orienter moralement. Au-delà d’une rhétorique recommandant l’ouver-
ture d’esprit, voire un simple bagage de culture générale, il s’agit à leur
contact d’interroger le cœur de la médecine, de renouveler une compré-
hension de l’art médical que les premiers médecins rationnels (les médecins
hippocratiques) avaient saisie, éclairant leur discipline de philosophie et
11Introduction
mettant au centre de leur pratique l’homme en tant qu’individu. Au fond,
la médecine elle-même est une discipline humaine et sociale 3. Déterminer
le sens de cette responsabilité appelle une réflexion éthique et épistémo-
logique nourrie des savoirs et questions spécifiques de ces disciplines de
sciences humaines et sociales.
Cette réflexion ne s’improvise pas. Une culture spécifique est nécessaire,
dont le lieu privilégié sont les savoirs constitutifs des « humanités » classi-
ques et des sciences humaines et sociales modernes au sens large : philo-
sophie, sociologie, anthropologie, psychologie, histoire, droit, linguistique,
auxquels se joignent les regards de l’économie, de la politique, de la psycha-
nalyse, avec une attention particulière aux arts, lieu de manifestation d’une
pensée sensible où, comme dit Proust, la vérité subjective se rend accessi-
ble4. La littérature donne en particulier à voir une irremplaçable variation
du vécu de la maladie, de la souffrance, du handicap, du vieillissement, des
positions de soignant et de soigné, et plus avant c’est toute l’expérience lit-
téraire qui est la source privilégiée d’une sensibilité au « dire » et aux vécus,
indissociable de l’attention éthique à l’autre et à l’existence. « Pour attein-
dre le singulier, l’apprentissage de la médecine doit s’appuyer aussi sur la
culture, telle qu’y contribuent par exemple les grands écrivains et que l’on
retrouve dans les textes de portée universelle, car ces auteurs explorent et
décrivent des expériences individuelles telles que les rencontrera le méde-
cin et qu’assurément il manquera si, limité à la raison brute, il reste un ins-
truit inculte »5. Les lumières de la bibliothèque, de la salle de cinéma, ou
encore de la scène et du musée doivent éclairer les lieux de l’apprentissage
et de l’exercice médical.
C’est l’évolution même des sciences du vivant et des biotechnologies
d’une part, des mœurs, des idées et du cadre politique d’autre part, qui a
conduit les savoirs biologiques et médicaux à solliciter les sciences humai-
nes. De plus en plus de questions se posent au citoyen, à son représen-
tant, au soignant, au soigné. De quel droit le médecin décide-t-il ce qui
concerne la vie d’autrui ? Qui évalue la légitimité de telle technique, de
telle demande d’un patient, de telle décision médicale, de telle politique
de santé ? Sur quels critères ? Et ce fut réciproquement œuvre des sciences
humaines de montrer que le problème scientifique est aussi un problème
social, que l’acte de soin engage une considération du statut des personnes,
3. Le psychiatre Henri Ey disait pour sa part qu’elle n’était « ni science exacte ni science
humaine ». Il en faisait lui aussi une discipline à « deux voix » : science naturelle vivante, sou-
mise à la flèche du temps biologique, évoluant dans la culture comme dans un milieu, tandis
que « le fond du problème de la Médecine » reste l’irréductibilité de la maladie à une forme
naturelle : « ce que le Médecin perçoit n’est pas quelque chose mais quelqu’un », la maladie
est une objectivité « immergée dans les rapports d’intersubjectivité », Naissance de la méde-
cine, Paris, Masson, 1981, p. 11-20.
4. Voir À l’ombre des jeunes filles en fleurs et Le temps retrouvé.
5. M. Serres, op. cit., p. 135.
12Soin et sens
et que toute pratique se structure de significations symboliques, de repré-
sentations et de normativités qui demandent à être interrogées. Il y a un
enjeu : que le souci de performance, le souci de réflexion et le souci de jus-
tification se conjuguent.
À bien des égards, la distinction entre des sciences dites « humaines et
sociales » (ce qui est une redondance : tout ce qui est humain est social) et
des sciences dites « dures » ou exactes » (ce qui est projeter un idéal d’ob-
jectivité et de certitude en grande partie imaginaire : ces savoirs construisent
leurs propres normes d’exactitude et ne font que viser le réel) est contesta-
ble. Il y a de la scientificité et une quête d’objectivité dans les premières tan-
dis que les secondes sont pour une part des discours, des pratiques sociales
et des comportements qui parlent de l’homme. Certes, objets et métho-
des diffèrent, mais c’est de manière générale chaque science qui traite de
son objet relativement à sa manière de le constituer : le physicien étudie
son objet en termes de relations mathématiques, le philosophe en termes
conceptuels, etc. La science ne scrute pas directement une réalité neutre
déjà là, mais des phénomènes qu’elle constitue. Les notions même d’esprit
et de matière sont, du point de vue des sciences, des constructions (« nous
ne connaîtrons jamais ni l’esprit ni la matière » reconnaissait C. Bernard6). Il
est trop simple d’opposer sciences humaines et sciences exactes en disant
que les unes sont « subjectives », structurées par une attitude de compré-
hension et d’interprétation, tandis que les autres sont objectives, produisant
des preuves et des explications. Plus avant, c’est le concept de « science »,
ainsi clivé, qu’il faudrait interroger : tout savoir est une modalité de l’esprit
humain dans son rapport au monde, de sorte que le concept de science
s’éclaire d’une réflexion sur la pensée elle-même.
C’est donc une rencontre qu’il s’agit de favoriser, rencontre entre le
champ des sciences biomédicales qui, dans la représentation sponta-
née, s’occupent de faits matériels, quantifiables, manipulables, et celui
de disciplines dont les « faits » étudiés sont pour l’essentiel des actions
humaines, des conceptions et des valeurs. Pour schématique qu’il soit,
on l’a dit, ce partage des champs indique l’essentiel : la médecine, en ce
qu’elle est rencontre d’autrui, confrontation à des histoires et des situa-
tions irréductibles à toute norme, prise de décisions qui interviennent
dans la vie des personnes et pratique sociale ne saurait se penser seule-
ment du côté technique et scientifique ni opposer son désir d’efficacité
à des questions interrogeant la légitimité des valeurs que ses choix enga-
gent. La relation entre médecin et patient a fait naître l’éthique médicale,
et la floraison des biotechnologies la réflexion bioéthique. Le médecin
ne peut pas les ignorer. Il n’y a pas de soin hors du sens. Or, ce sens, la
science ne le fournit pas.
6. Introduction à l’étude de la médecine expérimentale (1865), Partie II, ch. I, § IV.
13Introduction
Une entreprise de sensibilisation au questionnement et aux enjeux multi-
ples de la médecine ne peut être que pluridisciplinaire. Les sciences humai-
nes et sociales ne sont pas une « matière » ni une discipline, mais un champ
de savoirs qui ont chacun leur histoire et leur spécificité. L’abord des problè-
mes exige le dépassement de la division universitaire qui compartimente la
pensée en disciplines, disciplines dont la nécessaire spécificité ne doit pas se
traduire en illusion d’autonomie et de suffisance. Un manuel résolument plu-
ridisciplinaire cherche ainsi à donner à voir des « passages » entre les problè-
mes, les enjeux, les facettes du réel, les discours, les regards, comme autant
de mises en mouvement de la pensée. Il invite à se déplacer entre les multiples
champs d’études concernés : philosophie de la médecine, épistémologie des
pratiques médicales, philosophies morales, philosophies de l’existence, éthi-
que médicale, bioéthique, psychologie médicale, ethnopsychiatrie, anthro-
pologie de la santé, sociologie du soin, histoire de la pensée médicale et des
pratiques sanitaires, économie de la santé, techniques d’expression et de com-
munication, récits et témoignages autour de la médecine, etc.
La pluridisciplinarité n’est pas une aventure extérieure aux savoirs. Aucun
savoir n’est absolument clos sur lui-même. Aucun ne peut effacer les autres.
Les modifications qui naissent de leur rencontre affectent chaque champ disci-
plinaire non pas de l’extérieur, mais plutôt comme un mouvement où la spé-
cialisation croissante des objets et des méthodes s’articule à une circulation
accrue des idées, des outils, des connaissances. Les contours de la pluridiscipli-
narité ne peuvent d’ailleurs pas être rigoureusement délimités. Elle commence
au cœur de chaque discipline et renvoie, avant de désigner une entreprise
explicite de confrontation, à une migration et à un métissage constants des
éléments d’un champ d’étude à un autre, participant du mouvement de consti-
tution de chacun d’entre eux. Le « décloisonnement » des savoirs n’est ainsi
qu’une façon de les approfondir. C’est en scrutant ce qu’elle est, ce qu’elle
fait, ce qu’elle veut, que la médecine s’ouvre aux autres savoirs.
Tel est le mouvement même de constitution de la médecine moderne. Elle
s’est en effet d’abord constituée en lien avec la philosophie au moment où a
émergé la conscience de soi de la médecine (médecine rationnelle hippocra-
tique), revendiquant et conquérant sa spécificité contre les pratiques magi-
ques, puis s’est pluralisée (surtout à partir du XIXe siècle) en une multitude
de disciplines, dites « spécialités », au fur et à mesure de son devenir-science.
Cependant, de se tourner vers les sciences, la médecine avoue paradoxale-
ment qu’elle n’y est pas réductible, et de se détourner d’un passé littéraire
et philosophique (qu’elle-même avait figé et qui ne présentait plus rien de
fécond), elle s’est isolée des moyens de se penser. Nul qui a fait l’épreuve de
la maladie, sur lui-même ou sur l’un de ses proches, ne remettra en cause
le bien-fondé de cette quête scientifique. Il n’en demeure pas moins que le
médecin n’est proprement ni biologiste, ni chimiste, ni physicien.
L’opposition entre les humanités et les sciences humaines d’un côté et
les sciences dures ou « exactes » de l’autre ne décrit donc pas assez bien
14Soin et sens
les pôles entre lesquels la médecine se situe au cours de son histoire. S’il est
vrai que la médecine s’est débarrassée à bon droit d’une référence « sco-
lastique » stérilisante et de spéculations imaginaires pour devenir efficace
à partir du travail des sciences (à tel point que les prix Nobel de médecine
sont décernés à des biologistes), elle ne se laisse pas réduire à cette réfé-
rence scientifique qui est pour elle un outil indispensable mais non suffi-
sant. En d’autres termes, le point de non retour que détermine l’usage des
sciences pour développer l’efficacité universelle7 de la médecine ne signi-
fie pas que l’essentiel de la médecine s’y accomplit. La médecine est moins
une science qu’un usage des sciences : l’objectivité scientifique n’est en elle
qu’un moyen, la finalité étant l’individu, sujet unique, avec son histoire et
sa situation. Elle est, dit G. Canguilhem, « une technique ou un art au car-
refour de plusieurs sciences plutôt [qu’une] science proprement dite »8 et
selon la célèbre phrase de C. Bernard « le médecin n’est point le médecin
des êtres vivants en général, pas même le médecin du genre humain, mais
bien le médecin de l’individu humain »9.
Une réflexion épistémologique et éthique
C’est donc une réflexion sur l’unité, en médecine, d’une exigence de
science et d’un souci éthique que les sciences humaines cherchent à conduire
lorsqu’elles interrogent la pratique médicale. Elles invitent d’abord la méde-
cine à interroger ses présupposés, ses modes de pensée, ses représentations,
son histoire, et montrent que ses objets (ce qu’on appelle « santé », « mala-
die », « médicament », etc.) et ses méthodes (ce qu’on appelle « examiner »,
« diagnostiquer », « prescrire », « expérimenter », etc.) sont des construc-
tions culturelles et normatives. Le travail scientifique n’est pas un simple
décryptage des phénomènes naturels. Il est une production de connaissan-
ces et de conduites dans un contexte social, psychologique, idéologique,
matériel et technique donné. Il s’incarne dans des énoncés, des outils, des
gestes, des institutions et divers « collectifs de pensée » (selon l’expression
d’un pionnier de l’épistémologie médicale, le médecin L. Fleck10) qui sont
autant de choix, plus ou moins conscients. Même en s’identifiant à l’idéal
scientifique, le « médical » est resté une construction collective en mou-
vement impliquant valeurs et normes. De plus en plus confrontée à une
demande de justification, à une élucidation rationnelle et argumentée de
ses orientations pour que la société et les individus les acceptent, la méde-
cine contemporaine articule désormais cette réflexion épistémologique à
une réflexion éthique portant sur la légitimité des valeurs que son travail
7. Non dépendante d’un contexte culturel par contraste avec la médecine traditionnelle, ce
qu’exprime en un sens le nom d’associations comme « Médecins du monde » ou « Médecins
sans frontières ». (Mais ces ONG ont elles-mêmes une culture.)
8. Le normal et le pathologique (1943), Paris, PUF, 1998, p. 7.
9. Op. cit., IIe partie, ch. II, § 1.
10. Genèse et développement d’un fait scientifique (1935), Paris, Les Belles Lettres, 2005.
15Introduction
implique ou rencontre, sur leur partage possible, tout en intégrant les choix
individuels, les vécus, les affects, les déterminants culturels.
La rencontre d’autrui et les moments cruciaux de l’existence humaine :
naissance, maladies, blessures, souffrances, handicaps, mort, sont au cœur
de l’exercice médical. Le soignant est à l’épreuve de l’inquiétude du sujet,
de sa solitude, de sa vulnérabilité, de son affectivité, de ses souffrances, de
son angoisse. Et ce sont aussi les siennes propres qui surgissent selon les
situations rencontrées. Que la relation médicale soit non une relation de
pouvoir, mais une véritable relation de soin, respectueuse de toutes les per-
sonnes impliquées, est donc à la fois la visée éthique de la formation médi-
cale et l’expression du sens fondamental du métier de soigner. Dans cette
perspective, les sciences humaines sont moins un enseignement de l’éthique
que l’exposition du caractère éthique de la médecine. Les sciences humai-
nes suggèrent ici l’existence d’un double enveloppement où d’une part la
médecine intériorise de nouvelles exigences sociales (respect, consente-
ment, équité, solidarité, responsabilité, etc.) et où d’autre part elle est le lieu
même où ces exigences peuvent trouver une forme de concrétisation ins-
piratrice pour d’autres aspects de la vie sociale. Le lien médical serait sous
cet angle un miroir grossissant du lien social.
Sans doute s’agit-il donc à terme, en ouvrant l’angle, de penser certains
traits de notre époque. Même si nous ne pouvons par principe réfléchir à
notre situation autrement que de l’intérieur, sans jamais pouvoir prendre
sur elle un point de vue de surplomb, cette limite épistémologique est la
condition de possibilité d’une éthique : cette situation est la nôtre, et la pen-
ser c’est y intervenir, la changer. Davantage nous en prendrons la mesure,
davantage nous pourrons y investir nos choix et nos exigences pour en
infléchir de manière responsable certains des aspects. Pour que la méde-
cine garde, ou prenne, un visage humain11.
Tout ceci problématise l’exigence éthique de la médecine. L’éthique n’est
pas spontanée. Elle n’existe qu’à proportion d’une volonté. Et elle ne peut
s’improviser, s’opposant à l’arbitraire. Elle ne s’enseigne pas non plus comme
doctrine, recettes ou mots d’ordre : réflexion sur les valeurs, elle s’exerce
en situation, sur le fond de concepts et d’analyses qui lui servent de repè-
res et appellent, eux, une formation. Le praticien pose des actes quotidien-
nement, souvent dans un contexte où le temps est compté. C’est donc en
amont, dans une formation poursuivie tout au long du cursus et du métier,
que résident les conditions de possibilité de ce souci éthique qui fournit leur
sens profond à toutes les analyses de sciences humaines en médecine.
L’enseignement
Lorsque les sciences humaines ont été introduites dans la formation
médicale française (1994), avec un rôle fort dans le concours d’entrée en
11. Voir P. Skrabanek, La fin de la médecine à visage humain (1994), Paris, Odile Jacob,
1995.
16Soin et sens
médecine, suivant une orientation internationale12, le but déclaré était de
favoriser l’appropriation par chacun des multiples et complexes enjeux du
métier médical13. Le présent ouvrage se veut un compagnon de formation
en ce sens même. Son ambition est d’encourager la réflexion interrogative,
d’éveiller l’esprit critique, de susciter le goût de la curiosité, si fondamen-
taux aussi bien dans les sciences. Plus qu’une transmission de connaissan-
ces, il s’agit d’introduire aux problèmes, de donner des repères (historiques,
juridiques, conceptuels, etc.) et de sensibiliser au questionnement. La réfé-
rence à des données factuelles (connaissances scientifiques, éléments de
santé publique, dispositions légales, etc.), a en ce sens moins compté que
la saisie de logiques et de problématiques privilégiant les questions de sens
et de compréhension impliquées en médecine.
L’ambition de ce « Manuel » de sciences humaines pour les études médi-
cales ne peut être que modeste : la moindre des questions qui s’y trouve
abordée nécessiterait d’amples développements pour recevoir son déploie-
ment. Il renonce aussi à une illusoire exhaustivité et ne prétend pas à l’auto-
nomie, contradictoire avec l’esprit d’ouverture qu’il veut sien. Enfin, il fait
de la pluridisciplinarité moins son évidence que son problème. On ne plaide
pas ici la cause des sciences humaines et sociales vis-à-vis d’un monde scien-
tifique qui serait dénué de pensée et d’interrogations. Les médecins réflé-
chissent à leur art au moins depuis la médecine rationnelle hippocratique,
et le lien de celle-ci avec la philosophie fut premier. Les enseignants de
sciences humaines issus de ces disciplines doivent pour leur part appren-
dre continûment des acteurs de la médecine pour la saisir au lieu même
de son effectivité, c’est-à-dire dans la pratique, à l’épreuve des situations
cliniques ou de recherche. Mais la relation est réciproque : la médecine a
besoin de regards extérieurs et de savoirs autres que médicaux et scientifi-
ques pour se penser. Les exigences de réflexion impliquées aujourd’hui par
la pratique médicale ne permettent plus de s’en tenir à un vague humanisme
censé rappeler au technicien et au savant que la médecine est geste que
l’homme fait à l’homme. Encore moins à un sens moral supposé commun.
12. De nombreux pays européens ont intégré des enseignements de cet ordre dans
leur cursus ; les « medical humanities » sont également présentes dans les cursus américains.
L’Association Médicale Mondiale « invite instamment les écoles de médecine du monde entier
à inclure l’éthique médicale et les droits de l’homme dans le programme de leurs cours obli-
gatoires » (1999), et la fédération mondiale pour l’enseignement de la médecine renchérit en
posant que l’éthique médicale relève des compétences médicales auxquelles doit former l’en-
seignement. Voir www.sund.ku.dk/wfme/ et pour l’enseignement de l’éthique médicale selon
l’AMM : www.wma.net/ethicsunit/education.htm.
13. Un premier arrêté (18 mars 1992) introduisit un module de « culture générale »,
devenu module de « sciences humaines et sociales » par l’arrêté du 21 avril 1994 qui précise
que l’épreuve correspondant à cet enseignement dans le concours d’entrée en médecine doit
permettre d’apprécier « les capacités d’analyse et de réflexion des étudiants ». Selon un autre
arrêté (1995), le but de cet enseignement, qui « doit être assuré avec le concours d’universi-
taires des disciplines concernées », est « de développer chez les étudiants une approche pluri-
disciplinaire des problèmes de la société et de susciter leur réflexion sur la place de leur future
pratique dans un contexte élargi ».
17Introduction
La double reconnaissance du respect dû à tout autre et de la nécessité pour
chacun de réfléchir d’une autre manière qu’isolément, avec ses seuls repè-
res personnels, est la présupposition nécessaire de la démarche de respon-
sabilité qui est au cœur de la médecine. Le soignant est un citoyen que son
métier confronte d’abord à d’autres sujets, porteurs de demandes multi-
ples et doués de leur propre jugement, au sein d’un rapport de solidarité à
l’ensemble du corps social. Il importe qu’il ait à l’esprit des repères précis
et rigoureux pour penser sa place et ses responsabilités.
Comment devient-on médecin, soignant, et quel rôle les sciences humai-
nes jouent-elles dans cet apprentissage ? Cette double question interroge
l’identité de notre médecine.
Les textes qui suivent sont les éléments d’un dialogue à partager et à
poursuivre. Ils ont fait l’objet de lectures croisées entre auteurs de disci-
plines différentes, et ont été lus par un collectif d’étudiants. Ce livre est le
fruit d’un travail collégial auquel ont pris part autant des médecins et des
scientifiques que des enseignants et des chercheurs en sciences humaines
dont bon nombre ont la responsabilité de cette formation en faculté de
médecine. Il n’a pas recherché l’homogénéité et appelle plusieurs lectu-
res selon l’avancement du lecteur dans ses études, son chemin de pensée,
ses préoccupations. La pluridisciplinarité n’est pas convertible en un dis-
cours lissé qui fusionnerait des disciplines de style, de culture, de référen-
ces, de méthodes et d’objets différents. Il y a donc, d’une étude à l’autre,
des changements d’ambiance, de « coordonnées », de regards, en écho à
la pluralité des savoirs qui s’exprime. Les sciences humaines et sociales doi-
vent garder leur pluriel.
Enfin, surtout, elles se trahiraient de penser donner des leçons. Leur seule
fonction est de proposer des éléments de réflexion et d’ouvrir des questions.
Ainsi peuvent-elles espérer être utiles. Une médecine lucide sur ses moyens
et ses limites, éclairée sur ses devoirs et ses risques, consciente de toucher à
des aspects de l’existence humaine, individuelle et sociale, qui ne se laissent
pas saisir avec la seule raison instrumentale et technicienne, ouverte donc à
une raison soucieuse du sens, d’autrui, mettant à distance sa pulsion de maî-
trise pour privilégier le lien, le respect et la compréhension, acceptant l’in-
certitude solidaire de la prudence, ainsi qu’un « non savoir » et un « laisser
être » respectueux de l’être intime des sujets et de leurs droits, une méde-
cine se préoccupant de sa pertinence, au service des personnes et refusant
toute discrimination évitable est la seule médecine qui puisse éthiquement
et démocratiquement s’envisager.
Nous aimerions que les lecteurs ne considèrent pas ces études comme
des connaissances à apprendre, mais y voient des incitations à réfléchir et
à s’instruire par eux-mêmes. Ces questions appartiennent à tous.
(Jean-Marc Mouillie)
18Études
191
Nature de la médecine
1. Médecine magique, médecine rationnelle
La première question pourrait être de savoir ce qu’est la médecine.
L’objectif est d’identifier une fonction sociale, de caractériser une activité,
de circonscrire un territoire disciplinaire, de savoir en somme où commence
et où finit le proprement médical. Le point d’appui possible d’une telle
enquête est le moment où émerge la conscience de soi de la médecine : la
médecine grecque rationnelle hippocratique (VIe-IVe siècle av. J.-C. 1). Ce
moment fait césure.
Y a-t-il une médecine ou des médecines ?
La médecine est d’abord une réponse humaine, culturelle, à l’appel de
celui qui souffre. Le médecin cherche à secourir l’homme qui souffre dans
son corps. Ce geste immémorial, transculturel, manifeste une réassurance
du lien social et une sollicitude envers autrui. L’homme enterre ses morts ;
il soigne aussi son semblable blessé, malade, souffrant. « Rien ne nous per-
met d’isoler un «instinct de guérir» qui serait naturel »2. Il y a plutôt dans
le rôle thérapeutique une institution symbolique dont la présence a pris les
formes les plus variées selon les cultures et les époques. On a pu rappro-
cher cette présence universelle d’une fonction biologique visant à soulager
l’individu de situations et de vécus insupportables ou difficiles à vivre (B.
Malinowski, célèbre anthropologue de la première moitié du XXe siècle3).
Mais l’interprétation « biologisante », qui ferait de la médecine un « ins-
tinct », nierait la spécificité des pratiques humaines. Peut-être l’institution
symbolique de la médecine traduit-elle plutôt une logique d’humanisation,
le thérapeute intégrant le corps à l’ordre humain au lieu de l’abandonner à
1. Hippocrate lui-même naît en 460 av. J.-C. dans l’île de Cos. Pour une présentation de
cette médecine, nous renvoyons à Hippocrate, L’art de la médecine, Paris, G.F., 1979, recueil
de textes hippocratiques avec une présentation de Jacques Jouanna et Caroline Magdelaine,
et Hippocrate de Jacques Jouanna, Paris, Fayard, 1992.
2. J. Clavreul, L’ordre médical, Seuil, 1978, p. 48. Cela signifie aussi qu’il n’y a pas de
médecine animale à proprement parler : si des animaux manifestent bien des comportements
évoquant une thérapie (comme se lécher une blessure, l’enduire de boue, chez certains mam-
mifères) et l’acte de porter secours (tel le chien qui réagit face au malaise de son maître), il ne
s’agit pas d’un savoir institué dans et par une culture.
3. Magic, Science and Religion, Glencoe, Free Press, 1948.
21Vous pouvez aussi lire