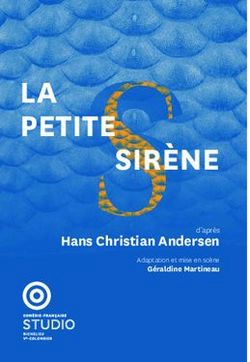Les chimpanzés et les éléphants, médecins par les plantes
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Les chimpanzés
et les éléphants,
médecins par les plantes
• FLORENCE BRUNOIS-PASINA •
Les marsupiaux, les
chimpanzés ou les éléphants savent
se soigner. La médecine – comme
bien d’autres savoirs – est partagée
par les humains avec les autres êtres
qui vivent sur cette planète : plantes,
minéraux, animaux, esprits… Pour
mieux comprendre ces partages de
connaissances et ce que certaines populations ont emprunté
aux animaux – reconnaissant à ce titre un certain endettement
à leur égard –, j’ai mis au point une méthode d’enquête. L’ethno-
éthologie travaille sur les éventuels transferts de savoirs ou de
comportements réciproques qui se jouent entre les humains
et les êtres vivants, dont celui de savoir prendre soin de soi en
recourant aux plantes médicinales.Les Kasua, une population
en empathie avec le monde
Cette méthode s’applique à l’ensemble des êtres qui constituent
un monde, et m’a conduite à devenir simultanément naturaliste,
collectrice de spécimens, chasseresse de preuves éthologiques,
écologiques idéelles et matérielles. Mon travail et ma vie partagée
avec la population kasua en Papouasie-Nouvelle-Guinée depuis
vingt-cinq ans ont été une révélation, tant leur société s’assimile
à un monde interspécifique, un ensemble complexe de milliers
d’êtres vivants. En effet, dès leur naissance, les enfants sont
éduqués à l’empathie interspécifique, c’est-à-dire la capacité,
sans aucune confusion entre soi et l’autre, à prendre le point de
vue de l’animal afin de ressentir son environnement propre, son
« Umwelt » (terme inventé par von Uexküll au début de xxe siècle),
et ainsi de mieux l’imiter. L’enfant grandit donc dans un contexte
social qui ne se limite pas aux humains, mais intègre aussi les
existants visibles et invisibles de la forêt. Être, être comme les
autres ou se différencier des autres, c’est-à-dire trouver sa place
parmi les autres et interagir avec eux. Une démarche complexe,
car ces autres peuvent être plante, animal ou encore esprit.
Parmi ces esprits, on trouve les Isanese, les gardiens du gibier,
qui sont les enfants de hapano, la mère des animaux. Les relations
des humains avec les Isanese sont basées d’une manière générale sur
des échanges réciproques. On offre des présents aux esprits pour les
remercier d’avoir donné les richesses de la nature. Cela concerne,
par exemple, la viande de gibier, des chants cérémoniels, des soins,
etc. Ces relations incitent l’enfant kasua à acquérir et à approfondir
perpétuellement ses connaissances éthologiques des êtres de la
forêt, en observant et en copiant parfois certains comportements
propres à chaque espèce, comme la lenteur, le camouflage, la
rapidité, les modes de défense, les réactions face à un prédateur…
Autant de façons de vivre que tout enfant doit connaître et ressentir
pour s’en imprégner et en imprégner son double de gibier. En effet,
chaque Kasua possède un double animal dont il va, au cours de ses
activités oniriques, adopter les yeux, l’odorat, l’ouïe, les attitudes
alimentaires et sexuelles… Une autre vie, une autre perspective surLES ChIMPANzÉS ET LES ÉLÉPh ANTS, MÉDECINS PAR LES PLANTES
le monde qui se partage dans les rêves. Car notre nuit de huit heures
n’existe pas chez les Kasua. La nuit est pour eux une autre façon
de vivre. Apprendre le jour pour rêver la nuit et rêver la nuit pour
apprendre le jour signifie pour eux reconnaître l’essence même
de tous ces multiples et divers composants du milieu forestier. Les
animaux participent de leur monde. Ils font partie de leur identité
la plus intime. Ainsi, imiter certains de leurs comportements – donc
enrichir l’éventail de ceux de l’humanité – est un phénomène très
répandu et conscientisé par ces individus. Les mythes témoignent
d’ailleurs de ces partages, de ces dons que les Kasua perçoivent de
tous ceux avec qui ils cohabitent et qui relèvent autant du domaine
de la technique, du cérémoniel, des comportements sexuels, de la
prédation que de la médecine.
L’automédication des animaux est une évidence pour
la population kasua. Selon eux, les animaux sont dotés
d’intentionnalité et d’une intelligence les conduisant à prendre
soin d’eux-mêmes et de leur progéniture. La pharmacopée kasua
repose essentiellement sur le recours aux écorces, considérées
comme la peau des arbres d’où transpire son intériorité,
sa puissance d’agir. Leurs exsudations (les suintements de
l’arbre) portent en elles la fertilité universelle qu’a diffusée leur
créateur Sito dans toutes les formes de vie que nous nommons la
biodiversité. De nombreux traitements concernant les plaies ou
les douleurs de dents ont ainsi été empruntés aux marsupiaux qui
coévoluent dans la cime des arbres, et se nourrissent exclusivement
de plantes, d’écorces et de sèves. C’est en les observant, notamment
les mères avec leurs petits, qu’ils ont découvert, en reproduisant
leurs actions, que certains usages avaient bien des propriétés
médicinales. Telle sève observée pour panser une plaie est propice
à atténuer l’infection corrosive des ulcères tropicaux, généralement
provoqués par les sangsues qui s’agrippent aux pieds, chevilles ou
jambes pour s’alimenter de votre sang. Telle écorce mâchouillée
atténue la peine dentaire en agissant comme anesthésiant. Les
Kasua ne se cachent pas d’avoir imité ces animaux. Car il ne s’agit
pas de pales copies mais bien d’imitation, puisque cette population
considère que les animaux n’agissent pas par instinct mais par
volonté, avec des intentions.Les Batooro et l’admiration
pour les chimpanzés
Avec Sabrina Krief, vétérinaire et phytochimiste, qui étudie le
comportement alimentaire et les pathologies des chimpanzés vivant
dans la forêt du parc de Kibale, à l’ouest de l’Ouganda, j’ai enquêté
sur la population locale, les Batooro. Notre but était de comparer
l’usage des plantes forestières à but médical chez les chimpanzés et
les humains. Notre ambition soulevait des interrogations inédites
sur les manières d’être et de faire avec les plantes. S’inscrivaient-
elles dans une histoire des comportements de l’ancêtre commun des
chimpanzés et des humains actuels ? Exprimaient-elles la possibilité
d’une transmission interspécifique des expériences, des savoirs et
savoir-faire du végétal ? Signifiaient-elles une communication ou
des observations mutuelles entre ces deux espèces, des mécanismes
de mimétisme, d’imitation et d’emprunt ?
L’univers des Batooro, société de pasteurs et d’agriculteurs,
s’approche de celui des Kasua en se présentant comme un
cosmos habité, lui aussi, par des communautés spirituelles. Les
maladies répertoriées sont essentiellement les sanctions que les
esprits infligent aux humains contrevenants. Pour s’en guérir,
les Batooro recourent exclusivement aux plantes forestières –
nommées kifunu –, comme leur avait enseigné leur créateur et
maître des animaux, Kaliisa. Celui-ci a ainsi donné au végétal le
formidable pouvoir de mettre en relation les mondes des hommes
et des animaux, et de garantir leurs échanges réciproques. Pour
comprendre l’univers des Batooro, il était donc indispensable de
travailler sur l’interspécificité entre toutes ces entités.
Cette interspécificité entraîne une connaissance éthologique
très fine des habitudes de la faune forestière, notamment sur
l’utilisation des végétaux : sur les 75 plantes médicinales réperto-
riées, 67 sont reconnues pour être utilisées conjointement par la
faune soit à des fins alimentaires, soit à des fins thérapeutiques,
en soignant essentiellement des troubles intestinaux (parasites,
diarrhée) ou des infections buccales et cutanées. Cette poly-
valence des usages des plantes met en évidence un partenaire
remarquable et remarqué : le chimpanzé, ekikuya.LES ChIMPANzÉS ET LES ÉLÉPh ANTS, MÉDECINS PAR LES PLANTES
Le chimpanzé : l’enseignant
des plantes médicinales
La singularisation du chimpanzé repose tout d’abord sur
ses nombreux points communs avec les humains. Son
mode alimentaire d’abord – essentiellement végétarien,
exceptionnellement carnivore – et la grande diversité de ses
comportements : réflexivité, communication interindividuelle
par les gestes, regard et usage d’une parole kugamba*. Autre
trait de ressemblance avec nous, la large palette d’émotions – le
rire, l’humour, les pleurs, la peur, l’amour, la jalousie, la haine, la
colère, la vengeance… Enfin, la vie sociale du chimpanzé est très
développée et composée de pratiques ritualisées ou collectivisées,
comme la chasse.
S’il est proche des humains, les Batooro considèrent aussi que
le chimpanzé vit en symbiose avec la flore forestière. Il y puise
l’ensemble des ressources utiles à son bien-être, contrairement
à d’autres animaux plus instinctifs comme les babouins, « qui
pensent avec leur seul estomac », comme disent les Batooro.
Selon cette population d’Ouganda, l’intelligence des chimpanzés
les aurait conduits à sélectionner 70 plantes « utiles » dont ils
extraient des parties bien déterminées (feuilles, écorce, tige,
etc.) à des fins alimentaires, technologiques ou médicinales,
pour s’automédicamenter ou soigner un congénère blessé ou
malade. Plusieurs pathologies les affectent régulièrement (fièvre,
diarrhée, parasites intestinaux, ulcères), pour lesquelles ils ont
recours à une dizaine de plantes, reconnues et identifiées par
les Batooro. Cette sélection ferait suite à leurs expériences
individuelles parfois malheureuses – « certains sont décédés
à la suite d’une consommation de plantes trop toxiques » –
parfois heureuses, leur permettant de découvrir un goût ou un
effet curatif. Ces expériences cumulées constituent finalement
une « culture botanique » que les chimpanzés se transmettent
collatéralement ou entre générations.
* « la parole nommée », en langue batooro.Une pharmacopée partagée entre
deux primates : humains et chimpanzés
Les résultats de notre travail avec Sabrina Krief furent non
seulement étonnants, mais des plus prometteurs pour établir
une histoire du comportement automédical chez ces deux
primates que sont les humains et les chimpanzés. Après plusieurs
mois d’enquête, je pus ainsi isoler un ensemble de 155 espèces
de plantes employées par les Batooro, dont 50 % à des fins
médicinales et 31 % (soit 47 spécimens) consommés par les
chimpanzés. Parmi celles-ci, 18 plantes sont identifiées par les
primatologues et les populations locales comme médicinales.
Et concernant 11 d’entre elles, la partie végétale, consommée
par les chimpanzés, est exactement celle qui entre dans la
composition des préparations médicinales traditionnelles pour
guérir des pathologies similaires : diarrhée, fièvre, malaria…
à titre d’exemples, certaines plantes utilisées par les Batooro
pour des symptômes abdominaux, comme les feuilles de Celtis
africana, de Ficus exasperata ou de Rubia cordifolia, sont également
mangées par les chimpanzés. Parfois, ces derniers ingurgitent
aussi le matin à jeun, sans les mastiquer, des feuilles de R.
cordifolia ou de Ficus exasperata, connues des villageois pour
soulager « les inconforts » ou réduire les douleurs abdominales.LES ChIMPANzÉS ET LES ÉLÉPh ANTS, MÉDECINS PAR LES PLANTES La « médecine chimpanzé » Dans le contexte scientifique et moderne, ces connaissances botaniques de l’animal ont de quoi interloquer. Mais pas pour les Batooro ! La question des compétences médicales des chimpanzés leur semble même naïve, presque stupide. Eux qui partagent depuis toujours la même forêt considère que c’est une évidence, incontestable et assumée. Les Batooro considèrent les chimpanzés comme des partenaires et reconnaissent, comme les Kasua, avoir imité leur « culture des plantes », qu’ils ont élaborée en « sélectionnant leurs aliments selon leurs besoins et leurs goûts, car ils n’aiment pas les plantes amères ou les plantes qui ont des épines ». Les chimpanzés « choisissent aussi les plantes selon leurs maladies (malaria, fièvre, infection de vers, diarrhée, blessure) ».
Batooro et chimpanzés : « s’imiter réciproquement » Les Batooro désignent d’ailleurs ces emprunts par une expression éloquente, kosibinizanga : « s’imiter réciproquement ». Ainsi, les chimpanzés ont appris de l’humain : l’usage du couteau, du rasoir, du bâton à fouir et du miroir, mais aussi la consommation des fruits et céréales issus de l’agriculture. Ils sont même allés jusqu’à reproduire les pires exactions que l’humain peut commettre, comme ce fut le cas avec cet exemple : à la suite du meurtre d’un chimpanzé juvénile, les adultes chimpanzés se sont infiltrés dans le village du meurtrier pour dérober et tuer un bébé batooro. Dans ce « jeu de miroir », expliquent les Batooro, « les chimpanzés sont durs (au sens où l’homme a du mal à les duper), car ils savent exactement ce qu’ils font ». Chez les humains, l’inverse est bien sûr tout aussi vrai. Les Batooro reconnaissent avoir beaucoup emprunté aux chimpanzés en utilisant par exemple la racine de l’arbre katimboro à des fins aphrodisiaques après les avoir vus déraciner sa base et mastiquer son extrait avant de s’accoupler. Ils ont découvert certains fruits en observant les chimpanzés, comme l’extraction du palmier Phoenix reclinata, dont les singes se concoctent une boisson qui provoque une certaine ivresse. Selon cette logique, on peut aussi se demander si l’eau ou le sel végétal que les Batooro adjoignent systématiquement à la préparation de leurs remèdes afin d’atténuer la toxicité ou l’amertume des plantes kifunu ne relève pas d’un réflexe également emprunté aux chimpanzés. Ces derniers sont en effet connus pour concocter de telles mixtures. Cependant, les chimpanzés « utilisent la terre, car ils n’ont pas accès à l’eau aussi facilement que les humains ». Ces découvertes sur la « médecine chimpanzé » sont d’autant plus importantes qu’elles reposent sur le devenir fragile des chimpanzés dans la forêt de Kibale. Mais aussi sur l’avenir des Batooro, qui sont aujourd’hui exclus du parc national de Kibale et ne peuvent plus pénétrer dans la forêt pour observer la faune. On peut craindre qu’ils finissent par perdre leurs connaissances des plantes forestières et que ce savoir partagé
avec les chimpanzés, témoin d’une histoire commune riche et complexe, disparaisse. Ce travail sur la culture médicinale des chimpanzés et sur ce qu’elle a apporté aux humains pose aussi la question éthique et juridique de la dette que nous avons vis-à- vis des animaux.
La pharmacopée des éléphants
Les recherches récentes sur les relations intimes que nouent les
cornacs (appelés aussi mahouts) avec les éléphants en Asie du
Sud-Est, plus particulièrement en Thaïlande et au Laos, nous
apportent de nouveaux exemples de la capacité des animaux à se
soigner et à partager leur pharmacopée végétale avec les hommes
qui prennent soin de leur quotidien. Leurs vies sont d’ailleurs
complètement entremêlées, enchevêtrées et participent ensemble
des relations au monde des esprits, ceux du village comme ceux
de la forêt. La particularité de cette relation interspécifique est
multiple.
Tout d’abord, elle s’inscrit exceptionnellement dans la
durée, car l’espérance de vie des éléphants ( jusqu’à 48 ans
pour l’éléphant d’Asie) explique leur intégration dans le domus
familial, villageois et spirituel. Ces animaux aident les humains
pour le transport des denrées récoltées ou des personnes, le
travail dans les champs ou en forêt. En échange, les cornacs leur
offrent nourriture, soins et offrandes pour éviter que l’éléphant
ne marronne, c’est-à-dire se détache de son soigneur et regagne la
forêt d’où il est originaire. Cette relation de proximité est en effet
discontinue : né et capturé dans la forêt, il peut certes marronner,
mais, surtout, l’homme le laisse repartir en forêt quand la saison
des travaux agricoles est achevée. Là, il retrouve ses congénères
pour un temps. La relation liant les cornacs aux éléphants est
donc tout à fait atypique, et se démarque par l’investissement
cognitif, émotionnel, sensuel, affectif et éthologique dont les
cornacs et les éléphants sont pleinement acteurs. C’est au travers
de cette étroite intimité et sous l’œil protecteur des esprits que
l’observation réciproque des comportements prend place. Elle
produit des connaissances interspécifiques, des partages comme
des transferts de l’un à l’autre.Les soins aux éléphants
et leur automédication
Dans les villages Tai-Lue, au nord-ouest du Laos, ethnographiés
par Nicolas Laisné, chaque éléphant est considéré comme
appartenant au foyer de son propriétaire, dont il est membre
à part entière. Son mahout et son propriétaire ont une grande
expérience, et prennent soin de lui grâce à un ensemble de
préparations transmises de manière informelle de génération
en génération par les membres de leurs familles. Pour des maux
plus complexes, ils peuvent faire appel à des spécialistes : les
mo, dont certains travaillent par incantations, les mo phi, qui
utilisent des préparations à base de plantes, le mo ya. Comme
l’avait expliqué Richard Pottier (2007), il faut donc distinguer
la médecine rituelle (le mo phi) et la médecine des remèdes (le
mo ya).
Les mo phi interviennent dans les principaux événements
qui jalonnent la vie des éléphants. Par exemple, à l’occasion du
Nouvel An (pi mai), quand on célèbre la cérémonie du baci pour
remercier les éléphants des services rendus avant de les relâcher
dans les forêts environnantes pendant la saison des pluies.
Quant aux médecins des remèdes, ils possèdent des codex
thérapeutiques – appelés tamla ya – où sont inscrites les
compositions de plantes pour les soins quotidiens des animaux :
constipation, circulation, irritations cutanées, perte d’appétit ou
autres signes de faiblesse.
Puisant dans leur environnement immédiat et tenant compte
de l’état de santé des animaux, les communautés locales ont ainsi
développé des savoirs médicaux singuliers. Mais elles témoignent
aussi de la riche connaissance qu’ont les éléphants de la forêt,
qui vont y chercher des végétaux spécifiques (écorces, feuilles,
racines, fruits…) pour se nourrir et se soigner. Aussi, dans les
villages Tai-Lue, on respecte le savoir des éléphants, considérés
comme capables de se soigner sans l’humain et de compléter,
si nécessaire, l’alimentation donnée par leurs cornacs, grâceà l’abondante diversité des espaces qu’ils parcourent en leur
compagnie.
Pour nombre de cornacs, la forêt est l’équivalent d’une
pharmacie, mais aussi le lieu où l’éléphant est en bonne santé.
Une autre étude auprès et avec des cornacs Tai-Lao du groupe
linguistique Tai, dans la province de Sayaboury au Laos,
menée par jean-Marc Dubost, a identifié 114 plantes réparties
dans 37 familles botaniques dont une ou plusieurs parties sont
consommées par les éléphants pour remédier à des maux tels
que la diarrhée ou les problèmes cutanés. Une pratique d’autant
plus précise qu’elle est genrée : certaines plantes sont utilisées
spécifiquement par les femelles en gestation, à la suite de la mise
bas ou au cours de l’allaitement des éléphanteaux. Observant
cette automédication chez les éléphants, les cornacs ont adopté
les mêmes plantes médicinales pour prodiguer eux-mêmes des
soins vétérinaires à leurs propres éléphants.Une médecine commune
des éléphants et des humains
La richesse de ces recherches au Laos a permis de chercher
des possibles convergences d’usage des plantes entre humains
et animaux. Ainsi, 15 plantes sont utilisées par les cornacs et
les éléphants pour guérir des mêmes maux, généralement
gastriques et intestinaux. Elles ont aussi observé des parallèles
entre l’usage qu’ont les éléphants de leurs excréments et celui des
cornacs Tai-Lao. Ces derniers récupèrent l’urine et les bouses,
particulièrement riches grâce à la diversité des plantes sauvages
qu’ils ingèrent. Si l’urine est surtout employée pour guérir le
diabète et les otites, la bouse ou encore le couvain aménagé par
le coléoptère Heliocopris servent à soigner les troubles gastro-
intestinaux ou les problèmes cutanés.
Une autre étude a interrogé des guérisseurs pour évaluer
les points communs entre leur pharmacopée et les plantes
médicinales utilisées par les éléphants. Les résultats sont
éloquents : sur les 114 espèces consommées par les éléphants,
72 font partie de leur pharmacopée. Mais leur usage n’obéit pas
toujours au même but : 12 plantes seulement sont utilisées pour
soigner la même pathologie. De même, si nous retrouvons la
racine d’H. perforata dans la pharmacopée des guérisseurs, des
cornacs et des éléphants, seuls les deux derniers s’en servent
pour guérir une diarrhée.
Cette information conforte incontestablement la piste d’un
transfert de connaissances par l’observation entre les cornacs et
les éléphants, et toute la culture de l’attention et du soin qui en
découle. La question de la réciproque reste entière : ne peut-on
pas supposer un éventuel transfert des hommes vers les éléphants
domestiqués, lesquels lors de leur relâche en forêt pourraient
partager avec leurs congénères sauvages ce que les cornacs leur
ont appris au cours de leur coexistence et des soins prodigués ?
Cette triangulation circulaire, attestée par Laisné à partir de son
ethnographie auprès des Tai-Lue, exigerait alors de repenser nos
connaissances. Car il ne s’agirait plus de préserver une espèce etson savoir, mais bien « une communauté hybride en termes de
patrimoines interspécifiques dynamiques ». Ce qui constituerait
selon ce chercheur une arme épistémologique pour comprendre
ce qui se joue dans les zoonoses. Ce sont des maladies très variées
qui se transmettent entre les animaux et les humains via l’eau,
la nourriture, etc. On trouve, par exemple, la salmonellose, la
grippe aviaire, le coronavirus…
Nous devons donc développer de nouvelles approches,
notamment dans le domaine de l’élevage. L’étude des relations
entre éleveurs et animaux pourrait apporter les éclairages
nécessaires à une meilleure surveillance des maladies et à leur
traitement afin de (re)construire la pharmacopée vétérinaire
locale, en prenant en compte les savoirs scientifiques vétérinaires,
les savoirs locaux et les savoirs possédés par les animaux capables
d’automédication.
Ces travaux en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Afrique et en
Asie remettent ainsi en cause le concept occidental de médecine,
qui considère que seul l’homme, plus particulièrement le savant,
détient la capacité de réfléchir pour diagnostiquer et soulager
des pathologies. Déjà, en 1969, hubert Gillet écrit pour son
cours d’ethnobotanique au Muséum d’histoire naturelle de
Paris sur le comportement alimentaire des animaux sauvages
qu’« il est possible que l’observation, faite par certains indigènes,
de l’enlèvement occasionnel de certaines écorces d’arbres de la
savane africaine ait attiré leur attention sur ces arbres comme
plantes médicinales ». Dans le même registre, A-G. haudricourt
ne se demandait-il pas en 1987 si « les hommes n’avaient pas
été éduqués par les animaux qu’ils côtoient » ? Assumer cette
possibilité remet bien sûr en cause le concept occidental de
médecine et son arrogance. Pour reconnaître une médecine
« chimpanzé », « marsupiale » ou encore « éléphantesque », nous
sommes aujourd’hui contraints de renoncer aux pratiques des
Modernes pour constater des similitudes entre les humains et les
animaux que l’anthropocentrisme assumé de notre médecine
ne permettait pas de voir ni même d’envisager.Vous pouvez aussi lire