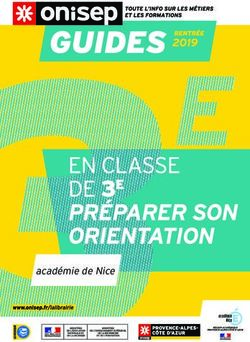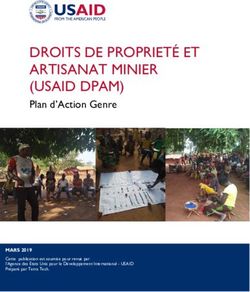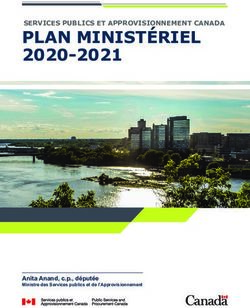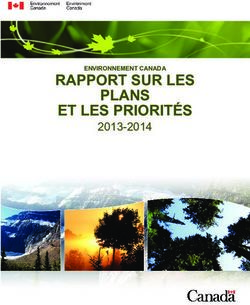Marais de Chevilly Plan de gestion - GRÉSY-SUR-AIX - Pôle Gestion des Milieux Naturels
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Marais de Chevilly
Mai 2016
Plan de gestion
Commune de GRÉSY-SUR-AIX
GRÉSY
Département de la SavoieAvant-propos
Localisé à l’est du massif des Bauges, à cheval sur les départements de la Savoie et de la Haute-
Savoie, l’Albanais est une région vallonnée et bocagère dont l’un des intérêts écologiques majeurs
repose sur ses zones humides. Aussi, 43 d’entre elles (dont 13 sites savoyards) ont été intégrées au
réseau écologique européen “Natura 2000” dont la finalité est la sauvegarde des habitats naturels
et des espèces les plus menacés de l’Union européenne.
Le marais de Chevilly est l'une des dernières zones humides importantes de l'Albanais
savoyard. Il fait partie de ce site Natura 2000 intitulé “réseau de zones humides de l'Albanais”. Le
document d’objectifs de ce site, validé en Comité de pilotage en décembre 2004, est composé
d’une partie générale et d’une partie “documents d’application” propre à chaque zone humide,
qu’actualise le présent plan de gestion.
A partir de 1995, le Conservatoire a engagé une démarche de restauration des marais de
l’Albanais, après les étangs de Crosagny, le marais de Chevilly a été le 2e site pour lequel
collectivités et Conservatoire se sont associés pour établir un plan de gestion (avril 2001) et définir
les actions de restauration et d’entretien à entreprendre.
Plus de dix ans après la rédaction du premier plan de gestion et du document d’application
(2003), la rédaction d’un plan de gestion actualisé s’avérait nécessaire afin :
• d’intégrer dans ce document l’ensemble des données actualisées dont on dispose et
des évolutions constatées depuis quinze ans : données habitats / flore / faune, actions
de gestion et de suivi menées, état de conservation des milieux/espèces, usages sur le
site…
• actualiser les objectifs de gestion et les opérations à mener en tenant compte des
données actualisées.
Des fiches-actions seront rédigées dans un 2e temps pour décliner les objectifs et les modalités
de gestion sur la base du parcellaire maîtrisé, suite aux résultats du complément d’animation
foncière initié fin 2015
oOo
Ce document est principalement à destination :
• des membres de l’équipe intervenant sur le site,
• des financeurs,
• des scientifiques (universitaires, membres d’un conseil scientifique…).
Un document dénommé “plan de gestion synthétique” est également produit à l’intention
d’un plus large public (propriétaires, commune…).
1
P LAN DE GESTION DU MARAIS DE C HEVILLY (G RESY - SUR -A IX ), 2016 – CEN S AVOIESommaire
1. PRESENTATION GENERALE DU SITE............................................................................... 5
1.1. LOCALISATION ET DESCRIPTION SOMMAIRE ................................................................................. 5
1.2. STATUTS ET ZONAGES ENVIRONNEMENTAUX ............................................................................... 5
1.2.1. Document d’urbanisme .............................................................................................. 5
1.2.2. Statut foncier .............................................................................................................. 7
1.2.3. Zonages environnementaux et paysagers.................................................................. 7
1.3. LIEN AVEC LES PROCEDURES TERRITORIALES ET LOCALES .............................................................. 11
1.3.1. Contrat de bassin versant “lac du Bourget” ............................................................. 11
2. ETAT DES LIEUX ET ENJEUX ......................................................................................... 12
2.1. DYNAMIQUE DE FONCTIONNEMENT ........................................................................................ 12
2.1.1. Approche historique de la connaissance du site ...................................................... 12
2.1.2. Paramètres abiotiques influençant la dynamique du milieu.................................... 12
2.1.3. Activités socio-économiques sur le site .................................................................... 15
2.1.4. Atteintes au milieu ................................................................................................... 18
2.1.5. Historique de la gestion du site par le CEN Savoie ................................................... 20
2.2. PATRIMOINE NATUREL : BILAN ET EVALUATION.......................................................................... 23
2.2.1. Habitats naturels et état de conservation................................................................ 23
2.2.2. Espèces patrimoniales .............................................................................................. 31
2.2.3. Synthèse des enjeux ................................................................................................. 38
2.3. SERVICES ECOLOGIQUES (OU AUTRES) RENDUS PAR LE SITE .......................................................... 39
2.3.1. Services d’approvisionnement .................................................................................. 39
2.3.2. Services de régulation .............................................................................................. 39
2.3.3. Services à caractère social........................................................................................ 39
2.4. CAPACITE DU SITE A ACCUEILLIR DU PUBLIC ............................................................................... 40
3. OBJECTIFS .................................................................................................................. 41
3.1. OBJECTIFS A LONG TERME : PRINCIPES GENERAUX ...................................................................... 41
3.1.1. Conservation des habitats et des espèces ................................................................ 41
3.1.2. Amélioration des connaissances et du fonctionnement des habitats ...................... 41
3.1.3. Pédagogie ................................................................................................................. 41
3.2. OBJECTIFS POUR LA DUREE DU PLAN DE GESTION ....................................................................... 45
4. ACTIONS ENVISAGEES ................................................................................................ 47
4.1. MAITRISE FONCIERE ET D’USAGE ............................................................................................. 47
4.2. OPERATIONS DE GESTION ...................................................................................................... 49
4.2.1. Non-intervention / libre évolution ............................................................................ 49
4.2.2. Travaux de restauration et de création de milieux .................................................. 49
4.2.3. Travaux d’entretien .................................................................................................. 50
4.2.4. Gestion des invasives................................................................................................ 50
4.2.5. Ramassage et évacuation des déchets..................................................................... 50
4.3. AMELIORATION DES CONNAISSANCES ...................................................................................... 51
4.3.1. Étude “biodiversité” des boisements en libre évolution ........................................... 51
4.3.2. Étude de la population d’écrevisse à pieds blancs ................................................... 51
4.3.3. Suivi scientifiques et écologiques ............................................................................. 51
4.4. ANIMATION AGRICOLE .......................................................................................................... 51
2
P LAN DE GESTION DU MARAIS DE C HEVILLY (G RESY - SUR -A IX ), 2016 – CEN S AVOIE4.5. SENSIBILISATION/COMMUNICATION ........................................................................................ 52
4.5.1. Actions pédagogiques .............................................................................................. 52
4.5.2. Communication sur les actions menées ................................................................... 52
4.6. COORDINATION, ANIMATION ET SUIVI ADMINISTRATIF DU PLAN DE GESTION .................................. 52
5. ANNEXES ................................................................................................................... 53
ANNEXE 1 : LES ZONES HUMIDES DE L’ALBANAIS ................................................................................. 54
ANNEXE 2 : FLORE DU MARAIS DE CHEVILLY ........................................................................................ 55
ANNEXE 3 : FAUNE DE CHEVILLY ....................................................................................................... 62
ANNEXE 4 : 43 SERVICES RENDUS PAR LES ECOSYSTEMES EN FRANCE ...................................................... 65
ANNEXE 5 : GRILLE DE CLASSEMENT POUR LE POTENTIEL “ACCUEIL DU PUBLIC” DU SITE DE CHEVILLY ............ 66
3
P LAN DE GESTION DU MARAIS DE C HEVILLY (G RESY - SUR -A IX ), 2016 – CEN S AVOIE4
P LAN DE GESTION DU MARAIS DE C HEVILLY (G RESY - SUR -A IX ), 2016 – CEN S AVOIE1. Présentation générale du site
1.1. Localisation et description sommaire
cf. carte 1 p. 4
Localisé à 335 mètres d'altitude sur la commune de Grésy-sur-Aix, le marais de Chevilly est une
zone humide d’une surface de 7 hectares environ. Il se situe dans le bassin versant du lac du
Bourget, entre l’autoroute A41 à l’ouest, la route départementale RD49 à l’est, le hameau de Droise
au nord et celui des Mellets au sud.
Ce marais périurbain s’inscrit dans un secteur agricole intensif orienté vers la maïsiculture. Il
est fortement dominé par des roselières dont une partie est en voie de colonisation par les ligneux.
Il bénéficie d'une bonne alimentation en eau, régulière et importante, ce qui lui confère de fortes
potentialités biologiques mais en même temps des difficultés de gestion : seuls 2 hectares environ
sont fauchés annuellement par le CEN Savoie
Le périmètre de l’étude “plan de gestion” s’étend au-delà du marais à sa proche périphérie et
concerne une surface de 15,88 hectares.
1.2. Statuts et zonages environnementaux
1.2.1. Document d’urbanisme
1.2.1.1. SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT)
La commune de Grésy-sur-Aix se situe dans le périmètre du SCOT de Métropole Savoie. Le
marais de Chevilly est classé en “espace naturel à protéger”, le reste du périmètre du plan de
gestion ainsi que ses abords proches sont classés en “agricole protégé” et en partie en “paysage
protégé”.
1.2.1.2. Plan local d’urbanisme (PLU)
Cf. carte 2 p. 6
Le cœur du site correspondant au marais est classé en zone naturelle “secteur de marais ou de
zones humides faisant l’objet d’une forte protection”(NH), pour une surface de 7,5 ha. À sa
périphérie, les parcelles sont classées en zone agricole “à enjeux paysagers où toute nouvelle
construction est interdite” (As), pour une surface de 7,55 ha ; 4 parcelles ou partie de parcelles
(0,01 ha) sont classées en zone urbaine à “habitat de densité faible” (UD).
Zonage A NH UD
Surface 7,57 ha 7,94 ha 0,40 ha
Proportion du périmètre d’étude 49,6 % 49,9 % 2,5 %
5
P LAN DE GESTION DU MARAIS DE C HEVILLY (G RESY - SUR -A IX ), 2016 – CEN S AVOIE6
P LAN DE GESTION DU MARAIS DE C HEVILLY (G RESY - SUR -A IX ), 2016 – CEN S AVOIE1.2.2. Statut foncier
Cf. carte 3 p. 8
Le périmètre du plan de gestion comprend 71 parcelles situées sur le territoire communal de
Grésy-sur-Aix, dont 17 (en gras dans la liste ci-dessous) sont incluses dans le site “marais de
Chevilly” (Cf. périmètre délimité en orange dans la carte 3) :
Section B : 334, 335, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354,
355, 356, 357, 358, 359, 370, 371, 372, 373, 374, 377, 378, 379, 381, 385, 386, 388, 391, 393, 531, 532, 534,
535, 536, 537, 539, 546, 548, 549, 830, 831, 1771, 1772, 1776, 1782, 1784, 1786, 1794, 1940, 1943, 1945,
1946, 1947, 1948, 1949, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2027, 2028
Le marais de Chevilly est l’un des premiers sites d'intervention foncière du CEN Savoie ; en
1992, la première intervention foncière a permis une acquisition par le CEN et la signature de sept
conventions d’usage. En 1999, une opportunité foncière se traduit par l’acquisition d’une nouvelle
parcelle et de deux parcelles en convention.
Fin 2015, des contacts ont été pris avec les propriétaires privés des parcelles restant sans
maîtrise foncière ni d’usage par le CEN dans la zone humide (parcelles B342, 343, 344, 345, 350,
351, 831), afin de compléter la MFU ; cette animation s’est soldée par le renouvellement d’une
convention expirée (1996-2007) sur la parcelle B343, ainsi que par l’acquisition en cours de la
parcelle B350 (parcelle qui a fait l’objet d’une convention avec le CEN entre 1993 et 2004).
Aujourd’hui, la maîtrise foncière et d’usage du CEN s’établit à :
• 4 parcelles en propriété (B 341, 346, 348, 353), soit 1 ha 84 a 90 ca ;
• 1 parcelle en cours d’acquisition (B350), soit 15 a 40 ca ;
• 7 parcelles en convention (B343, 347, 349, 352, 534, 1784, 1794), soit 3 ha 71 a 54 ca.
Soit, 5 ha 71 a 84 ca de MFU du CEN Savoie dans la zone humide
1.2.3. Zonages environnementaux et paysagers
Cf. carte 4 p. 10
1.2.3.1. Inventaires scientifiques
• Inventaire ZNIEFF
Le marais de Chevilly constitue la ZNIEFF de type I n° 73050002 intitulé “marais de Chevilly”.
• Inventaire départemental des zones humides
Le marais de Chevilly, situé au cœur du périmètre d’étude, est une zone humide d’intérêt
départemental, inscrite à l’inventaire départemental des zones humides, réalisé en 2004-05 pour le
territoire du Lac du Bourget et ses montagnes (identifiant 73CPNS0032).
D’autres zones humides sont présentes dans le secteur :
• située de l’autre côté de l’autoroute :
o à 600 m à l’ouest, “la plaine du Cran” (73CPNS0028) ;
o à environ 300 m au sud-ouest, “Coudurier, côté voie ferrée” (73CPNS0030) et
“Coudurier en bordure de la Deisse” (73CPNS0031)
• à 600 m au nord : “Droise” (73 CPNS0033) ;
• et à 2 km à vol d’oiseau au nord-est, le “marais des Ires” (73CPNS0060), une zone
humide d’intérêt départemental gérée par le CEN Savoie.
7
P LAN DE GESTION DU MARAIS DE C HEVILLY (G RESY - SUR -A IX ), 2016 – CEN S AVOIE8
P LAN DE GESTION DU MARAIS DE C HEVILLY (G RESY - SUR -A IX ), 2016 – CEN S AVOIE• Corridors biologiques
Les corridors sont des connexions entre les réservoirs de biodiversité. Le marais de Chevilly est
inclus dans un des corridors biologiques inventoriés à l’échelle savoyarde. Celui-ci relie la
montagne de la Chambotte, englobe les zones humides citées précédemment et rejoint les gorges
du Sierroz, celles-ci étant directement connectées au massif des Bauges.
1.2.3.2. Protection contractuelle
• Natura 2000
Le marais de Chevilly est rattaché au site Natura 2000 S10 “Réseau de zones humides de
l’Albanais” (n°8201772) depuis le 22 décembre 2003, dont l’opérateur depuis 2007 est le SIGEA
(Syndicat intercommunal de gestion des étangs de l’Albanais). Il est l’un des 13 marais savoyards
qui composent ce réseau, dont deux à 2 km au nord-est et au nord : marais des Ires (communes
d’Épersy et Mognard) et marais de la Deisse (communes de St Girod et Albens).
Le marais de Chevilly au sein du réseau de zones humides de l’Albanais
(Voir carte des zones humides de l’Albanais en annexe 1 p. 54)
L’écriture des plans de gestion lorsqu’elle s’applique à des sites inscrits au réseau NATURA
2000 doit tenir compte des éléments naturels remarquables présents, mais aussi intégrer les
obligations découlant de l’application de la Directive Habitats, Faune, Flore (articles 6 et 10) portant
sur les éléments paysagers extérieurs au site et garants du maintien de ses fonctionnalités
écologiques, et prioritairement le maintien des connexions entre sites.
Qu’en est-il des marais du réseau de zones humides de l’Albanais ?
Ce réseau riche de 43 sites couvre une surface de 606 ha, soit à peine 2 % de la surface du
territoire, et s’étend sur plus de 30 km, depuis le marais des Vorges au nord (en Haute-Savoie)
jusqu'au Marais des Saveux au sud (Drumettaz-Clarafond en Savoie). Avec des surfaces aussi
réduites sur un étalement aussi important, -l’éloignement entre marais atteint parfois plusieurs
kilomètres-, le maintien des connectivités entre eux est prioritaire pour la conservation du réseau.
Aussi, toutes les zones humides situées dans ce périmètre, si petites soient-elles et malgré leur
intérêt écologique parfois faible, participent de près ou de loin à la cohérence du réseau, dont le
maintien conditionne à plus ou moins brève échéance leur préservation. La stricte conservation de
ces zones humides ne suffira pas, encore faut-il conserver entre elles un minimum de trame verte
et notamment bocagère pour permettre les échanges et la dispersion des espèces de faune
comme de flore.
Aujourd’hui, après dix ans de mise en œuvre de la Directive Habitats dans l’Albanais, force est
de constater que non seulement les conditions d’échanges entre les sites n’ont cessé de se
dégrader, mais que les menaces se font de plus en plus fortes. Les zones humides continuent d’être
impactées (remblaiement, urbanisation), qu’elles soient ou non dans le réseau Natura 2000, ainsi
que la trame verte qui risque d’être interrompue par endroits, isolant les marais et les condamnant
à s’appauvrir.
9
P LAN DE GESTION DU MARAIS DE C HEVILLY (G RESY - SUR -A IX ), 2016 – CEN S AVOIE10
P LAN DE GESTION DU MARAIS DE C HEVILLY (G RESY - SUR -A IX ), 2016 – CEN S AVOIE• Site Conservatoire
Le CEN Savoie gère ce marais depuis plus de 20 ans. Les premiers travaux de restauration en
1992 ont consisté à restaurer la végétation (débroussaillage, bûcheronnage et dessouchage), et à
restaurer le principal ruisseau alimentant le marais. Le Conservatoire y mène régulièrement des
inventaires et suivis scientifiques (Cf. § 2.1.5 p.20).
1.2.3.3. Autre statut environnemental
• Réserve de chasse
Le marais de Chevilly est intégralement classé en réserve communale de chasse.
1.3. Lien avec les procédures territoriales et locales
1.3.1. Contrat de bassin versant “lac du Bourget”
Cet outil technique et financier fixe les grands objectifs de gestion intégrée de l’eau sur le
bassin versant du lac du Bourget, en cohérence avec la Directive cadre européenne sur l’eau et le
SDAGE.
Ce deuxième contrat en cours (2011-2017) permet de pallier aux difficultés rencontrées
actuellement pour mobiliser les financements liés aux contrats Natura 2000. En 2016, une
opération de fauche avec exportation a été inscrite au titre de la fiche-action B1b-1 du volet
“entretien des zones humides” en faveur du marais de Chevilly.
11
P LAN DE GESTION DU MARAIS DE C HEVILLY (G RESY - SUR -A IX ), 2016 – CEN S AVOIE2. Etat des lieux et enjeux
Le marais de Chevilly est un des marais les plus remarquables de l’Albanais savoyard. Son
intérêt biologique est mis en évidence en 1983. Il héberge un cortège d’espèces patrimoniales,
dont certaines de la directive Habitats qu’il convient de préserver par une gestion adaptée. Il
bénéficie d'une bonne alimentation en eau, régulière et importante, ce qui lui confère de fortes
potentialités biologiques mais en même temps des difficultés de gestion.
2.1. Dynamique de fonctionnement
2.1.1. Approche historique de la connaissance du site
Fauché manuellement jusque dans les années 1960, le marais présente à l’époque un aspect
de prairies humides ouvertes avec un fossé de drainage central. L’abandon progressif de la fauche
dans les années 1970 à 1990 a conduit au développement du roseau et au comblement du drain.
Encore aujourd’hui, le marais de Chevilly n’est plus exploité à des fins agricoles. En revanche, le
Conservatoire gère une partie du site depuis 1992 (Cf. § 2.1.5, p. 20).
La comparaison des photographies aériennes de 1971 et 2013 (Cf. photos p. 13) est révélatrice
des changements opérés sur ce site en plus de 40 ans.
Dans le marais, les changements portent essentiellement sur le développement des ligneux.
En 1971, certains secteurs du marais sont encore exploités et la présence des ligneux se résume à
quelques haies.
C’est à l’extérieur du marais que les évolutions sont les plus flagrantes, avec d’une part
l’accroissement important de l’urbanisation avec :
• à l’ouest la construction de l’autoroute A41 à la fin des années 1970,
• au sud le développement des hameaux de Les Mellets, le Fontanil et Arbussin ;
• et au nord, à la Biolle, le long de la route D1201.
D’autre part, le paysage agricole dans lequel s’inscrit le marais passe d’une multitude de
petites parcelles diversement exploitées à de grands ensembles orientés principalement vers la
maïsiculture.
2.1.2. Paramètres abiotiques influençant la dynamique du milieu
2.1.2.1. Géologie1
Le marais se situe sur une vaste étendue molassique s’étendant entre Rumilly, Annecy et
Albens et qui atteint au sud la dépression du lac du Bourget au niveau d’Aix-les-Bains. Cette
molasse, plissée lors de la mise en place des chaînons jurassiens, a créé les collines et dépressions à
l’origine du relief de l’Albanais. Au quaternaire, une couverture d’alluvions s’est déposée sur cette
molasse. Lors des phases d’érosion glaciaire, ces alluvions se sont maintenues au niveau des
dépressions alors qu’elles ont été décapées au niveau des collines environnantes, provoquant à
nouveau l’affleurement de la molasse.
1
Texte extrait du plan de gestion de 2001
12
P LAN DE GESTION DU MARAIS DE C HEVILLY (G RESY - SUR -A IX ), 2016 – CEN S AVOIEIllustration 1 : Photo-comparaison du site de Chevilly : 1973 / 2013
13
P LAN DE GESTION DU MARAIS DE C HEVILLY (G RESY - SUR -A IX ), 2016 – CEN S AVOIELes couches de surface du marais sont constituées par un mélange de tourbes (dépôts
lacustres), d’argiles fines issues du retrait glaciaire et de sables entraînés depuis les collines par
ruissellement. Le profil ci-dessous résulte d’une coupe réalisée d’après la carte géologique et ses
ordres de grandeur sont donc à considérer à titre indicatif.
Succession de couches
désordonnées de graviers,
tourbe, sables et argiles sur
une épaisseur de 2 m
Couche assez imperméable
d’environ 2 m, composée
d'argiles tourbeuses
contenant des galets et des
blocs
Socle rocheux de molasse,
imperméable.
Illustration 2 : Coupe pédologique du marais de Chevilly,
d'après F. CHAZARENC, 1999)
2.1.2.2. Hydro-pédologie1
Le marais de Chevilly se situe en fond de vallon, dans le sous-bassin versant du Sierroz, lui-
même inclus dans le bassin versant du lac du Bourget.
Cette zone humide de tête de bassin versant est installée sur des dépôts glaciaires remaniés
appelés “Kame”, sous lesquels se trouve un substratum molassique et morainique imperméable.
Dans une telle configuration, les formations de kame, très perméables, jouent un rôle d’aquifère. Le
niveau d’eau dans le marais est tel qu’il est souvent saturé en eau.
Un sondage pédologique de 90 cm de profondeur a été réalisé en 2009 au centre ouest du
marais ; les résultats présentés ci-après révèlent une faible épaisseur de tourbe (10 cm).
Illustration 3 : Sondage pédologique réalisé au marais en 2009
1 D’après Poinard A. & Ramello P., 2009
14
P LAN DE GESTION DU MARAIS DE C HEVILLY (G RESY - SUR -A IX ), 2016 – CEN S AVOIE• Fonctionnement hydrologique
Cf. carte 5 p.16
Le proche bassin versant, collectant les eaux de surface, représente une centaine d’hectares
situés à 90 % à l’est du site. La zone humide de Chevilly est principalement alimentée par une
source, sous forme de ruissellements diffus et par apports canalisés. Les eaux parvenant au marais
s’infiltrent pour partie jusqu’à la couche d’argile puis s’écoulent gravitairement vers le sud. Deux
apports bien localisés sont issus : d’un petit fossé amenant les eaux d’une source située sur le
versant au nord-est du site et d’un autre petit fossé situé à l’est et collectant les ruissellements
diffus de pente. Un petit ruisseau à faible débit s’écoule dans le marais et constitue au sud l’unique
exutoire du site. Quelques petits ruisselets bien conservés s’écoulent dans les boisements d’aulne.
Au fond du vallon, un ancien drain est aujourd’hui comblé en grande partie par la litière de
roseaux qui ralentit les écoulements. Devenu très peu fonctionnel, ce système de drainage n’exerce
plus aujourd’hui qu’un impact très modéré, voire nul, sur le niveau hydrique du marais.
Si en période pluvieuse, on observe une saturation totale des sols en eau, des sondages
pédologiques réalisés en août 2000 ont montré un enfoncement de la nappe oscillant entre 0,60 et
1,30 m.
• Qualité physico-chimique de l’eau
Bénéficiant d’un bassin versant très peu urbanisé, le marais de Chevilly ne souffre pas de rejets
d’eaux usées. En revanche, l’existence d’un secteur fortement atterri et eutrophisé (colonisé par
orties et graminées neutrophiles), à la sortie du fossé collectant les eaux du versant est, laissent
présager d’importantes quantités d’intrants en provenance des cultures périphériques et
alimentant probablement le marais.
De nouvelles analyses d’eau seraient à réaliser dans le marais pour évaluer l’impact de la
maïsiculture périphérique sur la qualité de l’eau alimentant le site.
2.1.3. Activités socio-économiques sur le site
Cf. Carte n° 6 p. 19
2.1.3.1. Agriculture
Le marais n’est plus exploité à des fins agricoles depuis plusieurs décennies, mais la blache des
parcelles fauchées par le CEN Savoie est toutefois valorisée auprès d’éleveurs locaux.
En revanche, l’agriculture est omniprésente dans toute la périphérie du marais, dans le
périmètre d’étude comme dans le proche bassin versant du site, hormis au sud où le hameau des
Mellets accueille un habitat de type résidentiel.
L’agriculture pratiquée se caractérise par la très forte prédominance de la maïsiculture.
Quelques parcelles sont exploitées en céréales (blé tendre notamment). Quelques hectares de
prairies temporaires et de prairies permanentes, ainsi qu’une trentaine d’ares voués à la culture de
petits fruits (cassis, groseilles, fraises) complètent ce panorama (Cf. carte n°6). Entre les cultures,
certaines parcelles cultivées accueillent des engrais verts qui permettent à la fois de limiter
l’érosion de sols et d’absorber les nitrates. (Cf . § Habitats/Terres agricoles, p. 28).
15
P LAN DE GESTION DU MARAIS DE C HEVILLY (G RESY - SUR -A IX ), 2016 – CEN S AVOIE16
P LAN DE GESTION DU MARAIS DE C HEVILLY (G RESY - SUR -A IX ), 2016 – CEN S AVOIEmaïs
marais
maïs
prairie
maïs Baies et blé
Illustration 4 : Activités agricoles autour du marais (© CEN73 / V. Bourgoin)
2.1.3.2. Sports et activités de pleine nature
• Chasse
S’il ne fait l'objet d'aucun usage à finalité économique directe, la chasse apparaît comme la
dernière activité qui tire encore partie du site, mais de manière indirecte, puisqu’il est classé en
réserve de chasse communale, et sert donc de réservoir de biodiversité aux autres secteurs de la
commune.
L’état actuel du marais semble particulièrement favorable au gros gibier : sanglier, chevreuil,
renard et beaucoup moins au petit gibier de type bécassine, inféodé aux prairies humides
régulièrement fauchées.
• Promenade, randonnée
Situé à proximité de l’agglomération d’Aix-les-Bains / Grésy-sur-Aix, le marais présente une
valeur sociale et culturelle non négligeable et malgré son inaccessibilité aux promeneurs, les
alentours du site (chemins agricoles, RD49) sont fréquentés par les VTTistes, les cyclistes et les
promeneurs notamment.
17
P LAN DE GESTION DU MARAIS DE C HEVILLY (G RESY - SUR -A IX ), 2016 – CEN S AVOIE2.1.4. Atteintes au milieu
2.1.4.1. Pollutions
Pollutio
Des sources de pollution de plusieurs natures impactent le marais.
Plusieurs dépôts sauvages de déchets ont été constatés,, par endroit sur plus d’un mètre de
hauteur, principalement au sud-est
sud est du site. Ils se situent plus précisément à l’abri des regards,
regard dans
le boisement qui délimite le marais et accueillent des déchets tels que : branchages et autres
déchets verts, caisse en bois, pots métalliques, plastiques divers, tuiles...
tuiles..
Un secteur a également fait l’objet de dépôts de déblais (Cf.( Illustrationss ci-après).
Illustration 5 : dépôts sauvages dans les boisements du site (© CEN73 / V. Bourgoin)
2.1.4.2. Plantes invasives
Plusieurs espèces de plantes invasives ont été recensées sur le site : solidage géant,
impatience de l’Himalaya, laurier-cerise.
laurier . Le solidage géant est l’invasive la plus représentée sur le
site en termes de surface colonisée,
colonisée, même si le marais de Chevilly n’est globalement pas dans un
état de conservation préoccupant par rapport à cette invasive, du fait
fait de la gestion menée par le
CEN Savoie depuis 1992.
La présence des autres invasives est beaucoup plus anecdotique et doit faire l’objet d’une
éradication dès lors que leur présence reste modérée :
• un foyer d’impatience de l’Himalaya se situe au bord de la route et sera facilement
enrayé s’il est géré rapidement ; il ne s’étendra pas si la gestion par fauche perdure ;
• quelques pieds de laurier-cerise
laurier se situent dans les boisements ts au sud du site ;
• à noter quelques pieds de cassis dans la roselière.
18
P LAN DE GESTION DU MARAIS
MA DE C HEVILLY (G RESY - SUR -A IX ), 2016 – CEN S AVOIE19 P LAN DE GESTION DU MARAIS DE C HEVILLY (G RESY - SUR -A IX ), 2016 – CEN S AVOIE
2.1.5. Historique de la gestion du site par le CEN Savoie
• Opération de restauration et d’entretien
Le CEN Savoie1 (Conservatoire d’Espaces Naturels), association loi 1901 au service de la
biodiversité savoyarde, créé en 1991, intervient sur le marais de Chevilly depuis 1992.
Non entretenu depuis près de 25 ans à l’époque de la prise de gestion par le CEN, le marais a
nécessité au préalable une phase de restauration lourde. L'objectif initial était d'augmenter la
superficie des habitats herbacés hygrophiles, ces opérations ont donc consisté à :
• débroussailler par gyrobroyage 4,3 ha de roselière, fourrés à bourdaines et saulaie,
• abattre et dessoucher 0,1 ha de taillis d'aulnes,
• améliorer l’alimentation du marais (nettoyage du principal ruisseau)
A partir de 1995, la faible portance des sols liée à des pluies estivales, empêche le travail des
engins dans certains secteurs du marais. Confronté à ces contraintes techniques imprévues et
difficiles à contourner en l'absence de dispositif de drainage temporaire des sols, le CEN renonce
aux objectifs de prairie humide sur ces secteurs. Ceux-ci ont depuis lors été rendus à leur
dynamique naturelle et à une vocation prioritaire de roselière, avec des enjeux avant tout
ornithologiques (rousserolle effarvatte, rousserolle verderolle et bruant des roseaux).
À partir de 1996, les objectifs de restauration n'ont donc été poursuivis que sur la partie la
moins humide, au nord du site, réduisant à environ 2 ha-2,5 ha (soit moins de 30 % du site) la
superficie susceptible d'être réhabilitée en prairies humides. Entre 1996 et 2000, cette zone a ainsi
fait l'objet d'une fauche annuelle tardive (août) ; la matière n'ayant pu être exportée que les 4
dernières années.
Le tableau ci-dessous synthétise les opérations de gestion menées depuis 2001 (Cf. Carte 6bis
p.21) sur les milieux humides ouverts (bas-marais, magnocariçaies, prairies humides et
mégaphorbiaies) :
Date
Type d’intervention Surface
d’intervention
2001 à 2004 Fauche annuelle avec exportation selon conditions météo 2,4 ha maximum
2005 Fauche avec exportation 1,31 ha
Broyage sans exportation 0,33 ha
2006 Fauche avec exportation 1,38 ha
Broyage sans exportation des secteurs habituellement
1,12 ha
fauchés
Broyage sans exportation des secteurs habituellement
2008 2,41 ha
fauchés
2009 Fauche avec exportation 2,32 ha
2010 Fauche avec exportation 1,66 ha
2011 Fauche avec exportation 0,89 ha
2012 Fauche avec exportation 0,98 ha
2013 Fauche avec exportation 1,66 ha
Non réalisée à cause des
2014 Fauche avec exportation
conditions météorologiques
Tableau 1 : Historique des interventions du CEN Savoie de 2001 à 2014
1 Cf http://www.cen-savoie.org/cen-savoie)
20
P LAN DE GESTION DU MARAIS DE C HEVILLY (G RESY - SUR -A IX ), 2016 – CEN S AVOIE• Études et suivis scientifiques
Le CEN Savoie a également mené des actions de suivis scientifiques qui ont porté sur :
• la recherche ciblée d’espèces patrimoniales : écrevisse à pieds blancs (2003/2014) ;
• des inventaires faunistiques : odonates (2009), orthoptères et rhopalocères (2000),
amphibiens (2007) ;
• des relevés floristiques (2008, 2014) et la cartographie de la flore patrimoniale (2010) ;
• le suivi de l’évolution des habitats (2010) et cartographie des habitats (2008, 2012,
2014)…
21
P LAN DE GESTION DU MARAIS DE C HEVILLY (G RESY - SUR -A IX ), 2016 – CEN S AVOIE22
P LAN DE GESTION DU MARAIS DE C HEVILLY (G RESY - SUR -A IX ), 2016 – CEN S AVOIE2.2. Patrimoine naturel : bilan et évaluation
2.2.1. Habitats naturels et état de conservation
(IC : intérêt communautaire ; IP : intérêt prioritaire)
Cf. carte n°7 p. 22
2.2.1.1. Habitats aquatiques
• Eaux courantes
Les eaux courantes du marais (Code Corine : 24.1) suivent le tracé d’un ancien fossé de
drainage abandonné, et parcourent le site du nord-est vers le sud-ouest, sur une longueur de
940 m. Il prend sa source sur le versant nord-est, longe la route et se déverse dans le marais par une
buse. Son lit traverse des roselières et des secteurs boisés humides ; en amont surtout, son état de
comblement, d’encombrement et d’ombrage rend ce milieu peu favorable à la vie aquatique, mais
opère une fonction de “lagunage” et d’épuration des eaux certainement très favorable. En
revanche, dans certains boisements humides et plus encore à l’exutoire, ses caractéristiques
physiques (largeur, niveau d’eau et luminosité) et chimiques sont plus propices à la vie floristique
et faunistique (amphibiens, insectes aquatiques, écrevisse à pieds blancs…). Ses eaux riches en
carbonate de calcium produisent localement en sous-bois des dépôts de calcaire, sur lesquels se
développe une végétation fontinale (Cf. Boisements humides sur tuf).
Illustration 6 : écoulements d’eau dans le marais (CEN73/V. Bourgoin)
• Eaux non courantes
Au nord du site, dans le sous-bois de l’aulnaie marécageuse à la limite avec la roselière se
trouve une mare forestière d’une surface d’environ 200 m² environ (Code Corine : 22.M).
Très ombragée et donc très sombre, cette mare est actuellement peu favorable à la flore, ainsi
qu’aux odonates et amphibiens, malgré des abords en pente douce et donc accessibles.
Illustration 7 : Mare forestière (CEN73/V. Bourgoin)
23
P LAN DE GESTION DU MARAIS DE C HEVILLY (G RESY - SUR -A IX ), 2016 – CEN S AVOIE2.2.1.1. Habitats herbacés humides
• Bas-marais calcaires
Cet habitat rare et menacé en région Rhône-Alpes est d’intérêt européen. Les marais de
l’Albanais intègrent bien cet habitat et jouent un rôle important dans sa préservation à l’échelle
régionale. Le site de Chevilly compte près de 7 200 m² de bas-marais calcaires (Code Corine : 54.21,
IC), répartis en deux îlots situés au nord pour le plus grand et au centre pour le second.
Il s’agit d’un bas-marais alcalin sur tourbe oligotrophe à orchis des marais (Orchis palustris) et
choin noirâtre (Schoenus nigricans). Cet habitat est assez peu typique pour l’îlot nord, présentant un
faciès à jonc subnoduleux (Juncus subnodulosus) et à grands carex, pauvre en espèces
caractéristiques (Carex davalliana, Epipactis palustris, Eriophorum latifolium…). Bien que de plus
faible surface, le second îlot est beaucoup plus typique, avec la domination du choin noirâtre et des
petits carex, et la présence notamment de l’orchis de Traunsteiner (Dactylorhiza traunsteineri).
L’état de conservation de ces bas-marais alcalins est actuellement très bon grâce à un degré
d’humidité suffisant et un régime régulier (quasi-annuel) de fauche des deux îlots.
Dans la mesure du possible, la limitation des apports azotés et phosphatés en provenance des
parcelles voisines devrait éviter le glissement de la végétation de bas-marais vers une
magnocariçaie. Le maintien de végétations périphériques filtrantes (roselière, mégaphorbiaies,
fourrés arbustifs ou boisements) est à ce titre important.
Illustration 8 : Végétation de bas-marais calcaire à Chevilly (CEN73/V. Bourgoin)
• Magnocariçaie
Cette végétation de grands carex se développe sur sol très humide mais tolère une
exondation une partie de l’année (Code Corine : 53.21). En termes de dynamique de végétation,
elle correspond à un état de transition entre les milieux aquatiques et les formations boisées
humides.
À Chevilly, cette formation est minoritaire et occupe trois petites stations, dont deux à l’est du
site et une au sud, pour une surface totale d’environ 0,6 ha. On rencontre deux types de
magnocariçaie : un groupement dominée par la laîche élevée (Carex elata) en bon état de
24
P LAN DE GESTION DU MARAIS DE C HEVILLY (G RESY - SUR -A IX ), 2016 – CEN S AVOIEconservation et un groupement dense et peu diversifié à laîche des marais (Carex acutiformis)
envahi par le roseau (Phragmite australis).
La station la plus au nord est fauchée annuellement ; la seconde n’a pu être fauchée qu’à la
faveur de conditions de portance du sol favorables, à savoir en 2006, 2007 et 2009.
• Prairies humides
Le marais de Chevilly renferme un petit îlot de prairies humides (Code Corine : 37.31, IC) sur
tourbe eutrophe alcaline à molinie bleutée (Molinia caerulea) et oenanthe de Lachenal (Oenanthe
lachenalii). Malgré une surface très limitée d’à peine 500 m², cet habitat est typique sur le site, avec
la présence notable de la scorzonère humble (Scorsonera humilis), accompagnée par la plupart des
espèces caractéristiques de l'habitat (Carex flacca, Molinia caerulea, Mentha aquatica, Lysimachia
vulgaris, Potentilla erecta, Filipendula ulmaria, Carex panicea, Carex hostiana).
Cet habitat d’intérêt européen, rare et menacé en Rhône-Alpes, bien que relativement
fréquent dans les marais gérés de l’ouest savoyard, est en bon état de conservation sur le site, du
fait de la fauche quasi-annuelle mise en œuvre par le CEN Savoie. Pour autant, il faut surveiller une
éventuelle extension de la mégaphorbiaie périphérique à filipendule (Filipendula ulmaria) qui
indiquerait une eutrophisation en provenance des parcelles limitrophes.
La gestion préconisée est le maintien du régime de fauche actuel, ainsi que la limitation des
intrants des parcelles voisines.
• Mégaphorbiaie
Un îlot de mégaphorbiaie en bon état de conservation occupe une surface de près de 900 m²
en limite ouest de la zone humide, au contact du maïs, en rive droite de l’écoulement d’eau.
Cet habitat (Code Corine : 37.1) se caractérise par sa végétation vivace herbacée haute et
hygrophile, avec la présence de la reine des prés ou filipendule (Filipendula ulmaria), la lysimaque
commune (Lysimachia vulgaris)… C’est une formation prairiale hygrophile établie sur les anciennes
prairies humides de fauche favorisée par les amendements des cultures adjacentes. Cet îlot fait
partie des secteurs fauchés quasi annuellement par le CEN Savoie depuis plus de 10 ans.
Illustration 9 : Prairies humides en haut et mégaphorbiaie en bas (CEN73/V. Bourgoin)
25
P LAN DE GESTION DU MARAIS DE C HEVILLY (G RESY - SUR -A IX ), 2016 – CEN S AVOIE• Roselières
Il s’agit d’un peuplement à Phragmites australis (Code Corine : 53.112). La roselière, ou
phragmitaie, est l’habitat le plus représenté dans les marais de l’Albanais, c’est aussi l’habitat le plus
important du site de Chevilly en termes de surface après les espaces agricoles avec 2,25 ha, soit
près de 15 % de la surface totale du site.
Il s’agit d’une roselière de colonisation ayant envahi des habitats humides ouverts tels que
ceux mentionnés précédemment, du fait de l’absence de fauche régulière. Floristiquement
pauvres, ces roselières sèches n'accueillent plus que quelques espèces comme le cirse des marais
(Cirsium palustre), l'eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum), le gaillet gratteron (Galium
aparine)… du fait notamment de l’accumulation d’une épaisse litière de roseau. Ces espèces
parviennent encore à se maintenir en compagnie de cypéracées et joncacées dans les secteurs où
la densité du roseau et la couche de litière de débris végétaux ne sont pas trop importantes. Ces
roselières correspondent à un stade dynamique avancé des milieux humides ouverts ; à noter :
• la roselière au nord du site (à l’est du bas-marais) : en mauvais état de conservation car
atterrie et piquetée de saule cendré ;
• la roselière dans la moitié sud du site : encore bien humide et peu eutrophisée, donc
en bon état de conservation ; toutefois, un secteur un peu plus sec à l’extrémité sud de
ce secteur est en voie de colonisation par la bourdaine (Frangula alnus) et l'aulne
glutineux (Alnus glutinosa) et mériterait d’être fauchée annuellement si les conditions
de portance des sols le permettaient.
Si ces roselières atterries ont peu d’intérêt sur le plan de la flore, la présence de roselières avec
buissons est indispensable à certaines espèces de la faune (refuge, nidification, perchoir…) comme
les oiseaux de marais.
Illustration 10 : Roselières de Chevilly (CEN73/V. Bourgoin)
26
P LAN DE GESTION DU MARAIS DE C HEVILLY (G RESY - SUR -A IX ), 2016 – CEN S AVOIE• Prairies méso-hygrophiles
Présent uniquement en bordure nord-est du site, cet habitat s’apparente à une prairie
mésophile de fauche collinéenne des sols frais mésotrophes à colchique d'automne (Colchicum
autumnale) et fétuque des prés (Festuca pratensis), temporairement inondés mais aussi liés à des
conditions microclimatiques et édaphiques fraîches (Code Corine : 38.22, IC). Il est peu typique à
Chevilly, montrant des signes d'eutrophisation et de dérive vers une végétation de friche humide.
C’est un habitat assez commun en Rhône-Alpes et en Savoie, mais souffrant souvent d'une
dégradation liée à l'intensification du régime de fauche et à l'eutrophisation généralisée des
parcelles agricoles. Son mauvais état de conservation se traduit par le développement d'espèces
rudérales eutrophes.
Cette prairie joue un rôle épurateur de l'eau qui alimente le cœur du marais. Dans cette
optique, son évolution éventuelle vers une mégaphorbiaie ne serait pas dommageable. Les
préconisations de gestion pour cet habitat sont le maintien de la fauche avec exportation.
2.2.1.2. Habitats boisés
• Fourrés humides
Ces saulaies arbustives à saule cendré (Salix cinerea) (Code Corine : 44.921) sont des fourrés
hygrophiles (voire inondés) de colonisation des bas-marais, prairies marécageuses, magnocariçaies
ou roselières à l'abandon. Elles se développent sur sol nettement engorgé et hydromorphe,
asphyxiant, sur nappe stagnante. Ces stades arbustifs couvrent une surface cumulée de 0,58 ha ; ils
s’expriment sous forme d’îlots de saule cendré, parfois associé à la bourdaine (Frangula alnus) et
l’aulne glutineux (Alnus glutinosa) et se situent principalement au contact des boisements feuillus
humides, au centre et à l’ouest de la zone humide. L’îlot situé au nord-est du site est composé de
quelques vieux et très beaux spécimens de saule cendré, dont l’intérêt pour la faune (oiseaux,
insectes notamment…) n’est plus à démontrer.
• Boisements humides
Ces boisements humides d’aulnes, ou aulnaie glutineuse (Code Corine : 44.91), se répartissent
en cinq secteurs dans la moitié ouest de la zone humide. Ils occupent 1,24 ha, et représentent donc
plus de 8 % de la végétation du site. Ces aulnaies marécageuses sont des boisements hygrophiles à
aulne glutineux (Alnus glutinosa) pour la plupart situés sur des sols gorgés en eau et longuement
inondés. Du fait de l’intensité de l’ombrage, la diversité de la flore herbacée reste limitée à
quelques espèces qui tolèrent l’ombre, dites sciaphiles, comme la laîche des bois (Carex sylvatica),
la prêle géante (Equisetum telmateia) et la fougère des marais (Thelypteris palustris).
Le petit cours d’eau qui divague dans les trois secteurs d’aulnaie glutineuse situés dans les
deux-tiers sud du site inonde régulièrement le sous-bois et apporte des dépôts actifs de calcaire
plus ou moins consistants. Ces dépôts tufeux dans l’aulnaie (Code Corine : 44.91 x 54.12, IP)
confèrent à ces boisements humides une valeur patrimoniale remarquable et permettent le
développement de beaux groupements aquatiques et fontinaux, avec l’expression d’une flore
bryophytique spécialisée et typique sur le site. Cet habitat, plutôt rare en Rhône-Alpes,
uniquement présent dans les secteurs calcaires et très souvent limité à de petites surfaces, est
assez bien représenté sur le site le long des ruisselets et des écoulements au sein des boisements
de la partie sud. Il nécessite un apport quasi continu d'eau calcaire de bonne qualité et dépend
donc du maintien du régime hydrique et de la qualité de l'eau.
27
P LAN DE GESTION DU MARAIS DE C HEVILLY (G RESY - SUR -A IX ), 2016 – CEN S AVOIEIllustration 11 : Saulaies à gauche, forêt humide et son sous-bois au centre et à droite (CEN73/V. Bourgoin)
• Boisements de feuillus mésophiles
Les boisements feuillus mésophiles occupent 1,55 ha du site. Il s’agit d’une chênaie
pédonculée-frênaie neutrophile à primevère élevée (Primula elatior) (Code Corine : 41.23, IC). Ce
boisement sur sol à bonne humidité permanente, mais à niveau hydrique moindre que l’aulnaie
glutineuse, se caractérise par la présence d’espèces plus mésophiles telles que le chêne pédonculé
(Quercus robur), l'érable sycomore (Acer pseudoplatanus), le troène (Ligustrum vulgare), le
cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) et l’aubépine (Crataegus monogyna). Son sous-bois se
compose d’un tapis herbacé diversifié caractérisé par la présence de la primevère élevée,
l’anémone des bois (Anemone nemorosa), l’ail des ours (Allium ursinum)…
Ces boisements feuillus, non exploités à l’heure actuelle, sont considérés en bon état de
conservation, si l’on ne tient pas compte des décharges sauvages. Leur tendance à gagner du
terrain sur les milieux ouverts sera à réguler dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion du
site : la position des lisières de ces boisements sera à maintenir, voire à faire reculer selon les
secteurs. La gestion de ces boisements, en dehors des lisières, consistera essentiellement à
continuer à les laisser évoluer naturellement sans intervention.
2.2.1.3. Terres agricoles
C’est de loin le milieu le plus représenté du site. À l’échelle des 15 ha étudiés correspondant au
périmètre Natura 2000, les espaces à vocation agricole représentent 7,86 ha, soit 51,5 %.
L’usage dominant est la grande culture (Code Corine : 82.1), avec en 2014 : près de 5 ha de
maïs et 1,62 ha d’autres céréales (blé notamment).
A ces cultures, s’ajoutent une parcelle plantée en petits fruits (cassis et groseilles) située au
nord-ouest de la zone humide, ainsi que près de 1 ha de prairies et pâtures mésophiles améliorées.
La zone humide de Chevilly est un îlot naturel isolé au milieu des terres agricoles, à forte
prédominance des cultures intensives pour lesquels l’emploi d’intrants est courant. Le lessivage
28
P LAN DE GESTION DU MARAIS DE C HEVILLY (G RESY - SUR -A IX ), 2016 – CEN S AVOIEVous pouvez aussi lire