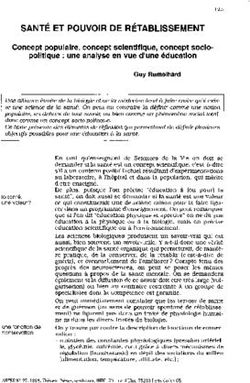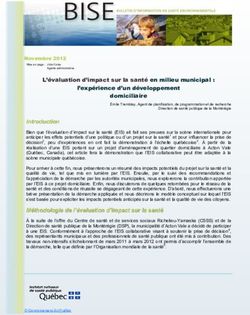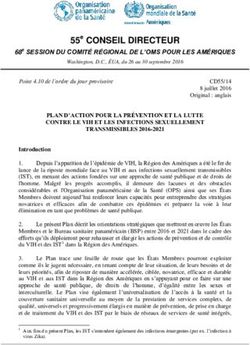Méfaits de l'alcool au Canada - Hospitalisations entièrement attribuables à l'alcool et stratégies de réduction des méfaits - Canadian Institute ...
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Méfaits de l’alcool au Canada Hospitalisations entièrement attribuables à l’alcool et stratégies de réduction des méfaits
La production du présent document est rendue possible grâce à un apport financier de Santé Canada et des gouvernements provinciaux et territoriaux. Les opinions exprimées dans ce rapport ne représentent pas nécessairement celles de Santé Canada ou celles des gouvernements provinciaux et territoriaux. À moins d’indication contraire, les données utilisées proviennent des provinces et territoires du Canada. Tous droits réservés. Le contenu de cette publication peut être reproduit tel quel, en tout ou en partie et par quelque moyen que ce soit, uniquement à des fins non commerciales pourvu que l’Institut canadien d’information sur la santé soit clairement identifié comme le titulaire du droit d’auteur. Toute reproduction ou utilisation de cette publication et de son contenu à des fins commerciales requiert l’autorisation écrite préalable de l’Institut canadien d’information sur la santé. La reproduction ou l’utilisation de cette publication ou de son contenu qui sous-entend le consentement de l’Institut canadien d’information sur la santé, ou toute affiliation avec celui-ci, est interdite. Pour obtenir une autorisation ou des renseignements, veuillez contacter l’ICIS : Institut canadien d’information sur la santé 495, chemin Richmond, bureau 600 Ottawa (Ontario) K2A 4H6 Téléphone : 613-241-7860 Télécopieur : 613-241-8120 www.icis.ca droitdauteur@icis.ca ISBN 978-1-77109-618-8 (PDF) © 2017 Institut canadien d’information sur la santé Comment citer ce document : Institut canadien d’information sur la santé. Méfaits de l’alcool au Canada : hospitalisations entièrement attribuables à l’alcool et stratégies de réduction des méfaits. Ottawa, ON : ICIS; 2017. This publication is also available in English under the title Alcohol Harm in Canada: Examining Hospitalizations Entirely Caused by Alcohol and Strategies to Reduce Alcohol Harm. ISBN 978-1-77109-617-1 (PDF)
Table des matières
Remerciements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Sommaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Pourquoi les méfaits de l’alcool représentent-ils un enjeu important? . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Comprendre les méfaits de l’alcool au Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Méthodes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Résultats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Dans quelle mesure les ventes d’alcool et la forte consommation varient-elles à
l’échelle du Canada? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Dans quelle mesure les hospitalisations entièrement attribuables à l’alcool
varient-elles à l’échelle nationale? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Comment les politiques et stratégies relatives à l’alcool varient-elles à
l’échelle nationale? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Système de contrôle du commerce de l’alcool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Accès physique à l’alcool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Fixation des prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Dépistage, intervention rapide et orientation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Points à surveiller à l’avenir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Conclusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Annexe A : Méthodes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Annexe B : Tableaux de données supplémentaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Annexe C : Intégration de l’approche DIRO aux stratégies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Annexe D : Texte de remplacement pour les figures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Références . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49Méfaits de l’alcool au Canada : hospitalisations entièrement attribuables
à l’alcool et stratégies de réduction des méfaits
Remerciements
L’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) aimerait remercier les représentants des
13 provinces et territoires qui ont fourni et validé les renseignements sur les politiques et
sur la vente au détail ayant servi à étayer les résultats du présent rapport. L’ICIS souhaite
également remercier, pour leur travail de révision technique :
• Monica Bull, conseillère en santé mentale et dépendances, ministère de la Santé et des
Services communautaires de Terre-Neuve-et-Labrador
• Kristianne Dechant, gestionnaire, Communications et Recherche, Régie des alcools et des
jeux du Manitoba
• Norman Giesbrecht, scientifique émérite, Institut de recherche sur les politiques en santé
mentale, Centre de toxicomanie et de santé mentale
• David MacDonald, analyste principal de la santé, ministère de la Santé et des Services
sociaux des Territoires du Nord-Ouest
• Opal McInnis, spécialiste en services communautaires de santé mentale, Santé mentale et
Dépendances, ministère de la Santé et des Services sociaux du Nunavut
• Catherine Paradis, analyste principale, Recherche et Politiques, Centre canadien de lutte
contre les toxicomanies
• Tim Stockwell, directeur, Centre for Addictions Research of BC
• Gerald Thomas, directeur, Politiques sur l’alcool et les jeux, ministère de la Santé de la
Colombie-Britannique
• Ashley Wettlaufer, coordonnatrice de recherche, Centre de toxicomanie et de santé mentale
Veuillez noter que les analyses et les conclusions figurant dans le présent rapport ne reflètent
pas nécessairement l’opinion des personnes ou organismes mentionnés ci-dessus.
La production de ce document a mis à contribution de nombreuses personnes au sein de
l’ICIS. L’ICIS remercie tout particulièrement l’équipe de l’Initiative sur la santé de la population
canadienne et celle de la Division de la recherche et de la conception d’indicateurs pour leur
contribution au présent rapport.
4Méfaits de l’alcool au Canada : hospitalisations entièrement attribuables
à l’alcool et stratégies de réduction des méfaits
Sommaire
Les méfaits pour la santé et la vie sociale associés à la consommation d’alcool constituent un
sujet de préoccupation grave et croissant tant au Canada qu’à l’étranger. À l’échelle mondiale,
l’alcool figurait au troisième rang des principaux facteurs de risque de décès et d’invalidité
en 2010, alors qu’il occupait le sixième rang en 19901. Au Canada, on estime que les coûts
économiques des méfaits liés à l’alcool ont dépassé les 14 milliards de dollars en 20022.
De ce montant, environ 3,3 milliards de dollars correspondaient aux coûts directs en soins de
santé, la majeure partie allant aux hospitalisations entièrement ou partiellement attribuables
à l’alcool. Les hospitalisations peuvent servir d’indicateur pour évaluer le fardeau que
représentent les méfaits de l’alcool au fil du temps2.
Au Canada, l’octroi des permis de vente d’alcool de même que le contrôle et la distribution
d’alcool sont réglementés par les provinces et territoires, ce qui permet d’optimiser les
avantages sociaux et économiques tout en réduisant les méfaits de la consommation d’alcool
pour la santé et la vie sociale. Les politiques et stratégies de réduction de la consommation
d’alcool et des comportements à risque contribuent efficacement à atténuer les méfaits de
l’alcool, et ce, malgré la complexité du lien entre la consommation et ses effets néfastes.
Il existe diverses politiques et stratégies relatives à la consommation d’alcool qui sont fondées
sur des données probantes. Le présent rapport se concentre plus particulièrement sur les
politiques et stratégies en matière de fixation des prix, de systèmes de contrôle, d’accès
physique à l’alcool ainsi que de dépistage, d’intervention rapide et d’orientation (DIRO).
Ces politiques et stratégies ont été retenues parce qu’elles relèvent des responsables
provinciaux et territoriaux de l’élaboration des politiques, que leur capacité à réduire les
méfaits et les coûts liés à la consommation d’alcool a été démontrée et qu’elles varient
considérablement d’une province et d’un territoire à l’autre.
Le présent rapport offre un aperçu des variations pancanadiennes de la consommation
d’alcool (y compris la vente et la forte consommation d’alcool) et des méfaits liés à l’alcool
(grâce à l’indicateur Hospitalisations entièrement attribuables à l’alcool). Il dresse également
un portrait sommaire des variations provinciales et territoriales au chapitre des politiques et
stratégies sur l’alcool. Le rapport repose sur les données recueillies par Statistique Canada
et l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) ainsi que sur les renseignements fournis
par les ministères et organismes provinciaux et territoriaux.
En combinant les données de diverses sources et un survol des politiques et stratégies en
vigueur, le rapport vise à cerner les lacunes en matière de politiques et pratiques ainsi que
les sous-groupes qui, en raison de leur vulnérabilité aux méfaits de l’alcool, requièrent plus
d’attention. De plus, des renseignements récents sur les hospitalisations attribuables à l’alcool
fournissent un point de départ pour la surveillance du fardeau de l’alcool sur les systèmes de
santé et l’incidence des politiques et stratégies relatives à l’alcool sur ses méfaits.
5Méfaits de l’alcool au Canada : hospitalisations entièrement attribuables
à l’alcool et stratégies de réduction des méfaits
Voici certaines des principales conclusions du rapport :
• L’alcool est à l’origine d’un plus grand nombre d’hospitalisations que les crises
cardiaques. En 2015-2016, environ 77 000 hospitalisations étaient entièrement attribuables
à l’alcool, tandis qu’environ 75 000 étaient liées à une crise cardiaque.
• Les taux de vente et de forte consommation d’alcool varient d’une autorité
compétente à l’autre. Par exemple, les taux de vente et de forte consommation
d’alcool étaient supérieurs à la moyenne à Terre-Neuve-et-Labrador, au Québec, au Yukon
et dans les Territoires du Nord-Ouest (la moyenne étant de 5 consommations ou plus pour
les hommes et de 4 ou plus pour les femmes en une même occasion au moins une fois par
mois au cours d’une année)3.
• Le taux d’hospitalisations varie considérablement. Les provinces de l’Est affichent,
pour l’indicateur Hospitalisations entièrement attribuables à l’alcool, un taux inférieur à
celui des provinces de l’Ouest, et le taux des territoires est en moyenne supérieur à celui
des provinces. En outre, d’importantes variations régionales (au sein des provinces) ont
été observées dans les résultats de l’indicateur, plusieurs régions nordiques et éloignées
affichant des taux élevés.
• Les taux varient selon le sexe, le revenu et l’âge. Dans l’ensemble, les taux de forte
consommation et d’hospitalisations étaient plus élevés chez les hommes que chez les
femmes. Le taux de l’indicateur Hospitalisations entièrement attribuables à l’alcool était
toutefois plus élevé chez les filles que chez les garçons dans le groupe des 10 à 19 ans.
Un taux plus élevé d’hospitalisations a également été observé chez les personnes des
quartiers au revenu le plus faible comparativement à celles des quartiers au revenu le
plus élevé.
• Les politiques et interventions relatives à l’alcool varient à l’échelle nationale.
Les politiques et interventions en matière de réduction des méfaits de l’alcool fondées
sur des données probantes visent notamment à renforcer le contrôle des prix et de l’accès
à l’alcool, ainsi qu’à mettre en œuvre des stratégies provinciales globales de gestion de la
consommation d’alcool et de ses méfaits.
• Des études et des analyses plus poussées sur les politiques et les interventions
sont nécessaires. Dans le secteur de la santé, la prévention de même que le dépistage,
les interventions rapides et les orientations peuvent contribuer à réduire les méfaits de
l’alcool, surtout au sein des populations à risque élevé. L’adoption de la gamme complète
de politiques de réduction de la consommation d’alcool et de ses méfaits nécessite
probablement un partenariat et une collaboration entre les secteurs.
6Méfaits de l’alcool au Canada : hospitalisations entièrement attribuables
à l’alcool et stratégies de réduction des méfaits
Introduction
Pourquoi les méfaits de l’alcool
représentent-ils un enjeu important?
La consommation d’alcool fait partie de la culture canadienne : près de 80 % des Canadiens
boivent de l’alcool4 et la plupart en consomment avec modération5, 6. Les méfaits de l’alcool
(les conséquences négatives de sa consommation) représentent néanmoins un sujet de
préoccupation grave et croissant en matière de santé de même que l’une des principales
causes de blessures et de décès au Canada1. La consommation d’alcool est passée du
sixième rang en 1990 au troisième rang en 2010 des principaux facteurs de risque de décès
et d’invalidité à l’échelle mondiale1, 7.
La consommation d’alcool a de nombreuses conséquences sur le plan de la santé, ainsi que
sur les plans social et économique. Le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies a
publié les Directives de consommation d’alcool à faible risque du Canada afin d’informer les
Canadiens sur les façons de réduire les risques à long terme sur la santé, ce qui comprend
les maladies chroniques telles que le cancer, la cirrhose du foie, le diabète ou les maladies
cardiovasculaires (voir l’encadré 1) i, 11, 12. Une récente étude révèle qu’en 2015, il y a eu
5 082 décès attribuables à l’alcool au Canada13.
Encadré 1 : Directives de consommation d’alcool à faible
risque du Canada
Ces directives indiquent aux Canadiens comment réduire les risques de méfaits liés à l’alcool
en respectant des limites de consommation sûres. Pour réduire les risques à long terme pour
la santé,
• les femmes ne devraient pas boire plus de 10 verres par semaine — au plus 2 verres par
jour, en règle générale;
• les hommes ne devraient pas boire plus de 15 verres par semaine — au plus 3 verres par
jour, en règle générale.
Les directives recommandent également de ne pas boire lorsque vous conduisez un véhicule
ou si vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir. Elles recommandent aussi de reporter la
consommation d’alcool chez les jeunes jusqu’à l’âge autorisé par les lois locales. Pour obtenir
de plus amples renseignements, consultez les Directives de consommation d’alcool à faible
risque du Canada.
i. D’autres organismes, comme la Société canadienne du Cancer, Action Cancer Ontario, le Fonds mondial de recherche
contre le cancer et l’American Institute for Cancer Research, recommandent une limite quotidienne d’un verre par jour
pour les femmes et de 2 verres pour les hommes8-10.
7Méfaits de l’alcool au Canada : hospitalisations entièrement attribuables
à l’alcool et stratégies de réduction des méfaits
La consommation abusive d’alcool (y compris les habitudes de consommation causant
des problèmes de santé14) peut également avoir des répercussions sociales plus vastes,
comme le chômage, l’absentéisme et le crime. L’incidence sur les non-consommateurs est
considérable et peut se manifester notamment sous forme de blessures dues à des attaques,
d’incidents au travail, d’accidents de la route, de bouleversements familiaux, de violence,
d’abus et de perte de revenu15, 16.
Les coûts économiques de la consommation d’alcool sont également considérables2.
En 2002, le coût total (application de la loi, prévention et recherche, perte de productivité)
des méfaits liés à l’alcool dépassait 14 milliards de dollars au Canada, dont 3,3 milliards
directement reliés aux soins de santé ii, 2. Les hospitalisations liées à l’alcool peuvent coûter
cher aux systèmes de santé. En 2014-2015, le coût moyen par hospitalisation entièrement
attribuable à l’alcool (voir l’encadré 2) était estimé à 8 100 $17, alors que le coût d’un séjour
moyen à l’hôpital était de 5 800 $18. Le coût supérieur des hospitalisations entièrement
attribuables à l’alcool est principalement dû aux séjours plus longs : 11 jours en moyenne,
contre 7 jours pour l’ensemble des hospitalisations20.
ii. Le Centre for Addictions Research of BC procède actuellement à la mise à jour des estimations des coûts économiques de
la consommation d’alcool.
8Méfaits de l’alcool au Canada : hospitalisations entièrement attribuables
à l’alcool et stratégies de réduction des méfaits
Encadré 2 : En quoi consiste une hospitalisation
entièrement attribuable à l’alcool?
L’information sur les sorties des hôpitaux peut être Près de 3 hospitalisations sur 4 en raison
d’affections entièrement attribuables à
utilisée pour estimer les méfaits de l’alcool dans la l’alcool sont causées par des troubles
collectivité et le fardeau qu’ils imposent sur les mentaux et du comportement, tels qu’une
dépendance ou une intoxication à l’alcool
systèmes de santé. Dans le présent rapport, les
hospitalisations entièrement attribuables à l’alcool
désignent les séjours hospitaliers à des fins de
traitement d’affections considérées comme
entièrement (100 %) attribuables à une
(Source : ICIS, 2015)
consommation abusive d’alcool21. Le tableau
ci-dessous présente les principales affections ayant
mené à une hospitalisation entièrement attribuable à l’alcool en 2015-2016 au Canada.
Pour plus de précisions, consultez les notes techniques de l’indicateur Hospitalisations
entièrement attribuables à l’alcool dans le Répertoire des indicateurs de l’ICIS.
Tableau 1 Principales affections entièrement attribuables à l’alcool,
Canada, 2015-2016
Troubles de santé mentale Affections physiques
(pourcentage d’hospitalisations) (pourcentage d’hospitalisations)
Problèmes chroniques liés à la consommation Cirrhose du foie induite par l’alcool (13 %)
d’alcool (24 %)
Sevrage alcoolique (23 %) Pancréatite aiguë induite par l’alcool (6 %)
Consommation abusive d’alcool (18 %) Hépatite induite par l’alcool (4 %)
Intoxication alcoolique (9 %) Insuffisance hépatique induite par l’alcool (4 %)
Delirium du sevrage alcoolique (5 %) Effets toxiques de l’alcool (3 %)
Remarque
Plus d’une de ces affections peut être liée à chaque hospitalisation.
D’après les données sur les admissions à l’hôpital liées à l’alcool recueillies par le
National Health Service en Angleterre, les affections entièrement attribuables à l’alcool
représentaient environ 30 % de toutes les hospitalisations liées à la consommation
d’alcool22; les hospitalisations restantes étaient partiellement attribuables à l’alcool
(p. ex. cancer, blessures liées à un accident de la circulation, maladie cardiaque).
Même si elles ne représentent que la pointe de l’iceberg au chapitre des méfaits de
l’alcool, les hospitalisations entièrement attribuables à l’alcool étaient plus nombreuses
que les hospitalisations à la suite d’une crise cardiaque au Canada en 2015-2016.
9Méfaits de l’alcool au Canada : hospitalisations entièrement attribuables
à l’alcool et stratégies de réduction des méfaits
Comprendre les méfaits de l’alcool au Canada
Le présent rapport donne un aperçu des habitudes de consommation d’alcool, des résultats
de l’indicateur Hospitalisations entièrement attribuables à l’alcool et de quelques politiques
et stratégies relatives à l’alcool dans les provinces et territoires afin de dresser un portrait
actuel des méfaits de l’alcool au Canada. Comme l’illustre la figure 1, les liens entre la
consommation d’alcool et ses méfaits sont complexes. Ils dépendent de la personne, de
facteurs culturels et sociaux, des approches de réglementation de la consommation et
de l’accès à l’alcool adoptées par les autorités compétentes, ainsi que de la disponibilité
de services et de programmes de prévention ou de réduction des méfaits au sein des
populations à risque. Outre les gouvernements, les régies et sociétés des alcools provinciales
et territoriales ainsi que l’industrie des boissons alcoolisées jouent également un rôle
déterminant dans la réduction des risques liés à la consommation d’alcool1.
Il a été démontré qu’une stratégie intégrale de réduction de la consommation d’alcool
(y compris de la consommation à risque ou abusive) peut contribuer à limiter les méfaits
de l’alcool5, 23, 24. Cette stratégie combine des approches à l’échelle de la population
(qui s’adressent à l’ensemble de la population) et à l’échelle individuelle (qui visent les
consommateurs à risque)25. Les stratégies à l’échelle de la population ont généralement
pour but de prévenir la consommation à risque et abusive, et favorisent une réduction de la
quantité d’alcool consommée15, 26-28. Les stratégies à l’échelle individuelle (p. ex. dépistage,
intervention rapide et orientation [DIRO]) visent des populations et des comportements à
risque précis, ainsi que des habitudes de consommation, des produits ou des lieux présentant
un risque élevé de méfait29-31.
Nous pouvons tirer des leçons d’une stratégie globale de lutte contre le tabagisme qui a
réussi à réduire la prévalence du tabagisme et de la mortalité due au cancer du poumon au
Canada32. Cette stratégie a également permis de changer les normes culturelles relatives à
l’acceptabilité sociale du tabagisme; un tel changement culturel serait nécessaire pour assurer
une réduction à long terme des méfaits liés à l’alcool25.
10Méfaits de l’alcool au Canada : hospitalisations entièrement attribuables
à l’alcool et stratégies de réduction des méfaits
Figure 1 Cadre conceptuel des méfaits liés à l’alcool
Facteurs Consommation d’alcool Facteurs
sociétaux Volume Habitudes individuels
Niveau de
développement Âge
Culture Résultats pour la santé Sexe
Contexte de Chroniques Aigus Facteurs
consommation familiaux
Production,
Statut
distribution et
socio-
réglementation Mortalité selon Conséquences Effets néfastes économique
de l’alcool
la cause socioéconomiques pour autrui
Remarque
La figure ci-dessus a été traduite pour les besoins du présent rapport, car la version d’origine n’est disponible qu’en anglais.
Source
Figure adaptée du rapport Global Status Report on Alcohol and Health 2014 de l’Organisation mondiale de la santé avec la
permission de l’éditeur.
Méthodes
Le présent rapport examine la consommation d’alcool, les hospitalisations entièrement
attribuables à l’alcool ainsi que les politiques et stratégies en vigueur relatives à l’alcool
à l’aide des sources de données ci-dessous. De plus amples renseignements sont fournis
à l’annexe A.
• Les données de Statistique Canada ont été utilisées pour décrire la consommation d’alcool,
y compris les ventes et la forte consommation.
• Les données de l’ICIS ont servi à calculer les résultats de l’indicateur Hospitalisations
entièrement attribuables à l’alcool. Les taux d’hospitalisations ont été subdivisés selon le
sexe, le type de région (urbaine ou rurale et éloignée) et le revenu du quartier, ce qui a
permis de cerner les populations à risque d’hospitalisation entièrement attribuable à l’alcool.
• Les politiques et stratégies existantes relatives à l’alcool ont été définies et validées par les
ministères provinciaux et territoriaux responsables de la distribution et de la réglementation
de l’alcool ainsi que de la prévention et du traitement. Le présent rapport est axé sur la
fixation des prix, l’accès physique à l’alcool et l’approche DIRO, car ces aspects relèvent
des responsables provinciaux et territoriaux de l’élaboration des politiques, leur capacité
à réduire les méfaits et les coûts liés à la consommation d’alcool a été démontrée et ils
varient considérablement d’une province et d’un territoire à l’autre.
11Méfaits de l’alcool au Canada : hospitalisations entièrement attribuables
à l’alcool et stratégies de réduction des méfaits
Résultats
Dans quelle mesure les ventes d’alcool et la
forte consommation varient-elles à l’échelle
du Canada?
Les provinces et territoires où les ventes sont plus élevées
affichent également, en moyenne, une prévalence plus
élevée de forte consommation d’alcool
La consommation d’alcool et les habitudes de consommation varient considérablement
à l’échelle mondiale, au sein des pays et selon les consommateurs33. Comme l’illustre la
figure 2, une forte consommation d’alcool (5 verres ou plus chez les hommes et 4 verres
ou plus chez les femmes en une même occasion au moins une fois par mois sur une
période d’un an) a été déclarée par 18 % des personnes de 12 ans et plus au Canada.
Le pourcentage de forte consommation allait de 14 % au Nunavut à 33 % dans les Territoires
du Nord-Ouest. En moyenne, la forte consommation d’alcool était plus prévalente dans les
provinces et territoires où les ventes étaient plus élevées. En 2014, les ventes d’alcool et
le taux de forte consommation étaient plus élevés à Terre-Neuve-et-Labrador, au Québec,
au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest que dans l’ensemble du Canada.
12Méfaits de l’alcool au Canada : hospitalisations entièrement attribuables
à l’alcool et stratégies de réduction des méfaits
Figure 2 Forte consommation d’alcool (autodéclarée) et ventes
d’alcool (volume absolu des ventes totales par habitant),
selon la province ou le territoire, 2014
40 % 14
Volume absolu des ventes totales par habitant (litres)
35 % 12
Pourcentage de la population déclarant
30 %
10
une forte consommation
25 %
8
20 %
6
15 %
4
10 %
5% 2
0% 0
T.-N.-L. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T.N.-O. Nun. Can.
Pourcentage de la population déclarant une forte consommation, 12 ans et plus
Volume absolu des ventes totales par habitant (litres), 15 ans et plus
Remarques
Le volume absolu des ventes totales par habitant (litres) est calculé pour la population de 15 ans et plus dans le tableau
CANSIM 183-0023 de Statistique Canada.
Une politique de restriction de la consommation d’alcool allant de l’accès de base à l’exclusion totale est en vigueur au Nunavut.
Il existe 2 entrepôts de vente d’alcool; toutefois, les achats et acquisitions hors territoire, le trafic illégal et l’alcool de contrebande
ont une incidence sur la consommation d’alcool exclue des données relatives aux ventes. Les ventes par habitant excluent
également les quantités associées aux permis d’importation.
Sources
Statistique Canada. Tableau 183-0023 : Ventes et les ventes par habitant de boissons alcoolisées des régies des alcools
et d’autres points de vente au détail, selon la valeur, le volume et le volume absolu, annuel. CANSIM (base de données).
Consulté le 7 avril 2017.
Statistique Canada. Tableau 105-0501 : Profil d’indicateurs de la santé, estimations annuelles, selon le groupe d’âge et le
sexe, Canada, provinces, territoires, régions sociosanitaires (limites de 2013) et groupes de régions homologues, occasionnel.
CANSIM (base de données). Consulté le 7 avril 2017.
La forte consommation d’alcool varie selon le sexe et le
revenu ainsi que tout au long de la vie
La forte consommation d’alcool est plus prévalente chez les hommes que chez les femmes.
Selon les données de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), la
forte consommation d’alcool est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes ainsi
qu’au sein du groupe des 20 à 34 ans (données non illustrées).
13Méfaits de l’alcool au Canada : hospitalisations entièrement attribuables
à l’alcool et stratégies de réduction des méfaits
Comme le montre la figure 3, la forte consommation suit une échelle des revenus, les taux
les plus élevés ayant été observés chez les hommes des groupes à revenu élevé. Un résultat
semblable a été observé chez les femmes, mais avec des différences moins marquées.
Figure 3
Pourcentage de forte consommation d’alcool, selon le
quintile de revenu et le sexe, 2014
40 %
35 %
Pourcentage de forte consommation
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%
Q1 (quintile de Q2 Q3 Q4 Q5 (quintile de
revenu le plus bas) revenu le plus élevé)
Hommes Femmes
Remarques
Les quintiles de revenu sont basés sur le revenu ajusté des ménages autodéclaré dans le cadre de l’ESCC 2014.
Les limites de confiance sont calculées à partir des coefficients de variation fournis dans le fichier de microdonnées à grande
diffusion 2014 de Statistique Canada. Même si l’ESCC est représentative de 98 % des Canadiens habitant dans la collectivité,
elle exclut certains groupes, comme les personnes vivant dans les réserves.
Source
Statistique Canada. Fichier de microdonnées à grande diffusion de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes.
2013-2014 (82M0013X2016001). Les calculs, l’utilisation et l’interprétation de ces données relèvent intégralement de l’Institut
canadien d’information sur la santé.
Dans quelle mesure les hospitalisations
entièrement attribuables à l’alcool varient-elles
à l’échelle nationale?
En 2015-2016, environ 56 600 Canadiens ont été hospitalisés en raison d’une affection
entièrement attribuable à l’alcool. De ce nombre, 21 % ont été hospitalisés à au moins
2 reprises au cours de la même période pour ce type d’affection. Au total, environ
77 000 hospitalisations ont été enregistrées, soit une moyenne de 212 par jour. Au cours de
la même année, il y a eu 75 000 hospitalisations à la suite d’une crise cardiaque (moyenne de
205 par jour).
14Méfaits de l’alcool au Canada : hospitalisations entièrement attribuables
à l’alcool et stratégies de réduction des méfaits
En 2015-2016, le taux global normalisé selon l’âge de l’indicateur Hospitalisations
entièrement attribuables à l’alcool était de 239 par 100 000 habitants. Comme l’illustre la
figure 4, les taux étaient en moyenne plus élevés dans les territoires que dans les provinces.
Exception faite de la Nouvelle-Écosse, les taux des provinces de l’Est étaient en moyenne
inférieurs à ceux des provinces de l’Ouest. Les variations géographiques peuvent refléter
des différences quant à la prévalence de la consommation abusive, à l’organisation et à la
prestation des soins ainsi qu’à la disponibilité des services et du soutien pour les personnes
vulnérables aux méfaits de l’alcool dans la collectivité34.
Figure 4
Taux normalisés selon l’âge de l’indicateur
Hospitalisations entièrement attribuables à l’alcool par
100 000 habitants de 10 ans et plus, selon la province
ou le territoire, 2015-2016
1 500 1 315
1 400
1 300
1 200
1 100
676
800
700
600 421
500
400 345 327 349
308
300 186 237 248
172 183 195
239
200
100
0
T.-N.-L. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T.N.-O. Nun.
Taux ajusté Taux canadien
Remarque
Taux normalisés selon l’âge d’après la population type canadienne de 2011.
Sources
Base de données sur la morbidité hospitalière, Base de données sur les congés des patients, Système national d’information sur
les soins ambulatoires et Système d’information ontarien sur la santé mentale, 2015-2016, Institut canadien d’information sur la
santé; estimations démographiques, 2015, Statistique Canada.
15Méfaits de l’alcool au Canada : hospitalisations entièrement attribuables
à l’alcool et stratégies de réduction des méfaits
Encadré 3 : Variations régionales des résultats de
l’indicateur Hospitalisations entièrement attribuables
à l’alcool
Les taux provinciaux et territoriaux de l’indicateur Hospitalisations entièrement attribuables
à l’alcool allaient de 172 par 100 000 habitants au Nouveau-Brunswick à 1 315 par
100 000 habitants dans les Territoires du Nord-Ouest. Les écarts étaient toutefois plus
marqués à l’échelle régionale. En 2015-2016, les taux ajustés selon l’âge de l’indicateur
Hospitalisations entièrement attribuables à l’alcool variaient de 111 par 100 000 habitants
dans le Réseau local d’intégration des services de santé du Centre de l’Ontario à 3 126 par
100 000 habitants dans la Région sociosanitaire du Nunavik au Québec. Les résultats
provinciaux, territoriaux et régionaux sont présentés dans l’outil Votre système de santé
de l’ICIS.
Par ailleurs, les Canadiens vivant dans des régions rurales et éloignées affichaient des taux
supérieurs à ceux des citadins (voir l’annexe B) pour l’indicateur Hospitalisations entièrement
attribuables à l’alcool. La disponibilité d’un moins grand nombre d’options de traitement dans
la collectivité pourrait expliquer en partie les taux plus élevés d’hospitalisations dans les
régions rurales et éloignées.
Le lien entre les ventes d’alcool, la forte consommation et les
hospitalisations est complexe
Dans certains cas, les ventes d’alcool et la forte consommation suivent la même tendance
que les hospitalisations. Dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon par exemple,
les taux d’hospitalisations sont plus élevés que la moyenne, tout comme les taux de forte
consommation et de ventes (voir la figure 2). De même, la Colombie-Britannique affichait
le taux provincial le plus élevé pour l’indicateur Hospitalisations entièrement attribuables à
l’alcool et un taux de ventes supérieur à la moyenne. En Alberta, le taux d’hospitalisations
était élevé et celui des ventes et de forte consommation, relativement élevé. Au Québec
toutefois, le taux d’hospitalisations était faible, en moyenne, mais les taux de forte
consommation et de ventes dépassaient la moyenne canadienne.
16Méfaits de l’alcool au Canada : hospitalisations entièrement attribuables
à l’alcool et stratégies de réduction des méfaits
Pour une meilleure compréhension des méfaits de l’alcool dans les provinces et territoires,
les études futures devront tenir compte des variations régionales au sein des provinces
et territoires. Celles-ci devraient être examinées en parallèle avec les différences et les
tendances au fil du temps quant à l’organisation et à la prestation de services de traitement
des méfaits de l’alcool. Ces renseignements permettraient de déterminer dans quelle mesure
la prestation des services dans la collectivité répond aux besoins des personnes vulnérables
aux méfaits de l’alcool.
Les hommes de 20 ans et plus sont plus susceptibles que les
femmes d’être hospitalisés pour des affections entièrement
attribuables à l’alcool
Comme l’illustre la figure 5, les taux d’hospitalisations entièrement attribuables à l’alcool
varient selon le sexe et l’âge. Des renseignements détaillés concernant les enfants et les
jeunes sont présentés à l’encadré 4. À partir de l’âge de 20 ans, les hommes affichaient des
taux plus élevés que les femmes pour l’indicateur Hospitalisations entièrement attribuables
à l’alcool, les taux des 2 sexes culminant autour de la cinquantaine. Les taux plus élevés
dans la cinquantaine sont en partie dus à une exposition cumulative à long terme à l’alcool33.
Les femmes affichaient les taux d’hospitalisations les plus bas à un âge avancé, alors que les
hommes affichaient les taux les plus bas dans leur jeunesse.
Les adultes d’âge moyen (2 fois plus Les différences de taux d’hospitalisations entre les
d’hommes que de femmes) sont à
l’origine de
sexes sont semblables à celles observées dans
la les habitudes de consommation d’alcool, où la
moitié prévalence autodéclarée de forte consommation était
des hospitalisations
pour des affections significativement plus élevée chez les hommes que
entièrement chez les femmes (voir la figure 3). Ces différences entre
attribuables
à l’alcool
les hommes et les femmes adultes cadrent avec les
conclusions d’études internationales antérieures35, 36.
(45 à 64 ans)
(Source : ICIS, 2015)
17Méfaits de l’alcool au Canada : hospitalisations entièrement attribuables
à l’alcool et stratégies de réduction des méfaits
Encadré 4 : Hospitalisations entièrement attribuables à
l’alcool chez les enfants et les jeunes
Les résultats de notre étude montrent que les jeunes représentent une très faible proportion
du nombre total d’hospitalisations attribuables à l’alcool au Canada (figure 5). Il n’en reste
pas moins que 6 jeunes de 10 à 19 ans ont été hospitalisés en moyenne chaque jour en
raison d’affections attribuables à l’alcool en 2015-2016. En plus de consommer de l’alcool
alors qu’ils n’avaient pas l’âge légal de boire dans leur province ou territoire, bon nombre de
jeunes ont des habitudes de consommation abusive menant à une hospitalisation.
La consommation abusive d’alcool et l’intoxication alcoolique sont les diagnostics les plus
courants associés aux hospitalisations entièrement attribuables à l’alcool chez les enfants et
les jeunes de 10 à 19 ans (résultats non illustrés). Les filles de 10 à 19 ans sont plus souvent
hospitalisées que les garçons du même groupe d’âge pour des affections attribuables à
l’alcool. En fait, c’est la seule période de leur vie au cours de laquelle plus de femmes que
d’hommes sont hospitalisées pour ce type d’affections (voir la figure 5).
Les initiatives de prévention axées sur les jeunes Canadiens Chaque jour, jusqu’à
6 jeunes
peuvent réduire les risques de méfaits à court et à long terme.
Les stratégies de réduction et de prévention des méfaits de de 10 à 19 ans
(plus de filles que de garçons)
l’alcool devraient également cibler les jeunes, ceux-ci étant
plus à risque que les adultes de vivre des expériences négatives
liées à l’alcool37. Les jeunes qui boivent avec excès sont plus
sont hospitalisés en
susceptibles d’adopter des comportements à haut risque, raison d’affections
par exemple embarquer dans la voiture d’un conducteur entièrement
en état d’ébriété ou consommer des drogues ou de attribuables à l’alcool
l’alcool avant les relations sexuelles38. (Source : ICIS, 2015)
18Méfaits de l’alcool au Canada : hospitalisations entièrement attribuables
à l’alcool et stratégies de réduction des méfaits
Figure 5
Taux bruts de l’indicateur Hospitalisations entièrement
attribuables à l’alcool par 100 000 habitants de 10 ans
et plus, selon le groupe d’âge et le sexe, 2015-2016
600
552 548
522
500
500 468
431
Taux bruts par 100 000 habitants
402
400
347 332
304
300 255 258
222 211 220
201 180
183
200 169
151 143 147 152 153 155
116 119
101 91
100 76 63
35
20
10
0
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
lus
4a
9a
4a
9a
4a
9a
4a
9a
4a
9a
4a
9a
4a
9a
4a
9a
tp
se
-1
-1
-2
-2
-3
-3
-4
-4
-5
-5
-6
-6
-7
-7
-8
-8
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
an
90
Hommes Femmes
Sources
Base de données sur la morbidité hospitalière, Base de données sur les congés des patients, Système national d’information sur
les soins ambulatoires et Système d’information ontarien sur la santé mentale, 2015-2016, Institut canadien d’information sur la
santé; estimations démographiques, 2015, Statistique Canada.
Les taux d’hospitalisations entièrement attribuables à l’alcool
sont plus élevés chez les personnes vivant dans un quartier à
faible revenu
Les personnes vivant dans un quartier à faible revenu affichaient des taux plus élevés pour
l’indicateur Hospitalisations entièrement attribuables à l’alcool que celles vivant dans un
quartier à revenu élevé. En fait, dans l’ensemble du Canada, les taux d’hospitalisations étaient
2,5 fois plus élevés dans les quartiers à faible revenu que dans les quartiers à revenu élevé
(les résultats provinciaux sont présentés à l’annexe B). Cette tendance concorde avec les
résultats d’une étude antérieure39. Les méfaits sont plus courants dans les groupes à faible
revenu, qui consomment habituellement moins que les groupes à revenu élevé : c’est ce
qu’on appelle le paradoxe des méfaits liés à l’alcool (voir l’encadré 5).
19Méfaits de l’alcool au Canada : hospitalisations entièrement attribuables
à l’alcool et stratégies de réduction des méfaits
Encadré 5 : Le paradoxe des méfaits liés à l’alcool
Dans la présente étude, nous avons constaté qu’un revenu faible était associé à
une prévalence moins élevée de forte consommation d’alcool, mais également à des
taux significativement plus élevés pour l’indicateur Hospitalisations entièrement attribuables
à l’alcool.
Cette constatation est conforme à ce qu’on trouve dans la littérature, à savoir que les
personnes au statut socioéconomique (SSE) élevé consomment autant sinon plus d’alcool
que les personnes au SSE faible, mais que ces dernières sont victimes d’une part
disproportionnée des méfaits liés à l’alcool36, 40, 41.
Ce paradoxe pourrait s’expliquer par une susceptibilité accrue aux conséquences d’un faible
revenu (p. ex. niveaux de stress plus élevés, moins de réseaux de soutien social, moins de
ressources pour se prendre en charge et autres facteurs de risque, comme une alimentation
moins équilibrée et un manque d’activité physique)27, 42, 43. De plus, l’exposition à des
environnements de consommation dangereux, le choix de boisson et la fréquence de
consommation excessive pourraient également expliquer le paradoxe43.
Comment les politiques et stratégies relatives
à l’alcool varient-elles à l’échelle nationale?
La consommation d’alcool et ses résultats sur la santé dépendent de facteurs individuels
et sociétaux, notamment les politiques et stratégies mises en place par les gouvernements
pour réglementer la distribution de l’alcool ainsi que les politiques et programmes de lutte
contre ses méfaits (voir la figure 1 et le tableau A1 à l’annexe A). Dans la présente section,
nous nous intéressons en premier lieu aux variations dans les politiques de réglementation
de l’offre et de l’accès à l’alcool à l’échelle de la population : systèmes de contrôle, accès
physique et fixation des prix de l’alcool. Dans un deuxième temps, nous présentons la
stratégie de dépistage, d’intervention rapide et d’orientation (DIRO) conçue pour réduire
les méfaits chez les personnes vulnérables ou à risque élevé.
20Méfaits de l’alcool au Canada : hospitalisations entièrement attribuables
à l’alcool et stratégies de réduction des méfaits
L’alcool se vend dans plusieurs types d’emplacements, dont les magasins d’alcool appartenant
à l’État et les restaurants. Ces points de vente sont catégorisés comme suit : consommation
hors lieux, consommation sur place et vente à emporter.
• Points de vente pour consommation hors lieux : détaillants et magasins autorisés
(p. ex. magasins d’alcool appartenant à l’État, détaillants privés, dépanneurs) qui vendent
des boissons alcoolisées à consommer ailleurs qu’au point de vente (p. ex. à domicile).
• Points de vente pour consommation sur place : détaillants autorisés (généralement des
restaurants, pubs, bars et cafés) qui vendent des boissons alcoolisées à consommer là où
elles ont été achetées.
• Vente à emporter : vente d’alcool dans des emplacements détenteurs d’un permis de
consommation sur place, comme les restaurants et les bars, à des fins de consommation
hors lieux (p. ex. à domicile).
21Méfaits de l’alcool au Canada : hospitalisations entièrement attribuables
à l’alcool et stratégies de réduction des méfaits
Système de contrôle du commerce de l’alcool
Politique
Le système de contrôle du commerce de l’alcool est le mécanisme utilisé par les provinces et
territoires pour réglementer la vente et la distribution d’alcool. La politique suivante en matière
de systèmes de contrôle a été examinée :
• détaillants publics d’alcool pour consommation hors lieux en tant que pourcentage du
nombre total de détaillants d’alcool iii.
Constatation : Un contrôle gouvernemental accru est associé à une
consommation moins élevée et à moins de méfaits
Le contrôle que le gouvernement exerce sur la vente au détail d’alcool peut réduire la
consommation d’alcool et, en conséquence, ses méfaits15, 44, 45. Le démantèlement des
monopoles gouvernementaux et une privatisation accrue entraînent une hausse des ventes
d’alcool par habitant5, 46, de la consommation et des méfaits44, 47-50. En Colombie-Britannique
par exemple, la privatisation accrue (et la densité des points de vente au détail) a été
associée à une augmentation de la mortalité liée à l’alcool51.
Résultats pancanadiens : La proportion de détaillants d’alcool
appartenant à l’État varie d’une province et d’un territoire à l’autre
Comme l’illustre la figure 6, la proportion de détaillants d’alcool appartenant à l’État varie
considérablement à l’échelle nationale, allant de 0 % en Alberta et dans les Territoires
du Nord-Ouest à 100 % au Nunavut et au Yukon.
Les ventes à emporter — qui sont permises au Québec, au Manitoba, en Saskatchewan,
en Alberta, en Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest —
ne sont pas prises en compte dans les calculs relatifs aux détaillants d’alcool appartenant à
l’État. Au Yukon, 85 restaurants et bars détiennent un permis de vente d’alcool à emporter;
il s’agit de la seule forme de vente au détail privée dans la province. En Saskatchewan,
on compte 450 établissements détenant un permis de vente à emporter, comparativement
à 75 détaillants publics et 194 détaillants privés. Au Québec, les restaurants et les bars
détenteurs d’un permis de vente d’alcool sont autorisés à vendre des boissons alcoolisées
pour accompagner un repas qui doit être emporté ou livré (à l’exception de la bière en fût et
des spiritueux).
iii. Le nombre total de détaillants d’alcool comprend les détaillants publics et privés. Les magasins d’alcool, les établissements
détenant un permis de vente d’alcool pour consommation hors lieux et les contractuels indépendants sont considérés
comme du domaine privé. Les ventes à emporter sont exclues.
22Vous pouvez aussi lire