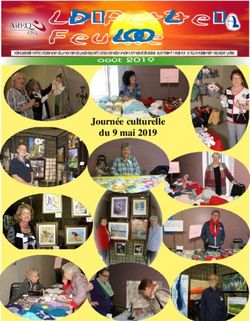Quelle était la religion des 46 présidents américains ?
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Publié le 3 février 2021(Mise à jour le 3/02) Par Louis Fraysse Quelle était la religion des 46 présidents américains ? Joe Biden, le nouveau locataire de la Maison Blanche, n’est que le deuxième président catholique de l’histoire des États-Unis. 57 ans. C’est la période qu’il aura fallu attendre pour qu’un catholique soit de nouveau élu à la Maison Blanche. Comme son prédécesseur John Fitzgerald Kennedy, arrivé au pouvoir en 1961, Joe Biden est démocrate et d’ascendance irlandaise. Les deux hommes sont les deux seuls catholiques à avoir occupé la présidence – les catholiques comptent aujourd’hui pour près d’un cinquième de la population américaine. La Constitution américaine, rappelons-le, interdit tout test ou prérequis de nature religieuse pour l’attribution d’une fonction publique. Reste que la quasi-totalité des présidents des États-Unis étaient chrétiens. Pratiquement tous ont par ailleurs prêté serment sur une bible lors de leur cérémonie d’investiture, ce qui n’est pas non plus requis par la Constitution mais relève d’une coutume remontant à George Washington lui-même, le tout premier président du pays.
Épiscopaliens et presbytériens Si l’appartenance religieuse des présidents reflète celle de la société (en 2007, 78 % des Américains se définissait comme chrétiens, selon le Pew Research Center – une proportion tombée à 65 % douze ans plus tard), elle le fait toutefois à travers un miroir déformant. Parmi les 46 hommes qui se sont succédé à la Maison Blanche, presque la moitié étaient ainsi épiscopaliens ou presbytériens. Tant les presbytériens, qui s’inscrivent dans la tradition réformée, que les épiscopaliens, de rite anglican, incarnent dans le pays un protestantisme dit “mainline” (“historique”, “traditionnel”). On leur oppose habituellement les nombreux courants du protestantisme évangélique. Plus populaire, plus conservateur, ce dernier représente 25 à 30 % de la population, selon que l’on y inclut ou non les Églises protestantes noires, en majorité baptistes. Les Églises protestantes historiques, elles, rassemblent quelque 14 % des Américains. Le cas de Jefferson et de Lincoln Depuis l’après-Seconde Guerre mondiale, cependant, les présidents élus tendent à mieux refléter la diversité religieuse du pays. Les États-Unis ont ainsi connu des présidents épiscopaliens, bien sûr (Gerald Ford, George Bush senior), presbytériens (Dwight Eisenhower, Ronald Reagan), baptistes (Jimmy Carter, Bill Clinton), méthodiste (George W. Bush), quaker (Richard Nixon), calviniste (Lyndon Johnson, membre des Disciples du Christ) ou encore catholiques, comme on l’a vu. Quant à Barack Obama et Donald Trump, s’ils se définissent comme chrétiens, ils ne s’inscrivent pas dans un courant particulier. À travers l’histoire américaine, plusieurs autres présidents, et non des moindres, n’avaient pas d’appartenance religieuse précise. C’est notamment le cas de Thomas Jefferson, troisième président des États-Unis et l’un des principaux rédacteurs de la Constitution. Ayant pris ses distances avec le christianisme, rapporte un article du Pew Research Center, ce père fondateur est notamment connu pour avoir édité sa propre version du Nouveau Testament – expurgée des miracles attribués à Jésus. En ce qui concerne l’emblématique Abraham Lincoln, président lors de la guerre de Sécession (1861-1865), les historiens débattent toujours de la nature de ses croyances religieuses.
Un Congrès représentatif ? Quant à l’actuel Congrès des États-Unis, l’équivalent du Parlement français, sa composition religieuse s’écarte à certains égards de celle de la population. 88 % des sénateurs et représentants se revendiquent ainsi du christianisme, contre 65 % des Américains. Les protestants (55 %), les catholiques (30 %) et les juifs (6 %) sont surreprésentés par rapport à leur poids dans la société – respectivement 43 %, 20 % et 2 %. Deux groupes, à l’inverse, sont largement sous-représentés. Seuls 0,4 % des élus à la Chambre des représentants et au Sénat sont pentecôtistes, alors que le pentecôtisme réunit 5 % de la population. Mais c’est surtout vis-à-vis des personnes “sans religion” que l’écart est le plus net. Alors qu’elles représentent aujourd’hui un quart de la population américaine, leur proportion au Congrès ne s’élève qu’à… 0,2 %. À lire également : États-Unis : le président élu doit-il obligatoirement prêter serment sur la Bible ? Élu président, Joe Biden appelle à “restaurer l’âme de l’Amérique” États-Unis : Kamala Harris, colistière de Joe Biden et protestante baptiste États-Unis : l’assaut du Capitole, ultime legs de Donald Trump ?
Publié le 1 février 2021(Mise à jour le 3/02) Par Louis Fraysse Bible : le roi David a-t-il réellement existé ? Malgré l’apport de l’archéologie, on en sait très peu sur ce personnage majeur de l’Ancien Testament. “Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi.” Cette promesse que fait Dieu à David, relatée en 2 Samuel 7,16, fait du berger devenu roi le fondateur d’une dynastie éternelle, celle d’Israël. Mais David a-t-il seulement existé ? Les historiens qui se penchent sur cette question se heurtent à une difficulté majeure : la rareté des sources disponibles. Ce que l’on sait de David, on le tire essentiellement de la Bible. “Les autres documents historiographiques relatant son règne, comme les Antiquités juives (VI-VII) de Flavius Josèphe, dépendent très largement du récit biblique”, précise ainsi le bibliste Matthieu Richelle, professeur d’Ancien Testament à l’université catholique de Louvain-la-Neuve, dans un chapitre de l’Histoire des Juifs (PUF, 2020). Au sein même de la Bible, les Chroniques reprennent des pans entiers des livres de Samuel et des Rois.”
Saül, David et Salomon Dans l’Ancien Testament, les deux livres de Samuel s’attachent à retracer les origines de la monarchie israélite à travers trois figures tutélaires : Saül, David et Salomon. S’ils gardent quelques souvenirs historiques, ces récits, soutient le bibliste Thomas Römer, titulaire de la chaire “Milieux bibliques” au Collège de France, sont “largement légendaires”. Les livres de Samuel présentent David comme un guerrier au service de Saül, dont la lutte victorieuse contre les Philistins permit l’instauration d’un royaume indépendant. David se distingue par ses hauts faits, en tuant notamment le géant philistin Goliath. Mais Saül est désavoué par Dieu, qui élit à sa place David. Selon la chronologie biblique, ce dernier devient roi d’Israël en 1010 avant notre ère. Un âge d’or Pour les rédacteurs du texte biblique, David est parvenu à unifier l’ensemble des douze tribus d’Israël en un seul royaume et à faire de Jérusalem la capitale du peuple juif. “Dans ces conditions, résume Matthieu Richelle, la Monarchie unifiée [par David] reste dans la mémoire collective comme un âge d’or.” Le portrait que fait la Bible de David, cependant, n’est pas qu’éloges et louanges. Assassinats pour monter sur le trône, adultère, conflits familiaux… “Le tout aboutit à une fin de règne crépusculaire“, souligne le bibliste. Comment considérer l’historicité du texte biblique au sujet de David et de son règne ? Pour les chercheurs, il s’agit à la fois d’appréhender les techniques littéraires employées par les rédacteurs, les sources qu’ils mobilisent, et surtout leurs motivations. La durée du règne de David en est un exemple. Selon les livres de Samuel et des Rois, David, tout comme Salomon, a régné quarante ans. Or cette période de quarante années est une durée conventionnelle dans la Bible, rappelle Matthieu Richelle. Elle est ainsi attribuée à plusieurs dirigeants dans le livre des Juges, ainsi qu’à certains épisodes à la forte portée symbolique, comme le séjour des Hébreux au désert. Pour le bibliste, “il est possible que les durées de règne de David et Salomon constituent des nombres “typologiques”, à ne pas prendre à la lettre, ce qui relativise la valeur de la date retenue pour le début du règne du premier : 1000 représente un horizon.”
L’archéologie à la rescousse Cette prééminence du texte biblique dans ce que l’on sait de David fait que ce roi, pour reprendre les mots de Thomas Römer, est “difficilement saisissable” sur le plan historique. En 1993, une découverte majeure est pourtant venue bouleverser la donne. À Tel Dan, dans le nord d’Israël, des archéologues exhument alors les fragments d’une stèle datant de la fin du IXe siècle avant notre ère. Dans l’inscription qu’ils parviennent à déchiffrer, un roi araméen se félicite d’avoir vaincu la “maison de David”, “maison” étant ici synonyme de “dynastie”. Cette trouvaille archéologique semble indiquer que David aurait non seulement existé, mais qu’il était considéré, y compris par ses adversaires, comme le fondateur de la royauté judéenne. Elle pourrait être renforcée par le déchiffrement de la stèle de Mésha. Découverte en 1868 par un missionnaire alsacien, cette dernière n’a toujours pas été déchiffrée en intégralité. Mais les progrès des techniques d’imagerie numérique pourraient bien changer les choses. Selon l’historien Michael Langlois, nouveau directeur de Réforme, il est probable que l’un des passages de la stèle mentionne la “maison de David”. Si cette inscription venait à être confirmée, il s’agirait d’un autre témoignage historique de l’existence du roi David. Chef de clan ou dirigeant d’un empire ? L’existence historique de David tend donc à faire consensus parmi les historiens… mais c’est à peu près tout. Les opinions des chercheurs quant au degré d’historicité des affirmations bibliques sur David, rapporte Matthieu Richelle, “se répartissent sur une échelle allant du “minimalisme” (David comme simple chef de clan) au “maximalisme” (David comme dirigeant un empire), avec bien des positions intermédiaires”. Parmi ces divergences et ces débats constitutifs de la démarche scientifique, il est une certitude, que souligne le professeur de l’université de Louvain-la-Neuve. David, dont la mémoire a été célébrée par la Bible, est encore à ce jour une “figure clé de la mémoire culturelle d’Israël”. En savoir plus :
Histoire des Juifs. Un voyage en 80 dates de l’Antiquité à nos jours Pierre Savy (dir.), PUF, 2020, 29 €. Les 100 mots de la Bible Thomas Römer PUF, 2020, 9 €. À lire dans Réforme : Série “L’accession au trône de David” (1/6) : Son onction par Samuel Série “Le règne de David” (1) : L’arche de l’alliance et le temple de Jérusalem Publié le 28 janvier 2021(Mise à jour le 28/01) Par Louis Fraysse
Une histoire des Juifs en 80 dates, entretien avec l’historien Pierre Savy Dans un livre paru aux Presses universitaires de France, quelque 70 historiens retracent 3 000 ans d’histoire des Juifs. Entretien avec le médiéviste Pierre Savy, maître d’œuvre de l’ouvrage aux côtés des historiennes Katell Berthelot et Audrey Kichelewski. En introduction de votre Histoire des Juifs, vous expliquez que ce livre « comble un manque réel ». Pour quelle raison ? Pour une raison très simple : il manquait, en langue française, une histoire des Juifs qui soit à la fois très accessible et tout à fait sérieuse sur le plan scientifique. C’est le défi que je me suis lancé, avec le concours indispensable de Katell Berthelot, Audrey Kichelewski et des dizaines d’historiens qui ont accepté de jouer le jeu. Car si ce livre n’est pas un ouvrage d’érudition mais bien de vulgarisation, il réunit néanmoins parmi les tout meilleurs spécialistes de l’histoire des Juifs et du judaïsme. Avec cet ouvrage, nous donnons à voir au grand public le meilleur de la recherche universitaire. Ce livre n’est pas une histoire du « judaïsme », ni une histoire des « juifs », mais bien une histoire des « Juifs » ; la majuscule importe ici. Cela renvoie à ce que signifie être juif… C’est là une question essentielle, à laquelle le livre ne prétend pas apporter de réponse définitive. Si nous avons opté pour la majuscule, c’est que nous estimons qu’au-delà de la religion, les Juifs forment également un peuple. Certes, c’est un peuple caractérisé par une diversité immense, qu’elle soit linguistique, culturelle, liturgique ou encore culinaire. De même, être juif aujourd’hui en France n’est pas la même chose qu’être juif dans le royaume antique de Juda. Mais nous pensons qu’il existe tout de même une homogénéité, une continuité, aussi lâche soit-elle, dans ce qui constitue l’identité juive à travers les siècles. Cela tient à la conscience d’être juif, pour commencer, mais aussi à d’autres traits plus ou moins
appuyés selon les lieux et les époques, comme la transmission de la Torah, la passation d’un bagage culturel plutôt que matériel, une forme de dispersion, à travers l’expérience de la diaspora, ou encore une position souvent minoritaire. Pourquoi avez-vous fait le choix d’un survol de l’histoire des Juifs en 80 dates plutôt qu’à l’aide d’une grande synthèse ? Il y avait là une vraie volonté de notre part. Comme nous tenions à proposer un livre accessible, le choix de la date nous est paru comme la meilleure solution. La date a quelque chose de ludique, elle offre au lecteur la liberté de butiner, de voyager à travers l’histoire, d’aller et revenir entre les siècles et les continents au gré de ses envies et intérêts. Au lecteur désireux de creuser davantage un sujet donné, nous indiquons après chaque chapitre une brève bibliographie. Chaque article est une sorte de synthèse de l’état des connaissances et des grands débats historiographiques sur un sujet défini. Il présente également l’usage qui a pu être fait, à travers l’histoire, d’un événement donné – je pense par exemple à la conversion des Khazars au judaïsme, vers 740, qui a refait surface avec le conflit israélo-palestinien et les réflexions critiques sur le sionisme. En n’optant pas pour une grande synthèse historique, nous perdons sans doute une unité de ton, mais nous gagnons une grande et fructueuse diversité de points de vue. Ce livre est un livre d’histoire mosaïque ; nous ne prétendons pas tout aborder, tout dire de l’histoire des Juifs, ce qui serait de toute façon illusoire. Quant au choix des dates, il a constitué un casse-tête, mais un casse-tête stimulant ; nous avons là encore opté pour la diversité. Si certaines dates sont des passages obligés, comme l’expulsion des Juifs d’Espagne en 1492 ou l’insurrection du ghetto de Varsovie en 1943, d’autres sont moins connues et peuvent être l’occasion de présenter des pans entiers de l’histoire culturelle ou religieuse juive, comme l’édition de la Mishnah, vers 220, ou l’ordination de la première femme rabbin, Regina Jonas, en 1935. Comme date d’entrée des Juifs dans l’histoire, vous avez choisi 1207 avant notre ère, avec la stèle de Mérenptah. Pourquoi ? Avec Katell Berthelot, qui a coordonné la première partie du livre, laquelle s’étend des origines au VIIe siècle, nous avons décidé de n’utiliser que les dates que l’on connaît grâce aux documents historiques. La question qui se pose en filigrane est ici celle de l’usage des textes bibliques. Comme la Bible n’est pas à
proprement parler un livre d’histoire, nous avons décidé d’écarter les événements qui ont comme seule et unique source le récit biblique. La stèle de Mérenptah est un document épigraphique, le premier de l’histoire à mentionner l’existence d’un peuple nommé « Israël », vaincu par un pharaon égyptien du nom de Mérenptah. Mais cela ne signifie pas bien sûr que les historiens n’accordent pas de crédit à la Bible juive ; nous consacrons ainsi la deuxième date du livre (vers 1000 avant notre ère) au roi David, dont l’existence historique est avérée. Comment aborder la question de l’antisémitisme, si prégnante dans l’histoire des Juifs, sans lui consacrer l’essentiel des notices ? C’est une autre question fondamentale, qui nécessite une réponse équilibrée. Les historiens du judaïsme ont été fortement marqués par un texte du grand historien américain Salo Baron (1895-1989), qui rejetait la conception « lacrymale » de l’histoire juive, cette tradition de martyrologies qui voyait en l’expérience juive une litanie sans fin de malheurs. Sans nier évidemment les souffrances et la longue construction d’une infériorité du peuple juif, qui a culminé au XXe siècle avec la Shoah, nous avons voulu montrer que l’histoire des Juifs est aussi une histoire de réalisations culturelles majeures, de prospérité, de bonheur et parfois, oui, de tranquillité. Vous avancez que « la conscience minoritaire est historiquement indissociable du fait juif ». Qu’est-ce à dire ? Précisons-le d’emblée : cette conscience minoritaire ne dit pas toute l’expérience juive. L’histoire des Juifs a ainsi connu des royaumes, dans l’Antiquité et avec, depuis 1948, l’État d’Israël. Cela dit, au fur et à mesure que les sociétés occidentales ont été christianisées, la conscience d’être en situation d’infériorité numérique et donc de faiblesse s’est progressivement imposée dans la conscience juive. Cette conscience minoritaire a suscité de nombreux débats quant à ses implications, par exemple autour de la question de l’« alliance verticale » : faut-il à tout prix s’allier avec les cercles dominants, afin de bénéficier de leur protection, de peur d’être brutalement rejetés de la société ? Certains travaux d’historiens ont aussi démontré comment ce sentiment minoritaire a sans doute aidé les Juifs à accompagner la modernité ; on le voit très bien dans des épisodes comme le Risorgimento, en Italie, où l’implication des citoyens juifs est très frappante. En France, les protestants partagent avec leurs compatriotes juifs cette
longue expérience de la minorité. Au-delà de cette similarité, en quoi pensez-vous que ce livre peut intéresser les lecteurs protestants ? Tout comme les Juifs, les protestants sont une minorité avant tout définie par une inscription religieuse ; les deux groupes ont aussi en commun une présence très ancienne en France et une longue histoire de persécutions. Plus généralement, je vois une sensibilité proche dans le rapport au texte, dans l’importance de l’étude et, sur un plan plus théologique, dans la contestation du clergé et de la sainteté. Quant à l’intérêt de cet ouvrage pour des lecteurs protestants, je pense que la relation avec le judaïsme est un sujet brûlant pour tout chrétien – Jésus, après tout, était juif ! Sur un plan plus historique, culturel, nombre de protestants seront interpelés par cette condition minoritaire, par le fait d’être perçu comme différent au sein de la société. Dernièrement, en tant que citoyens français, ce livre nous interroge car il aborde des questions que nous nous posons tous au- delà de nos identités particulières, notamment quant à la définition d’une identité collective, de ce qui fait de nous des citoyens d’un même pays, tout simplement. Propos recueillis par Louis Fraysse À lire Histoire des Juifs. Un voyage en 80 dates de l’Antiquité à nos jours, Pierre Savy (dir.), PUF, 2020, 29 €.
Publié le 27 janvier 2021(Mise à jour le 27/01) Par Louis Fraysse Protestantisme en Chine : un état des lieux Avec près de soixante millions de fidèles, la Chine est l’un des pays qui comptent le plus de protestants au monde. Entretien avec Juliette Duléry, doctorante en sociologie politique. Qui sont les protestants chinois ? Juliette Duléry, doctorante à l’université de Paris à l’Institut français de recherche sur l’Asie du Sud-Est, a mené plusieurs terrains de recherche à Pékin, Shenzhen et Changsha. Entretien. On connaît mal en France le christianisme chinois. Quelles sont ses origines ? Les premiers chrétiens occidentaux, des missionnaires jésuites, se sont installés en Chine à la fin du XVIe siècle. Le protestantisme, lui, est plus récent. Il gagne l’empire du Milieu au début du XIXe siècle, porté par des missionnaires comme l’Écossais Robert Morrison (1782-1834). À l’époque, les protestants n’ont pas le droit de résider en Chine ; ils évangélisent donc à partir des périphéries du monde chinois, comme Canton. Ce n’est qu’après les défaites chinoises lors des guerres de l’Opium (1839-1842 puis 1856-1860) qu’ils vont être autorisés à construire des églises à l’intérieur des terres. La relation entre la Chine et le protestantisme, depuis, est marquée par une profonde ambivalence. D’un côté, il reste associé par l’État-parti et une partie de la société à cet héritage semi-colonial. Mais de l’autre, il a toujours véhiculé une image de modernité occidentale, aux yeux d’une nation qui cherchait justement à se moderniser. Ce n’est sans doute pas un hasard si plusieurs figures politiques
majeures de la Chine républicaine (1911-1949), comme Sun Yat-sen et Tchang Kaï-chek, étaient protestantes. Peut-on dresser un état des lieux du protestantisme en Chine aujourd’hui ? Il est globalement difficile d’avoir des statistiques fiables. Dans une étude sérieuse, le Pew Forum Research estimait néanmoins à 58 millions le nombre de protestants dans le pays en 2011. Comme ailleurs dans le monde, les mouvements pentecôtistes et charismatiques se diffusent le plus rapidement. Notons que les Églises évangéliques, en Chine, ont très tôt été dirigées par des pasteurs chinois, ce qui a amené les chercheurs à parler d’un protestantisme “indigène”. Les Églises historiques, à l’inverse, ont d’abord été soutenues par des organisations missionnaires étrangères, comme les YMCA (Young Men’s Christian Associations, NDLR) ou la London Missionary Society. Avec l’arrivée du maoïsme, en 1949, l’État a repris à son compte cet « indigénisme », en rompant les liens avec les dénominations étrangères, et en supervisant de manière accrue l’ensemble des Églises chinoises. Les protestants sont-ils présents partout dans le pays ? À l’échelle de la Chine, le protestantisme représente quelque 4,4 % de la population (environ 3 % en France, NDLR). Mais c’est au sein des grandes villes côtières qu’il est le plus dynamique. Surnommée la “Jérusalem de la Chine”, la métropole de Wenzhou compte ainsi entre 10 et 15 % de protestants, en majorité évangéliques. Les liens sont historiquement forts entre ces villes côtières et Taïwan et Hong Kong, dont sont venus de nombreux évangélistes. Vous écrivez que le protestantisme est porteur d’une « triple altérité » aux yeux du régime. Qu’entendez-vous par là ? Athée, l’État-parti voit d’un mauvais œil l’existence de mouvements religieux. Le “Document 19”, une directive de 1982 du comité central du Parti communiste chinois (PCC), qualifie ainsi les religions d’instruments d’aveuglement des masses appelées à disparaître à long terme. Aujourd’hui, il demeure interdit aux cadres du PCC de professer une religion même si, dans le cadre privé, c’est autorisé. En tant que groupe social, le protestantisme représente aussi une menace potentielle pour le régime, à l’instar des autres organisations de la société civile.
Le PCC exerce en conséquence une politique d’endiguement délibérée visant à réduire le nombre de protestants, en limitant le nombre de lieux de culte notamment. Et pour devenir pasteur d’une église officielle, il faut obligatoirement avoir été formé dans l’un des séminaires de théologie officiels. Enfin, le protestantisme reste assimilé à un “cheval de Troie” de la démocratie, donc de l’influence étrangère. Le gouvernement a mis en œuvre une politique d'”anti- infiltration” à son égard. Cette dernière s’est accentuée depuis l’arrivée au pouvoir de Xi Jinping, en 2012. À l’occasion du XIXe congrès du PCC, en 2017, le président chinois avait ouvertement appelé à une “sinisation” des religions dans le pays. En parallèle des Églises protestantes officielles, il existe un mouvement florissant d’« Églises de maison ». D’où vient-il ? Ce phénomène date de la période communiste. Lors du Grand Bond en avant (1958-1961) puis pendant la Révolution culturelle (1966-1976), le gouvernement a fermé tous les lieux de culte. Le protestantisme a toutefois survécu, car nombre de fidèles ont continué à se rassembler de manière clandestine dans leurs maisons. Ces “Églises de maison” ou “Églises souterraines” sont aujourd’hui aussi dynamiques que les Églises officielles, agrées par le PCC, mais elles sont en contrepartie surveillées de près par les autorités locales. Ces dernières tolèrent des rassemblements d’une vingtaine de personnes ; au-delà, les églises sont étroitement supervisées. Le pouvoir réprime par ailleurs toute contestation d’ordre politique : l’avocat Wang Yi, qui avait qualifié Xi Jinping de “pécheur devant Dieu” lors d’un prêche en décembre 2018, a depuis été placé en détention pour subversion. Attention toutefois à ne pas trop simplifier les choses : la frontière est assez floue entre le monde des Églises officielles et celui des Églises de maison. La grande majorité de ces dernières adoptent une rhétorique d’allégeance au gouvernement, et certaines Églises autorisées disposent elles aussi de groupes de maison. L’État-parti cherche à endiguer le protestantisme, et pourtant il progresse… Comment l’expliquez-vous ? Le protestantisme, on l’a vu, a toujours incarné une forme de modernité à l’occidentale. Le mouvement évangélique et plus particulièrement les mouvements charismatiques creusent ce sillon de la modernité ; ils séduisent par
leur dynamisme, l’accès direct à Dieu qu’ils professent ou encore leur valorisation des nouvelles technologies. Croyance héritée, le protestantisme se propage aussi via les cercles privés, qu’ils soient familiaux, amicaux ou professionnels. C’est là quelque chose de tout à fait marquant. Alors que le religieux est contrôlé de près dans l’espace public et jusque dans les lieux de culte, le monde des affaires bénéficie d’une bien plus grande liberté. J’ai ainsi visité, dans la banlieue de Shenzhen, une usine bâtie par un homme d’affaires évangélique. Comme de nombreux autres dirigeants d’entreprises, il évangélise ouvertement ses employés, à travers l’organisation de chorales ou de séances de lecture de la Bible, auxquelles la participation est fortement encouragée. De telles pratiques seraient impensables en France, alors que notre pays garantit une bien plus grande liberté religieuse. Ce paradoxe est emblématique de l’environnement flou, mouvant, dans lequel évolue le protestantisme en Chine aujourd’hui. Propos recueillis par Louis Fraysse Pour en savoir plus Juliette Duléry, « La visibilité des organisations protestantes en Chine sous le regard de l’État-parti », Questions de communication 37, 2020, p. 143-166.
Publié le 26 janvier 2021(Mise à jour le 26/01) Par Louis Fraysse Pour une histoire globale de la peste noire : le nouveau cours de l’historien Patrick Boucheron Alors que l’épidémie de Covid-19 sévit toujours, le professeur au Collège de France consacre son nouveau cours à la pire pandémie de l’histoire. La pire catastrophe démographique de l’histoire de l’humanité, rien de moins. En effaçant la moitié de la population mondiale en seulement cinq ans, la peste noire a marqué au fer rouge la conscience de ses contemporains. Sidérant par son ampleur, l’événement continue d’interroger aujourd’hui. Et c’est justement le sujet du nouveau cours du médiéviste Patrick Boucheron, titulaire de la chaire Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle, au Collège de France. Diffusée le 5 janvier dernier, la première séance propose une introduction générale, intitulée “in medias res“. In medias res, “au milieu des choses”, tant plane aujourd’hui l’ombre d’une autre pandémie, la Covid-19. Situation sanitaire oblige, Patrick Boucheron s’exprime devant un amphithéâtre quasiment vide, mais grâce au numérique, son cours est en accès libre sur le site du Collège. Pandémie et cohésion sociale Comment faire l’histoire de la peste noire ? Patrick Boucheron commence par le récit de l’arrivée de la peste en 1347 à Marseille, l’une des principales portes d’entrée de la maladie dans le royaume de France. Au bout de plusieurs mois, la
cour du tribunal est contrainte de déménager pour s’installer sur le port, pour fuir, précise un notaire, “la terrible puanteur des morts qui s’échappe du cimetière”. Malgré l’effarement des contemporains devant la violence de la pandémie, dont l’origine et le mode de propagation sont alors inconnus, les historiens notent que dans le royaume, pourtant ravagé en 1348, la cohésion sociale tient bon, tant bien que mal. Mais la saignée démographique aura dans les décennies suivantes de fortes incidences sur la société. La forte pénurie de main d’œuvre cause une pression sur les salaires, tant l’offre de travail est supérieure à la demande, que la classe dirigeante tente de contenir. Le cours de Patrick Boucheron est l’occasion d’une réflexion sur les sources. Dans les textes, la pandémie laisse ainsi parfois une empreinte indirecte : dans la commune d’Orvieto, en Italie, la surmortalité est telle qu’on en vient à manquer de cire pour les bougies, utilisées pour les enterrements. Les autorités décident donc de réglementer le poids des cierges lors des funérailles. Une “histoire profonde” Au fil de sa séance d’introduction, Patrick Boucheron s’interroge : l’histoire de la peste noire ne serait-elle pas trop centrée sur l’Europe et sur une période – de 1347-1353 – trop restreinte ? Le directeur d’ouvrage de la très remarquée Histoire mondiale de la France (Seuil, 2017) plaide ici encore pour une histoire “globale”, une “histoire profonde” de la peste, sur les plans chronologique, géographique et même… climatique. Cette histoire profonde, soutient le chercheur, “appréhenderait la peste noire du germe aux étoiles, depuis le décodage de l’ADN extrait sur la pulpe dentaire des restes osseux exhumés dans le cimetière londonien d’East Smithfield, en 1348, jusqu’à la mesure de la variation cosmique de l’irradiation solaire, qui modifie le climat du Qinghai sur le plateau tibétain et fait donc sortir le germe meurtrier de son silence pathologique”. Un « laboratoire de l’interdisciplinarité » Longtemps caractérisée par un primat “absolu” des sources écrites, l’histoire de la peste noire a été révolutionnée depuis une quinzaine d’années par les progrès
de l’archéologie funéraire, de la microbiologie et de la zoo-anthropologie. Les apports des “archives du sol”, en complément des sources plus traditionnelles, font aujourd’hui de l’histoire de la peste noire un “laboratoire de l’interdisciplinarité”, précise Patrick Boucheron. Aux historiens désormais d’utiliser à bon escient les connaissances offertes par ces nouvelles disciplines scientifiques. “Si la peste noire est bonne à penser, souligne encore le professeur, c’est parce qu’elle met à l’épreuve, de manière paroxystique, la robustesse de la société médiévale.” En savoir plus : Le cours de Patrick Boucheron, sur le site du Collège de France : cliquez ici À lire sur reforme.net : Un mal qui répand la terreur : 1348, la peste noire s’abat sur l’Europe La peste noire, un “châtiment divin” Patrick Boucheron : “Dire aux jeunes qu’il n’y a pas lieu de désespérer”
Publié le 26 janvier 2021(Mise à jour le 3/02) Par Louis Fraysse Qu’est-ce que les “nations” dans la Bible ? “Je ferai de toi une grande nation” déclare Dieu au futur Abraham. Comment comprendre cette expression ? Les lecteurs de la Bible le savent bien : de nation(s), il est souvent question dans le texte biblique. La nation, selon le dictionnaire Le Robert, est un “groupe humain assez vaste, qui se caractérise par la conscience de son unité et la volonté de vivre en commun”. En français, cependant, le mot possède une forte connotation historique, indissociable de la Révolution française et de l’expérience républicaine. Et la Bible dans tout cela ? Dans l’Ancien Testament, le mot “nation” traduit généralement l’hébreu goy. “Contrairement à son acception actuelle, ce terme n’a rien de péjoratif pour les rédacteurs du texte biblique, indique l’historien et bibliste Michael Langlois, nouveau directeur de Réforme. On l’utilise le plus souvent par opposition à un autre mot hébreu, ‘am, que l’on traduit plutôt en français par “peuple”. ‘am/peuple évoque davantage le côté filial, l’idée d’ancêtres communs, de liens biologiques entre des personnes. Goy/nation possède à l’inverse une connotation politique, on l’emploie pour désigner un groupe d’individus qui forment un ensemble cohérent, un groupe qui vit une destinée commune, sans nécessairement avoir des liens de sang. Notons, en guise de nuance, que les choses ne sont pas tout à fait aussi schématiques, et il est parfois difficile de distinguer aussi clairement ces deux sens.”
De la Genèse à l’Exode On retrouve notamment la mention du mot “nation” dans l’un des passages les plus célèbres de l’Ancien Testament. En Genèse 12,2, Dieu déclare ainsi à Abram, le futur Abraham : “Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai ; je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction.” Plus loin, dans le livre de l’Exode, chapitre 19, verset 6, Dieu dit à Moïse : “Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte.” Cette même expression de “nation sainte” est reprise dans le Nouveau Testament, dans l’épître de Pierre. De quoi est-il question ? Un projet commun “Moïse est celui qui va donner une loi au peuple juif, une loi présentée comme un projet de Dieu et qui, en définissant une organisation sociale et politique, vise à faire d’Israël une nation porteuse d’un projet commun, décrypte Michael Langlois. Israël, béni par Yahvé, doit devenir un témoin pour l’humanité entière. Mais pour que cela advienne, pour qu’il soit visible aux yeux du monde, il faut que le peuple d’Abraham forme une entité politique, géographique, religieuse, bref, une nation.” Quant à l’expression “royaume de prêtres”, pour désigner Israël, elle s’inscrit dans la même visée, selon le chercheur. “De la même façon que le prêtre est un médiateur entre Dieu et les hommes, la fonction d’Israël, en tant que nation, est d’être une médiatrice entre Dieu et l’humanité.” Une lumière pour les autres nations “Cette notion de “nation sainte” est l’aboutissement de la promesse faite à Abraham en Genèse 12, estime Michael Langlois. Abraham n’est pas élu par Dieu pour séparer son peuple du reste de l’humanité, mais son élection vise au contraire à l’universalité. En Genèse 15,5, Dieu dit ainsi à Abraham : “Contemple le ciel, je te prie, et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui dit : Ainsi sera ta descendance.” À travers cette image de grande quantité, de multitude, on comprend que la postérité d’Abraham, ce nouveau peuple qui va naître, va être un instrument de bénédiction pour toute l’humanité.”
En reprenant l’expression “nation sainte”, l’épître de Pierre (1 Pierre 2,9) poursuit dans cette voie. “Bien que n’étant pas descendants physiques d’Abraham, les chrétiens le deviennent sur le plan symbolique, précise Michael Langlois. L’apôtre Paul ne dit pas autre chose quand il parle de ceux qui ont été choisis par Dieu “selon la foi” : s’ils ne sont pas les héritiers d’Abraham par le sang, les chrétiens le deviennent par la foi. Ils portent donc en eux la promesse d’être membres de cette nation dont la vocation est d’être une lumière pour les autres nations.” Publié le 19 janvier 2021(Mise à jour le 20/01) Par Louis Fraysse États-Unis : l’assaut du Capitole, ultime legs de Donald Trump ? Alors que Joe Biden s’apprête à succéder à Donald Trump, Réforme a proposé à deux historiens de réfléchir au trumpisme et au tournant qu’a constitué l’assaut du Capitole, le 6 janvier dernier. Le 20 janvier 2021, le démocrate Joe Biden sera officiellement investi 46e président des États-Unis d’Amérique. Donald Trump, le premier président de l’histoire du pays à être visé par deux procédures de destitution, a annoncé qu’il
ne participerait pas à la cérémonie d’investiture de son successeur. Le milliardaire refuse toujours de reconnaître sa défaite lors de l’élection de novembre dernier, une élection entachée selon lui de fraudes massives – sans qu’il en ait fourni la moindre preuve. Chercheuse associée à l’université Paris-3 Sorbonne nouvelle, Maya Kandel est une spécialiste reconnue de la politique étrangère américaine. Directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales, Romain Huret est l’un des meilleurs connaisseurs du conservatisme américain. Le 6 janvier dernier, une foule de manifestants proTrump ont pénétré de force dans l’enceinte du Capitole, à Washington D. C., pour contester la validation par le Congrès de l’élection de Joe Biden. Au-delà de la violence de cet assaut, on est frappé par sa portée symbolique. Que nous dit cet épisode de l’état du pays aujourd’hui ? Maya Kandel : Ce qui s’est déroulé au Capitole le 6 janvier est à la fois logique mais choquant, prévisible mais sidérant. Prévisible, car depuis plusieurs décennies, le Parti républicain a entrepris un glissement vers la droite, dont la présidence de Donald Trump marque l’aboutissement. Avec le milliardaire, l’extrême droite est entrée à la Maison Blanche et, pour le dire schématiquement, l’extrême droite n’aime pas rendre le pouvoir une fois qu’elle l’a acquis. Par ailleurs, cela faisait des mois que les analystes mettaient en garde contre le risque de violences de nature politique en cas de défaite du candidat républicain. Cela étant dit, la prise du Capitole constitue un choc, elle est le signe qu’un nouveau palier a été franchi. Cet événement sans précédent est une atteinte directe aux institutions des États-Unis et au processus démocratique, dont la transition ordonnée du pouvoir constitue une caractéristique fondamentale. Mitch McConnell, le chef de la majorité républicaine au Sénat et allié fidèle de Trump, ne s’y est pas trompé lorsqu’il a qualifié ces violences d’attaque « contre la souveraineté du peuple qui légitime notre République ». Romain Huret : Nous venons assurément d’assister à un moment extraordinaire, dont on mesure mal encore les conséquences à long terme. Jamais on n’avait vu un président appeler ouvertement à jouer ainsi avec les limites du légal et de l’illégal, à remettre en cause de façon systématique la légitimité de l’exercice démocratique. Quant à la dimension symbolique de cette occupation physique, violente, de l’un des lieux fondateurs de la nation américaine, elle saute aux yeux.
Les militants qui sont entrés de force dans le Capitole ne l’ont pas fait par hasard ; occuper ce lieu est une manière de signifier que les élus à Washington ne sont pas les vrais dépositaires de la démocratie, cette dernière appartenant au peuple américain, qui est prêt à la défendre les armes à la main si nécessaire. Vous reliez l’attaque du Capitole à la “militarisation” de la société américaine. Comment expliquer ce phénomène ? R. H. : Les États-Unis ne se voient pas assez comme ce qu’ils sont, à savoir une société en guerre. Depuis l’après-Seconde Guerre mondiale, le pays vit dans un état de guerre permanent, largement accentué après le 11 septembre 2001. La militarisation de la société est entretenue par le complexe militaro-industriel, qui emploie des millions d’Américains, et plus encore par l’engagement de millions d’hommes et de femmes dans des théâtres d’opérations militaires. Aujourd’hui, le pays compte deux millions de soldats et quelque dix-huit millions d’anciens combattants. Cela fait donc vingt millions de personnes, sans même parler de leurs familles, qui ont connu l’expérience du feu, soit environ 9 % de la population. C’est considérable. Or les guerres qu’ont menées les États-Unis, en Irak ou en Afghanistan, ont été extrêmement violentes, et l’on sait les séquelles physiques et psychologiques qu’elles laissent sur les militaires de retour du front. Des militaires qui constituent des recrues de choix pour les milices paramilitaires… R. H. : Nombre de ces anciens combattants peinent à se réinsérer dans la vie civile, à suivre les traitements médicaux qui s’imposent à eux étant donné leur état de fragilité mentale – le suicide et la crise des opiacés ont fait des ravages parmi eux. Comme l’a très bien montré l’historienne Kathleen Belew, un certain nombre de ces ex-soldats ont trouvé dans les milices paramilitaires des espaces de sociabilité, de camaraderie, un point de repère dans leurs vies. Longtemps à la marge du mouvement conservateur, car considérées comme trop radicales, ces milices ont bénéficié de l’accession au pouvoir de Donald Trump, qui leur a accordé son soutien. La translation semble évidente entre cette poudrière sociale qu’est la militarisation de la société et l’explosion ponctuelle de violences, à l’image du 6 janvier. Dans notre société française pacifiée et sécularisée, on peine à saisir l’influence de l’armée et de la religion sur la société américaine, deux éléments pourtant structurels.
Comment cela ? R. H. : La lecture religieuse du trumpisme (voir Réforme n° 3867 et sur reforme.net) est fondamentale pour comprendre les motivations de ses acteurs. Il en va de même pour sa lecture militaire. À plusieurs reprises dans son histoire, la France a connu des moments où les anciens combattants étaient très nombreux dans la société. Les historiens parlent à ce sujet de “brutalisation” du corps social, soit la traduction, dans la vie civile, en temps de paix, de l’expérience de guerre. On a alors des millions de personnes qui ont connu le feu et qui en gardent des traces, jusque dans leur comportement ou leur vocabulaire. Ce que peut enseigner la vieille Europe aux États-Unis, c’est que l’on n’engage pas autant de soldats dans des conflits violents sans en subir à terme les effets dans l’ensemble du corps social. L’un des grands enjeux de la présidence de Joe Biden sera de réussir à réinsérer ces anciens combattants dans la vie civile. “Avec le recul que nous offre ce premier mandat, il s’avère que la présidence de Donald Trump incarne à merveille le concept de “tribalisme” en politique” Vous avez utilisé le mot « trumpisme ». Comment définiriez-vous ce mouvement ? R. H. : Le trumpisme incarne selon moi la version la plus épurée, la plus radicale et la plus violente du conservatisme américain. Ce dernier se caractérise par sa profonde diversité : il y a ainsi des conservateurs sociaux, fiscaux ou encore religieux. Donald Trump s’est emparé de chacune des facettes du conservatisme et les a renvoyées à leur radicalité la plus extrême, et sa personnalité même lui a permis de trouver un écho au sein d’une frange de la population qui lui est restée particulièrement fidèle. Si l’on étudie dans le détail la parole du milliardaire, on constate que chacun peut se reconnaître dans ses propos. En restant somme toute assez vague sur le fond, mais en employant un langage direct, décomplexé, Donald Trump a noué une relation fusionnelle avec ses partisans, qui se retrouvent dans sa personne, même s’ils viennent d’horizons différents – chrétiens évangéliques, ouvriers de la Rust belt [littéralement « Ceinture de la rouille », région industrielle du nord-est des États-Unis en plein déclin, ndlr] ou membres de milices suprémacistes par exemple. M. K. : La grande force de Donald Trump est d’être parvenu à mobiliser des
millions d’Américains qui, auparavant, ne participaient pas à la vie politique. Ces militants sont avant tout attachés à sa personne, et l’on peut se demander ce qu’ils vont faire si le milliardaire disparaît du paysage politique – c’est sans doute la préoccupation première de la majorité des élus républicains à l’heure actuelle. Avec le recul que nous offre ce premier mandat, il s’avère que la présidence de Donald Trump incarne à merveille le concept de “tribalisme” en politique. On doit notamment cette notion à la politologue Liliana Mason qui démontre, dans l’un de ses ouvrages, comment les identités partisanes, idéologiques, religieuses et raciales des Américains se sont progressivement alignées, rendant les partis républicain et démocrate de plus en plus homogènes. Pour Mason, cet « alignement » identitaire a des conséquences politiques majeures. Quand la politique devient une question identitaire, il est en effet de plus en plus difficile d’établir le moindre compromis, et chaque électorat devient à la fois plus partial et moins tolérant vis-à-vis du bord opposé. Cette notion de tribalisme est particulièrement utile pour comprendre le soutien indéfectible de dizaines de millions d’électeurs républicains à Donald Trump, malgré les nombreux revirements de ce dernier : si l’affiliation à un parti est une affaire d’identité, écrit Liliana Mason, alors les positions politiques concrètes importent peu ; elles peuvent être modifiées au gré du positionnement du parti ou de son leader. Le génie de Trump est donc d’être parvenu à s’adresser directement aux différents groupes qui composent le Parti républicain en parlant avant tout à leurs identités, et en saisissant cette angoisse de « perte de statut » qui définit les motivations du vote populiste, comme l’a montré par exemple la politiste Pippa Norris. R. H. : Cette dimension identitaire est en effet essentielle pour comprendre le trumpisme. À bien des égards, ce dernier s’inscrit dans la continuité du Tea Party, ce grand mouvement populaire de protestation fiscale qui avait submergé le pays en 2009. Mais là où le ciment du Tea Party était l’économie, le trumpisme repose avant tout sur une obsession identitaire. La thématique de la défense de l’identité blanche et chrétienne n’est pas chose nouvelle aux États-Unis, on peut penser à l’émergence puis au retour du Ku Klux Klan, aux XIXe et XXe siècles. La différence, c’est que Donald Trump et les idéologues qui l’entourent ont replacé ce combat identitaire dans un contexte mondial, avec leur soutien apporté au Brésil de Jair Bolsonaro et à la Hongrie de Viktor Orban. M. K : Le trumpisme est aussi le produit direct de l’évolution du Parti républicain
Vous pouvez aussi lire