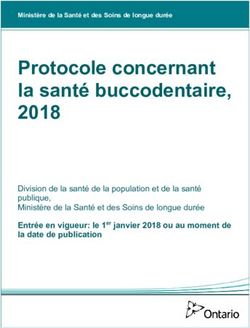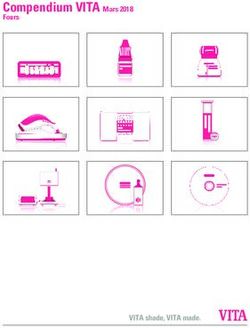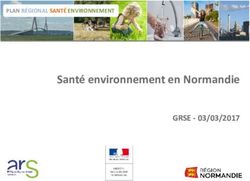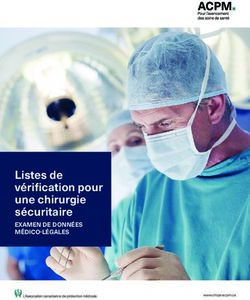SANTÉ PUBLIQUE DU médecine humanitaire en gynécologie - 7décembre 2015
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
SANTÉ PUBLIQUE
Marion Ravit, Ingénieur biostatisticienne, UVSQ.
Economiste de la santé.
DU médecine humanitaire en gynécologie
7décembre 2015
1Pour Winslow (1920)
la santé publique consiste en « l’art et la science :
• d’améliorer l’état de santé de la population ;
• de prévenir la maladie ;
• et de promouvoir la santé et l’efficacité des services de
santé ;
• par la coordination des efforts de la société »
« La santé publique est la science et l’art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et de promouvoir la santé et l’efficacité physiques à
travers les efforts coordonnés de la communauté pour l’assainissement de l’environnement, le contrôle des infections dans la population,
l’éducation de l’individu aux principes de l’hygiène personnelle, l’organisation des services médicaux et infirmiers pour le diagnostic précoce et
le traite- ment préventif des pathologies, le développement des dispositifs sociaux qui assureront à chacun un niveau de vie adéquat pour le
maintien de la santé. »
3Pour l’OMS (2002)
la santé publique représente « l’ensemble des efforts par
des institutions publiques dans une société pour :
• améliorer ;
• promouvoir ;
• protéger ;
• et restaurer la santé de la population ;
• grâce à une action collective. »
4Définir la santé publique
La santé publique se présente comme une approche collective des
actions de santé ;
• organisation de la santé à l’échelle de populations entières,
• en mettant en avant la prévention et la promotion de la santé.
Ceci inclut toutes les approches organisées, tous les systèmes de
promotion de la santé, de prévention des maladies, de lutte contre la
maladie, de réadaptation ou de soins orientés en ce sens.
Santé publique Médecine clinique
Prévention Traitement curatif
Approche populationnelle Approche individuelle
5Domaines d’action historiques de la santé
publique
• Il y a 4000–5000 ans au moins : construction par la société
mycénienne des réseaux d'égouts, des WC et des dispositifs de
chasse d'eau. La plupart des civilisations qui l'ont suivie, ont introduit
des mesures d'assainissement, d'hygiène et de quarantaine.
• Au cours du dernier millénaire : besoin de combattre des
pandémies de maladies graves telles que le choléra, la lèpre, la
variole, le typhus, la syphilis et la peste, a rendu ces mesures
particulièrement nécessaires.
• Une meilleure compréhension et l'identification des origines des
maladies et des actions à prendre pour les combattre ont permis de
définir et de mettre en œuvre ces mesures de santé publique de
façon plus rationnelle et systématique depuis quelques siècles.
6
OMS, 2002.Domaines d’action historiques de la santé
publique
• 18e et 19e siècles : l'emprise de la santé publique a englobé
successivement des domaines tels que:
- la protection des enfants et des travailleurs
- la prise en charge des personnes âgées, des handicapés et des
malades mentaux
- les problèmes de santé liés à l'urbanisation rapide.
• Depuis des siècles, la santé publique dirige ses efforts
principalement en faveur de l'assainissement, de l'hygiène et de la
lutte contre les maladies transmissibles.
• Dans de nombreux pays, la création d'un Ministère de la Santé
semble avoir pour objet de permettre à l'Etat d'aborder ces domaines
de manière plus systématique et plus efficace.
7
OMS, 2002.Médecin de santé publique
CliSP - Collège de liaison des Internes de Santé Publique
8
https://www.youtube.com/watch?v=nkRda4XjI2cFonctions essentielles de santé
publique (OMS)
1 : Contrôle et analyse de la situation sanitaire
2 : Surveillance épidémiologique/ prévention et lutte contre les
maladies
3 : Elaboration de politiques et planification dans le domaine de la
santé publique
4 : Gestion stratégique des systèmes et services de santé pour
améliorer la santé de la population
5 : Réglementation et mesures coercitives pour la protection de la santé
publique
6 : Développement et planification des ressources humaines dans le
domaine de la santé publique
7 : Promotion de la santé, participation et droit de regard des citoyens
8 : Assurance de la qualité des services de santé destinés à une
population cible et à la population générale.
9 : Recherche, développement et mise en œuvre de solutions
innovatrices en matière de santé publique. 9
OMS, 2002.Les FESP concerne un très grand nombre d'activités qui relèvent de la
santé publique:
Par exemple concernant le contrôle et l'analyse de la situation sanitaire:
l'évaluation de l'état de santé, l'analyse des tendances de morbidité et
de mortalité et l'identification des menaces existantes et potentielles
pour la santé
Elles peuvent comprendre des activités entreprises dans de nombreux
domaines du secteur public comme du secteur privé.
10
OMS, 2002.Population
Approche populationnelle ne signifie pas toute la population :
Le plus souvent, un programme de santé publique concerne une
population ciblée:
- Vulnérable
- Par genre
- Par âge
- À risque...
11Quelques définitions
• Politique de santé publique est l’ensemble des choix stratégiques
des pouvoirs publics pour choisir les champs d’intervention, les
objectifs généraux à atteindre et les moyens qui seront engagés.
(terme anglais « Politics »). Il s’agit de maintenir ou d’améliorer l’état
de santé d’une population.
• Plan de santé publique est un ensemble de dispositions arrêtées
en vue de l’exécution d’un projet et comporte une série de
programmes d’actions. Il opère des choix stratégiques en retenant
certains types d’intervention plutôt que d’autres et fixe les priorités
de son action en les hiérarchisant. (terme anglais « Policy »).
• Programme de santé publique est un ensemble cohérant d’actions
pour atteindre des objectifs précis (ex : programme tuberculose).
• Action de santé publique est la composante opérationnelle d’un
programme ; elle s’inscrit dans les objectifs du programme en
12
définissant un mode d’intervention particulier. Cours IFSISanté Publique et Santé de la
Femme
13Pour la banque mondiale
Ce qu'il faut faire pour favoriser la santé des femmes :
• éduquer les filles et les garçons
• réduire le nombre de grossesses chez les adolescentes
• donner aux mères les moyens d’espacer les naissances et de
choisir la taille de leur famille
• améliorer la nutrition maternelle
• veiller à ce que les accouchements soient assistés par un
personnel qualifié et donner un meilleur accès à des soins
obstétricaux, anténatals et post-partum complets et d’urgence
14
Banque mondiale (http://www.banquemondiale.org/omd/sante_des_meres.html)Femmes et programmes de santé en
Afrique
Quels programmes de santé pour les femmes en Afrique et
pourquoi ? :
Les programmes de santé de la reproduction :
- réduire la morbidité et la mortalité liées à la maternité, aux
grossesses, aux accouchements et aux avortements
- lutter contre les pratiques traditionnelles néfastes à la santé
des femmes
- atténuer l’impact des MST et du sida
Nécessité d’une évaluation de la situation pour une meilleure
identification des problèmes de santé de la reproduction et une analyse
plus fine pour établir les priorités en fonction de l’ampleur, de la sévérité́
et de la vulnérabilité́ de chaque problème. 15
(Awa Coll-Seck, 2000)• Programmes de planification familiale : - Aujourd’hui la croissance démographique est globalement ralentie dans le monde, les taux de mortalité baissent. - Les politiques de santé et de population adoptées par la plupart des États ont crée des conditions favorables pour une promotion de la planification familiale. Mais : la situation en Afrique reste préoccupante avec une fécondité encore très élevée Conséquences d’une absence de planification familiale : décès maternels et infantiles dus aux grossesses rapprochées, avortements clandestins effectués dans des conditions dangereuses... 16
• Programmes de maternité sans risque :
800 femmes décèdent chaque jour de complications liées à la
grossesse ou l’accouchement
Nécessité d’une volonté́ politique au plus haut niveau, un
programme de maternité́ sans risques dont la mise en œuvre sera
facilitée par une mobilisation communautaire, un système de soins
prénatals et obstétricaux performant et décentralisé et une approche
multisectorielle.
Les obstacles pour accéder à une prise en charge de qualité sont
variés : géographiques, techniques technique, administratif, humain,
culturel
Dans la plupart des pays africains des programmes nationaux appuyés
par une coopération bilatérale et multilatérale sont opérationnels mais
les résultats escomptés sont encore loin d’être atteints.
17• Programmes de MST/sida :
Près de 15 millions de femmes en âge de procréer dans le monde sont
séropositives au VIH. Les taux les plus élevés sont retrouvés en Afrique
au Sud du Sahara.
Dans la plupart des pays africains, les comités nationaux de lutte contre
les MST/sida appuyés par des organisations non gouvernementales
(ONG) et groupements féminins ont développé des programmes de
prévention du sida chez les femmes et des projets de prévention de la
trans- mission mère-enfant.
Seuls des programmes prenant en compte les facteurs de risque et
de vulnérabilité des femmes, mis en œuvre au niveau
communautaire et à large échelle, seront à la hauteur du défi à
relever.
18Les programmes de santé sexuelles
• Lutte contre les violences sexuelles :
Problème de santé publique récent.
Conséquences de violences sexuelles: les blessures physiques et
psychologiques, à l’origine de MST y compris l’infection par le VIH,
grossesses non désirées et d’avortements clandestins, humiliation de la
femme.
Les violences domestiques contraignent souvent les femmes et limitent
considérablement leur capacité à contrôler leur sexualité et leur
fécondité.
campagnes d’information et d’éducation sur l’ampleur et la gravité
du phénomène et sur les droits de la personne humaine. Dans
différents pays, des groupes de pression se constituent.
Sensiblilisation de la police à la détresse des femmes….
19• Les mutilations sexuelles :
Pratique traditionnelle assez répandue, l’excision et l’infibulation
en sont les plus courantes.
Quelles que soient les raisons invoquées (culturelles,
hygiéniques, esthétiques ou religieuses) la cruauté du geste, la
gravité des conséquences sur la santé et la sexualité des fillettes
et des femmes, font de ces mutilations sexuelles une violation
des droits de la personne.
=> Malgré les mesures juridiques prises par certains pays, la
pression de l’opinion internationale, la lutte des mouvements de
femmes et les campagnes médiatiques, cette pratique est
encore vivace.
20Autres probèmes de santé
Problèmes qui ne font pas l’objet de programmes spécifiques:
pathologies cancéreuses féminines et des troubles mentaux,
entre autres.
Dans la plupart des autres programmes de santé, une approche
genre n’est pas adoptée, ce qui conduit souvent à une
marginalisation des femmes.
Exemple : les programmes de lutte contre la drogue et le tabagisme
ciblent plus les garçons que les filles.
Les femmes ne sont pas seulement bénéficiaires de
programmes, elles jouent un rôle important dans l’adhésion et le
succès de certains programmes (Programme élargi de
vaccination (PEV)) mais aussi dans la prise en charge des
malades en tant que dispensatrices de soins.
21Santé Publique et Santé
Maternelle
22La santé maternelle : un enjeu de
santé publique
• 800 femmes décèdent chaque jour de complications liées à la
grossesse ou l’accouchement. 99% des 585 000 décès maternels
annuels surviennent dans les PED dont 47% en Afrique sub-
saharienne où dans sa vie, une femme a une chance sur 16 de
mourir d’une complication liée à la grossesse.
• 80% des décès maternels sont dus aux complications obstétricales
directes. Disposer des soins obstétricaux d’urgence (SOU) complets
et de qualité et assurer l’accès à ces soins sont les interventions
efficaces pour traiter ces complications.
• De tous les OMD, c’est celui pour lequel on enregistre le moins de
progrès.
23
Banque mondiale (http://www.banquemondiale.org/omd/sante_des_meres.html)
Alexandre Dumont, 2012OMD
24OMD 5 : Améliorer la santé maternelle
d'ici 2015
Réduction de 75 % du taux de mortalité maternelle entre 1990
et 2015
25
Banque mondiale (http://www.banquemondiale.org/omd/sante_des_meres.html)Programmes, Actions mis en place
pour améliorer la santé
maternelle?
26Santé Publique et Santé
Maternelle : exemple au Niger
27santé publique
Actions mises en place pour
améliorer la santé maternelle?
Exemple au Niger:
Problèmes? Actions mises en place?
https://www.youtube.com/watch?v=wxoUxg3xz5M 2829
Problème au niveau de la prise en charge des
complications obstétricales
=> Modèle des 3 délais (ou retard)
Trois principales phases de délai dans la prise en charge des urgences
obstétricales:
1/ le délai dans la décision de consulter
2/ le délai dans l’acheminement des patientes
vers les structures adaptées
3/ le délai dans la prise en charge
au sein des formations sanitaires
3031 A. Dumont, 2012
Exemple d’ interventions
Soins à domicile, CPN, prévention,
éducation des femmes, …
Moyens de communication
(téléphone, radio), véhicules de
transport, réduction de la barrière
financière (coût du transport),
services de santé intermédiaire, …
Moyens disponibles, formation
continue, méthodes d’audit clinique,
l’intervention de leaders d’opinion,
systèmes de rappel et d’aide
32
A. Dumont, 2012Autres actions mises en œuvre :
Lors de la CPN :
- Distribution de moustiquaire
- Prévention de l’anémie avec la distribution de
comprimés de fer
- Vaccination contre le tétanos
- PTME
+ Education des filles
Promotion des droits de la femme…
33Santé Publique et Santé
Maternelle : exemple au Mali
34Prises en charge des soins de santé
maternelle : exemple
Le Système de Référence-Évacuation (SRE) mis en place par la
Direction Régionale de la Santé de Kayes-Mali dès 2001 pour réduire
la mortalité maternelle comprend:
-un dispositif de financement
-un système d’alerte et d’évacuation sanitaire
-la mise à niveau des SOU.
+ le Mali a instauré la gratuité de la
césarienne en 2005
35
Fournier, 200936
Santé Publique et santé
maternelle : exemple de la
PTME
37PTME : Prévention de la Transmission Mère- Enfant du VIH/Sida La PTME est concernée par 3 des 8 OMD : l’objectif 4 (réduire la mortalité infantile), l’objectif 5 (améliorer la santé maternelle) et l’objectif 6 (combattre le VIH/SIDA, la tuberculose, le paludisme et d’autres maladies). La PTME du VIH de la mère à l’enfant dans l’utérus, à l'accouchement ou lors de l’allaitement requiert un ensemble complet de services depuis la prévention de la primo-infection au VIH chez les femmes à la prévention des grossesses non désirées des femmes vivant avec le VIH, en passant par la prévention de la transmission des femmes enceintes vivant avec le VIH à leur nourrisson et par les soins, le traitement et le soutien aux femmes vivant avec le VIH et à leur famille. 38
L’approche globale de la PTME par les Nations Unies
comprend les aspects suivants :
- Assurer une prévention primaire du VIH chez les femmes
en âge de procréer
- Prévenir les grossesses non désirées chez les femmes
séropositives
- Prévenir la transmission du VIH de la mère séropositive à
son bébé
- Fournir un traitement, des soins et un soutien appropriés
aux femmes séropositives, à leurs enfants et à leur
famille.
39La transmission du VIH d’une femme infectée à son enfant peut
survenir pendant la grossesse, pendant l'accouchement ou
après celui-ci par l’allaitement. Le risque de transmission de la
mère à l’enfant peut être réduit :
- par un traitement antirétroviral
- par une césarienne
- en évitant l’allaitement, mais uniquement s’il existe une
solution d’alimentation de remplacement acceptable,
réalisable, abordable, durable et sûre. Dans le cas contraire,
l’allaitement exclusif est recommandé pendant les six
premiers mois.
L’administration rapide de médicaments antirétroviraux aux
femmes enceintes séropositives et à leur(s) nouveau-né(s) réduit
de façon significative le risque de transmission du VIH de la
mère à l’enfant. Les mères séropositives doivent également avoir
accès à des traitements ARV pour protéger leur propre santé.
4041
Conclusion
42Conclusion
• La santé publique : approche collective des actions de santé avec une
organisation de la santé à l’échelle de populations entières et mise en avant la
prévention et la promotion de la santé
• Politique de santé publique: choix stratégiques des pouvoirs publics pour choisir
les champs d’intervention, les objectifs généraux à atteindre et les moyens qui seront
engagés.
• Femmes et programmes de santé en Afrique : multiples programmes de santé
de la reproduction, de santé sexuelles et autres mis en œuvre. Importance de la
femme et son éducation dans tous les domaines.
• La santé maternelle est un enjeu de santé publique (plus de 800 décès par jour/
99% dans les PED): beaucoup de programmes et d’interventions.
=> Lorsque je vais intervenir dans un pays (quelque soit mon rôle): important de se
renseigner sur les politiques de santé publique, les différents programmes et
interventions.
43MERCI!
44Références
• Organisation Mondiale de la santé. Bureau régional du Pacifique Occidental. Fonctions
essentielles de Santé Publique : le rôle des minitères de la santé, 2002.
• Cours IFSI : cours en santé publique, notions de base.
http://www.infirmiers.com/etudiants-en-ifsi/cours/cours-sante-publique-notions-de-
base.html
• Actualité et dossier en santé publique n° 30 : Santé publique et pays pauvre
(http://www.hcsp.fr/explore.cgi/Adsp?clef=52)
Anna Coll-Seck : femmes et programmes de santé en Afrique
• Alexandre dumont, Bull. Acad. Natle Méd., 2012, 196, no 8, 1521-1534, séance du 6
novembre 2012
• Fournier P, Dumont A, Tourigny C, Dunkley G, Dramé S (2009) Improved access to
comprehensive emergency obstetric care and its effect on institutional maternal
mortality in rural Mali. Bull World Health Organ 87(1):30–8.
• Liens suggérés
http://www.banquemondiale.org/omd/sante_des_meres.html
45Vous pouvez aussi lire