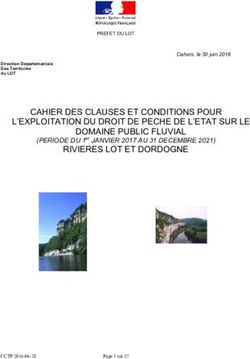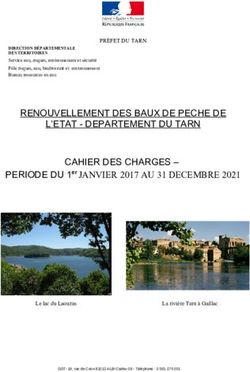Congrès mondial de droit constitutionnel à Oslo, 2014 Atelier 15: Les mutations du principe de séparation des pouvoirs
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
1
Dr. Bosa Nenadić*
Congrès mondial de droit constitutionnel à Oslo, 2014
Atelier 15: Les mutations du principe de séparation des pouvoirs
Le principe de séparation des pouvoirs et le contrôle
de constitutionnalité
- L’expérience de la République de Serbie -
Les cours constitutionnelles étaient dès le début considérées comme le principal
garant des rapports établis par la constitution entre les différentes autorités publiques et,
par la suite, entre ces autorités et les citoyens.
Dans leur pratique quasi centenaire, les cours constitutionnelles ont contribué aux
mutations du principe de séparation des pouvoir qui est un des principes fondamentaux de
l'établissement et de l'organisation du pouvoir des Etats contemporains. L’examen de la
pratique de la justice constitutionnelle met en évidence que le principe de séparation des
pouvoirs, qui avait constitué le principe de base de l'Etat de droit, censé être protégé par
la cour constitutionnelle, s'est transformé avec le temps en un critère de règlement des
différents conflits constitutionnels, plus précisément en un critère d'interprétation des
normes constitutionnelles.
Le présent mémoire met particulièrement en relief comment la Cour constitutionnelle
de Serbie contribuait, par sa pratique et sa politique de contrôle de constitutionnalité, aux
mutations du principe de séparation des pouvoirs, proclamé par la Constitution, et à quel
point ses décisions ont influencé la transformation de l’exercice « du pouvoir politique »(le
législatif et l’exécutif) ainsi que celle de l’exercice du pouvoir judiciaire, qualifié
d’indépendant et d’autonome dans le cadre de la séparation des trois pouvoirs.
I
Le principe de séparation des pouvoirs a été très largement appliqué. La réalisation de la
séparation des pouvoirs s’est avérée, dans la vie réelle, un processus beaucoup plus complexe et
exigeant que celui de son élaboration théorique et de quelque autre normalisation
constitutionnelle que ce soit. A quelques exceptions près, il fait partie, même aujourd’hui, dans
sa forme tripartite, des fondements de « l’organisation politique » de nombreux Etats en dépit des
propositions et des idées fréquentes portant sur la mise en œuvre d’une « nouvelle séparation des
pouvoirs».1
Avant la mise en place de la cour constitutionnelle, il était considéré que le contrôle de
constitutionnalité était incompatible avec un régime parlementaire, ainsi qu’avec un pouvoir
judiciaire indépendant. La doctrine du parlementarisme prévoyait la suprématie de la loi dans le
*L'auteure est juge de la Cour constitutionnelle de Serbie et Présidente de cette Cour dans la période de 2007 à
2010, nenadic@ustavni.sud.rs
1
Pour comprendre pourquoi il est nécessaire de modifier la séparation traditionnelle des pouvoirs, V. B.Ackerman,
The New Separation of Powers, Harvard Law Review, Ch 113,3/2000, 634-729. i A. Sajo, Dangerous liaisons:
checks and balances and the separation of powers (Ch3), Limiting Government: An Introduction to
Constitutionalism, Budapest, 1999, 69-102.2
cadre de l’ordre juridique, tandis que la doctrine de l’indépendance du pouvoir judiciaire était
basée sur l’idée « d’un contrôle interne de juridictions inférieures“ et sur l’inviolabilité des arrêts
d’une cour suprême (de cassation), comme la plus « éclairée » de toutes les autorités
gouvernementales. Cependant, l’influence de la conception de Kelsen, relative aux cours
constitutionnelles, était exceptionnelle en Europe du 20e siècle, particulièrement grâce à une idée
répandue selon laquelle il était possible d’intégrer cette instance dans l’architecture de la
séparation des pouvoirs sans provoquer des perturbations importantes dans « l’ordre des choses »
établi.2
La mise en place et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle d’Autriche et plus
particulièrement de celle d’Allemagne, étaient à l’origine des inspirations et des encouragements
amenant à l’acceptation du contrôle de constitutionnalité dans la plupart des pays européens. En
dépit de nombreuses spécificités de chacune des cours constitutionnelles et de l’observation
selon laquelle le modèle de Kelsen s’est « ramolli » dans la pratique avec le temps, il est pourtant
possible de parler d’un « modèle européen du contrôle de constitutionnalité ». Il convient
d’indiquer ses principales caractéristiques comme suit : primo, c’est un contrôle de
constitutionnalité centralisé dans le cadre duquel les cours constitutionnelles bénéficient d’une
juridiction constitutionnelle exclusive et définitive (dont les arrêts ne sont pas susceptibles
d’appel); secundo, les cours constitutionnelles ont pour limites le règlement des conflits
constitutionnels et la formulation des réponses aux questions constitutionnelles; tertio, quoique
séparées officiellement des autorités gouvernementales, les cours constitutionnelles sont liées
avec celles-ci avec lesquelles elles entretiennent un dialogue permanent et participent à des
actions différentes ;quarto, dans la plupart des cas, les cours constitutionnelles contrôlent les lois
après leur entrée en vigueur (a posteriori), et ce n’est qu’exceptionnellement qu’elles le font
avant leur entrée en vigueur (a priori);3quinto, elles sont devenues un défenseur direct des
libertés et des droits de l’homme, garantis par la constitution, autrement dit une institution «qui
constitue pour les citoyens une juridiction par excellence ».4
II
Le débat sur la nécessité d’un contrôle de constitutionnalité centralisé était dès le début
lié à celui qui portait sur la conception classique de la séparation des pouvoirs. La littérature
témoigne de la difficulté de défendre l’existence d’une autorité constitutionnelle à part qui
n’appartient à aucun des pouvoirs existants, mais qui doit sans doute disposer des prérogatives
puissantes par rapport à ceux qui doivent faire l’objet de son contrôle. C’était le « scepticisme »
et des tensions soulevées par des conceptions différentes de la mise en œuvre du contrôle de
constitutionnalité qui créaient, de temps à autre, une atmosphère de tensions exceptionnelles. Il
convient d’évoquer une sorte de « guerres menées par les autorités » lors desquelles les cours
constitutionnelles procédaient à la suppression de lois et d’autres textes réglementaires, plus
précisément celles-ci prenaient des décisions dont le pouvoir politique n’était pas « satisfait »,
2
A.S.Sweet, Constitutional Courts and Рarliamentary Democracy,West European Politics, 25, 1/ 2002, 78.
3
Cf. А.S.Sweet, Why Europe Rejected American Judicia Review - and Why it May Not Matter, 101 Michigan
LawReview, 2003, 201-237.
4
P. Haberle souligne qu'une cour constitutionnelle n'est pas seulement „une cour d'Etat“ mais également „une cour
qui appartient à la société entière“ et que les ciotyens „se sont vus doter d'une juridiction par excellence“ P. Haberle,
Ustavna država (L’Etat constitutionnel), Zagreb, 2002, 118.3
c’est-à-dire qu’elles menaçaient « les objectifs politiques et autres auxquels ce pouvoir
aspirait ».5
Le problème qui consiste à déterminer le rôle ou le caractère d’une cour constitutionnelle,
dans le contexte de la séparation des pouvoirs, dure depuis l’établissement de celle-là jusqu’à nos
jours. S’en suivent les questions de savoir si la nature (le caractère) de ce haut organe de l’Etat se
réfère au nom « juridiction » ou bien à l’adjectif « constitutionnel », plus précisément ce qui
détermine principalement ou considérablement sa nature ou son caractère; une cour
constitutionnelle ne doit-elle régler que des conflits « d’origine authentiquement juridique » ou
lui est-il permis de statuer également sur les contentieux du caractère plutôt politique que
juridique et, enfin, « quelle est sa portée » et où se trouvent les limites du contrôle d’une cour
constitutionnelle.6
Toutes les cours constitutionnelles, indépendamment du pays et de l’époque de leur
« naissance », ont connu un parcours « d’adaptation » aux conditions de la séparation des
pouvoirs en cherchant « leur place » au sein de la structure de la séparation des pouvoirs. Leur
place réelle dépendait des solutions constitutionnelles, ainsi que du choix effectué par les
juridictions, lors du contrôle de constitutionnalité, entre « un activisme judiciaire explicite » suivi
de la position d’un « défenseur combatif de la démocratie », « une retenue judiciaire »
accompagnée « d’une autolimitation modérée ou rigide », et une position passive, accompagnée
de la neutralité judiciaire.
Pour comprendre le rôle de la cour constitutionnelle dans les pays contemporains dans le
contexte du principe de séparation des pouvoirs, il est important de prendre en considération les
aspects différents de la fonction de la cour constitutionnelle. Tout d’abord, les cours
constitutionnelles jouent un rôle important tant dans les processus de création que dans celui
d’exercice d’un droit. A la différence des étapes initiales du fonctionnement des cours
constitutionnelles et de la prise des décisions simples, relatives à la (non)constitutionnalité, la
pratique de prise de décisions dites interprétatives, du type et du contenu différents, a commencé
à occuper le devant de la scène. C’est ainsi que le rôle de la cour se rapprochait progressivement
de celui qui est propre aux titulaires du pouvoir législatif en règle générale, quoique du point de
vue théorique, la mission principale de la cour constitutionnelle ne consistât pas à créer le droit,
mais avant tout à l’interpréter. La limite entre l’interprétation et la création du droit est devenue
extrêmement flexible7, notamment dans les conditions d’une liberté importante des cours
constitutionnelles quant à l’interprétation des normes constitutionnelles. En fait, compte tenu de
l’ampleur et du caractère abstrait de ces normes, les objectifs fixés peuvent être atteints sous
5
Cf. A. Barak, The Judge in a democracy, Princeton , 2006, 213-226; Б. Ненадић, О јемствима независности
уставних судова (B.Nenadić,Sur les garanties de l’indépendance des cours constitutionnelles), Beograd, 2012, 57-
78 .et Пејић, Улога и значаj Уставног суда у очувању владавине права (I. Pejić, Le rôle et l’importance de la
Cour constitutionnelle pour la sauvegarde du règne du droit), Beograd, 2013, 56.
6
Selon T. Koopmans, les limites du contrôle de constitutionnalité soulèvent des questions politiques (réservées par la
constitution uniquement aux branches politiques du pouvoir); la difficulté contre-majoritaire ; la question de la
discrétion et les méthodes d’interprétation T. Koopmans,Courts and Political Institutions – A Comparative View,
Cambridge, 2003,51.
7
En théorie, la cour constitutionnelle est désignée comme un législateur aussi bien „négatif“ que „positif“. En outre,
elle est qualifiée « d’assemblée constituante en session permanente », « un législateur opérant dans l’ombre », « une
chambre parlementaire spécialisée », « un législateur masqué », « le législatif suprême »etc.Cf. A.S.Sweet, Complex
Coordinate Construction in France and Germany”, in C.N.Tate & T.Vallinder (eds.) The Global Expansion of
Judicial Power, New York,1995, 225. et B. Nenadić, Constitutional Court of Serbia from a “Negative”to a
“Positive”Legislator,The Positionof Constitutional Courtsand Their Influenceon the Legal Orderof the State,
Košice, 2013, 157.4
différentes formes et chacune d’entre elles peut se justifier ou trouver une raison d’être. Mais, ce
n’est que la cour constitutionnelle qui s’est vue doter « d’un pouvoir discrétionnaire en matière
d’interprétation créative » (W.Geiger) et de détermination de « la véritable signification » d’une
norme constitutionnelle. Il convient de supposer que même la cour constitutionnelle agira tout
d’abord dans l’esprit de la doctrine de Montesquieu en « proclamant le droit » par la
concrétisation des normes juridiques moyennant une interprétation formelle de la constitution.
Reste qu’en pratique, les cours constitutionnelles vont au-delà de ces actions et, en tant
qu’interprètes créatifs, agissent par leurs décisions « dans l’esprit » non seulement de la
constitution, mais aussi des circonstances et de l’époque de leur action. Elles mettent dans « un
rapport rationnel » la signification des normes et institutions constitutionnelles avec le milieu
réel.8 Dans ce sens, c’est dire que l’époque contemporaine a fait développer une nouvelle
fonction de cet organe constitutionnel. Celle-ci se reflète dans l’évolution interprétative de la
constitution qui connaît, sans une révision formelle, une évolution relative à la compréhension et
à l’interprétation de ses normes.
Par conséquent, il est incontestable que les cours constitutionnelles peuvent être
impliquées, dans une large mesure, dans un processus législatif même sur la base de leur rôle
principal « d’un législateur négatif », particulièrement lorsqu’elles contrôlent la
constitutionnalité d’un processus législatif « inachevé »(contrôle а priori), lorsqu’elles procèdent
ex officio à la procédure d’évaluation de la constitutionnalité des actes du pouvoir législatif ou
qu’elles enjoignent au législateur comment procéder pour exécuter sa décision. Néanmoins, la
cour constitutionnelle ne fait, en effet, que « prolonger la vie » des normes tant constitutionnelles
que législatives (en neutralisant leur sens habituel) par l’adoption des décisions interprétatives.
Par ailleurs, en comblant des lacunes juridiques, elle ne fait que « parachever » aussi bien les
textes législatifs que constitutionnels. C’est pourquoi se pose la question de savoir si les cours
constitutionnelles débordent de la sorte de leur fonction de base et si cela signifie une sorte
d’accaparement du domaine de compétence du constituant et du législateur (voire du pouvoir
judiciaire qui était traditionnellement doté de la fonction d’interprétation du droit qu’il applique).
En examinant l’aspect judiciaire de la fonction des cours constitutionnelles, ceux qui
affirment que la cour constitutionnelle est une juridiction « aussi bien par son genre que par son
essence » sont les plus nombreux.9 C’est ainsi que H.J. Papier avance que « la justice
constitutionnelle », constitue tout compte fait, c’est-à-dire dans l’ensemble une ’véritable’ justice
dont les dossiers sont souvent plus proches de la politique que ceux dont sont saisies les
juridictions de l’ordre judiciaire“.10Cependant, il est ajouté que grâce à son rôle, elle constitue
« une instance judiciaire supérieure à toutes les autres », plus précisément « un contrôleur
judiciaire général ».11Il convient de constater qu’il n’est pas si simple d’assurer, du point de vue
tant normatif que procédural, une „répartition“ précise des pouvoirs entre les juridictions de
l’ordre constitutionnel et judiciaire en matière de protection des droits de l’homme, et encore
8
В. Зоркин, Кризис, доверия и государство. Конституционные нормы и законыне должны вступать в
жесткое противоречие с реальностью, www.rg.ru/2009/04/10/Zorkin. html
9
Р. Лукић, Уставност и законитост у Југославији,Београд (R. Lukić, La constitutionnalité et la légalité en
Yougoslavie, Beograd), 1966, 95-96.
10
H.J. Papier, Ustavno sudstvo u teoriji i praksi (La justice constitutionnelle en théorie et dans la pratique),
Beograd, KAS, 2010, 34.
11
Savoir plus de ces opinions: B. Nenadic, op. cit.,50-57. et I. Pejić, Uloga ustavnog suda u očuvanju ustavne
demokratije (Le rôle des juridictions constitutionnelles dans la sauvegarde de la démocratie constitutionnelle),
Pravni život, 14/08, 1158-1159.5
moins un rapport équilibré et harmonieux entre les cours constitutionnelle et suprême dans le
cadre de la procédure de contrôle de constitutionnalité du pouvoir judiciaire.12
Il est évident que la doctrine traditionnelle de séparation des pouvoirs s’altère en présence
de la cour constitutionnelle, que les trois pouvoirs fonctionnent dans un milieu complètement
nouveau et se soumettent à « l’autorité du droit constitutionnel qui évolue incessamment »,13alors
que l’influence des cours constitutionnelles, concernant la création et l’application du droit,
devient de plus en plus manifeste. Une « nouvelle configuration de l’environnement » de la prise
de décision politique et judiciaire émerge – il semble souvent que le contrôle de
constitutionnalité s’est transformé en une nouvelle étape des procédures législative et judiciaire,
autrement dit qu’il est devenu habituel que la procédure de contrôle de constitutionnalité succède
à la procédure législative, tout comme le processus de protection des droits de l’homme, terminé
devant les plus hautes juridictions du pays, se poursuit devant la cour constitutionnelle. Les
pouvoirs législatif et exécutif ne peuvent plus escompter l’achèvement au parlement de la
procédure de délibération sur un texte de loi, autrement dit la perfection de la loi du point de vue
juridique et son inviolabilité.14Il en est de même pour les actes du pouvoir judiciaire, au sein des
systèmes qui se sont vus doter d’un plein recours constitutionnel visant la protection des droits
de l’homme fondamentaux devant les cours constitutionnelles.
En bref, le regard sur la pratique des pays européens, dans lesquels fonctionne activement
la justice constitutionnelle, illustre le mieux le « nouveau constitutionnalisme » européen qui
prévoit la soumission de la législation et de la justice « aux normes constitutionnelles et
législatives, selon leur interprétation faite par la cour constitutionnelle, faute de quoi leurs actes
seront annulés ».15La conséquence en est « la judiciarisation de la prise de décision politique“,
plus précisément „l’intervention des juges constitutionnels dans la procédure législative“, ainsi
que dans la procédure judiciaire, accompagnée de l’élargissement de la constitutionnalisation
vers de nombreuses branches du droit appliqué par les juridictions judiciaires. Par leur action, les
cours constitutionnelles influencent également l’établissement des limites de la „volonté du
législateur“ et de la portée „de l’intime conviction du juge“, y compris la prise de décisions
concernant la qualité des lois et l’évaluation de l’application du droit matériel et de l’état de fait
établi en matière de protection des droits de l’homme devant les juridictions judiciaires etc.16
III
Outre la question de connaître la position de la cour constitutionnelle dans le cadre de la
séparation des trois pouvoirs, la littérature juridique fait ressortir également la question de savoir
si la cour constitutionnelle pourrait être qualifiée de« quatrième pouvoir ». Selon les points de
vue exposés, en guise de réponse à cette question, la doctrine traditionnelle relative à la
séparation des pouvoirs n’est pas qualifiée exclusivement de tripartite, selon le principe numerus
clausus, la trichotomie traditionnelle est mise en question depuis longtemps etc. Le phénomène
« d’une nouvelle forme constitutionnelle », comme un reflet de la nécessité de l’existence d’un
12
L. Garlicki, Constitutional Courts versus Supreme Courts, International Journal of Constitutitonal Law, 1, 2007,
44-68.
13
Les informations relatives au travail de la CCS en font état. Les deux dernières années, la Cour a rendu 36 arrêts
annulant les dispositions de certaines lois et 4 371 décisions de recevabilité des recours constitutionnels, avant tout
contre les décisions de justice.
14
Cf. A.S.Sweet,Constitutional Courtsand Parliamentary Democracy, West European Politics, 25, 1/2002, 77-100.
15
Ibidem.
16
Ibidem.6
contrôle de constitutionnalité permanent et efficace, visant à assurer la protection de la
constitutionnalité et des droits de l’homme, mène à une séparation potentielle des quatre
pouvoirs.17
Nous partageons la position selon laquelle les cours constitutionnelles, en tant qu’organes
constitutionnels souverains, ont « envahi », plus précisément occupé leur propre espace
constitutionnel qui, dans le cadre de la séparation des pouvoirs, ne pourrait être précisément
défini ni comme « judiciaire » ni comme « politique ».18C’est un espace qui se trouve à la ligne
de démarcation entre le droit et la politique. Du point de vue théorique, son rôle peut être
expliqué par la nécessité d’introduire un « contrepoids juridique » aux branches politiques du
pouvoir –au législatif et à l’exécutif, mais aussi au judiciaire (à partir du moment où la cour
constitutionnelle s’est mise à assurer une protection directe des droits de l’homme). En
conséquence, elle est un garant complémentaire de la justice constitutionnelle parce qu’elle
assure la suprématie de la constitution et de la décision judiciaire. En bref, la cour
constitutionnelle a la fonction d’un mécanisme juridique « introduit d’une manière extrêmement
minutieuse dans le corps de la séparation des pouvoirs, visant à protéger son expression
constitutionnelle(I. Pejić) et à la sauvegarder contre le débordement d’émotions de la majorité
politique et « les fantaisies politiques » du parlement,19contre l’arbitraire du gouvernement, mais
également contre d’éventuelles « caprices judiciaires ». De ce point de vue, le rôle de la justice
constitutionnelle présume l’indépendance et la souveraineté des cours constitutionnelles pour la
sauvegarde du principe de séparation des pouvoirs – celui qui est devenu non seulement un
principe fondamental de l’Etat de droit, protégé par la cour constitutionnelle, mais également un
principe de l’interprétation judiciaire des normes constitutionnelles et législatives.20
En conséquence, la construction constitutionnelle de séparation des pouvoirs a accepté la
justice constitutionnelle comme un instrument constitutionnel important qui évoluait tout en
gardant les caractéristiques du « plus haut » contrôleur constitutionnel du pouvoir. Sa légitimité
se base sur le motif essentiel de règlement des conflits constitutionnels – maintenir le pouvoir (la
politique) dans les limites du droit, harmoniser les actes relatifs à l’ordre juridique, protéger
directement les droits de l’homme et libertés fondamentales de tout individu. Elle le fait
justement selon le principe de séparation des pouvoirs, en partant du fait qu’aucun pouvoir ne
doit dépasser les limites et le cadre de ses compétences, établis par la constitution, plus
précisément en empêchant un pouvoir d’entrer dans le domaine d’un autre, ainsi que dans celui
des droits de l’homme fondamentaux. De ce point de vue, la cour constitutionnelle constitue « un
correctif important de la démocratie constitutionnelle ».Par ailleurs, selon certaines thèses, « s’il
n’y avait pas de cour constitutionnelle, la tyrannie de la majorité et du règne de partis politiques
pourrait devenir une règle »21, alors que les décisions inconstitutionnelles des plus hautes cours
17
Cette théorie a ces adeptes non seulement parmi les professeurs de droit public, mais également parmi les juges de
la Cour constitutionnelle. Cf.Уставни суд Србије – У сустрет новом Уставу (La cour constitutionnelle – A la
rencontre d’une nouvelle constitution), 2004, 61-70, et Ustavno sudstvo u teoriji i praksi (La justice
constitutionnelle en théorie et dans la pratique), 155.
18
Cf. A. S. Sweet, op.cit.,80.
19
Cf. J. Limbach, Savezni ustavni sud Njemačke (La Cour constitutionnelle fédérale d'Allemagne), München:
University Press, IRZ, 2010, 48.
20
Cf. A.T.von Mehren, Constitutionalism in Germany – The First Decision of the New Constitutional Court, The
American Journal of Comparative Law, Vol. 1, No.1-2 (1952), 70-94.
21
Cf. W. Sadurski, Rights Before Courts: A Study of Constitutional Courts in Postcommunist States of Central and
Eastern Europe, Springer, 2008, 58.7
du pays seraient inviolables.22 D’autre part, selon certains avertissements, les cours
constitutionnelles se considèrent supérieures à la constitution (celle-ci ne constitue que ce que les
juges constitutionnels y lisent), que ce sont des organes supérieurs aux pouvoirs législatif,
exécutif et judiciaire (leurs décisions ne sont pas susceptibles « d’appel »), que le contrôle de
constitutionnalité «s’est écarté du droit chemin » et « a pris celui de l’enfer politique », voire « il
s’est mis imprudemment à délibérer au quotidien » et à corriger les erreurs des autorités
judiciaires.
Il est incontestable que le rôle « d’instigateur » ou de réalisateur d’une idéologie politique
n’est pas confié aux autorités constitutionnelles et qu’il ne faut pas les considérer comme des
organes qui sont en compétition avec le parlement qui constitue une représentation
démocratiquement élue des citoyens. Un autre rôle qui ne leur est pas confié est celui de
l’instance suprême judiciaire, qui est en rivalité avec la cour suprême (de cassation) ayant la
qualité d’organe suprême du pouvoir judiciaire dont le domaine de compétence couvre
principalement la protection des droits de l’homme fondamentaux.23 En conséquence, il est
attendu que la cour constitutionnelle « ne réduise pas trop l’espace réservé, dans le cadre de la
répartition constitutionnelle du pouvoir, au parlement » et au gouvernement, lors de la
délibération sur les conflits constitutionnels, et qu’elle laisse à la politique « suffisamment
d’espace pour façonner la société ».24De même, il est attendu de la cour constitutionnelle de ne
pas procéder au contrôle de juridictions inférieures pour vérifier les décisions rendues par les
juridictions judiciaires et de ne pas « corriger leurs erreurs » lors de l’évaluation de la
constitutionnalité des actes des autorités judiciaires, mais d’évaluer uniquement si un acte ou une
action d’une autorité judiciaire porte atteinte à un droit de l’homme ou à un droit des minorités et
si le pouvoir judiciaire a respecté le cadre de ses pouvoirs constitutionnels.
IV
Selon cette théorie, les cours constitutionnelles représentent un bon « capital public et
politique » pour éviter des conflits différents entre les trois pouvoirs, notamment du fait de la
tendance des pouvoirs législatif et exécutif à se laisser abuser par la majorité parlementaire,25et
du penchant du pouvoir judiciaire, comme d’ailleurs tout autre pouvoir, à sortir parfois de la
constitution et de la loi. Les contentieux relatifs à la violation du principe de séparation des
pouvoirs par les autorités gouvernementales sont, par leur nature, des conflits constitutionnels.
Le rôle de la cour constitutionnelle consiste à régler ces contentieux par une « lecture »
authentique de la constitution. C’est pourquoi le principe de séparation des pouvoirs, proclamé
par la constitution, n’est pas une déclaration pure et simple, ce principe étant « important pour
interpréter la constitution dans les cas où les normes constitutionnelles ne prévoient pas ou ne
22
B. Nenadić, On some aspects of the ralationship of constitutional and regular courts, Le rôle et l’importance de la
cour constitutionnelle pour la sauvegarde du règne du droit, 110-111.
23
La Cour constitutionnelle de Serbie a exprimé sa position y relative dans sa Décision IУз-97/2012, selon laquelle
„le droit de l’organe législatif de corriger une norme législative pour la rendre conforme à la constitution, ainsi que
le droit du pouvoir judiciaire d’examiner et de réviser sa propre décision, demeurent intacts“. La Cour
constitutionnelle ne peut pas „procéder à la prise de décisions constructives à la place du législateur, tandis que la
justice constitutionnelle ne peut pas trancher en dernier ressort des contentieux concrets à la place d’une juridiction
et en reprendre la compétence“.
24
V. Mas, La justice constitutionnelle en théorie et dans la pratique, 17.
25
Cf. L.Epstein, J.Knight & O.Shvetsova, The Role of Constitutional Courts in the Establishment and Maintenance
of Democratic Systems of Government, Law & Society Review, 35, 1/2001, 127.8
prévoient pas clairement l’autorité publique qui devrait exercer une activité concrète“(R.
Marković).
La littérature met également en valeur des évaluations selon lesquelles ces conflits ont
souvent un trait « politique » et que la renonciation de la cour constitutionnelle à statuer sur
certains conflits, selon le principe de la retenue judiciaire (judicial self-restraint) « ne signifie
pas que ses compétences sont réduites ou affaiblies, mais qu’elle renonce à « s’occuper de la
politique », plus précisément à s’impliquer dans un espace limité et réservé par la constitution à
une structuration politique libre »,26et à une intime conviction du juge. Les juges des cours
constitutionnelles évoquent eux-mêmes les dilemmes auxquels les cours constitutionnelles font
face lors du règlement de contentieux similaires, en expliquant « qu’il n’y a pas de critères clairs
qui serviraient d’indice ou de guide pour marquer le chemin étroit entre le droit et la
politique ».27 Il est difficile de faire la différence entre les contentieux juridiques
« authentiques », « vrais », de caractère constitutionnel et ceux de nature politique, ces derniers
étant également appropriés pour faire l’objet d’un examen judiciaire, étant donné que le droit et
la politique ne peuvent pas être considérés comme deux parties opposées.28
En ce qui concerne l’autorité du contrôle de constitutionnalité visant la protection des
dispositions constitutionnelles relatives à la séparation des pouvoirs, il est indiqué que les cours
constitutionnelles agissent souvent d’une manière plutôt confortable lorsqu’elles procèdent au
règlement de tels conflits. D’un point de vue extérieur, il semble que les cours tentent parfois
« plutôt de s’adapter que de manifester une force pour délibérer » ou une initiative pour
interpréter. C’est par les exemples de la pratique de la Cour constitutionnelle allemande que
Kommers illustre que lors du règlement des conflits relatifs à la séparation des pouvoirs, même
cette cour reporte rationnellement la prise de décision en attendant « que les choses se calment ».
Dans ce cas, c’est le temps qui sert d’allié à la cour parce que le report de la prise de décision
crée une situation qui fait disparaître l’urgence de la controverse ou que celle-ci « se règle d’elle-
même » par les moyens politiques, ce qui a poussé, dans de nombreux cas, ceux qui avaient
engagé une action à retirer leurs propositions.29La retenue émerge particulièrement dans la
pratique des cours constitutionnelles des pays de l’Europe centrale et du Sud-Est (dans lesquels
l’exercice du pouvoir s’était longtemps effectué dans les conditions de la concentration des
pouvoirs). Par ailleurs, ces cours manifestent, en règle générale, une « servilité » plus importante
pour le parlement et le gouvernement dans le cas des conflits relatifs à la séparation des
pouvoirs, que lors du règlement des questions portant sur la protection des droits de
l’homme.30Néanmoins, il existe d’autres points de vue qui ne se conforment pas aux estimations
selon lesquelles les cours constitutionnelles réalisent plus facilement leur capital politique dans le
26
H. J. Papier,op.cit., 35.
27
J.Limbach, The Role of Federal Constitutional Court, 29.
28
Lapratiquemontrequelescoursconstitutionnellespeuventavoirunimpactefficacesurlesprocessus politiques et ce sous
différentes formes. Cf. D. North, Institutions, Institutionalchange, andeconomicperformance, Cambridge1990; J.G.
March, J. P. Olsen, Rediscovering Institutions:The Organizational Basisof Politics, New York, 1989, 21-38, и B.
Smerdel, S. Sokol, Ustavno pravo (Le droit constitutionnel), Zagreb, 2006, 200-202.
29
D.P.Kommers, The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany, Durham and London: Duke
University Press, 1989, 38.
30
Cf.B. Nenadić, op.cit., 110-111 et W. Sadurski, op.cit., 51. Ici, ils’agit également de la protection du principe des
éparation des pouvoirs dans le cadre des conflits constitutionnels abstraits, où ce principe sert souvent de correctif
dans les décisions de la cour constitutionnelle.9
domaine des droits de l’homme, autrement dit les conflits relatifs à la séparation des pouvoirs
sont plus risqués et c’est un motif de plus pour les cours pour les traiter avec plus de prudence.31
V
En ce qui concerne la protection du principe de séparation des pouvoirs, deux domaines
d’activité se recouvrent partiellement lors de l’exercice de cette compétence des cours
constitutionnelles. En effet, la cour constitutionnelle doit attacher une attention particulière, en
protégeant et en respectant la séparation des pouvoirs, pour maintenir l’équilibre dans l’exercice
et la réalisation de sa propre fonction et de ses pouvoirs, plus précisément pour éviter de se
retrouver elle-même dans le domaine du pouvoir. Conscientes du bien-fondé du reproche selon
lequel « elles s’accaparent du domaine du pouvoir », les cours constitutionnelles (toutes
confondues et sur une base presque quotidienne)expriment dans leurs décisions leur position
selon laquelle il ne relève pas de leur compétence « d’évaluer la pertinence, le bien-fondé ou
l’efficacité des mesures législatives » ni « d’organiser les rapports sociaux » ou « de mener la
politique législative », autrement dit les cours constitutionnelles ne sont pas compétentes pour
agir en vertu d’un recours constitutionnel « en tant que juridiction supérieure »,plus précisément
d’examiner la régularité de « la mise en œuvre d’un droit ordinaire » dans les procédures
judiciaires.32
Par conséquent, à l’instar de certains pouvoirs qui doivent jouer leur rôle « dans un grand
respect pour les autres pouvoirs » et « selon le principe prévoyant que chacun des pouvoirs
remplisse son rôle », le contrôle de constitutionnalité doit être effectué avec une responsabilité et
une « prudence » toutes particulières de la cour constitutionnelle.33
VI
Le « motif de base du contrôle de la cour constitutionnelle, qui est centralisé et universel,
réside en Serbie contemporaine dans une exigence d’assurer le fonctionnement d’un Etat de droit
qui est basé, entre autres, sur la séparation des pouvoirs, ainsi que sur « la soumission de toutes
les autorités publiques à la constitution et à la législation », sans exception. Grâce à une histoire
particulière, la Cour constitutionnelle de Serbie (dans le texte ci-après : CCS) constitue une
institution spécifique au sein de la famille des cours constitutionnelles contemporaines. Sans
compter la Cour constitutionnelle de Yougoslavie et celles de toutes les républiques membres de
cette dernière, elle était la première cour constitutionnelle à voir le jour en 1963, dans le cadre de
l’architecture du pouvoir socialiste. Cette cour avait fonctionné pendant plus de vingt cinq ans
dans les conditions de la concentration des pouvoirs (et du système de parti unique), pour
commencer à s’adapter aux conditions de la séparation des pouvoirs après l’adoption de la
Constitution de 1990. Dans la Serbie contemporaine, la CCS fonctionne, conformément à la
Constitution de 2006, en présence d’un principe explicitement proclamé, consistant à séparer les
31
Cf. L. Epstein, J. Knight & O. Shvetsova, op.cit., 117-163 et D. Stojanović, Le rôle et l’importance de la Cour
constitutionnelle dans la sauvegarde du règne du droit, 129-130.
32
V. B. Nenadić, On Constitutional Review of Judicial Power, CCS, Beograd, 2014, 1-19. Pour savoir à quel point il
est facile d’exprimer ce point de vue et difficile de le mettre en oeuvre en pratique, particulièrement en présence de
la mention „non, mais“.
33
A. Barak,op. cit.,281.10
trois pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. La sélection de ses magistrats est effectuée par les
représentants de tous les trois pouvoirs.
Depuis sa formation jusqu’à nos jours, la CCS est traditionnellement dotée de la qualité
d’autorité constitutionnelle. Or, c’est la première fois que le constituant contemporain consacre à
cette autorité un titre à part dans la Constitution – le Titre VI, intitulé « La Cour
constitutionnelle », alors que toutes les autres autorités publiques sont regroupées dans le Titre V
intitulé „Organisation du pouvoir“. La Cour s’est vue octroyer le pouvoir, en qualité „d’autorité
indépendante et souveraine“ (telle qu’elle est définie explicitement par la Constitution), dont les
arrêts sont « exécutifs, définitifs et universellement contraignants » (art. 166.), pour exercer le
contrôle (la vérification) de la constitutionnalité des actes et des actions de toutes les autorités
publiques, sans exception, et pour protéger directement les libertés et les droits de l’homme (art.
167). Néanmoins, ceci n’annonce pas la clôture du débat portant sur le caractère de la CCS, sa
place au sein du système de l’organisation du pouvoir et encore moins de celui relatif à la portée
de ses pouvoirs par rapport aux pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Bien au contraire, les
questions anciennes ont été de nouveau soulevées dans le cadre de la théorie serbe concernant le
rôle, le fonctionnement et les délibérations de la CCS, ainsi que la question de savoir s’il existe
un lien de causalité entre la démocratie et la créativité de la cour constitutionnelle, si l’activisme
judiciaire fait partie de la fonction de la cour constitutionnelle et si cette dernière lutte ainsi pour
sa propre position et ses pouvoirs ou si ses efforts sont orientés vers la protection de la
constitution et de ses valeurs ; si la CCS peut être et demeurer dans les limites de son orientation
constitutionnelle si elle devient une autorité qui tranche non seulement les conflits
constitutionnels les plus complexes dans le pays, mais aussi ceux d’un poids politique
considérable, et particulièrement ceux qui lui sont souvent « transférés » par les autres autorités
lorsqu’elles « se sentent impuissantes » ou qu’elles souhaitent éviter leur propre responsabilité
devant l’opinion publique concernant la mise en œuvre des mesures impopulaires; 34 comment
assurer l’efficacité de la protection de la cour constitutionnelle, la CCS étant devenue „une cour
d’intervention quotidienne“ et une juridiction « des gens ordinaires » (saisie au cours d’une
année de plus de 23000 affaires) etc.35
Pour répondre à ces questions, il faut procéder à une analyse particulière qui dépasse le
cadre du présent mémoire. C’est pourquoi nous dirons seulement que ces questions sont d’une
importance particulière, même pour le règlement des contentieux relatifs à la séparation des
pouvoirs. Et ce d’autant plus que la Constitution de Serbie ne connaît pas une séparation si
stricte, et que celle-ci n’existe pas en réalité en tant que telle du fait de l’entrecroisement de
certaines prérogatives du pouvoir. C’est pour cette raison qu’il est justement souvent attendu que
la Cour constitutionnelle définisse même les limites des actions de certaines autorités publiques
lors de l’exercice de leurs compétences respectives, dans le cadre du contrôle de
constitutionnalité.
Compte tenu de ses compétences, établies par la Constitution, la CCS ne se distinguait
pas considérablement, du point de vue formel, de son modèle, la justice constitutionnelle austro-
allemande. Mais, il fallait attendre des décennies pour que la CCS se positionne en tant que
garant de la constitution. De nombreux facteurs ont eu certainement un impact dans ce domaine,
et notamment les événements tumultueux connus par la Serbie au cours des vingt-cinq dernières
années, au plan tant local qu’international. Néanmoins, selon une évaluation générale, la CCS
34
Lorsque les conflits politiques sont „tranférés“ à la cour, ce transfert signifie „une délégation massive virtuelle et
infinie de l’autorité de la prise de décision politique“. А.S.Sweet,op. cit., 58.
35
B. Nenadic, Sur les garanties de l’indépendance des cours constitutionnelles, 114-121.11
contemporaine a la possibilité de devenir la pierre angulaire du constitutionnalisme dans le pays,
le symbole principal du règne du droit et « un contrepoids efficace aux autorités politiques dans
l’Etat ».
VII
La pratique de la CCS connaît de nombreux cas dont le règlement a exigé l’interprétation
du principe de séparation des pouvoirs, comme « principe de base », et cela dans le cadre des
différents procès menés devant la présente Cour, à partir des contentieux portant sur un conflit de
compétence, à travers les litiges abstraits et concrets relatifs à la protection de la
constitutionnalité, aux conflits relatifs à la protection des droits de l’homme individuels.
Les contentieux portant sur la séparation des pouvoirs ne s’épuisent pas, même devant la
CCS, dans le cadre des conflits de compétence qui relèvent traditionnellement de la compétence
de la CCS36et au sujet desquels celle-ci n’agit qu’en qualité de tribunal des conflits.37 Dans la
plupart des cas, ils font partie des affaires relatives aux limites fonctionnelles que la Constitution
établit au sein de chaque pouvoir, ainsi que de celles portant sur la protection des autres valeurs
constitutionnelles qui n’entrent qu’indirectement dans le domaine de la séparation des pouvoirs.
Nous ne mentionnerons que quelques unes des décisions rendues par la CCS:
а) En statuant sur le contentieux dans le cadre de l’affaire IUp-153/2008 et en déclarant
non conforme à la Constitution la décision du Gouvernement, la Cour a adopté la position selon
laquelle le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs «implique l’existence d’une
répartition fonctionnelle des prérogatives entre les autorités constitutionnelles ». La conception
qui est à l’origine de cette décision prévoit que le principe de répartition fonctionnelle des
prérogatives « ne devrait être violé ni par les décisions juridiques du pouvoir exécutif ni par
celles du législateur lui-même ». La CCS continue à préciser « que même le Gouvernement ne
doit pas enfreindre la séparation fonctionnelle ou les domaines du pouvoir, établis par la
Constitution, par le mode et le résultat de son interprétation soit de ses propres prérogatives
fonctionnelles, soit des pouvoirs fonctionnels des autres autorités publiques, en attribuant à soi-
même ou à une autre autorité publique des pouvoirs fonctionnels dont l’attribution n’est pas
prévue par la Constitution ou qui ne peuvent pas être considérés comme des fonctions
constitutionnelles immanentes ».38 Or, à la différence de cette décision qui a été positivement
accueillie par les confrères, la décision relative à l’affaire IUz-231/2012, au sujet de l’évaluation
de la constitutionnalité des dispositions de la Loi sur le Gouvernement39, a fait l’objet des
observations selon lesquelles la CCS n’avait pas strictement observé son
36
C’est la situation dans laquelle les positions des autorités publiques divergent sur la question de savoir à qui
appartient le domaine de compétence dont relève la prise de décision concernant une question donnée. Ces
divergences se manifestent sous deux formes: les conflits dits positifs et négatifs.
37
Le nombre de ces conflits menés devant la CCS n’est pas important. La Cour a reçu 636 affaires dans la période de
2002 à 2013. En règle générale, il s’agissait des conflits dits négatifs, menés entre les juridictions et les autres
autorités publiques.
38
Il s’agit de la déclaration de non-conformité à la Constitution de la Décision relative au Conseil national des
infrastructures de la République de Serbie. En fait,le Gouvernement a fait entrer au Conseil le Président de la
République en l’investissant de la fonction de président du Conseil et des missions qu’il est censé exécuter en cette
qualité.
39
La décision concerne l’évaluation de la constitutionnalité de l’article13а de la Loi sur le Gouvernement (IUz-
231/2012),portant mise en place de l’institution « d’Adjoint au Président – premier vice-président du
Gouvernement ».12
principe« d’immutabilité fonctionnelle » lors de la prise de cette décision (rendue par la majorité
des voix).40
b) La théorie juridique a qualifié de conflits importants, en matière de séparation des
pouvoirs, un autre groupe de conflits constitutionnels introduit devant la CCS, quoique ces
conflits se rapportent avant tout à la nature du mandat parlementaire. Ayant pour objectif de
« défendre » le mandat parlementaire libre et la position du parlement en tant qu’organe
représentatif des citoyens (et non pas des partis politiques), la Cour a procédé à la cassation des
dispositions de plusieurs lois électorales, en les qualifiant de non conformes à la Constitution.41
La doctrine fait ressortir que la CCS a agi dans ces affaires non seulement comme un interprète
créatif de la norme législative, mais elle a également fait naître l’idée d’une constitution
« vivante »(I. Pejić).La créativité judiciaire manifestée dans certaines de ces décisions a été
qualifiée également « de dérogation au texte formel de la constitution », compte tenu de la norme
impérative prévue à l’article102, paragraphe2 de la Constitution, selon laquelle « un député est
libre de mettre irrévocablement son mandat, dans les conditions prévues par la loi, à la
disposition du parti politique à la proposition duquel il a été élu député ». La CCS a tranché le
litige en analysant le système représentatif de Serbie à la lumière des principes de base de la
démocratie. Il est particulièrement souligné dans la littérature que la CCS n’a pas manqué à ses
principes et qu’elle « ne s’est pas laissée influencer par les demandes de la politique quotidienne
et les règles de jeu des représentants de la majorité et de la minorité politiques » lors de la prise
des décisions au sujet des contentieux relatifs aux solutions législatives portant cessation du
mandat d’un député ou d’un élu, suite à l’interruption de sa qualité de membre auprès d’un parti
politique ou bien suite à la mise en jeu d’une démission dite à blanc.42Selon une autre
observation, la Cour constitutionnelle s’est « ingérée » dans la séparation des pouvoirs d’une
manière positive grâce au renforcement de la représentation des citoyens sur la base du principe
du mandat libre, en établissant ainsi une mesure adéquate dans les rapports entre les deux
pouvoirs, le législatif et l’exécutif.43
c) Les dix dernières années, la CCS a rendu de nombreuses décisions visant à déclarer
non conformes à la Constitution plusieurs dispositions de la Loi sur les magistrats, en raison de
la violation du principe de séparation des pouvoirs. La Cour a particulièrement mis en évidence
la violation du principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Par ailleurs, les dispositions de
la Constitution portant sur le principe de séparation des pouvoirs et de l’indépendance du pouvoir
judiciaire ont très souvent servi de critère complémentaire pour évaluer si un texte de loi portait
atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire, garantie par la Constitution. La Cour a
particulièrement examiné la question de savoir si les solutions législatives contestées offraient la
40
„La Cour a suivi manifestement le principe de la retenue judiciaire et a procédé à la cassation partielle de la
dispositon légale en lui laissant, au fond, le sens identique à celui qui lui avait été doné par le législateur“.I. Pejić,op.
cit., 66-67.
41
V. Les décisions de la Cour constitutionelles n° IUz-197/2002 et IUz-42/2008, relatives à la Loi sur les élections
législatives et les décisions n° IU-66/02, IU-201/03, IU-249/2003 et IUz-52/2008, relatives à la Loi sur les élections
locales.
42
En savoir plus : B. Nenadić, Sur le mandat parlamentaire: exemple de la Serbie,www.enelsyn.gr et B.
Nenadić, V.I. Prelić»Blank« Resignation as a specific of termination the representatives mandate in local
assemblies-experience of the Republic Serbia«, Mexico, December 2010.
43
I. Pejić, op. cit., 67. V. aussi Т. Маринковић, Политика у границама Устава – О начелимa представничке
демократије у jуриспруденцији Уставног суда Србије (T. Marinković, Politique saisi par la Constitution – Sur
les principes de la démocratie représentative dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle de Serbie), Niš,
2011, 161-184.Vous pouvez aussi lire