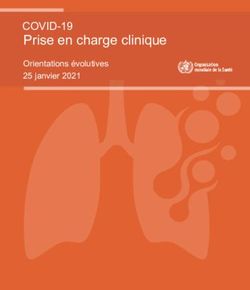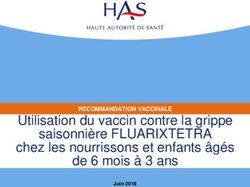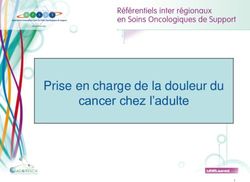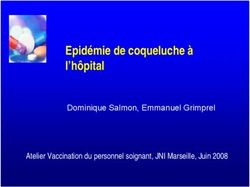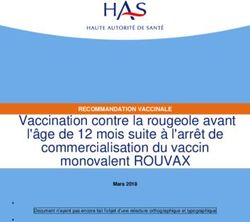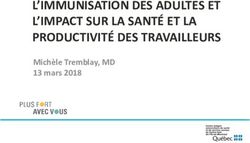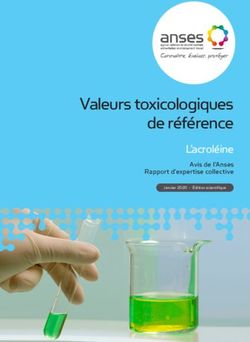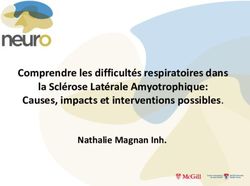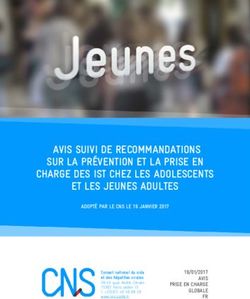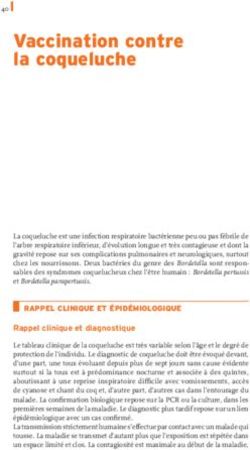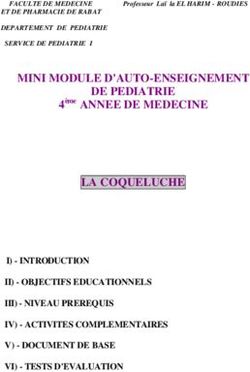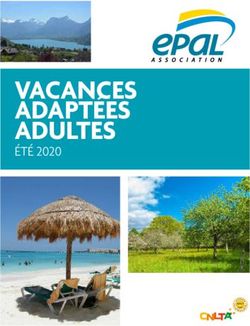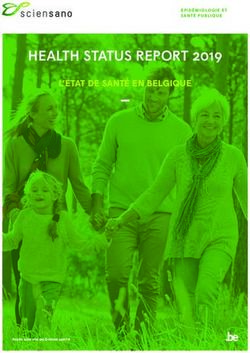Creative commons : Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 2.0 France (CC BY-NC-ND 2.0) ...
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
http://portaildoc.univ-lyon1.fr
Creative commons : Paternité - Pas d’Utilisation Commerciale -
Pas de Modification 2.0 France (CC BY-NC-ND 2.0)
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr
COQUAZ-GAROUDET
(CC BY-NC-ND 2.0)UNNERSITE CLAUDE BERNARD -LYON 1
FACULTE DE MEDECINE LYON EST
AIUlée 2014
COQUELUCHE MALIGNE DU NOURRISSON :
ETUDE DES FACTEURS ASSOCIES A LA MORTALITE
TIŒSE
Présentée
A1'Université Claude Bernard Lyon 1
Et soutenue publiquement le 24 mars l014
Pour obtenir lt. grade dt. Docteur en Médttint.
Par
Mathilde COQUAZ-GAROUDET
Nte lt 24 stptembrt 1985
A Sallanc.hes (74)
Thtse co-dirigtt.par le Pr Etiennt.h vouhty tf lt.Dr Robin Pouyau
COQUAZ-GAROUDET
(CC BY-NC-ND 2.0)Facunè d e Médecine lyon Est
liste des e nseignants 2013/20~4
Professeurs des Universi~s - Rratici ens Hospitlliers
ClasS@ exœptionnelle ECiilelonJ2
Chatelain Pierre Pédiatrie (surnombre)
c~ Pierre Rédiatrie
Carnier Jean-fran'?Jis PnEU1llologie : addictolog:e
Bienne Jérôme Bactéiologie-V.rologie : h~iène hœp· aiSe
Guérin Jean-françois Biologle et mêdecine du de-veloppement
et de la ~udlion : gynécologie médica!e
Kohler Rémy Chirurgie in~ 1iJe
Mauguière N-ançois Neurok!gie
IN inet Jacques Mêdeoine il.teme : gëria~ · et bic:llc:lge du
vieillissement : rnéœcne généra5e : addict~
Peyramood Dominique Maladie in'"ecl5euses : maladies ilrapicale-s
l1ùery Cancéro&Jgie : rad"Dth~
Roodrant D.a:ruel G)nêcobgie-abs'IÉ1rique : gynécologie médicale
Rudigoz Ralé-Ohartes Gynêcdogie-abs1étrique : gynécologie médicale
Professeurs des Universités - Priiticiens Hospitaliers
Classe exœpfionne:Ue EChelon 1
Baverel Gabriel P~lotlgie
Blay Jean..Yr.oes Can~ie ; radioth~
Denis Philippe Opht:ilinologie
F111et Gérard Cardiologie
Fauque l:)en1s Néphrologie
Goutat Cluistian Chirurgie dige-stive
Guéfln Ctru::le Rêsn~ion : I'Tlédecne d'urgence
laville Mauriœ Thêrspeufi:tue : m~ecine d'urgenœ : addictologie
lebot Jean.Jacque-s Anesthésioh:uie~é~irna'lion : médecine d'urgence
dartin x.a..œr Urologie
Mellier Georges ~êcd::igi_e-ahs1É1riq~e ; gynécomgie médicale
Micballet Mauriœtte Hematologie : transfuSIOI'II
Miossec Pie rre lmlii'Wno1ogie
Mornex Jean..Fr:an'?Jis Pl"lEUllDiogie : addil::tolog:e
IP - GUIes Neui"'dÜ'l.Jrgie
!Ponchon l1I.Ery Gas:troef1.1érologie : hépa'!Diogie : addittologie
IPugeat Michel Endocrinologie, diabète et maladies métabc6ques :
gy.n~ medicale
Revel M:er Radiologie et imagerie médicale
Rivoire Michel CancÉmi:lgie ; racfuthélapi?
Scoazec Jean...Yr.oes Anatorrœ et cytologie patbologiques
Vandenesch ~is Bactériologie-VJ"olcgie : hygiÈfle hosptaf:ëre
Professeurs des Universi té-s - Priitici ens Hospitlliers
PœmiÈfe classe
André-.FBerthezene Yws Radiologie et imagerie méclic.:tle BEnrand Yws Péctia:trie Bezîat Jean-Luc Chirurgie maxillo-faci * et stort~r.:ttdogîe Boille< Olivier Chirurgie digestive Borson-Ch.:tZO! Françoise EndocrinologE. diabète et maladies mÉ
Truy Eric Ob>rhîno-laryngologîe
v-
TUijman Francis Radiologie et imagerie rrédîCJie
·-
Bernard Anl:tomle
vamems Philippe EpkllémlologJe, égyn~ medicale
Ricllard Jun-Chris~ Rê.1nîm3:îon: !NœeN d'urgt neê
Rossetti Yws Physd:lgîe
Rouvière Olivier Radiologie et imagerie médîc.:tle
Saoud Mohamed Psychîalrie d"acU:es
Schaeffer laurent Biolog)e cellulaire
Schot1-Pethetaz Anne-M3rie EpidemîologE. économie de la santé et priwntîon
Souque< Jean-Christophe GaSIJ'œntéro~ : hépa1ologîe : addicx olog)e
\lukusic Sandra Neurologie
Wattel Eric HMutologîe : transfus-ion
Professeur des Unive-rsités · Médecine Générale
LE-trillîart
Moreau
Professeurs associés de Médecine Généule
Flori Marie
Zerbib Yws
-
Professeurs émérit es
Jérôme Chirurgie infantile
BoiAange< Pierre Bactérdogîe-Wdogîe : hygiène hospîtaf:ère
Boz;o Ancl Clau:le Physd:lgîe
ltti Roland Biophysi:jue et médecine twJCiéai-e
K..., Nicolas Anatomie et cytologie p.:rthotlgîques
Neîdhardl Jean-Pierre Anatomie
Petit Pool Aneslhé:sîolcgM~înu:tion : médecine d'urgence
Rousset Bernard Biolog)e cellulaire
SOndou Mare Neurodû"urgîe
Tîssot E6eme Chirurgie get1érale
r,.,. Olristian GaSIJ'œntéro~ : hépa1ologîe : addicx olog)e
Trouillas Paul Neurologie
Trouillas Jacqueline Cytologie et hîs1ologie
Maitres de Conférence - Praticiens Hospital iers
Hors d asse
Mehdi Biolog)e et mede-OOE du déwloppemen t et de la
reprcdJctOO : gynécologie médicale
Bmguier Pierre-Pa!J Cytologie et hîs1ologie
BW-Xuan Bernard Aneslhésiol~anînution : médecine d'urgenœ
Dawzîes Philippe Medecine et s.:tnté au travail
Germain Michèle Physd:lgîe
Haclj -A îssa Aoumeu• Physd:lgîe
J ouwt Anne Anatomie et cytologie p.:rthotlgîques
COQUAZ-GAROUDET
(CC BY-NC-ND 2.0)S-econde dasse
Buzluca Dargaud Yesm ~ématdlogie : t::ransfusion
Charrière S)bl Nu · ·an
Duclos Anto'Ine Epidémiol~ie. éconr::mie de la santE et prévention
Phan Alice Dermato-venerëologie
RheililliS S)Wain Neural~ie (s1ag.}
Rimmele Thomas Anesthè:siol~imation :
rnêdecine d 'LMgence (stag.)
Schluth-Balard Carolne Génétique
Thibault Héféne Rhys.iobgie
Vasiljevic Alexandre Anatonte. et cytologie pathologiques (stag.)
Venet fabE! ne Immunologie
Maitres œ Co.nfêrernees assooiês œ Médecine GênêraJe
Farge Thieiry
F~gan Sophie
LaM :xa..œr
COQUAZ-GAROUDET
(CC BY-NC-ND 2.0)SERMENT D’HIPPOCRATE
Je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité dans l'exercice de la
Médecine.
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans discrimination.
J'interviendrai pour les protéger si elles sont vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur
dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de
l'humanité.
J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je
ne tromperai jamais leur confiance.
Je donnerai mes soins à l'indigent et je n'exigerai pas un salaire au-dessus de mon travail.
Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés et ma conduite
ne servira pas à corrompre les mœurs.
Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement la vie ni ne
provoquerai délibérément la mort.
Je préserverai l'indépendance nécessaire et je n'entreprendrai rien qui dépasse mes
compétences. Je perfectionnerai mes connaissances pour assurer au mieux ma mission.
Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. Que je sois couvert
d'opprobre et méprisé si j'y manque.
COQUAZ-GAROUDET
(CC BY-NC-ND 2.0)à BCG et MPVD,
avec toute ma tendresse
« J’aime mieux tout de quelque chose que quelque chose de tout » Victor Hugo
COQUAZ-GAROUDET
(CC BY-NC-ND 2.0)REMERCIEMENTS
A Monsieur le Professeur Floret,
Merci Monsieur de me faire l’honneur de juger mon travail et d’en présider le Jury.
A Monsieur le Professeur Javouhey,
Vos qualités pédagogiques m’ont redonné le goût d’apprendre et l’envie de progresser en pédiatrie.
Je vous remercie d’avoir éveillé ma curiosité et confié ce sujet passionnant. Je vous suis reconnaissante
pour votre dynamisme qui a soutenu ma motivation tout au long de ce travail. Je me réjouis de rejoindre
prochainement l’équipe des urgences pédiatriques et vous remercie de m’en avoir offert l’opportunité.
A Monsieur le Professeur Gillet,
J’ai beaucoup apprécié vos enseignements, qui alliaient humour et rigueur. Je vous remercie d’avoir
accepté de juger mon travail et suis heureuse de poursuivre ma formation aux urgences pédiatriques à
vos côtés.
Au Docteur Pouyau,
Merci Robin de m’avoir aidée dans ce travail de recherche, formateur à bien des égards. J’ai pris
beaucoup de plaisir à travailler et suis reconnaissante de ta patience et de ta disponibilité notamment
pour m’expliquer les concepts et procédures de réanimation. Merci pour tes encouragements en
particulier ces dernières semaines.
COQUAZ-GAROUDET
(CC BY-NC-ND 2.0)Merci au Docteur Dr Ploin, je vous suis infiniment reconnaissante du temps que vous m’avez accordé
et de la clarté de vos explications en statistique.
Au Professeur Patural, aux Docteurs Baleine, Bœuf, Labenne, Millet, à Marie Cotillon et à chacune des
secrétaires, pour avoir pris le temps de m’accueillir et de m’aider dans l’élaboration de ce travail.. Ce
tour de France estival avait quelques notes impromptues !
A Mesdames Dockes, Quaglieri et Reynier ainsi qu’à madame Silarakis, merci pour votre remarquable
efficacité et votre disponibilité,
Quelle joie de pouvoir enfin vous remercier pour ces belles années et l’aide plus particulière que
vous m’avez témoignée cette année !
Dans le sens des aiguilles d’une montre :
« C’est l’heure où le long crocodile/ Languissament s’étire et bâille/ Et fait glisser les eaux du Nil sur
l’armure de ses écailles…l’eau du nil […] »
A Grand-mère et sa délicatesse envers chaque enfant, à Mamie pour la force de travail Veyrat
A Bab et Mig, à nos voix, à ce qu’elles portent à l’unisson ;
A Nanou, Stéphane, Helo, Gaspard, A Touni et Céline, pour votre affection et vos encouragements
A Cilou pour la richesse des souvenirs et pour le futur ! De méandres au loin, la route est droite !
A Claire et Jérémy, à votre petite Maxime !* L’internat n’aurait pas cette saveur sans nos dîners de
retrouvailles, avec le Mont-Blanc en terrasse et notre Hte-Savoie dans l’assiette ! Merci pour la sérénité
que vous distillez. Maxime sans le savoir tu m’avais inspirée.
A TouoouououououTZZzzzz !
A Caro, Basile et Corentin, aux heures apéritives de conseils, d’informatique et de mise en page ! A
Vincent, tu auras toujours 18 ans !
A mes chers oncles et tantes, et mes cousins
A mes chères MA : rue Lenepveu je connais mon repère. A nos années d’externat et plus encore, à ce
qui dépasse les cimes. Et à toutes nos retrouvailles ! L’essentiel est invisible pour les yeux…
Marine : à nos chroniques, à la spermato-académy, au ‘tit bichon vainqueur et à l’aldolase réductase, à
ton humour, ton imagination, et ton amitié fidèle. Et Louis-Marie, merci, pour tes conseils à l’aube du
départ ! Dans l’attente impatiente de la descendance! Mini Gaisne, je t’adresse cette dédicace !
Micha ma vieille branche, « l’homme est fait pour les grands espaces ! » Combien de voyages reste-t-il
à nos âmes ? La lune rousse et pleine veille sur les Pyrénées, rien ne l’égale. Pas même la constellation
du PTO. Merci pour ta précieuse amitié,
Marie Liesse, merci pour ta constante joie de vivre et ton optimisme ! Clin d’œil à JB, Constance et
Isaure ; à cucu resté dans ta valise…
COQUAZ-GAROUDET
(CC BY-NC-ND 2.0)Aux téméraires de Kolkata, au père Laborde, merci pour ces réflexions sur le Zinc, Vous m’avez révélé
combien l’enfance est précieuse et le prix de l’éducation.
Aux enfants d’EPN à leur spontanéité rafraichissante, A Renu et Luis, aux didis, dadas, au Dr Tobbias
et tous ceux que le courage rendent « responsables » ; à Agnès, aux français d’Howrah, à Elie, Quentin,à
Christelle et Benoît, votre sollicitude est un modèle, quelle joie de vous avoir rencontrés ! Vivement nos
prochains Chai bressans !
A Gabriel et Mad, les téméraires de Jerusalem,
Aux déesses du stade* : Merci les filles pour ce quotidien studieux et déjanté, absurde et insensé. Je vois
que votre contribution aux commentaires d’images sculpturales progresse, vous m’en voyez ravie!(ndlr :
deuxième porte à gauche).
Le produit final est un travail collectif, je vous dois beaucoup !
Adeline, [...] Chacune des petites voix intérieures te remercie infiniment. C’est sûr, sans toi, c’eut été
affreux (+ 20c). Taisez-vous ! J’admire ton énergie et ta rigueur de travail. Mais le mieux c’est encore
ta spontanéité et ta franchise, ce côté franchouillard, puce et vintage ! Merci pour tes conseils cette année
(« aspi…et bim ! »). Ode à la diapédèse et aux noisettes torréfiées !
Aude Marie, merci pour ta gentillesse et l’esprit d’artiste qui s’installe à ton retour! Vivement la reprise
des grands travaux !
A Lucky Lucke, pour ta vivacité d’ingénieur, tes idées lumineuses et ta mémoire inouie (ça suffit oui !).
Merci pour les ajustages qui font les gros titres de ce travail!
Hazel, RIGHT NOW! Now it is time to translate, are you ready?!?
A ma très chère Marya : je n’oublierais pas ton accueil un jour de mars. Merci pour cette année à tes
côtés, ta sagesse, ta tolérance et ta sollicitude. Et merci, pour ta relecture au loin.
*A Michel et Augustin® nos sponsors. (….ça peut)
Aux Lyonnais d’adoption, à Cyril et Constance les médecins du cœur, à Alice, Virginie, Hannah
A Jeanne et Adrien les brugiens, à Tim et Camille
Au Pr Ifrah, votre rigueur et votre exigence ont forgé mon apprentissage. Soyez remercié pour le temps
que vous avez consacré à notre enseignement.
Aux Dr Mouzet et au Dr Kouatchet,
A mes co externes angevins, exerçant ici et là,
COQUAZ-GAROUDET
(CC BY-NC-ND 2.0)Au service de médecine interne des portes du soleil,
Merci Dr Blanc, pour ce semestre mémorable. Votre connaissance prend sens dans « votre diligence et
votre humanité ». La médecine est un art, et vous en êtes l’esthète.
A Magali et Dom, à Quentin le rocker assidu au catéchisme, Olive, A Carole, Christine et Jean Michel ;
Au service de Pédiatrie de Bourg en Bresse,
Au Dr Rémy et au service de neurologie de Romans sur Isere, aux Drs Tacchini et Gaide
Aux Docteurs Bonnotte et Pitrat
A mes chers co internes: Au Dr Jomard : merci Nathalie pour ta précieuse aide et ton énergie incroyable !
Max et toi êtes si généreux ! A Cécile, Florent, Noémie et Eric, Elsa, Arnaud, Catherine, Thomas, Maia,
Taiana, Florent Aux Raviolle's Killer et toute sa team Naima et Mathieu, Delphine, Thomas, Clément,
Au Centre Hospitalier de Bourg en Bresse :
A l’équipe des urgences de Fleyriat : A l’équipe du PMU
A chacun des aide-soignant(e)s, infirmier(ère)s Formidableeueueueuh ! Plus énergiques que les
et ambulanciers, aux infirmiers de psychiatrie ; canassons, sont ses cuisinières puissance
A Ali pour m’avoir proposé cette année inouïe, thermomix®.
riche de tout et surtout d’inattendus. On le dit A chacun des aide-soignant(e)s, et chacune des
tous c’est tellement vrai : quelle chance de infirmières, à Christophe et notre Chef,
travailler à vos côtés ! A JF et Anne, redoutables gardiens d’une
A Yves et Régine, parce que franchement vous médecine raisonnable et raisonnée et d’un
m’édifiez, service contre la montre. Cette année était
Hélène, merci pour ta vitalité et ta gentillesse réellement un apprentissage et je vous suis
Au Dr Migliore, à Intubator pour avoir fait tellement reconnaissante de votre patience!
preuve de tant de pédagogie, et de patience C’est à son équipe que l’on reconnaît la
Au Dr Folacher-prise, la fuite n’est pas un mal, personnalité d’un chef. Quel plaisir de travailler
recherchons la vacuité de l’âme, à vos côtés !
A Manue pour tes conseils avisés, A ma chère babeth (la prochaine thèse je la
Alban, Anne, Anne-Sophie, Arnaud, Cécile, dicte)
Delphine, Emilie, Julien, Maud, Nicolas, J’appelle les rhumatisantes, Nathalie, Evelyne
Patrice, Ryma, Sebastien Stéphane, vous faites et Christelle !
de ce service un lieu unique ! Au Dr Bour (4409), Claire, Juliette et Xavier
(Theodore, Roland) aux internes des urgences
COQUAZ-GAROUDET
(CC BY-NC-ND 2.0)RESUME
Introduction : La coqueluche maligne est une forme rare d'infection à Bordetella pertussis caractérisée
par une détresse respiratoire aiguë associant, une hyperleucocytose supérieure à 50 G/L et une évolution
rapide vers une défaillance multi-viscérale.
Objectifs : Identifier les caractéristiques associées à la mortalité des formes malignes de coqueluche du
nourrisson. Etudier les modalités de prise en charge et l’évaluation des effets de la leucodéplétion sur le
pronostic.
Matériel et Méthodes : Nous avons réalisé une étude descriptive, rétrospective, au sein des services de
réanimation pédiatriques des CHU de Lyon, Grenoble, Saint Etienne, Clermont Ferrand et Montpellier,
Marseille et Rouen. Les nourrissons hospitalisés entre le 1er janvier 2008 au 13 novembre 2013 avec un
diagnostic microbiologique de coqueluche et présentant une détresse respiratoire aiguë justifiant une
ventilation mécanique et/ou une hyperleucocytose supérieure ou égale à 50 G/l ont été inclus. Leur prise
en charge a été comparée à celle proposée par l’équipe britannique de Rowlands en 2010.
Résultats : 23 nourrissons ont été inclus. Onze enfants (47,8%) étaient de sexe féminin. L'âge médian
au début des symptômes était de moins de 6 semaines (34j [21-67]). Le délai médian entre le début des
symptômes et le transfert en réanimation était de 6 jours [4-10]. A l'admission en réanimation, le score
PELOD médian était à 11 [1-20]. Les nourrissons étaient tachycardes (fréquence cardiaque médiane 181
bpm [177-199]). Le rapport Sp02/Fi02 médian initial était de 384 [238-452]. Dix-sept nourrissons (74%)
ont été intubés, 13 (76%) ont été ventilés par oscillateur à haute fréquence. Le chiffre de leucocytes
médian aux urgences était de 32 G/l [19-54] avec 7,5 G/l [5,5-13] PNN et 22 G/l [10-36] lymphocytes.
Parmi les 23 enfants, 9 (40%) sont décédés. Tous les nourrissons décédés présentaient une défaillance
respiratoire, cardio vasculaire (p=0,003) et une HTAP (p=0,002). Une anurie était associée dans tous les
cas (p< 0,001), avec une créatinine médiane de 81µmol/l [49-109,5] et une hyponatrémie majeure < 125
mmol/l dans 90% des cas. Dans 71% des cas, une défaillance hématologique et hépatique était associée.
Une leucodéplétion (EST ou leucaphérèse) a été réalisée dans 10 cas (43,5%), 7 d’entre eux ont survécu.
Une prise en charge par ECMO a été décidée dans 7 cas (30,4%) avec une mortalité élevée (6 décès).
La prise en charge répondait dans 15 cas à une proposition internationale et s’associait à 73% de survie
(11/15).
Conclusion : Nous avons identifié cinq facteurs associés à la mortalité de la coqueluche maligne :
l’élévation précoce de la CRP au-delà de 20 mg/l, la présence d’une HTAP à l’arrivée en réanimation,
l’augmentation des GB supérieure à 15 G/l par jour, l’inversion du rapport lymphocytes/PNN au cours
de l’évolution en réanimation et des désordres hydro-électrolytiques, représentés par l’hyponatrémie
inférieure à 125 mmol/l et l’anurie.
COQUAZ-GAROUDET
(CC BY-NC-ND 2.0)TABLE DES MATIERES
REMERCIEMENTS ........................................................................................................................................... 13
RESUME ......................................................................................................................................................... 17
TABLE DES MATIERES ....................................................................................................................................... 1
ABREVIATIONS ................................................................................................................................................. 4
INTRODUCTION GENERALE .............................................................................................................................. 6
I. LA COQUELUCHE ..................................................................................................................................... 6
I.1 DEFINITION .............................................................................................................................................. 6
I.2 DIAGNOSTIC............................................................................................................................................. 6
I.2.1 Contage infectieux........................................................................................................................... 6
I.2.2 Présentation clinique ....................................................................................................................... 7
I.2.3 Diagnostic biologique ...................................................................................................................... 8
I.3 EXAMENS PARA CLINIQUES .......................................................................................................................... 8
I.4 LES COMPLICATIONS DE LA COQUELUCHE ....................................................................................................... 9
I.4.1 La forme simple ............................................................................................................................... 9
I.4.2 La coqueluche grave ........................................................................................................................ 9
II. HISTOIRE NATURELLE DE L’INFECTION A BORDETELLA PERTUSSIS ........................................................ 10
II.1 EPIDEMIOLOGIE ...................................................................................................................................... 10
II.1.1 Données spatio temporelles .......................................................................................................... 10
II.1.2 Incidence dans le monde et en France .......................................................................................... 10
II.1.3 Une maladie contagieuse sous-estimée ........................................................................................ 11
II.1.4 Morbi mortalité de la coqueluche ................................................................................................. 11
II.2 PHYSIOPATHOLOGIE................................................................................................................................. 12
II.2.1 Microbiologie ................................................................................................................................ 12
II.2.2 Pathogénie générale ..................................................................................................................... 13
III. LA COQUELUCHE MALIGNE ................................................................................................................... 14
III.1 DEFINITION ............................................................................................................................................ 14
III.2 DIAGNOSTIC........................................................................................................................................... 16
III.2.1 Terrain ........................................................................................................................................... 16
III.2.2 Présentation initiale et caractéristiques évolutives ....................................................................... 16
III.2.3 Désordres hydro électrolytiques .................................................................................................... 17
III.2.4 Anomalies Hématologiques........................................................................................................... 18
III.3 PHYSIOPATHOLOGIE DE LA COQUELUCHE MALIGNE......................................................................................... 18
1
COQUAZ-GAROUDET
(CC BY-NC-ND 2.0)III.3.1 Microbiologie ................................................................................................................................ 18
III.3.2 Pathogénie .................................................................................................................................... 19
III.4 PRONOSTIC ............................................................................................................................................ 23
III.4.1 Facteurs démographiques ............................................................................................................. 23
III.4.2 Retard et méconnaissance diagnostique....................................................................................... 23
III.4.3 Facteurs associés à la mortalité .................................................................................................... 24
IV. PREVENTION ET PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE ............................................................................ 27
IV.1 PREVENTION .......................................................................................................................................... 27
IV.2 MESURES GENERALES .............................................................................................................................. 27
IV.3 TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE ...................................................................................................................... 28
IV.3.1 Spécifique ...................................................................................................................................... 28
IV.3.2 Complications infectieuses ............................................................................................................ 28
IV.4 PROCEDURES DE REANIMATION.................................................................................................................. 28
IV.4.1 Prise en charge hémodynamique .................................................................................................. 28
IV.4.2 Prise en charge de la détresse respiratoire ................................................................................... 28
IV.4.3 ECMO............................................................................................................................................. 30
IV.4.4 Leucodéplétion .............................................................................................................................. 31
IV.4.5 Algorithmes de prise en charge ..................................................................................................... 32
ETUDE D’UNE COHORTE MULTICENTRIQUE.................................................................................................... 34
I. INTRODUCTION ..................................................................................................................................... 34
II. PATIENTS ET METHODES ....................................................................................................................... 36
II.1 TYPE D’ETUDE ET METHODE DE SELECTION ................................................................................................... 36
II.2 LE RECUEIL DE DONNEES ........................................................................................................................... 36
II.2.1 Variables choisies .......................................................................................................................... 36
II.2.2 Calculs des délais et de la croissance des globules blancs ............................................................. 38
II.2.3 Evaluation de la prise en charge par EST et/ou ECMO .................................................................. 38
II.3 ANALYSE STATISTIQUE .............................................................................................................................. 39
III. RESULTATS ............................................................................................................................................ 40
III.1 PRESENTATION DE LA POPULATION ............................................................................................................. 40
III.1.1 Démographie ................................................................................................................................. 40
III.1.2 Présentation initiale ...................................................................................................................... 40
III.1.3 Complications infectieuses ............................................................................................................ 42
III.1.4 Evolution et complications systémiques ........................................................................................ 43
III.2 COMPARAISON DES NOURRISSONS DECEDES ET SURVIVANTS ............................................................................ 44
III.2.1 Evolution clinique, complications systémiques .............................................................................. 44
III.2.2 Analyse hématologique ................................................................................................................. 44
2
COQUAZ-GAROUDET
(CC BY-NC-ND 2.0)III.2.3 HTAP .............................................................................................................................................. 46
III.3 PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE ............................................................................................................. 46
III.3.1 Délais de prise en charge ............................................................................................................... 46
III.3.2 Prise en charge des défaillances d’organe .................................................................................... 47
III.3.3 Ex-sanguino-transfusion (EST) ....................................................................................................... 47
III.3.4 Autres thérapeutiques ................................................................................................................... 48
IV. DISCUSSION .......................................................................................................................................... 49
BIBLIOGRAPHIE .............................................................................................................................................. 59
ANNEXES ........................................................................................................................................................ 62
Annexe 1 : Posologies et durée de prescription de l’antibiothérapie dans la coqueluche du nourrisson .... 62
Annexe 2 : Prise en charge en EST : Comparaison de séries de cas ............................................................. 63
Annexe 3 : Score PELOD (PEdiatric Logistic Organ Dysfunction) ................................................................. 64
Annexe 4 : Définition des défaillances d’organe .......................................................................................... 66
3
COQUAZ-GAROUDET
(CC BY-NC-ND 2.0)ABREVIATIONS
ACR : Arrêt cardio-respiratoire
ADN : Acide Désoxyribo-Nucléique
ATCD : Antécédents
BGN : Bacilles Gram-négatif
B.Pertussis : Bordetella pertussis
Bpm : Battements par minute
CHG : Centre Hospitalier Général
CHU : Centre Hospitalo-Universitaire
CMV : Cyto-mégalo virus
DTCaPolio : Vaccin combiné diphtérie/tétanos/coqueluche acellulaire/poliomyélite,
à concentrations normales
dTcaPolio : Vaccin combiné diphtérie/tétanos/coqueluche acellulaire/poliomyélite, avec
doses réduites d’anatoxines diphtériques (d) et d’antigènes coquelucheux (ca)
ECMO : Extra Corporeal Membrane Oxygenation
EER : Epuration extra-rénale
ESLO : Extraorporeal Life support Organization
EST : Ex-sanguino-transfusion
ETT : Echographie trans-thoracique
FC : Fréquence cardiaque
FiO2: Fraction inspiratoire en oxygène
FR : Fréquence respiratoire
GB : Globules blancs
GCS : Glasgow Coma Scale
GDS : Gaz du sang
HTAP : Hypertension artérielle pulmonaire
IFN : Interféron
LBA : Lavage broncho-alvéolaire
LCR : Liquide céphalo-rachidien
LP : Leucaphérèse
Ly : Lymphocytes
MSN : Mort subite du nourrisson
4
COQUAZ-GAROUDET
(CC BY-NC-ND 2.0)NFP : Numération formule et plaquettes
NO : Nitric oxide, monoxyde d’azote
NOi : NO inhalé
OHF : Oscillateur haute fréquence
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
OR : Odds ratio
ORL : Oto-rhyno-laryngologie
PAM : Pression artérielle moyenne
PaO2 : Pression partielle artérielle en oxygène
pCO2 : Pression partielle sanguine en dioxyde de carbone
PCR : Polymerase Chain Reaction
PCT : Procalcitonine
PELOD : Pediatric Logistic Organ Dysfunction
P/F : PaO2/FiO2
PNN : Polynucléaires neutrophiles
pH : Potentiel hydrogène
SA : Semaines d’aménorrhée
SAMS : Staphylococcus aureus méticilline-résistant
SDRA : Syndrome de détresse respiratoire aigüe
SHU : Syndrome hémolytique et urémique
SIADH : Sécrétion inappropriée d’hormone anti-diurétique
SRIS : Syndrome de réponse inflammatoire systémique
SpO2 : Saturation pulsée de l’hémoglobine en oxygène
S/F : SpO2/FiO2
TNF : Tumor Necrosis Factor
U-MW : Test de U mann and Withney
VM : Ventilation mécanique
VNI : Ventilation non invasive
VRS : Virus respiratoire syncitial
5
COQUAZ-GAROUDET
(CC BY-NC-ND 2.0)INTRODUCTION GENERALE
La coqueluche maligne est une forme rare d'infection à Bordetella pertussis (B.pertussis)
caractérisée par une détresse respiratoire aigüe associant une hypoxie réfractaire une
hyperleucocytose supérieure à 50 G/L et une évolution rapide vers une défaillance
multiviscérale. Affectant préférentiellement le nourrisson de moins de 2 mois, la mortalité peut
atteindre 75% des cas (1).
I. LA COQUELUCHE
I.1 DEFINITION
La coqueluche est une toxi-infection bactérienne respiratoire particulièrement contagieuse,
transmise à l'homme par B.pertussis. Le terme « coqueluche » est employé la première fois en
1679 par Sydenham, mais son caractère paroxystique la distingue des autres infections
respiratoires depuis le Moyen-Age, avec une première description faite en France au XVème
siècle (2). Les Chinois la nomment « la toux des 100 jours », en référence à son évolution vers
la chronicité. En dépit de la politique vaccinale initiée dès les années 40 puis renforcée à la fin
du XXème siècle, la coqueluche sévit toujours. Son diagnostic est difficile et souvent méconnu
en raison de la variabilité des présentations cliniques, parfois déroutantes. A cela s’ajoute la
forte contagiosité de la maladie. Ces deux caractéristiques expliquent sa rapide propagation au
sein des groupes vulnérables. Diagnostiquée tardivement chez l'adulte, elle est responsable
d'une morbidité non négligeable chez l’enfant et même d’une mortalité potentielle chez le petit
nourrisson. La réalisation en routine de la PCR, de plus grande spécificité que les techniques
microbiologiques jusqu’alors utilisées, a probablement permis d’authentifier un plus grand
nombre de cas.
I.2 DIAGNOSTIC
I.2.1 Contage infectieux
La présence d’un contage infectieux, cas « index », est fréquemment retrouvée dans l’entourage
du patient lors de l’anamnèse. La plupart du temps, ce contact « tousseur chronique » est
retrouvé au sein de l’environnement familial (parents, grands-parents, fratrie) (3–5).
6
COQUAZ-GAROUDET
(CC BY-NC-ND 2.0)I.2.2 Présentation clinique
La forme clinique dépend de l’âge et du statut immun du patient. La coqueluche commune non
compliquée répond à une définition clinique aux caractéristiques bien établies chez le petit
enfant.
Forme typique de l’enfant non vacciné
Il s’agit de la forme classiquement décrite chez l’enfant d’âge scolaire, avant l’ère vaccinale.
Elle est devenue plus rare de nos jours dans les pays à fort taux de couverture vaccinale. Sa
progression est stéréotypée : après un contage respiratoire, la phase d’incubation dure entre 7
et 10 jours puis commence une période d'invasion d’une dizaine de jours appelée phase
« catarrhale ». Cette phase hautement contagieuse, est caractérisée par la présence de
rhinorrhées, éternuements, toux, et d’une discrète réaction conjonctivale. Il n’y a quasiment pas
de signe systémique, la fièvre est généralement absente. Tout laisserait supposer une infection
des voies aériennes supérieures banale. Toutefois, à la différence de celle-ci, la toux s’installe,
s’intensifie et se pérennise : c’est la phase quinteuse. Cette phase d’état de la coqueluche
dominée par son maître symptôme : « une toux paroxystique survenant par quintes c’est-à-dire
par accès répétés violents de secousses expiratoires de toux sans inspiration efficace entraînant
une congestion du visage voire une cyanose et finissant par une reprise inspiratoire bruyante en
chant du coq » (3). Ces quintes sont volontiers émétisantes, nocturnes, sensibles à la stimulation
de la sphère ORL, et associées à une production de mucus différente des sécrétions purulentes
des autres infections respiratoires. Elles durent de 3 à 4 semaines et sont suivies d’une phase de
convalescence de plusieurs semaines au cours de laquelle la toux (qui n’est plus quinteuse) peut
persister. L’enfant est apathique et on peut observer un amaigrissement, secondaire aux
vomissements et à l’anorexie. A distance d’un épisode de coqueluche, il n’est pas rare que le
patient présente à nouveau une toux paroxystique, quinteuse et récurrente notamment à
l’occasion de virose respiratoire (2).
Forme clinique du nourrisson
La présentation de la coqueluche chez le nourrisson est en général proche de celle de l’enfant
vacciné. Toutefois, la quinte « émétisante et cyanosante » ainsi que le chant du coq peuvent
manquer. La toux est asphyxiante, entraînant des épisodes d'apnée ou de bradycardie profonde.
Des signes de lutte initiaux peuvent simuler une bronchiolite aigue virale ou toute autre
7
COQUAZ-GAROUDET
(CC BY-NC-ND 2.0)infection des voies respiratoires (6). Des troubles digestifs sont fréquemment associés, en
particulier les vomissements précédant parfois les signes respiratoires (2–4,7).
Néonatalogie
La présentation clinique chez le nouveau-né, en particulier dans les formes sévères, est atypique
ce qui rend le diagnostic difficile. La toux peut manquer, les apnées répétées et la bradycardie,
symptômes fréquents en néonatalogie, peuvent dominer la présentation clinique (3,4,8,9). On
rapproche de cette description celle du petit nourrisson de moins de 2 mois chez lequel la
clinique peut être également trompeuse : malaise grave, mort subite, insuffisance respiratoire
aigüe, détresse vitale inexpliquée peuvent révéler d’authentiques coqueluches (10).
I.2.3 Diagnostic biologique
La preuve bactériologique est apportée par la mise en culture de sécrétions nasopharyngées par
aspiration ou écouvillonnage nasal, sur milieu spécifique de Bordet et Gengou. La fragilité de
B.pertussis explique la nécessité d’un milieu spécifique et le long délai de réponse (supérieur à
7 jours). Peu sensible (60% à la période catarrhale, 30% à la période des quintes, < 10% après
15 jours d’évolution), la culture est cependant très spécifique (100%) et donc intéressante d’un
point de vue épidémiologique mais peu adaptée à la pratique clinique (11). Depuis le début des
années 1990, le diagnostic de coqueluche est possible par détection du patrimoine génétique de
la bactérie par amplification génique (PCR) permettant un diagnostic dans les 24 à 48 heures.
Elle peut être effectuée sur les mêmes prélèvements que la culture, et est spécifique de chaque
espèce. En revanche, elle ne permet pas de tester la sensibilité des souches. Enfin, l’apparition
plus récente de la PCR en temps réel a encore amélioré les délais des résultats (environ 3
heures). La viabilité de la bactérie n’est pas nécessaire à la détection de l’ADN bactérien,
rendant la technique fiable malgré une antibiothérapie. Sa sensibilité est donc proche de 80%
et sa spécificité varie de 55 à 95% (12). L’examen est remboursé par la Sécurité Sociale depuis
2011.
I.3 EXAMENS PARA CLINIQUES
Dans les formes simples, aucun autre examen complémentaire que microbiologique n’est
nécessaire au diagnostic. Parfois, ils permettent d’écarter les diagnostics différentiels. La
radiographie de thorax peut montrer un parenchyme normal ou un syndrome bronchique. Sur
le plan biologique, une hyperlymphocytose sanguine est évocatrice du diagnostic, devenant
8
COQUAZ-GAROUDET
(CC BY-NC-ND 2.0)caractéristique lorsqu’elle est supérieure à 10 G/l (3). L’aspect cytologique est une
hyperlymphocytose constituée de petits lymphocytes matures. Un aspect de noyau fendu de ces
lymphocytes n’est pas constant, mais caractéristique de la coqueluche.
I.4 LES COMPLICATIONS DE LA COQUELUCHE
I.4.1 La forme simple
La forme commune guérit généralement sans séquelles, la toux pouvant se prolonger plusieurs
semaines. Des complications mécaniques surviennent parfois au décours de la toux ou des
vomissements : purpura pétéchial de la face, hémorragie sous conjonctivale, épistaxis hernie et
les otites moyennes aigues. Les complications nutritionnelles, redoutables, se retrouvent
essentiellement dans les pays en voie de développement.
I.4.2 La coqueluche grave
Toute coqueluche de l’enfant nécessitant une prise en charge en réanimation est appelée
coqueluche « grave ». Plus de 20% des coqueluches évoluent vers une forme grave, qu’elle soit
respiratoire (18%) ou neurologique (4%) (3,8,13–16). Elles affectent principalement le petit
nourrisson de moins de 3 mois non protégé par la vaccination. Les complications graves sont
inversement liées à l’âge et leur pronostic est variable. Certaines se grèvent d’une mortalité
importante. L’Académie américaine de pédiatrie distingue : « 1) les apnées, pouvant nécessiter
de façon transitoire une assistance ventilatoire mais de très bon pronostic, 2) les convulsions,
d’évolution favorable sous traitement, 3) de la pneumopathie en raison de l'hypoxie réfractaire,
de l'HTAP et de la défaillance cardiaque qu'elle entraîne » (14,17). Les complications
neurologiques se manifestent par des crises convulsives et une encéphalopathie primitive ou
secondaire à l’anoxie ou à l’action de la toxine. Soixante à 80% des complications respiratoires
sont représentées par les quintes apnéisantes et/ou cyanosantes (14,18). D’autres complications
respiratoires (surinfection, atélectasie, pneumothorax, pneumomédiastin, hémorragie
pulmonaire…) sont également décrites mais peu fréquentes. Enfin, 20% des coqueluches
hospitalisées en réanimation présentent une pneumopathie dont certaines entrent dans la
définition de la coqueluche maligne que nous détaillerons un peu plus bas (8,14,19,20).
9
COQUAZ-GAROUDET
(CC BY-NC-ND 2.0)II. HISTOIRE NATURELLE DE L’INFECTION A
BORDETELLA PERTUSSIS
II.1 EPIDEMIOLOGIE
II.1.1 Données spatio temporelles
La coqueluche sévit dans tous les pays du monde. Il n'existe pas de spécificité géographique en
ce qui concerne la virulence du germe. Que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe, elle peut
survenir tous les mois de l'année, avec un pic d'incidence en août, septembre et octobre. Cette
variation saisonnière était constatée dans 2 études américaines dans les années 1980 à 2000. Un
pic estival était noté de juillet à septembre aux Etats Unis (8). Cette donnée est fondamentale
pour la démarche diagnostique : la présentation clinique, déroutante, oriente à tort l’été vers une
bronchiolite virale.
II.1.2 Incidence dans le monde et en France
La coqueluche était une maladie infectieuse dévastatrice jusqu'à l'avènement dans les années
40 du vaccin cellulaire entier anticoquelucheux. On notait dans l'ère pré-vaccinale une
incidence de l'ordre de 157 cas pour 100 000 habitants aux USA. C’est en 1976 que le taux
d’incidence fut le plus faible avec, aux Etats-Unis, 1010 cas recensés soit 0,47 cas pour 100 000
habitants. Selon les estimations les plus récentes de l’OMS (2008), la coqueluche affecterait
chaque année environ 16 millions de personnes à travers le monde (2,21). Si son incidence a
diminué de façon considérable, la maladie persiste, même dans les pays à fort taux de
couverture vaccinale. Son incidence aurait même augmenté de 50% entre 1980 et 1990 chez les
nourrissons de moins de 4 mois (8), l’avènement de la PCR ayant probablement contribué à
authentifier davantage de cas.
En France, la déclaration n’est plus obligatoire depuis 1986. Mais, l’épidémiologie des formes
pédiatriques graves est désormais étudiée dans le cadre de la surveillance clinique et
bactériologique par le réseau sentinelle Renacoq. L’incidence moyenne de la coqueluche chez
l’enfant de moins de 17 ans était de 228 cas par an, dont 138 avaient moins de 6 mois. Dans
cette tranche d’âge, l’incidence diminue (703 cas par an entre 1996 et 1998 et 138 cas par an
entre 2008 et 2010), mais chez les petits nourrissons de moins de 2 mois elle reste stable (210
pour 100 000 habitants).
10
COQUAZ-GAROUDET
(CC BY-NC-ND 2.0)II.1.3 Une maladie contagieuse sous-estimée
Au début du XXème siècle, la contamination se propageait d’enfants à enfants, classant la
coqueluche au rang des maladies infantiles. L’épidémiologie s’est modifiée. L’infection à B.
pertussis est désormais plus fréquente chez l’adulte mais elle est sous-estimée, ce qui contribue
à la circulation de la bactérie chez les plus petits. La gravité est inversement liée à l’âge :
méconnaitre le diagnostic chez l’adulte expose le nourrisson à l’infection et aux complications
les plus graves.
II.1.4 Morbi mortalité de la coqueluche
Données épidémiologiques générales
La coqueluche reste mortelle au XXIème siècle. En 2008, l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) rapportait 195 000 décès. Aux Etats-Unis entre 1927 et 1929 la mortalité attribuée à la
coqueluche était de 43,5% (3). De nos jours, dans les pays où le taux de couverture vaccinale
avoisine 80%, la mortalité a chuté de façon spectaculaire avec un taux proche de 0,4% au début
des années 90 aux Etats-Unis (3,8). C’est en 1976 que la coqueluche connaît ses plus faibles
taux d’incidence et de mortalité avec 7 décès attribuables à B.pertussis aux Etats-Unis (0,003
décès pour 100 000 habitants) (8,22). Cependant, la recrudescence de la maladie constatée ces
dernières années s’accompagne d’une augmentation de la mortalité en particulier chez les
nourrissons non vaccinés.
Données démographiques
De tous les groupes d’âge, les enfants de moins de un an ont la plus forte incidence de la maladie
et pour l’écrasante majorité des hospitalisations, des complications et des décès (3,6,8,19). Aux
Etats-Unis de 2000 à 2004, le Centers for Disease Control and prevention (CDC) a recensé
2488 cas par an chez les moins de 1 an, 63% ont été hospitalisés et 0,8% sont décédés (23). En
2011, la surveillance par le réseau Renacoq a montré que, parmi les 234 cas recensés, 98 patients
(42%) avaient moins de 3 mois.
Morbi-mortalité de la coqueluche grave
La coqueluche est la première cause de décès par infection bactérienne en réanimation chez les
nourrissons âgés de 10 jours à 2 mois (24) ce qui représenterait, au sein des coqueluches graves
de réanimation, un taux de mortalité de 5 à 15% (14,18,24–27). Les complications graves de la
11
COQUAZ-GAROUDET
(CC BY-NC-ND 2.0)Vous pouvez aussi lire