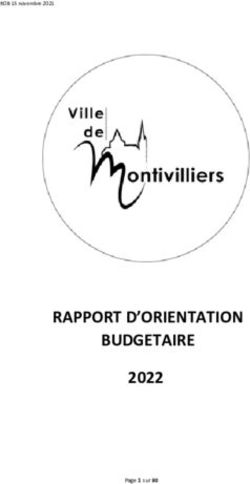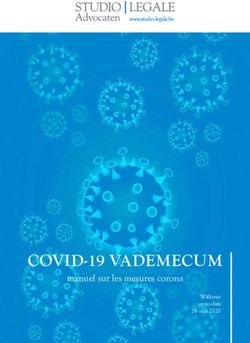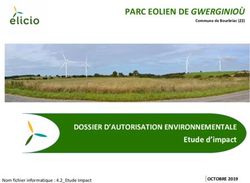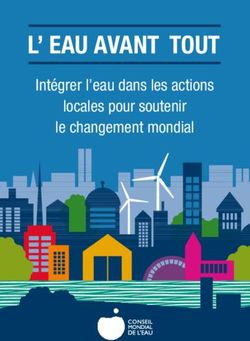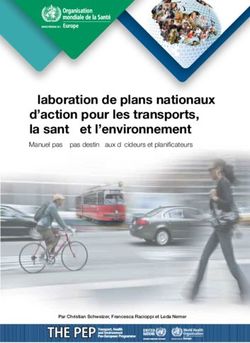DÉPARTEMENT (Pyrénées-Orientales) - RAPPORT D'OBSERVATIONS DÉFINITIVES ET SA RÉPONSE - Cour des comptes
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES
ET SA RÉPONSE
DÉPARTEMENT
(Pyrénées-Orientales)
Exercices 2019 et suivants
500, avenue des États du Languedoc CS 70755 34064 MONTPELLIER CEDEX 2 T +33 4 67 20 73 00 occitanie@crtc.ccomptes.frTABLE DES MATIÈRES
SYNTHÈSE............................................................................................................................... 5
RECOMMANDATIONS ......................................................................................................... 7
INTRODUCTION .................................................................................................................... 8
1. LES SUITES DU PRÉCÉDENT CONTRÔLE .............................................................. 9
Les suites données aux recommandations ................................................................. 9
1.1.1. L’organisation, le fonctionnement et le pilotage des services ....................... 9
1.1.2. Les ressources humaines .............................................................................. 10
1.1.3. La protection de l’enfant .............................................................................. 12
1.1.4. La compétence partagée tourisme ................................................................ 13
Les suites données à certaines observations ............................................................ 14
1.2.1. La mise en valeur du patrimoine monumental et environnemental ............. 14
1.2.2. La participation du département à la société d’économie mixte crématiste
catalane ........................................................................................................ 14
2. L’INFORMATION BUDGÉTAIRE ET LA FIABILITÉ DES COMPTES ............. 15
La fiabilité et la qualité comptable .......................................................................... 15
L’information budgétaire et financière .................................................................... 15
Les effets de la crise sanitaire sur les réalisations budgétaires 2020 ....................... 15
Les obligations de provisionnement ........................................................................ 17
2.4.1. Les provisions pour risque, charges et créances douteuses ......................... 17
2.4.2. Les provisions réglementées de l’IDEA ...................................................... 18
Les remboursements de personnels mis à disposition ............................................. 18
3. LA SITUATION FINANCIÈRE ................................................................................... 19
Les performances annuelles ..................................................................................... 19
3.1.1. Le niveau d’autofinancement ....................................................................... 19
3.1.2. Les produits de gestion ................................................................................ 20
3.1.3. Les charges de gestion ................................................................................. 22
Les investissements et leurs modalités de financement ........................................... 27
3.2.1. L’exécution du nouveau plan d’investissement ........................................... 27
3.2.2. La couverture de l’effort d’équipement par les ressources propres et les
financements extérieurs ............................................................................... 29
3.2.3. La dette......................................................................................................... 30
La situation bilancielle ............................................................................................. 31
La trajectoire départementale 2019-2021 ................................................................ 31
3.4.1. Le plafonnement annuel des dépenses réelles de fonctionnement (2018-2019)
...................................................................................................................... 31
3.4.2. La situation financière projetée fin 2021 ..................................................... 32
4. LES EFFETS DE LA CRISE PANDÉMIQUE SUR L’ORGANISATION ET LES
INTERVENTIONS DE LA COLLECTIVITÉ ................................................................... 35
L’adaptation des services publics départementaux .................................................. 35
La qualité des relations entre services déconcentrés de l’État et services
départementaux ........................................................................................................ 37
4.2.1. Le pilotage de la crise à l’échelle du territoire départemental ..................... 37DÉPARTEMENT DES PYRÉNEES-ORIENTALES
4.2.2. La qualité des relations fonctionnelles ......................................................... 38
Le retour d’expérience post crise ............................................................................. 40
5. LES INTERVENTIONS DU DÉPARTEMENT EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE . 41
Les caractéristiques socio-économiques du territoire départemental ...................... 41
Le cadre normatif ..................................................................................................... 43
Le poids de l’intervention économique ................................................................... 45
Les modalités d’intervention ................................................................................... 47
5.4.1. Le retrait de la participation à des opérations ou à des structures de
développement économique......................................................................... 47
5.4.2. Les conditions de soutien au bloc communal .............................................. 49
5.4.3. La compétence tourisme et « l’économie » de montagne ............................ 51
La stratégie d’intervention en temps de crise pandémique ...................................... 52
5.5.1. Le fonds de solidarité national ..................................................................... 52
5.5.2. Le fonds L’Occal ......................................................................................... 53
5.5.3. Le fonds départemental exceptionnel en soutien aux associations .............. 62
La participation au plan France Relance.................................................................. 63
ANNEXES ............................................................................................................................... 65
GLOSSAIRE........................................................................................................................... 73
Réponses aux observations définitives.................................................................................. 74
4SYNTHÈSE
La chambre régionale des comptes a procédé au contrôle des comptes et de la gestion du
département des Pyrénées-Orientales pour les exercices 2019 et suivants. La collectivité avait fait
l’objet d’un contrôle en 2019 sur la période 2013-2018. Le présent rapport porte plus
spécifiquement sur les suites données aux recommandations de la chambre formulées dans ce
rapport, sur les effets de la pandémie de 2020 sur l’organisation et le fonctionnement de la
collectivité ainsi que sur le soutien au développement économique.
Un renforcement du pilotage interne
La collectivité s’est appuyée sur le précédent rapport de la chambre pour renforcer le
pilotage de ses principales politiques publiques et consolider ses procédures internes. Les
difficultés engendrées par la crise sanitaire ont pu retarder, pour certaines, leur mise en œuvre
effective, sans les remettre fondamentalement en cause. Les recommandations portant sur des
processus longs sont en cours de mise en œuvre (projet pour l’enfant, contrôles des
établissements). La révision d’autres dispositifs, qui touchent à la conformité à la réglementation,
devrait trouver un aboutissement dans le cadre du nouveau mandat (heures supplémentaires,
recrutement des contractuels).
Le département a également renforcé sa démarche de fiabilisation des comptes et inscrit sa
communication financière vis-à-vis de son assemblée dans un processus d’amélioration continue.
Il devra la poursuivre, afin de respecter pleinement ses obligations en matière de provisions pour
risques et charges.
Un positionnement institutionnel affirmé pendant la crise sanitaire
Durant la crise sanitaire, la collaboration entre les services du département et ceux de l’État
a été particulièrement étroite. En appui de l’agence régionale de santé, l’intervention du
département dans le domaine sanitaire s’est accentuée, en particulier dans l’exécution des
premières mesures prises en urgence. En interne, la crise a été un facteur accélérant les mutations,
favorisant les dématérialisations des procédures et accentuant la mutabilité du service public local.
La collectivité doit désormais procéder à un retour d’expérience pour renforcer sa capacité d’action
dans des circonstances exceptionnelles.
Des équilibres budgétaires peu affectés par la crise sanitaire
L’impact de la crise pandémique s’est traduit par des dépenses nouvelles nettes de 4,7 M€,
soit à peine 0,9 %1 des charges de gestion 2020. Par ailleurs, le département a bénéficié de produits
exceptionnels, à hauteur de 6,4 M€.
La décorrélation entre les dépenses d’intervention sociale, qui présentent un risque
structurel de progression, et des recettes qui sont majoritairement exposées aux aléas conjoncturels
a, en effet, conduit la collectivité à une gestion prudente des équilibres financiers. Toutefois,
l’évolution des participations et contributions du département au bénéfice d’organismes tiers doit
le conduire à une certaine vigilance vis-à-vis des relations avec ses partenaires. Le niveau des
1 4,7 M€ de dépenses nettes Covid pour 520,3 M€ de charges de gestion 2020.DÉPARTEMENT DES PYRÉNEES-ORIENTALES
investissements continue de s’inscrire dans une tendance dynamique, portée par une
programmation pluriannuelle révisée en 2018 et la clôture des opérations de fin de mandat.
Le département a ainsi réalisé plus de 204,8 M€ d’investissement sur la période 2019-2020
(dépenses et subventions d’équipement), soit 102,4 M€ par an en moyenne, contre 90,4 M€ sur la
période 2013 à 2018. Compte tenu du faible niveau d’endettement initial, le levier de l’emprunt a
été mobilisé pour compléter le besoin de financement et même au-delà. Le fonds de roulement a
ainsi été abondé de 19 M€ par rapport à son niveau de 2018.
Un soutien direct au développement économique limité, y compris pendant la crise
sanitaire
Au-delà de la politique de soutien au développement économique effectuée par le biais de
la commande publique, le département doit inscrire ses interventions dans le cadre de la loi du
7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé) ce qui implique
une très grande rigueur dans la définition de sa stratégie. Si le poids des dépenses consacrées à ce
secteur a fortement baissé depuis 2015 (elles représentaient 0,42 % des dépenses totales en 2018)
en l’absence de dispositions légales prescriptives, le département, malgré les démarches
entreprises, n’a pas ramené ses participations dans des organismes tiers au seuil légal. Par ailleurs,
les conditions de soutien au bloc communal doivent être clarifiées, s’agissant en particulier des
aides à l’immobilier d’entreprise. De même, si la collectivité continue de peser sur l’économie
locale par la conduite d’actions relevant de ses compétences dites partagées, dont le tourisme, elle
doit veiller au respect des principes édictés par la loi NOTRé.
De fait, le secteur du tourisme constitue, avec l’agriculture et les services, le premier
secteur d’emploi. La crise pandémique a finalement eu des incidences limitées sur les créations et
les défaillances d’établissements. Le fonds national de solidarité, piloté par l’État, a en effet
concerné près de 20 000 entreprises pour un montant total de plus de 276 M€ au 30 juin 2021. Le
département n’a pas abondé ce fonds comme il en avait la possibilité, mais a contribué au fonds
régional « L’Occal » en dérogation au cadre de la loi NOTRé. Si la collectivité s’était engagée à
mobiliser des crédits à hauteur de 1,5 M€, le nombre de dossiers déposés par les bénéficiaires n’a
permis de mobiliser que 1/15ème de l’enveloppe initiale. De même, le fonds départemental
exceptionnel de soutien aux associations qui devaient faire face à un manque de fonds propres et
des difficultés de trésorerie n’a, en définitive, été mobilisé qu’à hauteur de 0,7 M€.
6RECOMMANDATIONS
Renforcer les conventions annuelles d’objectifs et de moyens avec les organismes tiers
à partir d’un dialogue de gestion partagé. Non mise en œuvre.
En lien avec la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, achever le
transfert de l’hôtel d’entreprises implanté sur l’Espace entreprises Méditerranée. Non mise en
œuvre.
En lien avec la région Occitanie et la communauté urbaine Perpignan Méditerranée
Métropole, achever le désengagement du département du syndicat mixte Logistique Occitanie
Pyrénées-Méditerranée. Non mise en œuvre.
Adopter un règlement d’intervention des aides au bloc communal conforme aux
compétences exercées par le département. Non mise en œuvre.
Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne
sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du présent
rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l’ensemble des
observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans sa synthèse.
Au stade du rapport d’observations définitives, le degré de mise en œuvre de chaque
recommandation est coté en application du guide de la Cour des comptes d’octobre 2017 :
Non mise en œuvre : pour les recommandations n’ayant donné lieu à aucune mise en œuvre ;
pour les recommandations ayant donné lieu à une mise en œuvre très incomplète après plusieurs
suivis ; quand l’administration concernée s’en tient à prendre acte de la recommandation
formulée.
Mise en œuvre en cours : pour les processus de réflexion ou les mises en œuvre engagées.
Mise en œuvre incomplète : quand la mise en œuvre n’a concerné qu’une seule partie de la
recommandation ; pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en cours n’a pas
abouti dans le temps à une mise en œuvre totale.
Totalement mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en
cours a abouti à une mise en œuvre complète ; lorsque la mise en œuvre incomplète a abouti à
une mise en œuvre totale.
Devenue sans objet : pour les recommandations devenues obsolètes ou pour lesquelles le suivi
s’avère inopérant.
Refus de mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles un refus délibéré de mise
en œuvre est exprimé.DÉPARTEMENT DES PYRÉNEES-ORIENTALES
INTRODUCTION
Aux termes de l’article L. 211-3 du code des juridictions financières « Par ses contrôles,
la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion. Elle
vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités
des organismes relevant de sa compétence. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et
valeurs. L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des
moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par
l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire
l’objet d’observations ».
Le contrôle des comptes et de la gestion du département des Pyrénées-Orientales a été
ouvert le 7 mai 2021 par lettre du président de section adressée à Mme Hermeline Malherbe,
ordonnateur en fonctions.
En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, l’entretien de fin
de contrôle a eu lieu le 23 juin 2021.
Lors de sa séance du 8 juillet 2021, la chambre a arrêté des observations provisoires qui
ont été transmises à Mme Hermeline Malherbe. Des extraits les concernant ont été adressés à des
tiers.
Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, dans sa séance du 28 octobre 2021,
a arrêté les observations définitives présentées ci-après. Elles tiennent compte du rapport relatif
aux suites données au précédent contrôle, communiqué à la chambre par courrier du 29 octobre
2021, conformément à l’article L. 243-9 du code des juridictions financières.
81. LES SUITES DU PRÉCÉDENT CONTRÔLE
Le précédent contrôle, inscrit au programme 2019 de la chambre, relevait pour partie de
l’enquête inter juridictions « protection de l’enfant ». Le rapport d’observations définitives (ROD)
a été présenté devant l’assemblée départementale le 19 octobre 2020. Sur les 14 recommandations
initiales, 3 avaient été considérées comme totalement mises en œuvre à la date de notification du
ROD, 4 mises en œuvre en cours, 1 mise en œuvre incomplète et 6 non mises en œuvre.
Les suites données aux recommandations2
Bien que la période soit concomitante à la crise sanitaire et à la campagne électorale, la
collectivité a fait siennes les recommandations de la chambre, en engageant les actions nécessaires.
Conformément aux dispositions de l’article L. 243-9 du code des juridictions financières,
l’ordonnateur devait présenter un bilan complet de leur mise en œuvre lors de la session du 25
novembre 2021.
1.1.1. L’organisation, le fonctionnement et le pilotage des services
Le département a structuré sa démarche de pilotage en produisant des suivis évaluatifs de
ses politiques publiques. Les différentes réalisations relevant essentiellement du bilan d’activité
ou de l’état d’avancement de programmation renforcent la connaissance des actions mises en
œuvre.
tableau 1 : détail de la démarche de pilotage
Actions réalisées Observations
Bilan pour l’année 2020 du plan pluriannuel d’investissement Suivi par engagement, ventilation selon le niveau des
(PPI), consistant en une évaluation financière et des réalisations engagements (non engagé, en retard, engagement conforme),
des différentes actions listées au PPI adopté par l’assemblée taux d’engagement 2020 à hauteur de 54 % par rapport au
délibérante en juillet 2019 prévisionnel, analyse des difficultés, perspectives en réponse
(réalisation 17 mai 2021). Le bilan doit pouvoir être réalisé
annuellement. Les données avaient été récoltées en 2020 pour
l’année 2019 mais le bilan n’avait pas été formalisé.
Évaluation des réalisations du projet de mandat par politique Mars 2021, 106 propositions qui se répartissent sur 11
publique recensant, pour 11 politiques publiques politiques publiques. 84 actions sont soit mises en œuvre, soit
départementales (hors sécurité civile), les principales actions en cours de mise en œuvre. 41 % des actions n’ont pas été mises
menées sur la période 2015-2021 en œuvre du fait de l’absence de compétences à la suite de
l’adoption de la loi NOTRé ou de compétences n’étant déjà pas
celles du département avant cette loi. Les propositions
nouvelles sont les plus concernées par un niveau de réalisation
faible.
Étude réalisée au second semestre 2019 sur le pilotage de la Un travail a été engagé conjointement afin d’introduire une
dépense sociale par la direction générale adjointe (DGA) des comptabilité analytique fondée sur la nomenclature stratégique
solidarités des politiques publiques. L’intégration se fera sous la forme
d’une expérimentation en 2021 pour la préparation du budget
principal (BP) 2022. Les activités de la nomenclature
stratégique serviront de base au dialogue de gestion budgétaire
pour la DGA « solidarités » qui s’ouvrira à l’automne 2021
(extension à l’ensemble des directions prévue pour les
arbitrages BP 2023 à l’automne 2022).
2 Les suites données aux recommandations relatives à la fiabilité des comptes sont présentées dans le chapitre dédié à cette
thématique.DÉPARTEMENT DES PYRÉNEES-ORIENTALES
Actions programmées (2021) Observations
Bilan à mi-parcours des actions relevant de la stratégie L’objectif est de pouvoir présenter un bilan à mi-parcours de la
départementale du tourisme et des loisirs 2019-2023 stratégie pour la fin de l’année 2021.
Bilan du schéma unique des solidarités 2018-2021 Le bilan a été réalisé par la mission « innovations sociales » du
pôle des solidarités (présentation en session publique prévue au
second semestre 2021).
Soutien à la démarche évaluative de la direction en charge du Des bilans annuels seront réalisés ainsi qu’un bilan au terme de
programme départemental d’insertion, fusionné au pacte la programmation (2021-2027).
territorial d’insertion, adopté par l’assemblée délibérante en
mai 2021
Anticipation de l’évaluation obligatoire et réglementaire du L’étude est à réaliser pour la fin de l’année 2021.
programme d’intérêt général « mieux se loger 66 » 2019-2022
Évaluation en continu des avancées de la structuration de la À partir d’un tableau de bord exploité actuellement, l’objectif
démarche achat, pilotée par la direction de la commande est de pouvoir suivre les préconisations qui ont été mises en
publique place. Constitution de l’équipe du service de coordination des
achats en cours (1 poste sur 2 pourvu à ce jour).
Source : département, retraitement de la chambre régionale des comptes (CRC)
La collectivité a complété cette démarche par un travail spécifique sur les outils de pilotage
interne et externe (cf. tableau 41 page 66). Le projet de service porté par la direction évaluation,
conseil en organisation, contrôle de gestion souligne la volonté de la collectivité d’inscrire dans le
temps cette démarche. Ces actions participent à un meilleur pilotage des politiques publiques
départementales. La recommandation de la chambre de « développer les outils de pilotage autour
d’un dialogue de gestion structuré » est donc totalement mise en œuvre.
1.1.2. Les ressources humaines
1.1.2.1. Mettre en place un processus de recrutement des contractuels conforme aux
dispositions de la loi du 26 janvier 1984 modifiée
Le département a engagé une révision de ses procédures de recrutement en précisant le
recours aux mobilités internes ou externes. Il a également adapté ses modalités de publicité des
postes vacants et de mise en concurrence aux exigences légales. Ainsi, les vacances de poste pour
les personnels de catégorie A intervenues depuis le dernier contrôle ont fait l’objet de déclarations
de vacances d’emploi normalement complétées par des procès-verbaux de désignation des
candidats retenus.
La chambre a examiné les recrutements des huit agents contractuels intervenus depuis 2019
pour une durée égale ou supérieure à 12 mois : cinq procès-verbaux de jury ainsi que les décisions
portant sur la mise à jour du tableau des emplois lui ont été adressés. Toutefois, il est rappelé que
les emplois permanents sont créés par délibération et sont, par principe, pourvus par des agents
statutaires (stagiaires ou titulaires). Si l’organe délibérant peut néanmoins introduire une clause
permettant, dans le cas où le poste ne peut être pourvu par un fonctionnaire, l’exercice des
fonctions par un agent contractuel de droit public à certaines conditions, la délibération doit alors
comporter, sous peine d’illégalité, les éléments suivants : le motif du recours à un contractuel, la
nature des fonctions, la catégorie hiérarchique A, B, C (niveau de recrutement, diplôme,
expérience...), la rémunération de l’emploi créé, le temps de travail hebdomadaire. La collectivité
doit s’astreindre à délibérer conformément aux exigences réglementaires. La mise en œuvre de la
recommandation de la chambre doit donc être considérée comme étant en cours.
101.1.2.2. Se conformer à la réglementation applicable en matière de temps de travail
Par délibération du 8 juin 2020, l’assemblée délibérante a acté la modification du règlement
intérieur relatif au temps de travail. Le département n’accorde plus à ses agents de journée de
récupération pour le 1er mai (pour les agents à temps partiel) et le 16 août (pour l’année 2020).
Toutefois, la chambre observe que la collectivité a délibéré sur des cycles de travail
hebdomadaires supérieurs à 35 heures pour dégager un nombre de jours de congés (33 jours)
dépassant le cadre réglementaire. Il est rappelé que l’article 1er du décret n° 85-1250 du
26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux fixe le droit à congé
annuel à cinq fois ses obligations hebdomadaires (35 heures) soit l’équivalent de 25 jours de
congés annuels. Tout dépassement doit donner lieu à des jours de récupération (dits RTT –
réduction du temps de travail) qui représentent la contrepartie des heures de travail exécutées en
sus de l’horaire légal. Enfin, le règlement intérieur interdit toute bonification pour fractionnement
des congés annuels (article 3) ce qui paraît également contraire à ces mêmes dispositions
réglementaires3. Dans sa réponse, l’ordonnateur précise vouloir modifier la structure des droits à
récupération et introduire une distinction entre les jours de congé acquis au titre du fractionnement
et ceux résultant des obligations hebdomadaires de service.
Sous ces réserves, la recommandation de la chambre est considérée comme totalement mise
en œuvre.
1.1.2.3. Se mettre en conformité avec la réglementation sur le régime indemnitaire des
horaires supplémentaires
Dans son contrôle précédent, la chambre avait soulevé deux problématiques relatives à
l’attribution des heures supplémentaires. La première identifiait une organisation perfectible dans
les modalités d’attribution, de suivi et de contrôle des heures supplémentaires. La seconde
problématique était liée à la base légale permettant le paiement de ces dernières. Les délibérations
n’apportaient pas suffisamment de précisions sur les grades éligibles, les missions pour lesquelles
ces heures sont susceptibles d’être attribuées, et les conditions dans lesquelles elles doivent être
réalisées.
La collectivité a engagé, en novembre 2020, un audit des procédures des directions qui font
le plus appel aux heures supplémentaires, ce qui a débouché sur un recensement de pistes
d’amélioration.
Par ailleurs, l’ordonnateur indique qu’il souhaite saisir l’opportunité de l’intégration de la
filière technique dans le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique territoriale (Rifseep) pour
redéfinir les périmètres d’attribution actuels des heures supplémentaires. Ainsi, les délibérations
devaient faire l’objet d’échanges préalables avec les représentants du personnel dans le cadre du
comité technique puis être adoptées au cours du second semestre 2021 ou du premier semestre
2022.
Toutefois, la transposition aux derniers cadres d’emplois non encore éligibles au Rifseep
est réglée par le décret n° 2020-182 du 27 février 2020, soit il y a plus de 13 mois (entrée en
3 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée (articles 55 et 57-1°) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale (JO du 27/01/1984) ; décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires
territoriaux (JO du 30/11/1985).DÉPARTEMENT DES PYRÉNEES-ORIENTALES
vigueur le 1er mars 2020). La chambre constate que l’intégration de la filière technique n’a que
peu de lien avec les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS). La collectivité n’a
pas régularisé son dispositif, renvoyant son règlement au mandat suivant. La mise en œuvre de la
recommandation de la chambre est considérée comme incomplète.
1.1.3. La protection de l’enfant
1.1.3.1. Adopter une procédure détaillée en vue de renforcer les contrôles des
établissements et services de protection de l’enfance
En complément des obligations de signalement d’enfants en danger ou à la transmission
d’une information préoccupante à la cellule de recueil des informations préoccupantes, la
collectivité a renforcé ses procédures internes et dégagé des ressources supplémentaires dédiées.
Afin de faciliter la gestion de ces informations, le département a mis en place une procédure
permettant d’uniformiser le traitement de ces déclarations, validée par l’assemblée départementale
en mars 2021. Les services sont désormais dotés d’un poste de catégorie A, rattaché à la direction
enfance-famille, dont les missions sont d’assurer le suivi des évaluations internes et externes
conduites par les établissements et structures, et de renforcer le contrôle des opérateurs. La
recommandation de la chambre est totalement mise en œuvre.
1.1.3.2. Finaliser la mise en place du projet pour l’enfant permettant d’accompagner le
mineur tout au long de son parcours, conformément à l’article L. 223-1-1 du code de l’action
sociale et des familles
Les référentiels « aide éducative à domicile » et « projet pour l’enfant » ont été présentés
aux cadres des territoires fin janvier 2020. La direction enfance-famille a engagé l’élaboration d’un
nouveau projet de direction. Dans ce cadre, un groupe de travail dédié a été constitué pour relancer
la démarche du projet pour l’enfant. Le service souligne que cette démarche nécessitera un
important travail d’appropriation et d’accompagnement au changement. La recommandation de la
chambre est en cours de mise en œuvre.
1.1.3.3. Offrir aux mineurs non accompagnés les garanties d’un réel accompagnement de
leur parcours en protection de l’enfance, quel que soit leur mode d’hébergement
Tandis que 51 jeunes étaient accueillis en 2013, le département a assuré, en 2020, l’accueil
de 611 mineurs non accompagnés (MNA), 79 étant in fine confiés au service de l’aide sociale à
l’enfance. Pour renforcer les garanties d’un réel accompagnement, la collectivité a décidé
d’accélérer la reconfiguration des locaux de l’Institut départemental de l’enfance et de
l’adolescence (IDEA) sur le site unique du Moulin à Vent. Une délibération prise lors de la dernière
séance publique de la mandature a acté ce programme de rénovation et le projet d’établissement
du foyer de l’enfance.
Le département a, par ailleurs, fait l’acquisition d’un immeuble de 80 logements qui lui
permettra, en lui associant une équipe de professionnels dédiés, d’assurer l’hébergement des MNA
à l’automne 2021.
12Le département programme également l’ouverture d’une structure d’hébergement en
semi-collectif et prépare le lancement d’un appel d’offres, sous forme de prestations
d’hébergement externalisées en semi-collectif et en pension complète pour des jeunes MNA. Cette
opération n’a pas encore été examinée par l’assemblée départementale. La recommandation de la
chambre est en cours de mise en œuvre.
1.1.3.4. Distinguer le coût de la mise à l’abri des MNA du coût de leur prise en charge afin
d’évaluer son adéquation avec le montant versé par l’État à ce titre et, le cas échéant, le niveau du
reste à charge pour le département
Un outil de suivi a été mis en place entre les services de la direction enfance-famille et ceux
de l’IDEA. Les services tiennent compte du coût du personnel du service MNA. Le coût de la mise
à l’abri des MNA a pu être justifié. La recommandation de la chambre est totalement mise en
œuvre.
1.1.3.5. Conduire un dialogue de gestion déterminant le financement de l’IDEA4 en
fonction d’objectifs en matière d’activité, de qualité de prise en charge, et de renouvellement des
équipements
Aujourd’hui, le dialogue de gestion ne s’appuie toujours pas sur des éléments de
tarification, de niveaux d’activité, ou de prise en charge. Comme pour l’ensemble des directions,
c’est le cadrage budgétaire qui précise aujourd’hui le niveau de contrainte dans la construction des
prévisions, en distinguant le financement des mesures nouvelles.
À la suite du précédent rapport de la chambre, les services se sont attachés à renforcer les
procédures de gestion dans les domaines « qualité comptable » et « ressources humaines » (RH)
tout en développant le pilotage budgétaire : outils de suivi, dialogue de gestion, projets
d’investissement, pilotage des dépenses de personnel, segmentation stratégique/analytique,
budgétaire, gestion des provisions/rattachement. La chambre prend acte du renforcement du
pilotage de la structure. Sa recommandation est en cours de mise en œuvre.
1.1.4. La compétence partagée tourisme
La mise en place d’indicateurs au sein de la convention d’objectifs est toujours en cours.
Toutefois, le département s’efforce de renforcer la qualité de ses relations contractuelles avec son
opérateur en préparant l’assemblée générale de l’agence départementale touristique (ADT) par une
analyse financière, en intégrant à l’avenant financier 2020 des résultats des indicateurs de suivi.
L’avenant financier 2021 de la convention d’objectifs intègre le plan d’actions 2021 et des
indicateurs de suivi. Enfin, le département a engagé la réalisation d’un bilan à mi-parcours du
schéma départemental de tourisme et des loisirs. Selon l’ordonnateur, il permettra ainsi de préparer
la prochaine stratégie tourisme en questionnant notamment le rôle et les missions de chaque acteur
dont l’ADT. La recommandation de la chambre est en cours de mise en œuvre.
4 Institut départemental de l’enfance et de l’adolescence ; les flux financiers retraçant l’activité de ce service sont retracés dans un
budget annexe.DÉPARTEMENT DES PYRÉNEES-ORIENTALES
Les suites données à certaines observations
1.2.1. La mise en valeur du patrimoine monumental et environnemental
Le département n’a pas suffisamment pris en compte la problématique de la valorisation à
vocation touristique de son patrimoine historique et naturel, alors qu’il dispose d’un potentiel
intéressant. La chambre a souligné, notamment, que l’acquisition du château de Castelnou s’est
faite sans que cette opération ne soit intégrée dans une stratégie d’ensemble.
La collectivité s’est appuyée sur un cabinet spécialisé pour conduire une réflexion sur le
patrimoine monumental : élaboration d’un diagnostic des monuments et proposition de scénarios
pour des projets de site pour le palais des rois de Majorque, le château royal de Collioure et le
prieuré de Serrabona. Une assistance à maîtrise d’ouvrage traitant de la mise en valeur culturelle
et touristique des sites patrimoniaux a permis de définir un projet de monument pour le château de
Castelnou et de disposer d’une programmation technique détaillée concernant la réalisation du
scénario retenu pour le site. Un accord entre le département et la communauté de communes des
Aspres prévoit l’exploitation conjointe du site (création de la SPL « Castell Nou »).
L’étude menée d’octobre 2020 à juin 2021 devait permettre au département de préciser son
schéma fonctionnel et directeur. Le plan pluriannuel d’investissement (PPI) devra être complété
des inscriptions des actions prioritaires à mener.
1.2.2. La participation du département à la société d’économie mixte crématiste catalane
Le département a saisi, en 2016, les communes membres de la société d’économie mixte
(SEM) crématiste catalane, afin de procéder à une cession des actions détenues au sein de cette
société qui a pour objet la construction et l’exploitation d’unités de crémations, de centres
funéraires et de jardins cinéraires. Cette démarche s’était traduite par la cession d’une faible partie
des actions détenues. Malgré ces démarches, et en l’absence de mesure contraignante prévue par
la loi, la collectivité détient aujourd’hui encore 821 actions de la SEM crématiste catalane pour un
montant de 328 400 €. Elle n’arrive pas à satisfaire aux obligations de cession qui s’imposent
pourtant à elle au regard du monopole des communes et établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) en matière de création et de gestion des crématoriums et des sites
cinéraires (article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales – CGCT).
________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________
Conformément aux échanges qui sont intervenus avec la présidente lors du précédent
contrôle, l’exécutif s’est effectivement appuyé sur le rapport de la chambre pour renforcer le
pilotage de ses principales politiques publiques et consolider un certain nombre de ses procédures
internes.
Les difficultés générées par la crise sanitaire ont pu retarder un certain nombre de
démarches, sans les remettre fondamentalement en cause. Les recommandations portant sur des
processus longs sont en cours de mise en œuvre : projet pour l’enfant, renforcement des contrôles
des établissements et services de protection de l’enfant, convention d’objectifs avec l’ADT. La
mise en place d’autres dispositifs, qui touchent à la conformité à la réglementation, devrait se
concrétiser dans le cadre du nouveau mandat (IHTS, recrutement des contractuels).
142. L’INFORMATION BUDGÉTAIRE ET LA FIABILITÉ DES
COMPTES
La fiabilité et la qualité comptable
Depuis le dernier contrôle de la chambre, la collectivité a renforcé ses procédures internes
en s’engageant dans une démarche de qualité comptable qui se traduit par des actions de
sensibilisation, de formation et de communication. Pour cela, elle a procédé au recrutement d’un
« chargé de mission qualité comptable ». Les premières tâches ont consisté à formaliser les
procédures de rattachement des charges et des produits à l’exercice, d’apurement des comptes
d’imputation provisoire (sur les sommes les plus anciennes) et à préparer la tenue d’une
comptabilité de stocks.
L’ordonnateur a également souhaité renforcer le suivi du patrimoine et, fin 2019, un
logiciel spécifique interfacé avec le logiciel comptable de l’institution a été acquis. Conformément
à ce que prévoit l’instruction budgétaire et comptable M52, le département a fait le choix d’une
tenue de comptabilité de stocks. Expérimentale en 2021, cette démarche doit être progressivement
étendue.
L’information budgétaire et financière
Le rapport d’orientation budgétaire s’était nettement enrichi depuis 2013 en déclinant, pour
l’année à venir et par domaine d’intervention départemental, l’exécution des crédits de l’année. La
collectivité s’était également appuyée sur les remarques de la chambre pour intégrer, dans le
rapport d’orientation budgétaire, les données d’exécution budgétaire les plus récentes, la structure
des dépenses de personnel et préciser la trajectoire des engagements pluriannuels.
Le rapport d’orientation budgétaire portant sur l’exercice 2021 a été soumis à l’assemblée
départementale le 16 novembre 2020. L’information financière et budgétaire a été de nouveau
enrichie puisque ce document comprend notamment une partie détaillée sur les effets de la crise
sanitaire et les projections ajustées pour 2021. Répondant plus directement à une observation de
la chambre, la partie consacrée à la gestion pluriannuelle des crédits dans sa vision prospective
avec la mise en œuvre du PPI 2019-2023 a été confortée, en consacrant la partie IV du rapport à
la politique d’investissement. Le volet RH du rapport a aussi fait l’objet d’une remise à plat avec
des éléments d’information sur les effectifs, les avantages en nature et les trajectoires attendues en
matière de RH.
Les effets de la crise sanitaire sur les réalisations budgétaires 2020
Le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement connaît une légère baisse en 2020
(taux de 94,2 % contre 96,6 % en 2019). Il en est de même pour l’investissement (restes à réaliser
– RAR - compris) avec un taux d’exécution de 81,7 % contre 82,1 % en 2019. Malgré les effets
de la crise, le département maintient la tendance dynamique observée depuis deux ans mais, en
investissement, la structure des taux de réalisation évolue. Si la diminution des RAR entre 2013 et
2018 soulignait une amélioration de la qualité de la programmation des opérations d’équipement
à partir de 2016, la crise se traduit par une augmentation des RAR et le rapport des RAR auxDÉPARTEMENT DES PYRÉNEES-ORIENTALES
réalisations des dépenses d’investissement dans l’année met en évidence les difficultés de
réalisation des contrats souscrits.
tableau 2 : taux de réalisation des dépenses réelles de fonctionnement et d’investissement (en €)
2018
2019 2020
(pour mémoire)
Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) mandats
518 686 425 533 601 810 540 209 907
émis + charges rattachées + RAR N
Vote DRF (budget primitif + décisions modificatives
531 749 332 551 891 421 572 894 341
+ RAR N-1)
Taux de réalisation 97,5 % 96,6 % 94,2 %
Réalisations dépenses d’investissement hors dette 79 583 003 101 999 492 107 138 215
RAR 14 621 197 22 094 189 40 761 169
Vote dépenses d’investissement hors dette 113 359 564 139 092 937 170 436 797
Taux de réalisation 83,1 % 89,2 % 86,7 %
Réalisations subvention d’investissement (018-204) 22 673 009 35 547 392 38 066 172
RAR 5 128 975 8 480 569 13 640 311
Vote subventions d’investissement (018-204) 34 641 062 53 326 359 63 276 782
Taux de réalisation 80,2 % 82,1 % 81,7 %
Réalisations dépenses d’équipement (20-21-23) 48 846 442 64 053 989 66 581 408
RAR 9 492 221 13 603 984 27 120 857
Vote dépenses d’équipement (20-21-23) 69 175 602 83 355 827 104 276 519
Taux de réalisation 84,33 % 93,1 % 89,8 %
Source : CRC
tableau 3 : poids des RAR sur les réalisations des dépenses d’investissement hors dette
TCA TCA
en € 2018 2019 2020
2019 2020
Réalisations dépenses d’investissement 79 583 003 101 999 492 107 138 215 28,2 % 5,0 %
RAR 14 621 197 22 094 189 40 761 169 51,1 % 84,5 %
Part des RAR sur les réalisations 18 % 22 % 38 %
Source : CRC
La collectivité évoque des retards dans la conduite de ses opérations de travaux, pour partie
liés aux conséquences de la crise sanitaire. Les services soulignent ainsi la suspension des chantiers
durant deux mois et la reprise organisée sur la base de protocoles sanitaires qui ont engendré un
important décalage dans la conduite des travaux. La crise a également perturbé
l’approvisionnement en matières premières. Enfin, le taux de réalisation est tributaire du niveau
de mobilisation d’opérateurs, tels que les bailleurs sociaux ou le service départemental d’incendie
et de secours (SDIS). Ces difficultés ont pu être, pour partie, compensées par le solde des
opérations correspondant à la fin du cycle d’investissement de la précédente mandature ou encore
la réponse du département aux conséquences de la tempête Gloria.
La périodicité des réalisations mensuelles des dépenses d’équipement 2020, comparée à
2018 et 2019, illustre le décrochage constaté en avril et mai 2020 qui n’a pas pu être rattrapé. Le
second confinement de septembre 2020 a pesé également sur la reprise amorcée dans l’été.
16graphique 1 : réalisations mensuelles des dépenses d’équipement
Source : département
Le département a engagé, au début de l’année 2021, un travail de refonte de suivi des
autorisations de programme (AP) avec l’ensemble des services gestionnaires, afin de confirmer le
plan de révision/clôture d’AP transmis lors du précédent contrôle de la chambre. Depuis, le
département étend progressivement le champ de ces AP. La collectivité prévoyait d’adopter son
nouveau règlement budgétaire et financier au début du mandat 2021. Un comité d’engagement
devrait s’assurer de la soutenabilité du PPI au regard des capacités financières et opérationnelles
du département.
Une démarche identique est en cours de déploiement, s’agissant des subventions
d’équipement. Un travail de « refonte » du logiciel de gestion des subventions est en cours depuis
le mois de mars 2021 afin de mettre à jour les informations sur la gestion des engagements, la pluri
annualité des opérations comptables telles que les rattachements, et en envisageant in fine une plus
grande intégration avec le logiciel de gestion financière. Une fois cette opération achevée, les
services prévoient d’enregistrer les engagements pluriannuels, ce qui pourrait les conduire à une
extension du cadre de gestion des subventions d’équipement votées en AP.
Les obligations de provisionnement
2.4.1. Les provisions pour risque, charges et créances douteuses
En application du principe comptable de prudence, il convient de constituer une provision
dès qu’apparaît un risque susceptible de conduire la collectivité à verser une somme significative.
Jusqu’à présent, le département s’abstenait d’inscrire des provisions, et ce quelle qu’en soit la
nature : pour risque (litiges et contentieux), charges (compte épargne temps – CET) ou pour
couvrir des créances anciennes et dont le risque de non-recouvrement est avéré. L’ordonnateur
s’appuyait sur la question de l’appréciation « du principe d’importance significative »5 pour
justifier cette pratique. La chambre a toutefois rappelé que ces éléments ne sauraient justifier la
méconnaissance de l’obligation réglementaire de provisionner à hauteur de l’ensemble des risques
et charges.
Le département a engagé, en 2021, la mise en place de provisions. Une provision pour
charges afférentes au CET a fait l’objet d’une évaluation transcrite dans une délibération en session
5 Qui devrait faire l’objet d’une définition dans la prochaine modification du règlement budgétaire et financier de la collectivité.Vous pouvez aussi lire