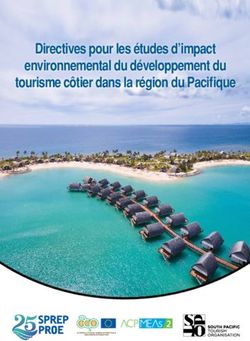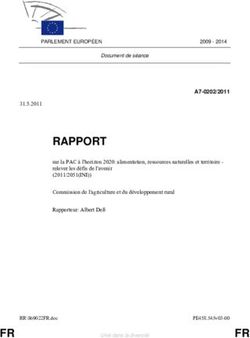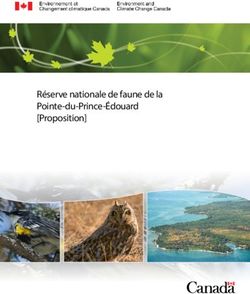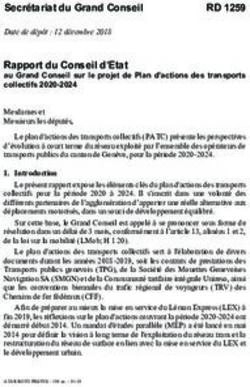DIRECTIVES ÉDITORIALES DE LA FAO
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Stratégie Nationale de Développement
de la Cuniculture au Bénin
(2018-2022)
Libérer le potentiel de la cuniculture pour la nutrition humaine et la création de richesses
DIRECTIVES
ÉDITORIALES
DE LA FAO
11 mars 2016
P O N C T U ATION | EMPLOI DES MAJUSCULES ET DES MINUSCULES | ITA LI
N O M B R E S | MOIS | UN IT É S MON É TAIR E S | ORT HOG R APH E | RES S O URStratégie Nationale de
Développement de la
Cuniculture au Bénin
(2018-2022)
Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO)
Cotonou, 2018Les appellations employées dans ce produit d’information et la présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) aucune prise de position quant au statut juridique ou au stade de développement des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. La mention de sociétés déterminées ou de produits de fabricants, qu’ils soient ou non brevetés, n’entraîne, de la part de la FAO, aucune approbation ou recommandation desdits produits de préférence à d’autres de nature analogue qui ne sont pas cités. Les opinions exprimées dans ce produit d’information sont celles du/des auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement les vues ou les politiques de la FAO. ISBN 978-92-5-1-130037-4 © FAO, 2018 La FAO encourage l’utilisation, la reproduction et la diffusion des informations figurant dans ce produit d’information. Sauf indication contraire, le contenu peut être copié, téléchargé et imprimé aux fins d’étude privée, de recherches ou d’enseignement, ainsi que pour utilisation dans des produits ou services non commerciaux, sous réserve que la FAO soit correctement mentionnée comme source et comme titulaire du droit d’auteur et à condition qu’il ne soit sous-entendu en aucune manière que la FAO approuverait les opinions, produits ou services des utilisateurs. Toute demande relative aux droits de traduction ou d’adaptation, à la revente ou à d’autres droits d’utilisation commerciale doit être présentée au moyen du formulaire en ligne disponible à www.fao.org/contact-us/licence-request ou adressée par courriel à copyright@fao.org. Les produits d’information de la FAO sont disponibles sur le site web de la FAO (www.fao.org/publications) et peuvent être achetés par courriel adressé à publications-sales@fao.org. Crédit photo couverture: © KAGOME Hamadé
TABLE DES MATIÈRES
SIGLES ET ABREVIATIONS vii
RÉSUMÉ EXÉCUTIF ix
1. INTRODUCTION 1
2. DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE 3
2.1. Approfondissement du diagnostic et élaboration de la Stratégie 3
2.2. Validation de la Stratégie et du Plan d’action quinquennal 5
3. CONTEXTE SECTORIEL DE L’ÉLEVAGE 6
3.1. Contribution à la croissance économique et à la sécurité alimentaire et nutritionnelle 6
3.1.1. Contribution à la croissance économique 6
3.1.2. Contribution à la sécurité alimentaire et nutritionnelle 6
3.2. Politique et stratégies de développement de l’élevage 6
3.2.1. Le PAG -Programme d’Action du Gouvernement 2016-2021 « Le Bénin Révélé » 6
3.2.2. Le PSDSA - Plan Stratégique de développement du Secteur Agricole 2017-2021 7
3.2.3. Le PDE - Programme de Développement de l’Elevage 7
3.3. Évolution et caractéristiques de la filière lapin 7
3.3.1. Évolution de la cuniculture au Bénin 7
3.3.2. Les acteurs de la filière lapin 8
3.3.3. Production 11
3.3.4. Transformation 12
3.3.5. Commercialisation 12
3.3.6. Eléments d’analyse économique de la filière lapin 13
4. DIAGNOSTIC DE LA FILIÈRE LAPIN AU BÉNIN 14
4.1. Un faible accès aux intrants spécifiques et aux services d’appui-conseil et vétérinaires 14
4.1.1. Prix élevé et en constante augmentation de la provende granulée 14
4.1.2. Difficulté d’accès au matériel génétique cunicole à haut potentiel de productivité 14
4.1.3. Insuffisance de l’offre d’appui-conseil technico-économique 15
4.1.4. Faible accès au crédit adapté à la filière lapin 15
4.2. De faibles productivité et production cunicoles 15
4.2.1. Faibles performances des souches locales de lapin 16
4.2.2. Absence de normes et de contrôle de qualité de la provende granulée pour lapin 16
4.2.3. Faible capacité du système d’alerte et de contrôle de la Maladie Hémorragique Virale 16
4.2.4. Prépondérance des systèmes extensifs et des élevages de petite taille 17
4.3. Une faible compétitivité et des difficultés d’accès au marché 17
4.3.1. Faible compétitivité-prix de la viande de lapin local 17
4.3.2. Une qualité commerciale et microbiologique de la viande de lapin peu satisfaisante 17
4.3.3. Difficultés d’accès au marché 18
4.4. Une chaîne de valeur peu structurée et faiblement sensible au genre 18
4.4.1. Une faible structuration de la chaîne de valeur lapin 18
4.4.2. Une faible gouvernance au sein de la chaîne de valeur 19
4.4.3. Une filière peu sensible au genre 19
4.5. Un environnement peu favorable au développement de la filière lapin 19
4.5.1. Faible capacité institutionnelle de la Direction de l’Elevage 20
4.5.2. Faible disponibilité de données sur la filière lapin 20
4.5.3. Faible investissement public dans la filière lapin 20
5. ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 21
5.1. Rappel des orientations stratégiques au niveau continental, régional et national 21
iii5.1.1. La LiDeSA - Stratégie de Développement de l’Elevage de l’Afrique 2015-2035 21 5.1.2 Le PADTE - Plan d’Action pour le Développement et la Transformation de l’Elevage dans 21 l’espace CEDEAO 2011-2020 5.1.3. Le Règlement N°07/2007/CM/UEMOA 22 5.1.4 Le PDE - Programme de Développement de l’Elevage 22 5.2. Défis de la filière lapin au Bénin 22 5.3. Vision de la Stratégie Nationale de Développement de la Cuniculture à l’horizon 2022 22 5.4. Axes stratégiques 22 5.5. Objectifs et principales actions 23 6. PLAN D’ACTION 2018-2022 25 6.1. Logique d’intervention 25 6.2. Accroissement de la productivité, de la profitabilité et de la production de lapin 25 6.2.1. Amélioration du patrimoine génétique cunicole 25 6.2.2. Sécurisation des besoins nutritionnels des lapins 26 6.2.3. Amélioration de la protection sanitaire du cheptel cunicole 27 6.2.4. Appui à la modernisation des exploitations et à l’intensification des systèmes d’élevage 27 6.3. Amélioration de la compétitivité et de l’accès au marché de la viande de lapin local 28 6.3.1. Amélioration des systèmes d’abattage, de conditionnement et de vente de la viande de lapin 28 6.3.2. Amélioration de l’accès aux informations sur le marché 28 6.3.3. Appui à l’exploitation des opportunités de marchés au niveau sous-régional 28 6.4. Développement de la chaîne de valeur lapin 29 6.4.1. Renforcement de l’organisation coopérative des cuniculteurs 29 6.4.2. Développement d’associations au sein des autres maillons de la chaîne de valeur 29 6.4.3. Appui à l’établissement de plateformes d’innovation multi-acteurs pour la promotion de la 29 filière lapin 6.4.4. Appui à la mise en place de l’Interprofession nationale de la filière lapin du Bénin 30 6.4.5. Facilitation de l’entrepreneuriat cunicole des jeunes et des femmes 30 6.5. Création d’un environnement favorable et incitatif pour le développement de la filière lapin 30 6.5.1. Amélioration de l’accès aux innovations et connaissances appropriées 30 6.5.2. Amélioration de l’offre de service aux cuniculteurs et aux autres acteurs de la chaîne de valeur 31 6.5.3. Renforcement de la formation initiale en cuniculture 31 6.5.4. Mise à jour et analyse régulières des données sectorielles sur la filière lapin 31 6.5.5. Amélioration de l’accès des acteurs de la chaîne de valeur lapin au financement public et privé 32 7. MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE ET DU PLAN D’ACTION 33 7.1. Dispositif de pilotage de la Stratégie et du Plan d’action 33 7.2. Financement du Plan d’action 33 7.2.1. Coût du plan d’action 33 7.2.2. Schéma de financement 33 7.3. Suivi-évaluation et capitalisation 34 7.4. Communication et visibilité 34 8. RISQUES ET HYPOTHÈSES 35 8.1. Risques 35 8.2. Hypothèses 35 RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 36 ANNEXES 38 Annexe 1. Résultats du diagnostic de la filière lapin au Bénin selon la méthode SEPO. 38 Annexe 2. Plan d’action budgétisé pour la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Développement 40 de la Cuniculture (SNDC) au Bénin (2018-2022) Annexe 3. Cadre logique du Plan d’action pour la mise en œuvre de la SNDC 2018-2022. 44 Annexe 4. Liste des personnes rencontrées. 45
REMERCIEMENTS
Financé par la FAO, ce document intitulé Stratégie Nationale de Développement de la Cuniculture
au Bénin (2018-2022) est l’un des résultats attendus de la mise en œuvre du TCP/BEN/3503 «Appui
à la Professionnalisation de la Filière d’Elevage Cunicole au Sud-Bénin - APFECS».
La coordination technique de ce travail a été assurée par Dr Tiemoko YO (Représentant Résident de
la FAO), Jean ADANGUIDI (Chargé de Programme de la FAO) et Yao AKPO (Directeur de l’Elevage).
Nos remerciements vont à l’endroit des cadres des directions techniques du MAEP (DPP, DE, INRAB,
DCQ, ABSSA, DDAEP, DQIF, Coordonnateur du projet TCP/BEN/3503, etc.) et autres personnes-
ressources qui ont apporté leurs expertises techniques à cette œuvre.
Le Représentant Résident de la FAO au Bénin,
Tiemoko YO, PhD.
vFIGURES
Figure 1. Modèle théorique d’analyse de la chaîne de valeur lapin au Bénin 4
Figure 2. Illustration de l’outil SEPO -Succès, Echecs, Potentialités et Obstacles (Agbo et al., sd). 5
Figure 3. Cartographie de la chaîne de valeur lapin au Bénin (Monsia et Agbede, 2014). 10
Figure 4. Schéma de commercialisation du lapin au Sud-Bénin (Monsia et Agbédé, 2014). 13
Figure 5. Schéma pyramidal de création et de diffusion du progrès génétique chez le lapin (Adapté 26
de Lebas et al., 1996).
viSIGLES ET ABRÉVIATIONS
ABeC Association Béninoise des Cuniculteurs
ABSSA Agence Béninoise de Sécurité Sanitaire des Aliments
APFECS Appui à la Professionnalisation de la Filière d’Elevage Cunicole au Sud-Bénin
ATDA Agences Territoriales de Développement Agricole
CARDER Centre Agricole Régional pour le Développement Rural
CECURI Centre Cunicole de Recherche et d’Information
CEDEAO Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest
CMMB Caisse du Mouvement Mutualiste Béninois
CNPBV Centre National des Produits Biologiques à Usage Vétérinaire
CTPEP Conseiller Technique Pour la Promotion de l’Elevage et de la Pêche
DDAEP Direction Départementale de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche
DE Direction de l’Elevage
DIP Direction de l’Informatique et du Pré-archivage
DLROPEA Direction de la Législation Rurale, de l’Appui aux Organisations Professionnelles
et à l’Entrepreneuriat Agricole
DPP Direction de le Programmation et de la Prospective
EMICoV Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des ménages
ESF Elevages sans Frontières
FADeC Fonds d’Appui au Développement des Communes
FAO Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
FIFO Principe du premier entré, premier sorti
FNDA Fonds national de Développement Agricole
FNPEEJ Fonds National de Promotion de l’Entreprise et de l’Emploi des Jeunes
FSA Faculté des Sciences Agronomiques
IDH Indice de développement Humain
IMF Institution de Micro-Finance
INRAB Institut National des Recherches Agricoles du Bénin
LABOVET Laboratoire Vétérinaire de Bohicon
LCSSA Laboratoire Central de Sécurité Sanitaire des Aliments
LiDESA Stratégie de Développement de l’Elevage pour l’Afrique
LRZVH Laboratoire de Recherche Zootechnique, Vétérinaire et Halieutique
viiMAEP Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche
OHADA Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
OIE Organisations Mondiale de la Santé Animale
PADTA Plan d’Action pour le développement et la Transformation de l’Elevage dans
l’espace CEDEAO
PAFILAV Projet d’Appui aux Filières Lait et Viande
PAG Programme d’Action du Gouvernement
PDE Programme de Développement de l’Elevage
PNIASAN Programme National d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire et
Nutritionnelle
PSDSA Plan Stratégique de Développement du Secteur Agricole
PVS Outil de l’OIE pour l’évaluation de la Performance des Services Vétérinaires
RDR Responsable du Développement Rural
RGPH Recensement Général de la Population et de l’Habitat
SCDA Secteur Communal pour le Développement Agricole
SEPO Succès, Échecs, Potentialités, Obstacles
SNCA Stratégie Nationale de Conseil Agricole
SNDC Stratégie Nationale de Développement de la Cuniculture
UA-BIRA Bureau Interafricain des Ressources Animales de l’Union Africaine
UCCEL/AC Union Communale des Coopératives des Éleveurs de Lapin d’Abomey-Calavi
UEMOA Union Économique et Monétaire Ouest Africaine
VHD Maladie Hémorragique ViraleRÉSUMÉ EXÉCUTIF
Au Bénin, le sous-secteur de l’élevage contribue à hauteur de 14,8% au PIB agricole. Toutefois, les productions
animales ne couvrent pas les besoins en protéines animales de la population béninoise. Le niveau élevé des
importations de viande traduit l’ampleur du déficit de l’offre intérieure qui est estimée à 52% pour la viande,
34% pour le lait et 62% pour les œufs (FAOSTAT 2014). Les importations de viandes et abats comestibles
ont évolué de 2 590 tonnes en 1996 à 17 200 tonnes en 2012; ce qui traduit la forte dépendance du Bénin en
produits carnés.
A côté des traditionnelles filières conventionnelles (bovins, ovins, caprins, volailles et porcins) qui font l’objet
d’une attention particulière des pouvoirs publics, l’élevage du lapin se développe progressivement. Le cheptel
cunicole national étant encore très faible, il n’a qu’une contribution marginale à la croissance et à la sécurité
alimentaire. L’élevage de lapins dispose pourtant d’atouts qui doivent être valorisés pour permettre à la filière
lapin de connaître un véritable essor: qualités nutritionnelles de la viande de lapin nettement au-dessus des
autres viandes; espèce à cycle court et à grande prolificité; source d’emplois et de revenus, notamment
pour les jeunes et les femmes; etc. Malgré ces atouts et la forte demande tant nationale que sous-régionale
en viande de lapin, la production cunicole tarde à décoller véritablement. C’est dans ce contexte, et pour
promouvoir la filière lapin, que le Gouvernement béninois, avec l’appui technique et financier de la FAO, a
entrepris d’élaborer la Stratégie nationale de Développement de la Cuniculture (SNDC) au Bénin assortie d’un
Plan d’action quinquennal 2018-2022.
La démarche méthodologique adoptée pour atteindre l’objectif et les résultats attendus de l’étude comprend
deux phases, à savoir: (i) l’approfondissement du diagnostic et l’élaboration de la Stratégie et (ii) la validation
de la SNDC et du Plan d’action quinquennal. En vue d’assurer la participation des parties prenantes, celle-ci
s’est basée sur l’approche chaîne de valeur. Un modèle théorique d’analyse de la chaîne de valeur lapin a été
élaboré, ce qui a permis d’effectuer le diagnostic approfondi de la filière lapin en utilisant l’outil SEPO (Succès,
Échecs, Potentialités et Obstacles), l’analyse de l’accès aux intrants et aux services, l’analyse des écarts de
productivité, l’analyse de la compétitivité et de l’accès au marché et l’analyse de la gouvernance de la chaîne
de valeur. Au terme de ces analyses, un mini-atelier a été organisé pour valider les résultats du diagnostic
et les axes stratégiques proposés avant l’élaboration du rapport provisoire de la SNDC 2018-2022 et de son
Plan d’Action. Enfin, un atelier technique et un atelier national ont été organisés, respectivement pour la pré-
validation et pour la validation de la SNDC et de son Plan quinquennal 2018-2022.
L’environnement politique de l’élevage et de la cuniculture est marqué par le Programme d’action du
Gouvernement (PAG «Le Bénin Révélé»), le Plan Stratégique de Développement du secteur Agricole
(PSDDSA), le Programme National d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle
(PNIASAN) et le Programme de Développement de l’Elevage (PDE). Un des objectifs quantitatifs de ces
stratégies est d’accroître la production de viande à partir des espèces conventionnelles et non conventionnelles
pour la porter de 63 277 tonnes en 2012 à 104 000 tonnes en 2021. Ce qui permettra de couvrir les besoins
de la population et de réduire le déficit des besoins en viande de 60 %. Pour atteindre ces objectifs, en plus
des filière viande, lait et œufs de table, l’élevage des espèces à cycle court bénéficiera d’appui dans le cadre
de la mise en œuvre du PNIASAN 2016-2021.
La trajectoire d’évolution de la cuniculture a été marquée par les faits suivants: (i) l’essor de la cuniculture
au Bénin a été observé à partir de 1988 avec la création du Centre Cunicole de Recherche et d’Information
(CECURI) au sein de l’Université d’Abomey-Calavi; (ii) la première épizootie de la Maladie Virale Hémorragique
(VHD) qui a décimé une importante partie du cheptel du Sud-Bénin estimée à 10 000 têtes environ en 1995;
(iii) la promotion de la filière lapin, après la fin de la première épizootie de la VHD par le CECURI et les
autres acteurs (ABeC, ONG, etc.), à travers notamment la mise en œuvre du projet CORUS « Projet de
Développement et de la Vulgarisation de la Cuniculture au Bénin » et, à partir de 2014, celle du projet FAO
« Appui à la Professionnalisation de la Filière d’Elevage Cunicole au Sud-Bénin – APFECS » est venue donner
un nouveau souffle après retrait de l’ONG Louvain développement et la crise de l’ABeC; (iv) enfin la survenue
de la deuxième épidémie de la VHD en fin 2015, qui a sévi dans les exploitations cunicoles jusqu’en fin 2016.
Cette évolution a abouti à une différenciation des élevages cunicoles en ces trois systèmes suivants: (i) le
système familial, élevage naisseur-engraisseur associé à d’autres activités agricoles avec une portée de
4-5 lapereaux par lapine-mère, soit environ 30 lapins engraissés par an avec un poids vif corporel (PV) de
ixmoins de 2 kg; (ii) le système d’élevage semi-intensif, élevage naisseur-engraisseur associé ou non à d’autres
activités agricoles (élevage notamment) avec une portée de 6-7 lapereaux, soit 36-40 lapins engraissés par
an et un PV d’environ 2 kg; (iii) le système d’élevage intensif, élevage spécialisé ou en voie de spécialisation
(naissage, engraissement, multiplication de reproducteurs performants), avec une portée de 7-8 lapereaux,
soit plus de 40 lapins engraissés par lapine et par an avec un PV de plus de 2 kg.
Au plan organisationnel, la filière lapin est caractérisée par l’existence d’acteurs jouant plusieurs rôles à la fois
tels que les éleveurs-provendiers, les éleveurs-transformateurs, les éleveurs-commerçants (presque tous étant
à la recherche de marchés), les éleveurs-transformateurs-commerçants et les transformateurs commerçants.
Le diagnostic de la filière lapin au Bénin a mis en évidence les principales contraintes suivantes qui limitent
sa performance:
un faible accès aux intrants spécifiques et aux services, notamment (i) le prix élevé et en constante
augmentation de la provende granulée, principale ressource alimentaire des lapins, (ii) les difficultés
d’accès au matériel génétique cunicole à haut potentiel de productivité, (iii) l’insuffisance de l’offre d’appui-
conseil technico-économique et (iv) le faible accès au crédit adapté à la filière lapin;
une faible productivité et production cunicoles dues essentiellement (i) à la faible performance des souches
locales de lapin, (ii) à l’absence de normes et de contrôle de qualité de la provende granulée pour lapin,
(iii) à la faible capacité du système d’alerte et de contrôle de la Maladie Hémorragique Virale et (iv) ) à la
prépondérance des systèmes extensifs et des élevages de petite taille;
une faible compétitivité et des difficultés d’accès au marché, caractérisées par (i) une faible compétitivité-
prix de la viande de lapin local par rapport à la viande de lapin importée congelée, (ii) une qualité
commerciale et microbiologique de la viande de lapin peu satisfaisante et (iii) des difficultés d’accès au
marché résumées par des éleveurs qui ont des difficultés d’écoulement d’une part et des clients qui ont
des difficultés d’approvisionnement régulier d’autre part;
une chaîne de valeur faiblement structurée et peu sensible au genre dont les causes sont (i) une faible
structuration horizontale et une absence d’organisation verticale de la chaîne de valeur lapin, (ii) une faible
gouvernance au sein de la chaîne de valeur dominée par les fournisseurs d’intrants, les transformateurs
et les commerçants et (iii) une faible insertion (moins de 20%) des femmes et des jeunes dans la chaîne
de valeur;
un environnement peu favorable au développement de la filière lapin, caractérisé par (i) une faible capacité
institutionnelle et opérationnelle de la Direction de l’Elevage, (ii) une faible disponibilité de données sur
la filière lapin nécessaires pour la planification et les prises de décision stratégiques et (iii) un faible
investissement public dans le sous-secteur de l’élevage et pour la promotion de la filière lapin.
Sur la base des résultats du diagnostic, des orientations stratégiques pour le développement de l’élevage au
niveau continental (Stratégie de Développement de l’Elevage de l’Afrique 2015-2035), régional (Plan d’Action
pour le Développement et la Transformation de l’Elevage dans l’espace CEDEAO 2011-2020, Règlement
N°07/2007/CM/UEMOA sur la Sécurité Sanitaire des Végétaux, des Animaux et des Aliments dans la zone
UEMOA) et national (PAG, PSDSA, PNIASAN et PDE), une vision a été définie et 4 axes stratégiques identifiés
pour la SNDC. La vision s’énonce comme suit:
Une filière lapin performante, attractive et créatrice de richesses, qui renforce la sécurité
alimentaire et nutritionnelle et contribue au développement socio-économique équitable
de la population béninoise.
Les quatre axes stratégiques dont la mise en œuvre permettra de réaliser la vision sont les suivants:
1. l’accroissement de la productivité, de la profitabilité et de la production de lapin;
2. l’amélioration de la compétitivité et de l’accès au marché de la viande de lapin local;
3. le développement de la chaîne de valeur viande de lapin et
4. la création d’un environnement favorable et incitatif pour le développement de la filière lapin.
Les objectifs stratégiques de la SNDC relatifs à ces quatre axes stratégiques sont les suivants: (i) une
augmentation de la production à 6 930 tonnes de viande de lapin en 2022; (ii) une augmentation des parts
de marché de la viande de lapin local à 90% sur le marché domestique et à 1% sur le marché sous-régional;
(iii) une gouvernance de la chaîne de valeur viande de lapin renforcée et (iv) une attractivité de la filière lapin
renforcée, notamment pour les jeunes et les femmes.
Le Plan d’action, instrument d’opérationnalisation de la SNDC, s’appuie sur les axes et les objectifs définis dans
les Orientations stratégiques. Il compte 17 actions prioritaires qui sont déclinés en 58 activités nécessaires et
suffisantes pour atteindre les objectifs stratégiques formulés plus haut. D’un coût estimatif de 1 632 900 000
francs CFA, le Plan d’action s’appuiera en grande partie sur le PNIASAN pour son financement.
Le succès de la mise en œuvre de la SNDC et du Plan d’action 2018-2022 sera assuré par une Cellule de
coordination logée au sein de la Direction de l’Elevage, ainsi que par l’élaboration et la mise en œuvre d’un
Manuel de suivi-évaluation orienté vers les résultats et d’un Plan de communication assurant l’information sur
les progrès et sur les résultats (effets et impacts) dudit Plan d’action.
x1. INTRODUCTION
A l’instar de la plupart des pays sub-sahariens, le secteur agricole constitue le principal moteur
de l’économie nationale au Bénin. Il contribue en moyenne pour 32,6% à la formation du produit
intérieur brut (PIB), génère environ 80% des devises d’exportation et emploie plus de 70% de la
population totale du pays.
Au sein de ce secteur, le sous-secteur de l’élevage contribue à hauteur de 14,8% au PIB agricole.
Toutefois, les productions animales ne couvrent pas les besoins en protéines animales de la
population béninoise. Le niveau élevé des importations de viande traduit l’ampleur du déficit de l’offre
intérieure qui est estimée à 52% pour la viande, 34% pour le lait et 62% pour les œufs (FAOSTAT,
2014). Les importations de viandes et abats comestibles ont évolué de 2 590 tonnes en 1996 à
17 200 tonnes en 2012, ce qui traduit la forte dépendance du Bénin en produits carnés (Direction
de l’Elevage, 2014).
A côté des traditionnelles filières conventionnelles (bovins, ovins, caprins, volailles et porcins) qui
font l’objet d’une attention particulière des pouvoirs publics, l’élevage du lapin ainsi que celui d’autres
espèces animales non conventionnelles (escargots, aulacodes, cobayes, etc.) se développent
progressivement. Le cheptel cunicole national étant encore très faible, il n’a qu’une contribution
marginale à la croissance et à la sécurité alimentaire.
L’élevage de lapins dispose pourtant d’atouts qui doivent être valorisés pour permettre à la filière
lapin de connaître un véritable essor. En effet, les qualités nutritives du lapin en font une espèce
dont la vulgarisation pourrait contribuer à l’amélioration du statut nutritionnel des familles béninoises.
C’est une viande pauvre en lipides et peu calorique, très bonne source de protéines de bonne
qualité, riche en acides gras oméga 3, excellente source de vitamines (B3 et B12), de minéraux
(phosphore, potassium) et d’oligoéléments (sélénium) (Lecerf et Clerc, 2009). En outre, le lapin est
une espèce à cycle court avec une grande prolificité. Son élevage dans des conditions optimales
pourrait constituer une source d’emplois, notamment pour les jeunes et les femmes, et de revenus
pour les producteurs et les autres acteurs de la filière lapin.
Malgré ces atouts et la forte demande tant nationale que sous-régionale en viande de lapin, la
production cunicole tarde à décoller véritablement. L’absence de statistiques sur les performances
réelles de cette filière rend difficile l’appréciation des perspectives de la filière cunicole. L’élevage
de lapins, intégré généralement dans de petites exploitations agricoles familiales, dispose d’une
importante marge de progression vers une filière performante et compétitive.
Dans le Sud-Bénin à forte densité de population (plus de 500 habitants/km2 contre une moyenne
nationale de 40 habitants/km2), seuls les élevages à cycles courts et de type intensifs (lapins, volailles,
aulacodes, porcs) offrent des possibilités de développement et constituent une niche d’auto-emplois
pour les jeunes et les femmes. Afin d’exploiter au mieux le potentiel de production et de génération de
revenus que constitue la filière lapin, la FAO a apporté un appui à l’élaboration et à la mise en œuvre
du projet TCP/BEN/3503 « Appui à la Professionnalisation de la Filière d’Elevage Cunicole au Sud-
Bénin - APFECS ». Ce projet a pour objectif de contribuer à assainir l’environnement administratif
et institutionnel de l’élevage cunicole, à améliorer sa productivité et sa compétitivité, à créer de
meilleures conditions de commercialisation et, in fine, un secteur rentable et attractif capable de
constituer une source d’auto-emplois pour les jeunes et les femmes.
Parmi les produits attendus de ce projet figure le Produit 8 « Une Stratégie Nationale de Développement
de la Cuniculture suivie d’un Plan d’actions quinquennal est élaborée et validée ». C’est dans ce
contexte, et en rapport avec la promotion des filières agricoles inscrite dans le Programme d’Action
du Gouvernement « Le Bénin Révélé » 2016-2021, que s’inscrit l’élaboration de la Stratégie Nationale
de Développement de la Cuniculture (SNDC) au Bénin et de son Plan d’action quinquennal 2018-
12022. Fondée sur le diagnostic approfondi du secteur cunicole, la SNDC a formulé des orientations stratégiques et les principales actions à mettre en œuvre pour lever les contraintes et réaliser le potentiel de la cuniculture. La SNDC est un document de référence pour toutes les interventions publiques et privées dans le domaine de l’élevage cunicole et de la promotion de la filière lapin dans son ensemble. Dès lors, son appropriation et sa mise en œuvre, impliquant toutes les parties prenantes, sont nécessaires pour promouvoir la filière lapin et améliorer sa contribution au développement socio-économique équitable des populations béninoises. 2
2. DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE
La démarche méthodologique adoptée pour atteindre l’objectif et les résultats attendus de l’étude
comprend 2 phases, à savoir: (i) l’approfondissement du diagnostic et l’élaboration de la Stratégie et
(ii) la validation de la SNDC et du Plan d’action quinquennal.
2.1. Approfondissement du diagnostic et élaboration de la Stratégie
Le diagnostic approfondi de la filière lapin fait suite à deux précédentes études diagnostiques
commanditées par la FAO, à savoir: (i) l’étude diagnostique des élevages à cycle court au Bénin.
Projet d’insertion des jeunes et des femmes dans des activités agricoles rentables: promotion de
modèles d’élevages à cycles courts de lapins, volailles et aulacodes (PPMECC) (Monsia et Agbédé,
2014) et l’étude de marché de la viande de lapin au Bénin (Sodjinou, 2016). Certains résultats de
ces études diagnostiques ont été pris en compte dans le présent document.
Cette phase d’approfondissement du diagnostic et d’élaboration de la Stratégie a consisté en
plusieurs étapes allant d’une réunion de cadrage à l’élaboration de la version provisoire de la SNDC
et du Plan d’actions quinquennal.
Une réunion de cadrage de l’étude s’est déroulée le 13 janvier avec le Représentant résident de
la FAO entouré du Chargé de programme et du Coordonnateur du projet APFECS. Au terme de la
réunion, la démarche méthodologique et le programme de la mission ont été validés.
Une revue documentaire initiale sur la cuniculture et sur l’ensemble de la filière lapin a été réalisée à
partir des documents stratégiques et techniques mis à disposition par la FAO et par le Ministère de
l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, mais aussi d’articles scientifiques et d’autres documents
collectés en ligne et à l’Université d’Abomey-Calavi, au CECURI, à l’ABeC, à l’UEMOA, à la CEDEAO,
à l’UA-BIRA, etc.. Une attention particulière a été portée sur l’« Étude diagnostique des élevages à
cycle court au Bénin » et sur l’« Étude sur le marché de la viande de lapin au Bénin », rapports de
diagnostic préliminaire de la filière lapin.
A partir de l’analyse des données secondaires, des outils de collecte de données et informations ont
été élaborés, sur la base d’un modèle théorique d’analyse de la chaîne de valeur lapin (Figure 1). Il
s’agit notamment de guides d’entretien avec les différentes catégories d’acteurs de la filière lapin, à
savoir les fournisseurs d’intrants, les prestataires de services publics et privés, les producteurs, les
transformateurs, les commerçants et les restaurateurs), ainsi que des institutions d’appui à la filière.
La particularité de ces guides était d’actualiser et de compléter les diagnostics préliminaires réalisés
précédemment.
3© FAO
Les entretiens et les visites de terrain se sont déroulés dans le Sud-Bénin, notamment à Cotonou,
à Porto-Novo, à Adjarra, à Calavi et à Bohicon. Les entretiens ont concerné les structures d’appui à
la filière (le CECURI, la Direction de l’Elevage, le CNPBV, le Laboratoire Vétérinaire de Bohicon, les
CARDERs, l’INRAB, les Cabinets vétérinaires privés, les ONG et les Institutions de Micro-Finance),
les organisations de cuniculteurs (ABeC, Coopératives communales et Unions de coopératives), les
transformateurs, les commerçants et les restaurateurs. Différents types d’exploitations cunicoles,
des restaurants, des supermarchés, le Centre d’application et l’Unité de fabrique de provende
granulée du CECURI ont été visités.
Le traitement des données et informations collectées s’est basé sur l’approche chaîne de valeur, en
analysant les Succès, les Échecs, les Potentialités et les Obstacles de chaque maillon de la chaîne
ainsi que des structures d’appui de la filière lapin. Les différents types d’analyse effectuée sont: (i)
l’analyse de l’accès aux intrants et de l’offre de services; (ii) l’analyse des écarts de productivité; (iii)
l’analyse de la compétitivité et de l’accès au marché; (iv) l’analyse de la gouvernance de la chaîne de
valeur et (v) l’analyse de l’environnement politique et institutionnel de la filière. Les résultats de ces
analyses et les orientations stratégiques nationales, régionales et continentales en matière agricole
et de développement de l’élevage ont permis d’identifier les défis de la filière lapin, de formuler la
vision de la SNDC à l’horizon 2022 et de définir les axes stratégiques.
4© FAO
Figure 2. Illustration de l’outil SEPO -Succès, Échecs, Potentialités et Obstacles (Agbo et al., sd).
Un mini-atelier de validation, regroupant une vingtaine de participants représentant les différentes
catégories d’acteurs concernés par la promotion de la filière lapin au Bénin, a été organisé le 3
février 2017 dans la salle de réunion de la FAO. Ce mini-atelier, qui s’est déroulé en sessions
plénières et en travaux de groupes, a permis de valider les contraintes, les défis, la vision et les axes
stratégiques proposés pour la promotion de la filière lapin au Bénin.
La validation des résultats du diagnostic et des propositions d’axes stratégiques a constitué un
quitus donné aux Consultants pour l’élaboration de la SNDC. Prenant en compte les amendements
et les recommandations de l’atelier, le rapport provisoire de la SNDC 2017-2021 a été élaboré, y
compris le Plan d’Actions quinquennal et les conditions de mise en œuvre pour la promotion de la
filière lapin.
2.2. Validation de la Stratégie et du Plan d’action quinquennal
Le processus de validation de la Stratégie et du Plan d’actions s’est déroulé en deux étapes, à savoir
l’atelier de pré-validation et l’atelier national de validation.
L’atelier de pré-validation, encore appelé atelier de validation technique, a regroupé d’une façon
exhaustive les représentants des acteurs de la chaîne de valeur, des institutions d’appui et des
institutions en charge de l’orientation politique des filières agricoles au Bénin. Une revue critique du
document est ainsi effectuée, des amendements faits, le document de Stratégie et de Plan d’action
validé et des recommandations formulées pour la mise en œuvre de la SNDC et du Plan d’actions.
L’atelier national de validation de la Stratégie et du Plan d’action, qui présente une connotation
politique, a été présidé par le Conseiller Technique à la Promotion de l’Elevage et de la Pêche. Il a
permis à plus de cinquante représentants des acteurs des différentes maillons de la filière lapin, des
institutions d’appui et de toutes les parties prenantes à la promotion de la filière lapin, de valider la
SNDC et le Plan d’action, de formuler des recommandations et d’élaborer une feuille de route pour
leur mise en œuvre.
Au terme du processus, un rapport de mission de l’étude a été élaboré et soumis à la Représentation
de la FAO au Bénin et au Gouvernement. Ce rapport rappelle le contexte de l’élaboration de la
SNDC, décrit les activités réalisées et les difficultés rencontrées, formule des recommandations et
propose une feuille de route préparatoire à la mise en œuvre de la SNDC et du Plan d’action 2018-
2022.
53. CONTEXTE SECTORIEL DE
L’ÉLEVAGE
Le quatrième Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH 4) du Bénin de 2013 a
permis de dénombrer une population résidente d’environ 10 millions d’habitants dont 60% vivent sur
10% de la superficie dans la partie sud du pays. Sur le plan social, le Bénin reste un pays à faible
développement humain, avec un Indicateur composite de Développement Humain (IDH) en 2011 de
0,427 qui le classe au 167ème rang sur 187 pays (PNUD, 2011).
3.1. Contribution à la croissance économique et à la sécurité alimentaire et
nutritionnelle
3.1.1. Contribution à la croissance économique
La croissance économique du Bénin a évolué de 3,3% en 2011 à 5,7% en 2015, avec une moyenne
annuelle de 5,1%. A cette croissance, le secteur agricole contribue pour une part importante avec
une moyenne de 2,4%. La croissance du sous-secteur élevage est passée de 3,5% en 2011 à
3,2% en 2014, même si cette régression est restée constante de 2012 à 2014 (MAEP, 2016). Ces
statistiques sont faibles au regard de la cible fixée pour 2015 qui est de 5%. La contribution du sous-
secteur élevage au PIB Agricole a augmenté de 2,88 points passant de 15,50% en 2011 à 18,5% en
2014. Le niveau atteint en 2014 est supérieur à la cible de 2015 qui est de 16%.
3.1.2. Contribution à la sécurité alimentaire et nutritionnelle
La consommation nationale de viande au Bénin qui est de 9 kg/habitant/an est en dessous de la
moyenne des pays au sud du Sahara (13 kg/habitant/an) et des normes minimales recommandées
par la FAO (21 kg/habitant/an). L’un des enjeux de la politique sectorielle dans le domaine de l’élevage
est de combler cet écart par l’exploitation des espèces conventionnelles et non conventionnelles et
la substitution aux importations massives à bon prix de certaines denrées alimentaires, dont la
viande, par la promotion de la production nationale. Dans cette perspective, la cuniculture pourrait
jouer un rôle important, notamment en améliorant la situation nutritionnelle très préoccupante. La
malnutrition chronique ou retard de croissance est passée de 32% en 2011 (EMICoV, 2011) à 34,4%
en 2014 (MICS, 2014). La situation est plus critique en milieu rural (35,2%) qu’en milieu urbain
(25,8%) et affecte plus les garçons que les filles (EMICoV, 2011).
3.2. Politique et stratégies de développement de l’élevage
3.2.1. Le PAG -Programme d’Action du Gouvernement 2016-2021 « Le Bénin Révélé »
Le Gouvernement veut faire du secteur agricole le principal levier de développement économique,
de création de richesses et d’emplois au Bénin (Présidence de la République du Bénin, sd). La
stratégie du PAG vise à instaurer une nouvelle dynamique de promotion de filières agricoles, à travers
l’amélioration des systèmes de production grâce à une politique responsable de modernisation de
l’agriculture et la promotion de l’agro-industrie gérée par le secteur privé. Les efforts seront centrés
sur la productivité et la compétitivité des filières phares (à haute valeur ajoutée et conventionnelles)
pour répondre à l’augmentation des besoins alimentaires de la population et de l’accès aux
marchés. Le Programme s’exécutera à travers des réformes et projets phares parmi lesquels le
projet d’« Amélioration de la production de viande, lait et œufs de table: atteindre à l’horizon 2021,
6des niveaux de production de cent quatre mille (104 000) tonnes pour la viande (vs. 68 000 en 2015),
cent soixante-douze mille (172 000) tonnes pour le lait (vs cent treize mille (113 000) en 2015) et
25 000 tonnes pour les œufs (vs. Cent quinze mille (15 000) en 2015). Dans cette perspective, la
mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Développement de la Cuniculture pourrait contribuer de
manière significative à la production de viande et la création de richesses et d’emplois.
3.2.2. Le PSDSA - Plan Stratégique de développement du Secteur Agricole 2017-2021
En plus des filières phares définies dans le PAG, le PSDSA a retenu celles qualifiées «d’autres
filières agricoles». Elles apportent également des revenus supplémentaires aux petits producteurs
dont les femmes. Enfin, ces différentes sortes d’élevage contribuent tant soit peu à la croissance
de l’économie béninoise. Considérés comme des filières d’appoint aux compléments en protéines
animales pour lesquelles le Bénin présente actuellement des déficits alimentaires, les élevages
des espèces à cycle court bénéficieront également d’appui dans le cadre de la mise en œuvre
du Programme National d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle
(PNIASAN).
3.2.3. Le PDE - Programme de Développement de l’Elevage
L’objectif global du Programme est de contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la
population et d’augmenter le volume et les recettes d’exportation. Spécifiquement, il s’agit d’accroître
durablement les niveaux de production et de compétitivité des filières animales. Un des objectifs
quantitatifs poursuivis par le PDE, calculé sur la base des normes de consommation définies par la
FAO en tenant compte des projections démographiques du pays à l’horizon 2020, est d’accroître la
production de viande à partir des espèces conventionnelles et non conventionnelles. L’objectif est
de porter de 63 277 tonnes en 2012 à 104 000 tonnes en 2021, afin de couvrir les besoins de la
population et de réduire le déficit des besoins en viande de 60 %. A noter que selon la Direction de
l’Elevage (2014), la filière viande est désagrégée en sous-filières viande bovine, viande de petits
ruminants, viande porcine, viande de volaille, viande de lapin et viande d’aulacode.
3.3. Évolution et caractéristiques de la filière lapin
3.3.1. Évolution de la cuniculture au Bénin
Jusqu’en 1987, la cuniculture était pratiquée sur l’ensemble du territoire béninois, mais dans de
mauvaises conditions d’élevage. Cet élevage ne bénéficiait d’aucun appui. Il n’existait non plus
de données fiables. La situation zootechnique des élevages était Avec une moyenne de 4 lapines-
mères et 17 sujets présents, la production était de 2 à 5 portées par an avec 2 à 6 lapereaux sevrés
par portée à l’âge de 6 semaines et plus (Kpodekon et Coudert, 1993).
L’essor de la cuniculture au Bénin a été observé à partir de 1988 avec la création du Centre
Cunicole de Recherche et d’Information (CECURI) au sein de l’Université d’Abomey-Calavi. Ce
Centre a été créé pour faire face à la situation zootechnique globalement médiocre et promouvoir un
développement rationnel et durable de la cuniculture au Bénin. A travers des actions de recherche-
développement, de formation, d’information, de vulgarisation et d’appui à la production (diffusion de
reproducteurs performants), des résultats très encourageants sur l’augmentation numérique des
petits ateliers dans les zones rurales et périurbaines, sur la productivité et sur la consommation de la
viande de lapin ont été enregistrés en moins de 5 ans. En termes de durabilité, le CECURI a œuvré à
l’introduction de la cuniculture dans les programmes de recherche, à l’introduction de l’enseignement
de la cuniculture dans les lycées agricoles et à l’université, au recyclage et à la formation continue
des éleveurs et des techniciens, à la naissance de l’Association Béninoise des Cuniculteurs (ABeC)
en 1993, à la sensibilisation des décideurs politiques et des partenaires financiers et, enfin, à la
tenue en mars 1992 d’un Congrès africain sur la cuniculture.
La cuniculture, en plein essor, a été frappée de plein fouet en 1995 par la première épizootie de la
maladie virale hémorragique (VHD) qui a décimé une importante partie du cheptel du Sud-Bénin.
Cette maladie virale a occasionné une perte estimée à 10 000 têtes environ (FAO, 2000). Pour revenir
7à la situation d’avant l’épizootie de VHD et assurer un développement durable, le Bénin a bénéficié de l’assistance de la FAO à travers le projet TCP/BEN/6714 « Appui à la lutte contre l’hémorragie virale du lapin et au développement de la cuniculture ». Les principaux résultats du projet ont été les suivants: (i) la mise au point d’une stratégie économique de prophylaxie envers les principales maladies du lapin, notamment la VHD et les coccidioses; (ii) la mise au point d’un programme de communication et d’information et son application partielle, y compris l’élaboration du Guide de l’éleveur de lapins en Afrique de l’Ouest; (iii) l’étude exhaustive des problèmes de commercialisation des produits cunicoles; (iv) la participation à la mise en place d’une unité à granuler en partenariat avec Louvain Développement (ex ADRAI) et l’AFC au sein du CECURI; (v) le repeuplement en lapins reproducteurs et (vi) la formation des différents intervenants et opérateurs de la filière cunicole. Après la fin de la première épizootie de la VHD, le CECURI et les autres acteurs (ABeC, ONG, etc.) ont poursuivi la promotion de la filière lapin à travers différentes actions telles que: (i) la mise en œuvre du projet intitulé « Projet de Développement et de la Vulgarisation de la Cuniculture au Bénin » dont le volet Amélioration génétique a permis l’augmentation de la portée à 7 lapereaux par lapine-mère et du poids au sevrage de 600 g à 30 jours; (ii) la formation de 1 500 cuniculteurs en techniques de production et en gestion économique entre 2007 et 2010; (iii) l’introduction des cages en grillage métallique galvanisé en 2009; (iv) la mise en place des postes de vente de lapins par l’ABeC avec l’appui de l’ONG Louvain Développement, etc. A partir de 2014, la mise en œuvre du projet FAO « Appui à la Professionnalisation de la Filière d’Elevage Cunicole au Sud-Bénin – APFECS » est venu donner un nouveau souffle après retrait de l’ONG Louvain développement et la crise de l’ABeC. Ce projet vise à renforcer la capacité technique et managériale des acteurs le long de la chaîne, d’introduire dans les élevages des reproducteurs plus performants, de mieux organiser les circuits de commercialisation et d’apporter un appui à l’administration pour l’édiction et le contrôle des normes de qualité des intrants d’élevage. L’exécution du projet APFECS a été sérieusement perturbée par la survenue de la deuxième épidémie de la VHD en fin 2015. Celle-ci a sévi dans les exploitations cunicoles jusqu’en fin 2016. Ce second épisode de la VHD au Bénin a eu de graves conséquences sur la filière lapin: décimage de 80 à 100% des effectifs, diminution drastique de l’offre de viande de lapin, perte d’emplois et de revenus, etc.. 3.3.2. Les acteurs de la filière lapin La Figure 1 présente les acteurs de la filière lapin au Bénin: les opérateurs de la chaîne de valeur pour le marché national et les institutions de support de la chaîne de valeur. L’une des caractéristiques organisationnelles de la filière est l’existence des acteurs jouant plusieurs rôles à la fois: les éleveurs provendiers, les éleveurs-transformateurs, les éleveurs-commerçants (presque tous étant à la recherche de marchés), les éleveurs-transformateurs-commerçants et les transformateurs commerçants. Il y a une faible segmentation de la filière, ce qui limite l’efficacité et l’efficience des actions. 8
Vous pouvez aussi lire