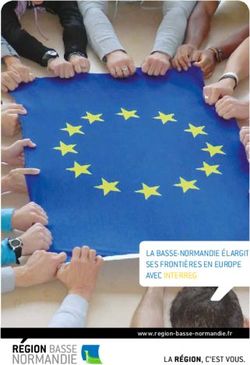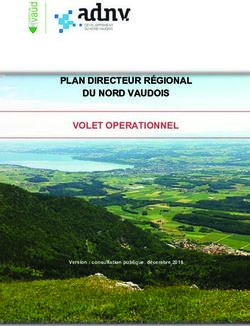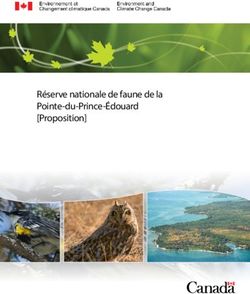Prairies et landes de Saint-Clément - Plan de gestion 2015-2020 - Cen Normandie Ouest
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Plan de gestion 2015-2020
Prairies et landes de Saint-Clément
Siège social
Octobre 2015
CEN-BN
320, Quartier du Val
Bâtiment B
14200 HEROUVILLE-ST-CLAIR
Tél / Fax : 02 31 53 01 05
www.cen-bn.fr
CODE APE : 9103Z
N° SIRET : 402 591 648 00041
Membre de la
Fédération des
Conservatoires
d’espaces naturelsPrairies et landes de Saint-Clément
(Commune de Saint-Clément-Rancoudray, Manche)
Photos couverture (vue aérienne de la vallée de la Cance : François NIMAL
Rédaction & mise en forme :
William ARIAL
Photographies :
William ARIAL et François NIMAL sauf mention contraire
Ce document doit être référencé comme suit :
ARIAL W., 2015 – Prairies et landes de Saint-Clément (commune de Saint-Clément-Rancoudray,
Manche), Plan de gestion 2015-2020. Rapport du Conservatoire d’espaces naturels de Basse-
Normandie pour l’Union européenne, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie & la Direction régionale de
l’Environnement, de l’aménagement et du logement de Basse-Normandie. 45 p.
Personnes ressources pour la gestion des sites :
- William ARIAL, chargé de mission
w.arial@cen-bn.fr / 06 77 93 42 15
- Roald HARIVEL, technicien
r.harivel@cen-bn.fr / 07 87 40 76 34____________________________________________________________________
SOMMAIRE
INTRODUCTION
SECTION A - DIAGNOSTIC DE L’UNITE COHERENTE DE GESTION ....... 2
A.1 Informations générales ........................................................................................................... 2
A.1.1 Localisation géographique............................................................................................... 2
A.1.2 Maîtrise foncière et personnes impliquées dans la gestion des sites ............................. 3
A.1.3 Historique des sites ......................................................................................................... 4
A.1.4 Statuts en faveur du patrimoine naturel ......................................................................... 5
A.2 Cadre physique ........................................................................................................................ 5
A.2.1 Climat............................................................................................................................... 5
A.2.2 Géologie........................................................................................................................... 7
A.2.3 Occupation des sols ......................................................................................................... 8
A.2.4 Evolution du réseau de haies dans et à proximité des sites ........................................... 9
A.2.5 Fonctionnement hydrologique ...................................................................................... 10
A.3 Habitats naturels et espèces ................................................................................................. 13
A.3.1 Les habitats naturels...................................................................................................... 13
A.3.2 La flore ........................................................................................................................... 17
A.3.3 La faune ......................................................................................................................... 19
A.3.4 Priorisation des enjeux liés aux habitats et espèces patrimoniaux .............................. 24
A.4 Cadre socio-économique et culturel de l’UCG et de son environnement proche ................ 26
A.4.1 Intérêts culturels, paysager, archéologique et historique ............................................ 26
A.4.2 Activités socio-économiques ......................................................................................... 27
A.5 Vocation à accueillir et intérêt pédagogique ........................................................................ 28
A.6 Valeur et enjeux .................................................................................................................... 28
A.6.1 Enjeux de conservation ................................................................................................. 28
A.6.2 Enjeux de connaissance du patrimoine ......................................................................... 28
A.6.3 Enjeux pédagogiques et socioculturels ......................................................................... 28
SECTION B - GESTION DES SITES ............................................ 29
Préambule : Historique de gestion ................................................................................................... 29
B.1 Précisions sur l’arborescence ................................................................................................ 30
B.2 Objectifs à long terme ........................................................................................................... 30
B.3 Objectifs du plan de gestion .................................................................................................. 30
B.4 Synthèse de l’arborescence................................................................................................... 32
SECTION C – PLAN DE TRAVAIL ............................................. 34
C.1 Définitions des opérations .................................................................................................... 34
C.2 Liste complète des opérations proposées............................................................................. 34
C.3 Descriptif détaillé des opérations ......................................................................................... 35
BIBLIOGRAPHIE
ANNEXES
Prairies et landes de Saint-Clément – Plan de gestion 2015-2020
Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandiep.1
___________________________________________________________________________
Introduction
Ce document constitue le premier plan de gestion de l’unité cohérente de gestion (UCG) « Prairies et
landes de Saint-Clément » située sur la commune de Saint-Clément-Rancoudray, dans le
département de la Manche (50). La définition de cette UCG nous a semblé pertinente au vu des
similarités écologiques des sites présents. Pour autant, ses contours ne sont pas définis clairement et
une réflexion devra être menée, notamment vis-à-vis du site de la Lande Mouton tout proche.
Ce premier plan de gestion, établi pour les cinq prochaines années a été rédigé selon le guide
méthodologique de l’Atelier Technique des Espaces Naturels (CHIFFAUT, 2006) mais s’inspire
également de la nouvelle méthodologie en cours d’élaboration.
Quatre objectifs à long terme ont été définis. L’enjeu prioritaire est la restauration et le maintien des
prairies et des landes tourbeuses.
Un certain nombre d’opérations de suivi scientifique vise à améliorer les connaissances et mieux
appréhender le fonctionnement des sites. Sur cette base, l’évaluation en 2020 de ce premier plan
permettra de réajuster ces objectifs à long terme si besoin.
Prairies et landes de Saint-Clément – Plan de gestion 2015-2020
Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandiep.2
___________________________________________________________________________
Section A - Diagnostic de l’unité cohérente de gestion
A.1 Informations générales
A.1.1 Localisation géographique
A.1.1.1 Aux plans national, régional et départemental
Département : Manche (50)
Canton : Mortain
Communauté de communes : CdC du Mortainais
Commune : Saint-Clément-Rancoudray
L’unité cohérente de gestion « Prairies et landes de Saint-Clément » se situe au Sud-Ouest du bourg
de Saint-Clément-Rancoudray, commune de la pointe Sud-Est du département de la Manche (50). Le
département de l’Orne est tout proche (quelques kilomètres à l’Est) (cf. figure 1).
Saint-Clément-Rancoudray
Figure 1 : Carte de localisation géographique de la commune
Deux sites composent cette UCG :
Les prairies de la Rastière se situent à quelques centaines de mètres au Sud du bourg de Saint-
Clément. Ce site borde la rivière la Cance, un affluent de la Sélune, sur environ deux kilomètres.
La lande de Champ Chevrel est quant à elle localisée à l’extrême Sud-Est du territoire communal, à
environ deux kilomètres du site de la Rastière (cf. figure 2). Elle s’insère dans le bassin versant de La
Meude, également affluent de la Sélune. Ces deux rivières serpentent dans un paysage à dominante
bocagère, à une altitude comprise entre 250 et 350 mètres.
Figure 2 : Localisation des sites de l’UCG « Prairies et landes de St-Clément »
(Fond : Cartes topographiques d’IGN (Top 25 Série bleue 1415 E))
Prairies et landes de Saint-Clément – Plan de gestion 2015-2020
Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandiep.3
___________________________________________________________________________
A.1.1.2 Limites des sites
Le site de la Rastière est limité à l’Ouest par la D357 reliant le bourg de Saint-Clément à celui de
Mortain et à l’Est par la petite route D 182 reliant l’axe Mortain-Ger. Il est constitué de deux groupes
de parcelles.
La Lande de Champ Chevrel est bordée par des parcelles agricoles et des boisements. Un chemin
rural facilité l’accès sur sa bordure Est. L’unité cohérente de gestion regroupe au total 10 parcelles
pour une surface de plus de 20 hectares (cf. figure 3 et tableau I).
Chemin rural
D182
D357
ZO04
ZO60
ZO01
Figure 3 : Extrait cadastral des sites de la Rastière et de Champ Chevrel
Tableau I : Registre parcellaire cadastral des parcelles concernées et surface correspondante
Site Section Numéro Surface (en ha) Commentaires
ZO 02 0,5
ZO 03 1,13
ZS 01 3,16
ZS 21 3,99
ZS 24 2,44
La Rastière
ZS 25 1,12
ZS 26 1,15
ZV 57 6,24
ZO 01 2,40 En cours d’acquisition
ZO 60 1,65 En cours d’acquisition
ZE 30 1,34
Champ Chevrel
ZE 31 0,69
Total 21,76
A.1.2 Maîtrise foncière et personnes impliquées dans la gestion des sites
A.1.2.1 Propriétaires et exploitants
Le Conservatoire est propriétaire de huit parcelles du site de la Rastière. Les parcelles ZS1, ZS21, ZS24
et ZV57, appartenant à la commune de Saint-Clément-Rancoudray, ont été acquises par le
Conservatoire en 2010. Les autres parcelles appartenant à des propriétaires privés, ont été acquises
en 2011.
Enfin, les parcelles ZO01 et ZO60 devraient être acquises d’ici la fin de l’année 2015.
Aucun agriculteur n’exploite actuellement les prairies de Saint-Clément. A terme, un bail pourrait
être convenu avec des exploitants intéressés par l’exploitation de certaines parcelles.
Mr Barbedette, exploitant en bovin allaitant (race limousine) fait pâturer son cheptel dans les
parcelles proches. La parcelle ZO04, incluse dans son exploitation, est quant à elle fauchée.
Prairies et landes de Saint-Clément – Plan de gestion 2015-2020
Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandiep.4
___________________________________________________________________________
A noter que les parcelles ZO01 et ZO60, en cours d’acquisition par le Conservatoire, sont exploitées
par Mr Hamel, agriculteur à La Colombe, qui y fait pâturer des génisses.
La parcelle ZE30 du site de Champ Chevrel appartient au Conservatoire. La parcelle ZE31 est quant à
elle propriété de Mr Labbé. Une convention de gestion lie Mr Labbé et le CEN-BN.
A.1.2.2 Gestionnaire
Le Conservatoire gère les sites avec les acteurs et propriétaires concernés. La Communauté de
Communes du Mortainais, collectivité récente ayant la compétence « cours d’eau » intervient sur le
cours de la Cance. Des interventions sur la végétation et des aménagements ont déjà été réalisés sur
le tronçon concerné en lien avec le Conservatoire.
La Société de chasse communale participe ponctuellement à la gestion des sites. 700 mètres de haies
sur talus ont ainsi été plantés avec l’aide des chasseurs en 2014. Un bail de chasse a par ailleurs été
signé en 2013 précisant les modalités de l’exercice de la chasse sur les parcelles du Conservatoire.
Notons que la gestion des haies semble une problématique récurrente dans le site de la Rastière.
Deux agriculteurs riverains ont interpellé le Conservatoire sur l’entretien des haies (appartenant au
Conservatoire). Dans les deux cas, une solution amiable a été trouvée : dans l’un des cas, l’agriculteur
a élagué lui-même les branches et arbres « gênants » de son côté, après accord et marquage des
branches avec le Conservatoire. Dans le second cas, le Conservatoire a élagué et mis en tas les
branches gênantes que l’agriculteur s’est chargé de traiter. Une attention devra être portée à cette
problématique à l’avenir.
Rappelons enfin que la société de pêche réalise des lâchers des Truites fario dans la Cance. Leur
fréquence et les lieux de dépôt ne sont pas connus.
A.1.3 Historique des sites
Les prairies de la Rastière ont, jusqu’aux années 2000, eu une vocation agricole (fauche et pâturage).
Depuis les années 90, la commune avait pour projet de créer un grand plan d’eau au long de la Cance
avec des aménagements pour accueillir le public. Lors du remembrement de 2001-2003, certaines
parcelles ont ainsi été découpées pour constituer une continuité tout au long de la Cance.
La commune a alors acquis la plupart des ces prairies dans les années 2003-2004 afin de réaliser le
projet de plan d’eau. C’est à partir de cette date que certaines prairies n’ont plus été exploitées.
D’autres ont été en revanche pâturées par des chevaux jusqu’en 2010 (cf. tableau II).
Le projet n’ayant jamais abouti, la commune a donc vendu au CEN-BN la totalité des prairies dont
elle était propriétaire.
La Lande de Champ Chevrel a été fauchée jusque dans les années 80. L’arrêt de la fauche à partir de
cette date a favorisé le développement progressif des éricacées et le piquetage par les ligneux à
partir des marges.
Prairies et landes de Saint-Clément – Plan de gestion 2015-2020
Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandiep.5
___________________________________________________________________________
A.1.4 Statuts en faveur du patrimoine naturel
Les sites ne bénéficient d’aucun statut de protection juridique.
Deux statuts en faveur du patrimoine naturel s’appliquent en revanche aux prairies de la Rastière. Il
s’agit de deux Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) :
ZNIEFF I « Haut-cours de la Cance et ses affluents » n°0066-0003 (Annexe 1)
ZNIEFF II « Haut-bassin de la Cance » n°00660000 (Annexe 1)
Aucune réglementation spécifique n’est associée à ce double zonage émanent de l’Etat. Il reconnaît
cependant les intérêts phanérogamiques, bryologiques, piscicoles et ornithologiques, associés au
contexte bocager et à la qualité de l’eau et des habitats naturels (habitats aquatiques et tourbeux
notamment).
Figure 4 : Zonages en faveur du patrimoine naturel concernant l’UCG
A.2 Cadre physique
A.2.1 Climat
L’unité cohérente de gestion « prairies et landes de Saint-Clément » se trouve en climat océanique
tempéré (cf. Figure 5) : les températures moyennes annuelles sont de 9.8°C, avec une amplitude au
cours de l’année de 3.4°C à 17.1°C. Les hivers sont parfois frais. Les précipitations y sont importantes
tout au long de l’année : les hauteurs minimales moyennes mensuelles, enregistrées pendant les
mois d’été (juin-juillet-août) sont supérieures à 70 mm. Plus précisément, le nombre moyen de jours
avec une hauteur de précipitation égale ou supérieure à 1 mm est de 158, soit près d’un jour sur
deux au cours d’une même année.
En effet dans notre région, le régime de vent dominant est de secteur Sud-Ouest. Les précipitations,
le plus souvent d'origine océanique, se déversent d'abord sur les reliefs occidentaux. Les collines du
Sud-Manche recueillent ainsi en moyenne 1200 à 1400 millimètres de pluie par an.
Prairies et landes de Saint-Clément – Plan de gestion 2015-2020
Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandiep.6
___________________________________________________________________________
Figure 5 : Diagramme ombrothermique de la station de Saint-Clément-Rancoudray (50)
selon le modèle de GAUSSEN avec P=2T.
(Statistiques 1972-2011, d’après Météo-France, 2012)
Ainsi, les précipitations moyennes annuelles relevées pour la commune de Saint-Clément-
Rancoudray pour la période 1972-2011 (données Météo-France, 2012) sont de 1260,2 millimètres.
L’UCG se situe donc dans un des secteurs les plus arrosés de la région Basse-Normandie (cf. figure 6).
Ces facteurs sont favorables aux systèmes tourbeux (et paratourbeux) : les précipitations
importantes et bien réparties sur l’ensemble de l’année concourent au maintien d’une forte
hydromorphie des sols.
A ces hauteurs de précipitations élevées, s’ajoute un nombre non négligeable de jours de brouillard ;
32 par an en moyenne, pour la période considérée, ce qui concourt à une hygrométrie importante
favorisant la formation et le maintien de systèmes tourbeux.
Figure 6 : Contexte pluviométrique régional (d’après COLLECTIF, 2005)
Prairies et landes de Saint-Clément – Plan de gestion 2015-2020
Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandiep.7
___________________________________________________________________________
A.2.2 Géologie
A.2.2.1 Histoire géologique et situation par rapport aux grands ensembles
Les prairies et landes de Saint-Clément se situent au cœur de la Normandie Armoricaine (partie
normande du Massif armoricain) composée de terrains anciens, sédimentaires et volcaniques.
1
Figure 7 : Extrait issu du portail InfoTerre du BRGM sur le secteur de l’UCG « Prairies et landes de St-Clément »
La carte géologique (figure 7) montre deux grands ensembles :
Dans la moitié Nord, les formations dominantes sont liées aux granites mancelliens (-585 à -
540 Millions d’années). On y retrouve leurs auréoles de métamorphisme, les cornéennes
(couche bKo²), roches particulièrement résistantes nées des fortes températures et pressions
exercées par ces plutons granitiques sur les schistes briovériens. On y retrouve également les
formations issues de l’altération et de l’érosion progressives de ces granites, les « arènes
granitiques » (couche orange Ayc4 au Nord de la figure 7).
La moitié Sud est quant à elle dominée par des formations plus récentes (du paléozoïque : -
540 à -250 Millions d’années), issues des phases de régression et de transgression marine
successives qui vont se déposer sous forme principalement de grès (grès de May (couche O4-
5, grès culminant (couche O6-S1),…) ou de schistes (Schistes du Pissot (couche O3-4), Schistes du
Pont-de-Caen (couche O5a), Schistes verts…).
Ce socle constitué de roches dures et peu perméables limite l’infiltration en profondeur de l’eau et
favorise le ruissellement de surface. Cette géologie locale conjuguée aux fortes précipitations
s’abattant sur le secteur est ainsi à l’origine de la densité du chevelu de ruisseaux et rivières drainant
le bocage du Mortainais. C’est le cas de la Cance (incluant les prairies de la Rastière) dont le fond de
vallée est tapissé par des limons sableux déposés il y a moins de 10 000 ans (couche Fz).
Les quelques dépressions ont quant à elles été comblées par les eaux de ruissellement et permis
progressivement la formation de minces placages tourbeux, comme c’est le cas dans la lande de
Champ Chevrel, ou encore dans la lande Mouton toute proche.
D’après l’inventaire du patrimoine géologique de Basse-Normandie, l’UCG ne comporte pas de site
géologique et ne présente donc pas d’intérêt géologique patrimonial particulier.
1
Site internet du Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM).
Prairies et landes de Saint-Clément – Plan de gestion 2015-2020
Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandiep.8
___________________________________________________________________________
A.2.3 Occupation des sols
La carte d’occupation des sols a été établie à partir des observations de terrain complétées par
analyse des orthophotographies de l’IGN.
Figure 8 : Occupation des sols et évolution du réseau de haies, site de la Rastière
Sur le site de la Rastière, les parcelles adjacentes à la Cance sont des prairies permanentes, pour la
plupart pâturées. En revanche, sur le début du « plateau », la pente quasi nulle et le caractère plus
drainant des parcelles a conduit certains agriculteurs à implanter des cultures (rotation blé – maïs).
Ces modifications de couverts (couvert cultural herbacé plus discontinu dans le temps et l’espace
qu’une prairie permanente) tendent à modifier les vitesses d’écoulement et le ruissellement. Ce
ruissellement entraîne des matières en suspension (MES), constituées par les particules détachées
par l’érosion. Ces MES peuvent provoquer différents types de désordre dans les milieux aquatiques,
comme l’envasement des plans d’eau, la dégradation des habitats des organismes aquatiques, la
turbidité des eaux destinées à la consommation... De plus, elles sont le support de substances
polluantes fixées sur les particules (CORPEN, 2007).
Figure 9 : Occupation des sols et évolution du réseau de haies, site de Champ Chevrel
Prairies et landes de Saint-Clément – Plan de gestion 2015-2020
Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandiep.9
___________________________________________________________________________
Pour le site de Champ Chevrel, les prairies ont plutôt bien « résisté » et seules une parcelle, par
ailleurs en aval du site, est aujourd’hui cultivée. On notera, à l’inverse du site de la Rastière qui a vu
les pratiques agricoles s’intensifier sur certaines parcelles, que c’est davantage un phénomène de
déprise qui s’observe à proximité du site de Champ Chevrel. Certaines prairies / landes, encore
fauchées dans les années 70 sont aujourd’hui boisées.
A.2.4 Evolution du réseau de haies dans et à proximité des sites
L’analyse des clichés photographiques pris lors des missions de l’IGN depuis montre une différence
nette de l’évolution du réseau de haies dans et hors culture pour le site des prairies de la Rastière (cf.
figure 8 ci-dessus). Les haies sur talus bordant une prairie ont en effet pour une très large part été
maintenues. A l’inverse, le maillage de haies pour les parcelles aujourd’hui cultivées a connu de
profonds changements. Quelques haies ont été arrachées entre les années 1946 et 1971 mais le plus
important linéaire de haies supprimées correspond aux trente dernières années. Le cas le plus
flagrant concerne la parcelle cultivée au Nord-Ouest du site. Historiquement, les anciennes haies
délimitaient les prairies.
Lors de leur mise en culture, les haies ont progressivement été supprimées (plus de 2 km linéaires au
total, soit 75% du linéaire originel) pour faciliter le passage des engins, le travail du sol et optimiser
les rendements.
Ces changements ont vraisemblablement eu des conséquences sur les vitesses d’écoulement de
l’eau, et indirectement sur l’érosion des sols et le lessivage des intrants et des produits
phytosanitaires vers la rivière la Cance. Ces effets sont néanmoins probablement atténués par les
prairies permanentes jouant un rôle tampon, aujourd’hui pour la plupart propriété du CEN-BN, tout
au long de la Cance.
Le schéma suivant, issu d’une brochure du Comité d’Orientation et pour des Pratiques agricoles
respectueuses de l’Environnement (CORPEN) sur les zones tampons illustre le rôle joué par les
prairies de St-Clément et les haies vis-à-vis des polluants et MES (rôle anti-érosif et anti-
ruissellement, rôle de limitation du transfert des polluants, rôle dénitrifiant,…). Ces effets ont en
effet été étudiés et ont fait l’objet de plusieurs publications et brochures téléchargeables sur le site
du CORPEN.
Dessin de François Bonneaud (dont l’original a été publié dans la brochure « l’agriculture et la forêt dans le
paysage » disponible sur le site internet du MAP) modifié avec les conseils de Régis Ambroise et Jean-Joël Gril
Prairies et landes de Saint-Clément – Plan de gestion 2015-2020
Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandiep.10
___________________________________________________________________________
A.2.5 Fonctionnement hydrologique
A.2.5.1. Réseau de fossés
Le site de la Rastière présente un réseau de fossés très dense (3800 mètres, soit 200 m/ha). Ils sont
pour la plupart perpendiculaires au cours de la Cance. Certains ont été creusés pour assainir les
terrains. Ils sont peu profonds et généralement en eau en hiver et au début du printemps.
D’autres ont été créés pour canaliser les eaux des sources (cf. figure 10). Ces derniers sont plus
profonds et en eau quasiment, voire toute l’année.
L’absence d’entretien de ces fossés à conduit à leur atterrissement progressif et pour certains à
l’installation d’espèces de milieux tourbeux à paratourbeux.
Figure 10 : Réseau de fossés et sens d’écoulement des eaux de surface, site de la Rastière
Le site de Champ Chevrel, située en tête de bassin (la ligne de partage avec les eaux du bassin de la
Loire se situe à environ 300 mètres à l’Est) ne présente pas de fossé conséquent et bien marqués.
D’anciens fossés, à peine visibles, sont présents au pied des talus marquant les limites de parcelles.
Néanmoins, à l’aval immédiat de la parcelle propriété du Conservatoire, un premier fossé draine les
eaux plus ou moins diffuses. Il est ensuite collecté dans un autre fossé, à proximité de la ferme de
Champ Chevrel, qui se déverse lui-même dans un affluent de la rivière la Meude.
Figure 11 : Réseau de fossés et sens d’écoulement des eaux de surface, site de Champ Chevrel
Prairies et landes de Saint-Clément – Plan de gestion 2015-2020
Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandiep.11
___________________________________________________________________________
A.2.5.2. Zones inondables
Seule le site de la Rastière est concerné par une zone inondable, sur sa quasi-totalité, à l’exception de
la moitié Sud des parcelles ZS1, ZS21 et ZS26 (cf. figure 12 ci-dessous).
Figure 12 : Zone inondable (d’après http://www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr)
Les photographies prises par le technicien de rivières de la communauté de communes du Mortainais
durant la crue de décembre 2012 illustrent le fait que les prairies de la Rastière constituent bien une
zone de débordement de la Cance.
Figure 13 : La Cance depuis la D182 Figure 14 : Débordement de la Cance
(Cliché : M. DRUET) (Cliché : M. DRUET)
Prairies et landes de Saint-Clément – Plan de gestion 2015-2020
Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandiep.12
___________________________________________________________________________
Figure 15 : Débordement de la Cance Figure 16 : La Cance depuis la D357
(Cliché : M. DRUET) (Cliché : M. DRUET)
Les conditions climatiques (températures fraîches et hauteurs de précipitations importantes) et
géologiques (roches dures et peu perméables) du Mortainais sont à l’origine de la présence de
nombreuses zones humides, parfois tourbeuses.
Les actions anthropiques, visant à tirer profit de ces milieux, ont pu néanmoins modifier le
fonctionnement de ces zones humides. Le réseau dense de fossés de la Rastière, creusés pour
faciliter l’écoulement des eaux de ruissellement vers la Cance en est une bonne illustration.
Plus récemment, l’intensification des pratiques agricoles, perceptibles au travers de l’évolution de
l’occupation des sols et du linéaire de haies est vraisemblablement plus préjudiciable à l’intégrité des
prairies humides en bordure de la Cance et de leurs cortèges associés.
Le site de Champ Chevrel, située en tête du bassin de la Meude, semble davantage épargné, avec
une occupation du sol quasi inchangée depuis plusieurs décennies.
Prairies et landes de Saint-Clément – Plan de gestion 2015-2020
Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandiep.13
___________________________________________________________________________
A.3 Habitats naturels et espèces
La description des habitats s’appuie sur les relevés phytosociologiques et les observations réalisés
lors des prospections de 2012 et 2015. Une carte de localisation des relevés figure à l’annexe 2. Deux
objectifs étaient recherchés :
- Etablir la cartographie des habitats naturels des sites : afin de mieux cerner les
fonctionnalités de ces habitats et leur dynamique, l’approche phytosociologique a été
privilégiée ;
- Dresser une première liste des espèces faunistiques et floristiques.
A.3.1 Les habitats naturels
A.3.1.1 Description des habitats
Méthodologie
La caractérisation des habitats s’appuie sur la méthode phytosociologique sigmatiste (WALTER, 2006).
Une soixantaine de relevés phytosociologiques ont été réalisés (cf. annexe 2).
Les données ont été dans un premier temps saisies dans la base de données SERENA. Elles ont
ensuite été extraites dans un tableur Excel afin d’être regroupées et exploitées.
Les relevés ont été caractérisés d’après la littérature phytosociologique, notamment la thèse de DE
FOUCAULT (1984) mais également à partir de l’étude méthodologique d’identification de " zones
humides à enjeux pour la flore et les végétations " appliquée au bassin de la Sélune (COLASSE &
ZAMBETTAKIS, 2013).
Résultats
24 habitats naturels (groupements végétaux) ont été mis en évidence. Ils sont présentés et décrits à
l’annexe 3. Une cartographie de ces habitats est présentée à l’annexe 4 et quelques clichés les
illustrent à l’annexe 5.
Il s’agit pour une très large part d’habitats humides dérivant d’anciennes prairies exploitées
extensivement par fauche ou pâturage. On y observe notamment :
- deux habitats de mégaphorbiaie : la mégaphorbiaie acide armoricaine et la mégaphorbiaie à
Scirpe des bois. Bien que physionomiquement différente, il semble que cette dernière se
rattache également au Junco-Angelicetum. On notera la présence d’une jonchaie à Jonc
diffus qui n’a pu être rattachée à un syntaxon. S’agit-il d’un faciès appauvri (du à la forte
compétition du jonc diffus) de la mégaphorbiaie acide armoricaine ?
- quatre habitats prairiaux, se répartissant selon un gradient d’humidité des sols, allant de la
prairie mésophile du Cynosurion cristati à la prairie tourbeuse du Caro-Juncetum.
- deux cariçaies : la cariçaie à Laîche à bec et la cariçaie à Laîche vésiculeuse,
- un habitat plus singulier de lande tourbeus, ceinturé par une boulaie à sphaignes.
A.3.1.2 Dynamique et évolution
L’arrêt de l’entretien de ces prairies humides depuis plusieurs années permet ainsi d’observer sur
cette même unité cohérente de gestion une diversité d’habitats humides transitoires s’inscrivant
dans les séries dynamiques des aulnaie-frênaies alluviales de l’Alnion incanae et des boulaies à
sphaignes du Sphagno - Alnion glutinosae.
La figure 17 ci-dessous, s’appuyant sur les travaux cités dans la partie méthodologie, tente de
schématiser les relations dynamiques théoriques entre les différents habitats naturels rencontrés.
On notera que tous ne sont pas représentés. Un focus a été réalisé sur les habitats de prairies et
landes, mieux représentés sur l’UCG et hébergeant vraisemblablement des éléments patrimoniaux.
Les habitats plus « marginaux » (très faible surface dans l’UCG) et très courants en Basse-Normandie
ont de fait été écartés.
Prairies et landes de Saint-Clément – Plan de gestion 2015-2020
Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandiep. 14
Plus sec Plus humide
Prairie mésophile Prairie humide acide Cariçaie à Laîche Cariçaie à Laîche à bec
Cynosurion cristati Cirsio dissecti - vésiculeuse Groupement à Carex rostrata
Scorzoneretum humilis Caricetum vesicariae
Prairie tourbeuse
Caro verticillati -
Juncetum acutiflori
Bas-marais acidiphile
cf. Caricetum canescenti-echinatae
Mégaphorbiaie acide
Moliniaie armoricaine
Caro verticillati - Molinietum Jonchaie à Mégaphorbiaie à Scirpe
caeruleae jonc diffus des bois
? Junco acutiflori -
Angelicetum sylvestris
Fourré et roncier Ptéridaie
Crataego mongynae- Holco mollis - Groupement de tourbière haute
Prunetea spinosae Pteridion aquilini Erico tetralicis - Sphagnetum rubelli
Bosquet de saule et d’aulne,
Fourré marécageux
Salicion cinereae
Hêtraie-Chênaie Chênaie pédonculée
Querco-Fagetea acidiphile
Boulaie à sphaignes
Quercion roboris
Sphagno palustris -
Aulnaie-frênaie alluviale Betuletum pubescentis
Alnion incanae
Figure 17 : Séries dynamiques présumées des prairies, cariçaies et mégaphorbiaies de l’unité cohérente de gestion.
A noter qu’il manque probablement des relations dynamiques.
Les habitats encadrés en vert ont été contactés dans au moins un des sites, ceux en noir n’ont pas été observés
dynamique progressive dynamique progressive possible Assèchement
Prairies et landes de Saint-Clément – Plan de gestion 2015-2020
Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandiep.15
___________________________________________________________________________
A.3.1.3 Evaluation de la valeur patrimoniale
Méthodologie
La valeur patrimoniale des habitats est évaluée à partir :
de l’intérêt régional qui s’appuie sur le travail de hiérarchisation des habitats mené par le
Conservatoire Botanique National de Brest (DELASSUS L. & ZAMBETTAKIS C., 2013), qui permet une
analyse fine des habitats, basée sur l’état des connaissances pour la région Basse-Normandie.
Certains des critères retenus par le CBN de Brest sont repris dans le tableau IV, à savoir :
- Rareté (classe « PC » : peu commun, « R » : rare, « TR » : Très rare, « ? » : rareté inconnue sur
le territoire),
- Tendance (« S » : apparemment stable, « R » : en régression, « ? » : tendance inconnue),
- Menace (« LC » : préoccupation mineure, « VU » : vulnérable, « EN » : En danger),
Le croisement de ces critères permet la hiérarchisation de l’intérêt régional des habitats (« Intérêt B-
N » dans le tableau III). Cinq classes sont représentées : « IP » : habitat d’intérêt régional prioritaire,
« IR » : intérêt régional, « pIR » : potentiellement d’intérêt régional, « AU » : syntaxons autres,
« DD » : données insuffisantes.
de l’intérêt communautaire (d’après l’Arrêté du 16 novembre 2001 relatif à la liste des types
d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages qui peuvent justifier la
désignation de zones spéciales de conservation au titre du réseau écologique européen Natura
2000)
L’intérêt patrimonial des habitats est attribué selon 3 classes, décrites dans le tableau III ci-dessous.
L’intérêt régional prévaut sur l’intérêt communautaire : ainsi, un habitat d’intérêt régional prioritaire
(IP) ou d’intérêt régional (IR) revêt une valeur patrimoniale forte (classe A), qu’il soit ou non d’intérêt
communautaire. En revanche, les syntaxons autres (AU) ou dont les données sont insuffisantes (DD)
se voient attribuer une valeur patrimoniale moyenne (classe B) s’ils sont d’intérêt communautaire et
faible (classe C) s’ils ne le sont pas (cf. tableau III).
Tableau III : Classement de la valeur patrimoniale des habitats
Intérêt régional
IP IR pIR AU DD
communautaire
Cas non
oui A A B B
rencontré
Intérêt
non A A B C C
Prairies et landes de Saint-Clément – Plan de gestion 2015-2020
Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandiep.16
___________________________________________________________________________
Tableau IV : Habitats d’intérêt patrimonial de l’unité cohérente de gestion (ne figurent dans ce tableau que les
habitats d’intérêt patrimonial fort. Les autres habitats n’y figurent pas car d’intérêt patrimonial faible)
Habitats naturels Intérêt Intérêt Intérêt
Correspondances phytosociologiques et description Code N2000 Surface Part de l’UCG
régional comm. patrimonial
sommaire
Herbier à Callitriche à crochets et Myriophylle à fleurs Non comptabilisé car présent
alternes IR oui 3260-1 A uniquement dans le lit de la
rivière la Cance
Callitricho hamulatae - Myriophylletum alterniflori
Mégaphorbiaie acide armoricaine
AU oui 6430-1 B 2 ha 98 a 13,72%
Junco acutiflori - Angelicetum sylvestris
Mégaphorbiaie à Scirpe des bois
AU oui 6430-1 B 4a 0,20%
Junco acutiflori - Angelicetum sylvestris
Prairie tourbeuse
IR oui 6410-6 A 70 a 3,24%
Caro verticillati-Juncetum acutiflori
Prairie humide acide
IR oui 6410-6 A 78 a 3,61%
Cirsio dissecti - Scorzoneretum humilis
Moliniaie
IR oui 6410-9 A 46 a 2,12%
Caro verticillati - Molinietum caeruleae
Boulaie à sphaignes
IR oui 91DO*-1.1 A 37 a 1,69%
Sphagno palustris - Betuletum pubescentis
Lande tourbeuse
IP oui 7110*-1 A 37 a 1,69%
Erico tetralicis - Sphagnetum rubelli
Cariçaie à Laîche vésiculeuse
IR non - A 5a 0,21%
Caricetum vesicariae
Cariçaie à Laîche à bec
IR oui 7140-1 Ap.17
___________________________________________________________________________
A.3.2 La flore
A.3.2.1 Etat des inventaires
Tableau V : Nombre de taxons recensés
Nombre de taxons recensés Niveau de connaissance
Bryophytes 3 Nul
Lichens 0 Nul
Champignons 0 Nul
Plantes vasculaires 126 Bon
La liste des espèces recensées dans l’unité cohérente de gestion est présentée en Annexe 7. Seules
les plantes vasculaires sont bien connues. La connaissance des autres groupes est quasi nulle. A noter
que trois espèces de Sphagnum sp. collectées en 2011 ont été déterminées par J.LAGRANDIE.
A.3.2.2 Evaluation de la valeur patrimoniale des espèces
Méthodologie
La valeur patrimoniale des plantes vasculaires est basée sur :
- Les cotations de rareté révisées en 2010 par le Conservatoire Botanique National de Brest
(BOUSQUET et al., 2010) ; ont été retenues les espèces au minimum rares en Basse-Normandie,
- Les statuts de menace (ZAMBETTAKIS et al., 2009),
- Les statuts de protection régionale (d’après l’arrêté Arrêté du 27 avril 1995 relatif à la liste
des espèces végétales protégées en région Basse-Normandie complétant la liste nationale).
Elle est évaluée selon les trois classes suivantes :
- Valeur patrimoniale forte (classe A) : espèces très rares et/ou menacées en Basse-Normandie
- Valeur patrimoniale moyenne (classe B) : espèces rares
- Valeur patrimoniale faible (classe C) : autres statuts
Résultats
L’unité cohérente de gestion comprend 8 espèces de valeur patrimoniale forte à moyenne. Deux sont
protégées et figurent dans la liste des espèces rares et menacées de Basse-Normandie. Elles sont
présentées dans le tableau VI qui précise par ailleurs leur répartition bas-normande et leur
localisation dans l’UCG. Elles sont illustrées à l’annexe 8.
Sept d’entre elles sont associées aux habitats tourbeux patrimoniaux recensés. En revanche, la Prêle
des bois (Equisetum sylvaticum) montre une écologie plus « plastique ». Les habitats des trois
stations recensées sur le site de la Rastière sont différents les uns des autres : talus pentus, ourlet
prairial à Houlque laineuse et mégaphorbiaie. D’autre part, les stations sont toutes en lisière de talus
et de haies, ces dernières semblant jouer un rôle indéniable vis-à-vis de l’espèce.
Prairies et landes de Saint-Clément – Plan de gestion 2015-2020
Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandiep.18
___________________________________________________________________________
Tableau VI : Espèces végétales d’intérêt patrimonial recensées
dans l’unité cohérente de gestion « Prairies et landes de St-Clément »
(Protection = PR : Protection Régionale ; Rareté en Basse-Normandie = TR : très rare, R : rare ; Menace en
Basse-Normandie= AS : A surveiller, M : Menacée). La répartition s’appuie sur l’analyse des cartes du site
ecalluna (http://www.cbnbrest.fr/ecalluna/, consultation le 16 septembre 2015).
Rareté Intérêt
Menace Protection Répartition en Basse-Normandie Etat des populations dans l’UCG
Nom latin du taxon régionale pat.
3 stations recensées à la Rastière : l'une en
A toujours été rare et localisée. Se faible effectif (10-20 pieds), l'autre
rencontrent dans les secteurs les plus abondante (plusieurs centaines de pieds)
Equisetum sylvaticum TR AS PR A
arrosés de la région: collines de sur la bordure Sud de la parcelle ZS26, une
Normandie, Cotentin troisième station de quelques pieds en
bordure de fossé
A toujours été rare mais s'est encore
raréfié; localisée actuellement au seul
Scirpus cespitosus Massif armoricain. A présent, 4-5 touffes observées dans la Lande
TR AS PR A
subsp. germanicus l'espèce est plutôt menacée par brûlée.
l'assèchement ou le développement
spontané des végétations arbustives.
Présent dans les 3 départements 2 stations découvertes en 2012, à faibles
mais toujours localisé. Connu des effectifs (1 à 10 pieds), dans des anciens
Carex curta R B
landes de Lessay, du Perche, de la fossés atterris et tourbeux du site de la
Lande Pourrie et du Virois Rastière.
5 stations régulièrement réparties dans le
Présent dans les 3 départements
Epilobium palustre R site de la Rastière, dans les secteurs B
mais confiné au massif armoricain
tourbeux
2 stations recensées (une de 30 pieds
Présente dans les 3 départements, environ (20 hampes fleuries en 2012) dans
Eriophorum
R plus "courante" mais localisée dans la prairie tourbeuse à l'Est du site de la B
angustifolium
l'Orne et la Manche Rastière, l'autre recensée (une dizaine de
pieds) dans le site de Champ Chevrel.
Présent principalement sur les reliefs: Quelques pieds présents en bordure de la
Juncus squarrosus R Mortainais, massif d'Andaine et lande tourbeuse dans le site de Champ B
d'Ecouve, Jurques; Très rare ailleurs Chevrel.
Découverte en 2014 à l'occasion des
Présente dans la partie armoricaine,
24Heures de la biodiversité, dans l'une des
Sibthorpia europaea R avec une plus forte occurrence dans B
prairies pâturées, en rive gauche
le Nord-Cotentin et le Mortainais.
(T.Bousquet com. pers.)
Espèce cantonnée aux reliefs arrosés Espèce régulièrement disséminée dans les
du Sud-Manche et de l'Ouest de secteurs tourbeux du site de la Rastière (11
Viola palustris R B
l'Orne: lande pourrie, marges des stations à faibles effectifs recensées en
forêts d'Andaine et d'Ecouves 2011 et 2012).
Prairies et landes de Saint-Clément – Plan de gestion 2015-2020
Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandiep.19
___________________________________________________________________________
A.3.3 La faune
A.3.3.1 Etat des inventaires
Tableau VII : Nombre de taxons faunistiques recensés
Nombre de taxons
Groupe faunistique Niveau de connaissance
recensés
Oiseaux 49 dont 21 NC ou NP Bon
Mammifères 7 Moyen
Reptiles 3 Moyen
Amphibiens 0 Nul
Poissons 4 Faible
Crustacés 1 Faible
Odonates 8 Bon
Hémiptères 5 Faible
Orthoptères 10 Moyen
Lépidoptères hétérocères 7 Faible
Lépidoptères rhopalocères 24 Bon
Mollusques 1 Faible
Coléoptères 32 Faible
Arachnides 12 Faible
Isopodes 0 Nul
Myriapodes 0 Nul
Total 164 Faible
La faune recensée dans l’unité cohérente de gestion s’élève actuellement à 164 taxons. La faune peut
ainsi être considérée comme assez mal connue.
La liste des espèces recensées est présentée en Annexe 9. Quelques espèces sont illustrées à
l’annexe 10.
Oiseaux
49 espèces ont été contactées dans l’UCG lors des inventaires de 2011 et 2012. Les prospections ont
été menées pendant la période de nidification. Les espèces hivernantes n’ont ainsi pas fait l’objet de
prospections spécifiques. Pour autant, celles observées durant cette période de manière aléatoire
ont été notées (4 espèces).
Le protocole utilisé s’inspire de la méthode des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA) (BLONDEL et
Al, 1970). Plusieurs écoutes matinales de 20 minutes ont été réalisées en différents points des sites
au cours de trois passages durant la période de nidification. Ces passages ont permis de renseigner
l’indice de nidification (Nidification certaine (NC), Nidification probable (NP), Nidification possible
(Npo)).
Sur les 49 espèces inventoriées, 36 sont nicheuses (15 nicheuses possibles, 9 nicheuses probables et
12 nicheuses certaines). Neuf espèces exploitent les sites comme zone d’alimentation ou de chasse
(biotope de nidification absent des sites mais présent à proximité). Cette liste renseignée des indices
de nidification figure à l’annexe 10.
Prairies et landes de Saint-Clément – Plan de gestion 2015-2020
Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandiep.20
___________________________________________________________________________
Les espèces du cortège des zones humides méritent une attention particulière. Il s’agit du Bruant des
roseaux, de la Locustelle tachetée et de la Cisticole des joncs. Les deux premières nichent tous les ans
sur le site de la Rastière(depuis au moins 2011). La Cisticole des joncs n’a niché en revanche qu’en
2011. Il est probable que cette espèce sédentaire, sensible à la rigueur des hivers (DUBOIS et al.,
2008), ne s’est pas maintenue sur ce site suite à la vague de froid particulièrement marquée au cours
de l’hiver 2011-2012.
En termes de potentialités, le Courlis cendré (Numenius arquata) pourrait nicher sur le site de la
Rastière : l’espèce est citée comme nicheuse dans la ZNIEFF de type 2 (données collectées dans les
années 80-90). Un mâle chanteur a été contacté au printemps 2011 dans les prairies humides en
bord de Cance à environ 1 kilomètre en amont du site (GIRARD C., comm. pers.). Un couple a été
observé dans le même secteur lors des 24 heures de la biodiversité organisés en 2014 sur la
commune de Saint-Clément-Rancoudray. Une gestion adéquate des prairies du site pourrait peut-
être favoriser son retour.
Mammifères
Aucune méthodologie particulière n’a été appliquée pour ce groupe. 7 espèces ont été contactées de
façon aléatoire, parmi lesquelles le Chevreuil, le Lièvre d’Europe, le Renard roux. Le Ragondin est
également bien présent tout au long de la Cance.
On notera l’observation le 1er juin 2011 d’une Hermine prospectant le linéaire de berges de la Cance
et les galeries de rongeurs en milieu de journée. Bien qu’elle ait été retirée de la liste des espèces
classées « nuisibles » depuis l’arrêté ministériel de 1988, l’Hermine est chassable en France.
De nombreux facteurs (disponibilités des proies, caractéristiques de l’habitat, conditions
climatiques…) influent sur l’ampleur des déplacements et la taille des domaines vitaux (DELATTRE,
1987). Néanmoins, les quelques études réalisées mentionnent des domaines vitaux pour un mâle de
8-16 ha (Suisse, DEBROT, 1983) et de 25 ha (Ecosse, LOCKIE, 1966). Il est donc possible que le site de la
Rastière constitue pour totalité (ou du moins pour une grande part) le territoire vital d’un individu.
Reptiles
La Couleuvre à collier (Natrix natrix) et le Lézard vivipare (Zootoca vivipara) sont des espèces très
communes en Basse-Normandie, par ailleurs bien représentées dans l’unité cohérente de gestion
(3 individus de Couleuvre à collier observés sur le site de la Rastière de façon « aléatoire » le même
jour).
La Vipère péliade (Vipera berus) n’a été observée que dans le site de Champ Chevrel où deux
individus ont été vus en août 2015.
Amphibiens
Aucune espèce d’amphibien n’a été recensée dans les sites. L’absence de mares semble être une
explication à la pauvreté spécifique de ce groupe biologique.
Poissons et Crustacés
Les données sont issues d’une pêche électrique réalisée le 27 juin 2008 en aval du pont de la D357, à
l’extrémité Ouest du site de la Rastière, par la FDAPPMA de la Manche.
4 espèces de poissons ont été observées. Il s’agit pour la plupart d’espèces rhéophiles, bien adaptées
aux courants marqués de la Cance. Le substrat argilo-limoneux de la Cance limite en revanche les
potentialités de frayères pour des espèces telles que le Chabot ou la Lamproie de Planer, présents
dans certains affluents de la Cance, tel que le ruisseau du Gué aux Loups dont la confluence avec la
Cance se situe à une centaine de mètres en aval de ce site.
La Truite fario est présente mais les effectifs capturés (4 individus) sont modestes (au regard des
autres pêches électriques réalisées dans le bassin (plus de 60 individus pour certaines pêches)). Les
Prairies et landes de Saint-Clément – Plan de gestion 2015-2020
Conservatoire d’espaces naturels de Basse-NormandieVous pouvez aussi lire