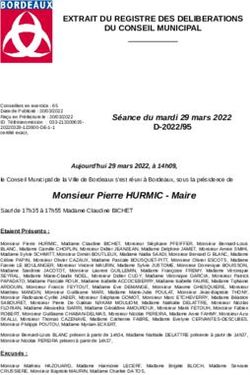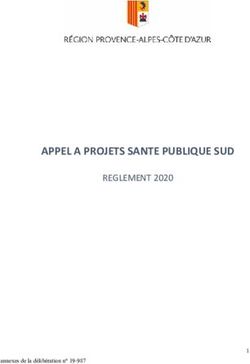GUIDE PRATIQUE DU PRÉSIDENT DE CME FEHAP DU PRÉSIDENT DE CME FEHAP
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
SOMM
PAGE PAGE PAGE
4 08 11
CONTEXTE MISSIONS RÔLE DU PCME
RÉGLEMENTAIRE DE LA CME
DE LA CME
Guide réalisé avec l’aide de :
Dr Laurence Luquel Dr Laurent Thomas
Dr Florence Trivin Dr Amélie Lansiaux
Dr Cécile Mauri Nathalie De Almeidera
Dr Vincent Bénard Dr Anne Lecoq
2MAIRE
PAGE PAGE PAGE
14 20 34
LE RÉGLEMENT PLACE DE LA QUESTIONS
INTÉRIEUR CME DANS SON FRÉQUEMMENT
ENVIRONNEMENT POSÉES
p.39 : Annexes
3Mais des modalités
de composition de la CME
différentes
Des missions communes
quel que soit le statut de
l’établissement… Tous les praticiens exerçant dans un établissement de
santé privé forment de plein droit une conférence médicale
La conférence médicale d’établissement est née en d’établissement (article L6161-2 CSP).
1991, afin de reconnaître le collectif médical des établis- Les praticiens exerçant dans un établissement de santé
sements publics et privés autour des trois missions qui public ou privé à but non lucratif forment une commission
leur ont été confiées : médicale d’établissement dont les membres sont élus.
Veiller à l’indépendance profes- Dans un premier temps, le terme de « commission » avait
sionnelle des médecins ; été réservé en 2009 aux seuls établissements publics de
Donner un avis sur les prévisions d’ati- santé par la Loi HPST, mais depuis la Loi de Modernisation
vité des établissements ; du Système de Santé de 2016 (LMSS) le régime électif
Participer à l’évaluation des soins. des commissions médicales d’établissement s’applique
également aux établissements de santé privés à but non
lucratif (article 1952 ).
¹ La loi HPST de 2009 rétablit également l’identité privée non lucrative dans le code de la Santé publique et permet à des établissements à but
non lucratif, de s’identifier comme ESPIC (Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif) auprès de leur ARS (décret du 20 mai 2010).
² L’article 195 de la LMSS, en rétablissant le régime électif de la CME dans les établissements privés à but non
lucratif, est en cohérence avec l’existence de communautés médicales salariées parfois très importantes, sans pour
autant être une forte contrainte organisationnelle pour des équipes médicales de plus petite taille.
6D’où l’importance Dans les suites de l’article L6161-2-11 du code de san-
du Règlement Intérieur (RI) té publique (CSP), le décret en Conseil d’Etat qui devait
définir les matières sur lesquelles la CME est consultée
ainsi que ses modalités de fonctionnement ne sont ja-
mais parus³.
Le Décret n° 2010-1325 du 5 novembre 2010 (préalables
à la LMSS) qui définit les missions de la conférence mé-
dicale d’établissement s’appliquant à tous les établis-
sements privés sans distinction est caduc même si non
officiellement abrogé.
Et un hiatus juridique
pour les établissements
privés non lucratifs
Le règlement intérieur de la CME est donc fondamental.
Signé par le président de CME (PCME) et le directeur, il
permet d’adapter les modalités de mise en œuvre de la
CME à la taille et aux spécificités de l’établissement, en
particulier et le cas échéant le lien avec le directeur médical.
Les présidents de CME des établissements privés à but
non lucratif, FEHAP, Unicancer, UGECAM, Croix-Rouge
constituent la « conférence nationale des PCME du privé
non lucratif ».
³ En 2018, la FEHAP s’est opposée en effet à la parution d’un projet du
dit-décret au motif qu’il n’était pas adapté à l’hétérogénéité de tailles
et de fonctionnement de ses établissements adhérents. De plus la
stratégie de transformation du système de santé « Ma Santé 2022 »,
annonçait des modifications dans les CME des établissements publics.
702
En référence aux articles 6161-2-1 et 6161-2-2
du CSP et au décret du 5 novembre 2010 (annexe 1)
La CME est :
CONSULTÉE SUR :
La Politique médicale de l’établissement
dont Projet Médical (PM) et Contrat Plurian-
MISSIONS
DE LA CME
nuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM)
L’avenant concernant la mission de service public
Le Règlement Intérieur de l’établissement
Les prévisions annuelles d’activité
- La CME doit faire des propositions, surtout sur
le projet médical et donne son avis (vote)
INFORMÉE SUR :
Les bilans d’analyse des Événements Indésirables (EI)
La programmation de travaux, l’aménagement
de locaux, l’acquisition d’équipements ayant un
impact sur la qualité et la sécurité des soins
- La CME doit demander à la direction
d’avoir une information au moins annuelle
sur ces sujets (pas d’avis ni de vote)
QUELQUES DÉFINITIONS
ET SIGNIFICATIONS
La CME est « consultée » ou « donne un avis » :
c’est son rôle de faire des propositions en particu-
lier sur le projet médical pour lequel le rôle de la
CME est très important) et elle émet un avis (éven-
tuellement un vote).
La CME « contribue à » : la CME doit avoir une par-
ticipation active et être force de propositions.
La CME « propose » : c’est du domaine du rôle
propre de la CME = production d’un écrit
La CME est « informée » : elle doit deman-
der à la direction d’avoir une information au
moins annuelle sur les sujets cités, à mettre
à l’ordre du jour ; pas d’avis ni de vote néces-
sairesproposition auprès de la direction
8CONTRIBUE À L’ÉLABORATION
DE LA POLITIQUE D’AMÉLIORA-
TION DE LA QUALITÉ ET DE LA
SÉCURITÉ DES SOINS :
Gestion des risques associés aux soins CONTRIBUE À L’ÉLABORATION
Dispositifs de vigilance / sécurité sanitaire
Politique du médicament et des dis- DES PROJETS RELATIFS À
positifs médicaux (DM)
Prise en charge de la douleur
L’ACCUEIL ET LA PRISE EN
Plan de développement professionnel du CHARGE DES USAGERS, DONT :
personnel médical de l’établissement
- La CME doit être active et être force de Éthique
proposition auprès de la direction Évaluation de la prise en charge
des patients, des urgences
Évaluation de la mise en œuvre de
la politique de santé publique
Fonctionnement de la permanence des soins
Organisation des parcours de soins
- La CME s’inscrit dans une dé-
marche co-constructive
PROPOSE UN PROGRAMME
D’ACTIONS AVEC INDICATEURS
DE SUIVI, PRENANT EN
COMPTE :
Les bilans d’analyse des événe-
ments indésirables (EI),
Les résultats du rapport de certification,
Les objectifs du CPOM / quali-
té et sécurité des soins
La CME valide le programme d’action
Le rapport de la commission des re-
lations avec les usagers
ÉLABORE UN RAPPORT
ANNUEL D’ACTIVITÉ
Production en propre de la CME
903
RÔLE DU PCME
Quel est le rôle spécifique
du Président de CME ?
11Il n’existe pas de texte précisant son rôle.
Animation
1 Le PCME a un rôle d’animation de la CME.
Représentativité
2 Le PCME a un rôle de représentativité des
praticiens de son établissement vis-à-vis des
tutelles (ARS, Conseil Départemental) ; sur le
territoire (lien avec le GHT, les instances de
démocratie sanitaire, les CPTS…).
pour la FEHAP
3 Le PCME peut être désigné pour avoir
un rôle de représentativité de la FEHAP
au sein de sa région (instances de
démocratie sanitaire, cellules d’allocation
des ressources …) ou au niveau national
(HAS...)
12De façon
pragmatique
Le PCME :
Est à l’interface entre les praticiens et la direction. Il a un lien direct
avec le directeur général et avec le directeur médical le cas échéant ;
Doit veiller au bon fonctionnement de la CME ;
Organise les délégations afin de partager la charge de
travail en particulier avec le Vice-président (VP) ;
Permet également au VP de se préparer à la fonction de
PCME en cas d’intérim ou pour la prise de relais ;
À un rôle particulier dans le bon fonctionnement
médical, dans la prévention de conflits.
ATTENTION :
La fonction peut entraîner des situations conflictuelles
ou difficiles implicites.
Soit avec ses confrères du fait d’une présupposée
trop grande proximité avec la direction ;
Soit avec la direction pour une défense des
intérêts médicaux jugée trop « syndicale ».
QUELQUES
CONSEILS
Anticiper le conflit : en ayant connaissance des enjeux
et sources de tension, cela permet de les détecter
plus tôt.
Savoir-être : être dans l’écoute bienveillante, reformu-
ler
Savoir déléguer et s’appuyer sur une équipe plutôt
que rester seul et maîtriser l’information
Savoir se référer à la réglementation pour redéfinir si
besoin le périmètre des missions, et l’acter de façon
partagée.
Et SURTOUT avoir un bon RÈGLEMENT INTÉRIEUR !
1304
Le réglement
intérieur
1415
Le règlement intérieur est adapté à la taille
de l’établissement et doit préciser les points
suivants :
Les modalités
d'organisation
de la CME
4.1
Lister les membres de la CME et dire à quel titre
ils interviennent :
Voix délibérative ou consultative (votant ou non votant) ;
Rappeler les missions de la CME ;
Décrire le fonctionnement de la CME,
La constution d’un bureau le cas échéant ;
CONSEIL : Le mode de désignation du PCME :
par élection ? ou contrat ? ;
Préciser les missions du PCME et de la CME
Le RI peut prévoir une (représentativité auprès des tutelles) ;
charte d’engagement du Les liens de la CME ou du PCME avec la direction générale,
président de CME. le directeur médical, le conseil d’administration, le CSE.
Se poser la question Les liens entre la CME et les travaux des com-
d’associer un membre missions et sous commissions qui sont régle-
patient partenaire/expert. mentaires ou instances opérationnelles.
164.2
Élections des membres de la CME et
désignation du président de la CME
(PCME)
Les modalités d’élection des membres de la CME : convocation par la direction, jour du scrutin ;
La durée du mandat et le nombre de renouvellement ;
Les modalités de désignation du bureau de la CME et du PCME :
- Si élections : vote à bulletin secret ou main levée ? ou « main le-
vée ou bulletin secret si l’un des membres en fait la demande »,
- Si désignation : modalités de validation par les membres de la CME
- Précise les motifs et les modalités de désignation du pré-
sident de CME par intérim : départ, démission ou autre
174.3
Calendrier annuel
de la CME
Il est conseillé de bâtir un plan annuel au-
tour du bilan d’activité de la CME de l’année
N-1 et des échéances de l’établissement
(rapport annuel de la CDU, EPRD, etc.
Cela permet de déterminer :
- Le nombre de réunions du bureau
- Le nombre de réunions de CME
- L’ordre de passage des commissions
Un nombre minimal des réu-
nions est indiqué dans le RI.
CONSEIL :
La régularité est préférable.
Choisir le même jour de la
semaine et le même horaire.
C’est un repère pour les
participants.
Le calendrier prévisionnel
semestriel ou annuel est
également préférable.
18Organisation pratique de la CME
4.4
Préparation
et élaboration
de l’ordre du jour
À discuter en bureau de la CME
et/ou en lien avec la direction ;
Faire le tour des médecins, phar-
maciens, DIM… pour demander les
sujets à mettre à l’ordre du jour ;
Préciser la liste des invités.
S'appuyer sur un ordre du jour type
ou renouveler à chaque séance ;
Définir si besoin et selon les su- Le déroulement
jets à l’ordre du jour, des temps
différents entre CME plénière et
CME restreinte aux praticiens ;
de la CME
Les modalités de convocation
(par qui, combien de temps à Horaires (prévoir plutôt fin de journée
l’avance et comment, mail ? ). si association de salariés et libéraux) :
prévoir annuellement : Durée de la CME (il est utile
- le retour des Commissions d’indiquer l’heure de dé-
et sous-commissions ;
- information sur les divers bilans :
but et l’heure de fin)
Rythme (mensuel ? Trimes-
La rédaction
bilan d’activité, (liste à citer). triel, quadrimestriel ?)
Déroulement : différen- et l’envoi des
cier, le cas échéant :
- Partie strictement médicale comptes rendus
- CME plénière (avec direction admi-
CONSEIL :
Conseils
nistrative, direction des soins, qua-
liticiens, autres invités éventuels.
Compte rendu type
Délai d’envoi
Prévoir une convocation type, - Sujets faisant l’ob- Modalité de rédaction
Prévoir une convocation
et un mailing des membres ; jet d’une invitation
type, et un mailing
Ildes
estmembres
utile de créer
; une
adresse générique du PCME.
Il est utile de créer
une adresse générique
du PCME.
1905
PLACE DE LA CME DANS
SON ENVIRONNEMENT
205.1
La CME tient compte des
politiques de santé
Nouvelle certification des établissements
de santé pour la qualité des soins
Développement des parcours complexes
en lien avec les établissements et service
médico-sociaux et la médecine de ville
Développement du numérique
Questionnements éthiques
Gestion de crise
21CLIN
Comité de lutte
contre les infections
nosocomiales
5.2
L’environnement
institutionnel
(interne et externe)
Le CLIN est chargé d’élaborer et de
conduire un programme d’action visant
à prévenir les infections nosocomiales
et réduire leur fréquence.
Missions
Les commissions Prévenir les infections en validant
et en vérifiant la bonne obser-
vance des protocoles de soins
et sous-commissions Surveiller les infections à l’aide
d’enquêtes régulières
internes à l’établissement Élaborer et diffuser des recomman-
dations de bonne pratique d’hygiène
Améliorer la formation des person-
nels de santé en hygiène hospitalière
Mettre en place des actions de sur-
veillance des infections nosocomiales
Renforcer le dispositif de lutte
contre les infections nosocomiales
Évaluer les actions menées
22CLUD
Comité de lutte
contre la douleur
Selon les articles de la loi n° 95-116 du 4 février 1995, les
établissements de santé sont tenus de prendre en charge
la douleur des patients qu’ils accueillent. Ces moyens
COMEDIMS
doivent être définis par le projet d’établissement visé à
l’article L.714-11.
Commission du médicament
Les responsabilités du CLUD sont de proposer, pour amé- et des dispositifs médicaux
liorer la prise en charge de la douleur, les orientations les
mieux adaptées à la situation locale devant figurer dans stériles
le projet d’établissement, et de coordonner au niveau de
l’ensemble des services de l’établissement toute action
visant à mieux organiser la prise en charge de la douleur.
Conformément aux articles R5126-48 et suivants du code
de la Santé Publique, la commission du médicament et
des dispositifs médicaux stériles participe, par ses avis, à
l’élaboration :
CLAN De la liste des médicaments et dispositifs médicaux stériles
dont l’utilisation est préconisée dans l’établissement ;
Des recommandations en matière de prescription et de
Comité de liaison alimentation bon usage des médicaments et des dispositifs médicaux
stériles et de lutte contre l’iatrogénie médicamenteuse.
et nutrition Le COMEDIMS peut être organisé en sous-commission :
Conformément à la circulaire DHOS/E1/n°2002/186 du 29
mars 2002, le CLAN est une structure consultative partici- La commission locale du livret thérapeutique
pant, par ses avis ou propositions, à l’amélioration de la La commission locale des antibiotiques
prise en charge nutritionnelle des malades et de la qualité La commission locale des gaz médi-
de la prestation en restauration. caux et sécurité anesthésique
Ce comité est composé de différentes catégories de pro- La commission locale du circuit du médica-
fessionnels concernés par le plateau du patient (du per- ment et des dispositifs médicaux stériles
sonnel de restauration au médecin, en passant par le per- Il se réunit au moins 3 fois par an et élabore un rapport annuel
sonnel paramédical). d’activité qui est transmis à la CME.
23CSTH
Comité de sécurité
transfusionnel
et d’hémovigilance
Le comité de sécurité transfusionnel et d’hémovigilance
a pour mission de contribuer, par ses études et ses
propositions, à l’amélioration de la sécurité des patients
qui sont transfusés dans l’établissement.
Il veille à la mise en œuvre de règles et procédures
d’hémovigilance.
Il est chargé de la coordination des actions
d’hémovigilance entreprises au sein de l’établissement.
Il s’assure auprès des services responsables de la
présence dans le dossier médical, mentionnée des
documents relatifs aux actes transfusionnels, et le cas
échéant de la copie de la fiche d’incident transfusionnel.
Il est saisi de toute question relative à la collaboration
des correspondants d’hémovigilance de l’établissement
de transfusion sanguine et de l’établissement, et plus
généralement de toute question portant sur les circuits
de transmission des informations, en vue d’améliorer
l’efficacité de l’hémovigilance. Il est averti des incidents
transfusionnels inattendus ou indésirables et conçoit
toute mesure destinée à y remédier.
COVIRIS
Comité des vigilances
et de gestion des risques
Conformément à la circulaire 2004-176 du 29 mars 2004, le
COVIRIS développe un programme de gestion globale des
risques et coordonne les différentes vigilances sanitaires
réglementaires instaurées dans l’établissement.
Cette organisation s’articule pour la gestion des risques
au travers d’une cellule de vigilance et pour les vigilances
sanitaires au travers de l’organisation mise en place par les
correspondants locaux des différentes vigilances sanitaires
encadrées :
Matériau vigilance ;
Hémovigilance et sécurité transfusionnelle ;
Pharmacovigilance ;
Biovigilance ;
Réactovigilance ;
Infectiovigilance.
24CREX
Comité de retour d’expé-
rience
Il est composé d’un groupe pluriprofessionnel.
Il a pour mission de réduire les risques et d’augmenter
la sécurité des soins, en prévenant, analysant et trai-
tant les risques éventuels ou survenus lors de la prise
en charge du patient, parmi eux :
Les infections associées aux soins ;
Les douleurs non soulagées ;
Les erreurs médicamenteuses ;
Les risques de chute ;
Un problème d’organisation ou
de coordination des soins ;
Le risque cutané ;
La maltraitance…
Chaque risque est anticipé et analysé pour assurer le
maximum de sécurité.
COPS
Commission d’organisation
de la permanence des soins
La COPS est une émanation de la CME qui veille à l’amé-
lioration de l’organisation des gardes et astreintes :
Met en place un point semestriel des
conditions de leur mise en œuvre ( au
moins une fois par semestre) ;
Intègre un représentant des internes pour or-
ganiser les lignes de gardes et astreintes des
internes et leur sécurisation par les séniors ;
Prend en compte le respect du repos de sécurité.
25LA CERTIFICATION
des établissements de santé pour la qualité des soins
Les 3 ambitions affichées par la HAS pour le développement de
la nouvelle certification, repositionnent le rôle de la CME :
Médicaliser la certification et mieux prendre en compte le
résultat de la prise en charge du patient, en termes d’efficacité, de
sécurité ou encore de satisfaction ;
Simplifier la démarche de certification pour faciliter
l’appropriation par les équipes de soins (5 méthodes d’évaluation) ;
Valoriser l’insertion territoriale de l’établissement et la
construction de parcours de soins ;
La CME copilote avec la direction l’élaboration, la mise en œuvre et
l’évaluation de la politique continue de la qualité et de la sécurité
des soins (critère 3.3-01).
26La détermination d’objectifs partagés d’amélioration
est portée par la CME à partir de l’analyse des
données principales que sont :
Les EPP et revues de pertinence définies en CME ;
Les résultats des IQSS ;
Les événements indésirables ;
La satisfaction et l’expérience des patients.
La CME développe la dynamique d’amélioration
continue de la qualité des soins en mobilisant
l’ensemble des équipes sur l’identification et la diffusion
des recommandations de bonnes pratiques cliniques
et organisationnelles au sein de l’établissement et sur
la réalisation de revues de pertinence des pratiques
(critère 3.7-01).
CONSEIL
La CME est un levier pour la mise en œuvre de la
nouvelle certification qui doit être un point abordé
très régulièrement.
27PRS
Projet régional de santé
Le projet régional de santé est un élément clé de la
transformation du système de santé régionale au service de la
santé de nos concitoyens. Le PRS est composé d’un ensemble
de documents qui définit, organise et programme la mise
en œuvre des priorités de santé et porte les évolutions du
système de santé dans notre région.
Il est en quelque sorte la feuille de route de la politique de
santé régionale.
C’est un pilotage stratégique, unifié de la politique de santé
qui permet de décloisonner l’organisation de notre système
de santé régional en intégrant, dans le plan, tous les secteurs
(organisation des soins ambulatoires et hospitaliers, offre
médico-sociale, santé publique, santé environnementale).
Le processus d’élaboration est partagé par une large
concertation avec l’ensemble des acteurs de la santé.
Ce sont des priorités de santé en région dans les différents
champs hospitaliers, ambulatoires, médico-sociaux et de
prévention au plus près des besoins de la population.
Démocratie sanitaire
La démocratie sanitaire est une démarche qui vise à associer
l’ensemble des acteurs du système de santé dans l’élaboration
et la mise en œuvre de la politique de santé, dans un esprit de
dialogue et de concertation.
L’ARS est en charge de la mise en place de cette démarche
par :
La participation des citoyens, des usagers et des acteurs
de santé dans les projets ou les débats publics ;
La mise en œuvre d’actions améliorant directement le
respect des droits des patients comme les formations
des représentants des usagers ou le développement
des conseils de vie sociale départementaux ;
L'animation des instances de démocratie en santé mises
en place au niveau régional (la conférence régionale
de la santé et de l’autonomie : CRSA) ou au niveau
L’environnement territorial (les conseils territoriaux de santé : CTS).
CRSA
institutionnel Conférence régionale de la santé et de l’autonomie
externe
Créée par la loi HPST du 21 juillet 2009, la conférence régionale
de la santé et de l’autonomie est un organisme consultatif qui
contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique
régionale de santé. Sa composition et ses missions en font
une instance de démocratie sanitaire incontournable en
région.
28Les avis de la conférence régionale de la santé et de l’auto-
nomie sont rendus publics.
Ils s’appuient sur 8 collèges et 4 commissions spécialisées :
La CSOS : commission Spécialisée pour l’Organisation des
LES MISSIONS Soins ;
de la CRSA
La CDSU : commission des droits des usagers du système
de santé ;
La CSP : commission spécialisée en prévention ;
La CSAMS : commission spécialisée dans la prise en charge
et accompagnement médico-sociaux.
C'est le lieu privilégié de concertation et d’expres-
sion de l’ensemble des acteurs dans le domaine de
la santé, y compris des représentants des usagers.
La CRSA peut faire toute proposition au Directeur
général de l’ARS sur l’élaboration, la mise en œuvre
et l’évaluation de la politique de santé dans la ré-
NOUVEAU EN 2021
gion. Elle rend des avis publics, notamment sur le
projet régional de santé (PRS), le plan stratégique
régional de santé (PSRS) et les projets de schémas Dans le cadre de la réforme des financements des
régionaux ; établissements il est instauré une dotation populationnelle
Le rapport annuel sur le respect des droits des usa- sur certaines activités (Urgences, psychiatrie, SSR), dont
gers ; la répartition par établissements se fait par le directeur
Elle organise des débats publics sur des questions général de l’ARS sur avis du Comité Consultatif d’allocation
de santé de son choix. des ressources (CCAR).
29Les divers contrats entre
établissement et ARS ?
CAQES
01 Le contrat d’amélioration de la qualité de l’efficience des soins
(CAQES) est un contrat qui lie l’ARS, l’organisme local d’assurance
maladie et les établissements de santé.
Il a pour objectif l’amélioration des pratiques en matière de
régulation des prescriptions médicamenteuses, de pertinence et
de sécurité des soins.
Contrat C’est une nouvelle contractualisation tripartite entre les
établissements de santé, l’ARS et l’assurance maladie. Ce nouveau
d’Amélioration contrat entériné dans l’article 81 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 est applicable à tous les établissements
sanitaires à compter du 1er janvier 2018.
de la Qualité Il vise à simplifier les dispositifs actuels de contractualisation avec
les établissements de santé, en regroupant les obligations relatives
de l’Efficience à la qualité et l’efficience incluses dans 4 contrats antérieurs :
Le contrat de bon usage du médicament et
des produits et prestations (CBU) ;
des Soins Le contrat pour l’amélioration de la qualité de l’organisation
des soins sur les prescriptions hospitalières de médicaments ;
Le contrat de pertinence des soins ;
Le contrat d’amélioration des pratiques
en établissement de santé.
30Les enjeux :
Anticipation et visibilité accrue (mise en
œuvre des projets d’établissement) ;
Responsabilisation et plus grande maîtrise des
moyens et des ressources pour les gestionnaires ;
CPOM
Contrôle de l’efficience a posteriori permettant de
recentrer l’action sur le pilotage et l’évaluation ;
Passage d’un régime de tutelle à un régime contractuel.
Les CPOM sont une opportunité pour penser, à moyen terme,
Contrats les objectifs et les moyens de l’établissement et services
issus de la loi du 2 janvier 2002. C’est l’outil privilégié de
déploiement de la politique de santé publique et de dialogue
pluriannuels entre les établissements et l’agence régionale de santé.
Le CPOM poursuit une double finalité :
d’objectifs Arrêter le positionnement de chaque acteur dans la
structuration de l’offre médico-sociale et préciser les
et de moyens synergies attendues avec les autres acteurs du territoire,
en référence aux orientations du projet régional de santé.
Définir les orientations des établissements en
matière de performance afin d’assurer l’amélioration
continue de la qualité de la sécurité de la prise en
charge, et plus largement du service rendu aux
usagers et l’efficience de la dépense publique.
Le contrat pluriannuel d’objectif et de moyen est l’occasion
d’un véritable dialogue entre l’ARS et les organismes
gestionnaires du champ sanitaire et médico-social.
02 315.3
Liens
avec les autres
présidents de CME
Le PCME est susceptible de rencontrer ses homologues qu’il faut
savoir identifier sur son territoire, notamment dans le cadre des
autorisations et du projet médical de territoire.
Les PCME des établissements publics et le président de
la communauté médicale du GHT (PCMG). Les PCME des
établissements privés lucratifs et non lucratifs.
Les médecins coordonnateurs des établissements médico-
sociaux.
Les médecins représentant les CPTS
Le PCME peut également participer au collectif des PCME du PNL.
La conférence des PCME du privé non lucratif : via le secrétariat
de la conférence ou son(sa) président(e).
La commission des PCME FEHAP co-animée par un(e)
président(e) et le conseiller médical de la FEHAP. Cette
commission est représentative des régions et des différentes
spécialités. Elle est force de proposition et à l’appui des
commissions et groupes de travail des directeurs : SSR, Santé
mentale, MCO, HAD, MRC.
32CONSEIL :
Transmettre vos
coordonnées mail au
secrétariat de la conférence
et au conseiller médical
pour être destinataire des
informations.
Vos référents actuels
Secrétariat de la conférence
des PCME PNL :
Nathalie De Almeida
n.dealmeida@ch-bry.org
Présidente de la conférence des
PCME PNL et de la commission
des PCME FEHAP
Laurence Luquel
laurence.luquel@hpgm.fr
Conseillère médicale FEHAP :
Anne Lecoq
annelecoq@fehap.fr
3306
QUESTIONS
FRÉQUEMMENT
POSÉES
3435
1
Une élection du
Présiden
commission méd
d’établissement
président de CME est-
elle obligatoire ?
Oui depuis la LMSS 2016
Faut-il
inviter d’autres
4
professionnels
de l’établissement
à la CME ?
Il est utile pour un fonctionnement op-
timal et pour la qualité des relations
professionnelles de convier en fonction
de l’ordre du jour : le directeur des soins
infirmiers, le responsable qualité, le di-
recteur financier, ou autres professions
2 Quand il y a
3
un directeur médical,
Faut-il inviter le doit-il être le
directeur/la direction président de CME ?
à la CME ? La loi indique simplement que les
membres de la CME sont élus et ne
précise pas les modalités d’élection
Il est utile de prévoir 2 temps, un temps
de son président.
médical et un temps avec la direction :
ne pas oublier que les médecins et la Il est important de s’accorder sur ce
direction d’un établissement doivent point avec le directeur et de le noti-
avoir pour objectif que l’établissement fier dans le RI afin d’éviter un conflit.
fonctionne au mieux (qualité des soins, En tout état de cause il faut préciser
attractivité), et qu’un temps d’échange dans le RI les rôles de chacun : rôle
régulier sera profitable à tous. du PCME, rôle du directeur médical,
et fonctionnement du binôme di-
recteur-président de CME.
36nt
dicale
6
Y a-t-il des sujets à
éviter en réunion
de CME ?
Les sujets sensibles ne doivent pas être
8
évoqués en questions diverses mais
être discutés en amont en commission
restreinte ou en comité ad hoc.
Les éventuels différents entre profes-
sionnels n’ont pas lieu d’être discutés
en CME.
7
La CME
doit-elle s’occuper
du programme
de développement
Faut-il un bureau professionnel continu ?
de la CME ?
La CME propose à la direction des orien-
À voir en fonction de la taille des éta- tations du DPC
9
blissements ; le bureau est composé du
président de CME et de praticiens élus
5
parmi les membres de la CME.
Y a-t-il possibilité d’une
Quel positionnement mise à disposition
la CME doit-elle avoir de temps partiel ou
par rapport d’une rémunération
à la Direction ? spécifique pour le
Une CME bien organisée et représen- président de CME ?
tative des praticiens de l’établissement
permettra un meilleur fonctionnement Cette disposition est prévue pour les
interne et une meilleure interface avec établissements publics, mais ne l’est pas
la direction, au bénéfice de tous. Le bi- actuellement pour les établissements
nôme directeur-président de CME fonc- privés ou privés à but non lucratif. Un
tionnant bien est un gage de qualité de temps de mise à disposition ou une ré-
l’organisation de l’établissement, et de munération spécifique sont à négocier
crédibilité our les interlocuteurs exté- au cas par cas avec le directeur de l’éta-
rieurs (ARS en particulier). blissement.
3710
Faut-il une assurance
particulière pour le
président de CME ?
11
Il est conseillé, si le président de CME
est un libéral d’en avertir sa compagnie
d’assurances et de demander une noti-
Un pharmacien peut-
fication d’accord de l’assurance. il être président
de la CME ?
Y a-t-il de
possibles Oui, l’ Article L6161-2-1 parle de
praticiens « Une commission mé-
situations dicale est élue par les praticiens
qui y exercent ». Les pharma-
d’urgences ou de ciens sont des praticiens, donc
crises à gérer par électeurs et éligibles. Comme il
n’y a pas encore de décret d’ap-
le président plication, le règlement intérieur
peut très bien définir, ou ne pas
de CME ? définir, la qualité du PCME.
La survenue de conflits en par-
13
ticulier, que ce soit entre pra-
ticiens ou entre praticiens et
établissement doit faire l’objet
d’un traitement rapide afin
d’éviter que la situation ne dé-
génère ;
12
entre praticiens, il
peut être utile que le président
de CME en informe la direc-
tion et/ou demande un avis
au Conseil départemental de
l’Ordre ;
entre Etablissement
Des médecins et praticien, il est souhaitable
que la Direction en informe le
peuvent-ils président de CME et que le bi-
être membres nôme Directeur/Président de
CME provoque une rencontre
des instances entre les parties. Il peut être
utile ici encore d’informer le
représentatives Conseil de l’Ordre.
du personnel ? Si un conflit survient
entre CME et Direction, il est
utile de chercher un consensus
Oui, s’ils se présentent aux élections par tous les moyens en gardant
et sont élus (Comité Social et Econo- à l’esprit que les 2 parties ont
mique (CSE), délégués du personnel) un intérêt commun.
38ANNEXE
39Annexe 1
Les textes de loi
Le code de santé publique, revu après la Loi n°2016-
41 du 26 janvier 2016 (article 195-8), précise le rôle
de la Commission médicale d’établissement pour les
établissements privés à but non lucratif :
Article L. 6161-2-1 Les établissements de santé rendent
La commission médicale est élue publics chaque année les résultats des
par les praticiens qui y exercent. Ses indicateurs de qualité et sécurité des
attributions sont prévues au I de soins, dans des conditions définies
l’article L.6161-2-2. Les matières sur par arrêté. Si cette obligation n’est pas
lesquelles elle est consultée ainsi que respectée, le directeur de l’ARS peut
ses modalités de fonctionnement sont prendre des mesures appropriées,
précisées par le décret en Conseil d’État notamment une modulation des
mentionné à l’article L 6161-11. dotations de financement des MIGAC.
Article L. 6161-2-2 Article L 6161-11
La commission est chargée de veiller Sont déterminées par décret en Conseil
à l’indépendance professionnelle des d’État les mesures réglementaires
praticiens et de participer à l’évaluation prévues à l’Art. 6161-1 et les modalités
des soins. Elle donne son avis sur la d’application des autres dispositions de
politique médicale de l’établissement ce chapitre.
et sur l’élaboration des prévisions
annuelles d’activité de l’établissement.
Ces prévisions sont communiquées à NB
l’ARS. Elle contribue à la définition de Cependant, le décret suscité n’est
la politique médicale de l’établissement jamais paru, Les articles en R du
et à l’élaboration de la politique code de santé publique, relevant
d’amélioration continue de la qualité du décret de 2010, qui étaient
et de la sécurité des soins ainsi que applicables avant la promulgation
des conditions d’accueil et de prise de la Loi n’ont pas été abrogés.
en charge des usagers. Elle propose On est dans une période intermé-
au responsable de l’établissement diaire en attendant le décret qui
un programme d’action assorti va décliner la Loi. Les articles sui-
d’indicateurs de suivi prenant en compte vants figurent toujours au code
les informations contenues dans le de Santé publique suite au décret
rapport de la commission des usagers. du 5 novembre 2010.
Elle est consultée sur toute demande de
l’établissement tendant à être habilité
à assurer le service public hospitalier.
La commission est consultée sur les
matières relevant de ses attributions,
dans les conditions fixées par le décret
en Conseil d’État mentionné à l’article
L 6161-11. Lorsqu’une consultation
préalable est prévue, l’avis de la
commission est joint à la demande
(d’autorisation ou d’agrément).
401. Le décret du 5 novembre 2010 non Article R. 6164-4
abrogé mais caduque La conférence médicale d’établissement
contribue à l’élaboration de projets rela-
Article R. 6164-1
tifs aux conditions d’accueil et de prise
La conférence médicale d’établissement en charge des usagers, notamment :
est consultée sur les matières suivantes :
La réflexion sur l’éthique liée à
La politique médicale de l’éta- l’accueil et à la prise en charge médicale
blissement, notamment le pro-
jet médical et les éléments du L’évaluation de la prise en charge des
contrat pluriannuel d’objectifs et patients, et le cas échéant des urgences
de moyens qui s’y rapportent ; et des admissions non programmées ;
Tout contrat ou avenant pré- L’évaluation, le cas échéant, de
voyant l’exercice par l’établis- la mise en œuvre de la politique
sement d’une ou plusieurs de soins palliatifs ;
missions de service public ; Le fonctionnement, le cas échéant, de
Le règlement intérieur la permanence des soins au sens du 1o
de l’établissement ; de l’article L. 6112-1 ;
Les prévisions annuelles d’ac- L’organisation des parcours de soins.
tivité de l’établissement.
Article R. 6164-5
Article R. 6164-2
La conférence médicale
La conférence médicale d’établissement
d’établissement :
est informée sur les matières suivantes :
Propose un programme d’actions qui
Les bilans d’analyse des événements
prend en compte les bilans d’analyse
indésirables, notamment ceux
des événements indésirables
mentionnés à l’article L. 6161-2,
mentionnés à l’article R. 6164-2. Il
survenus dans l’établissement ;
comprend les actions nécessaires
La programmation de travaux, pour répondre aux recommandations
l’aménagement de locaux ou du rapport de certification et
l’acquisition d’équipements sus- mettre en œuvre les objectifs et
ceptibles d’avoir un impact sur la les engagements fixés dans le
qualité et la sécurité des soins. contrat pluriannuel d’objectifs
Article R. 6164-3 et de moyens de l’établissement
en matière de sécurité des soins
La conférence médicale d’établissement et d’amélioration de la qualité. Il
contribue à l’élaboration de la politique prend également en compte les
d’amélioration continue de la qualité et informations contenues dans le
de la sécurité des soins, notamment en rapport annuel de la commission
ce qui concerne : des relations avec les usagers et de
La gestion globale et coordonnée la qualité de la prise en charge. Il
des risques visant à lutter contre les est assorti d’indicateurs de suivi ;
infections associées aux soins et à Élabore un rapport annuel d’activité
prévenir et traiter l’iatrogénie et les présentant notamment l’évolution
autres événements indésirables liés aux des indicateurs de suivi.
activités de l’établissement ; Le représentant légal de
Les dispositifs de vigilance destinés l’établissement tient le programme
à garantir la sécurité sanitaire ; d’actions et le rapport annuel à la
La politique du médicament et disposition du directeur général
des dispositifs médicaux stériles de l’agence régionale de santé.
La prise en charge de la douleur ;
Le plan de développement
professionnel du personnel
médical, maïeutique,
odontologique et pharmaceutique
salarié de l’établissement.
41Préambule : contexte réglementaire
En référence à l’article L6161-2-2
du CSP, les praticiens qui exercent
dans un établissement privé à but
non lucratif (ESPIC) forment de plein
droit une commission médicale
d’établissement désignée par le
sigle « CME », chargée de veiller
à l’indépendance professionnelle
des praticiens et de participer
à l’évaluation des soins.
En l’absence du décret d’application
prévu à l’article L6161-2-2, le
présent RI s’appuie sur le décret
n° 2010-1325 du 5 novembre
2010 s’appliquant à tous les
établissements de santé privés
lucratifs et non lucratifs.
ARTICLE 1, CHAMPS
DE COMPÉTENCE DE LA CME
Article 1.1, la CME est consultée sur
les matières suivantes :
ANNEXE 2
La politique médicale de
l’établissement, notamment le
projet médical et les éléments
du contrat pluriannuel et de
Le règlement
moyens qui s’y rapportent ;
Tout contrat ou avenant prévoyant
l’exercice par l’établissement
d’une ou plusieurs missions
intérieur type,
de service public ;
Le règlement intérieur
de l’établissement ;
Les prévisions annuelles
version sept. 2021
d’activité de l’établissement.
Article 1. 2, la CME est informée sur
les matières suivantes :
Les bilans d’analyse des événements
indésirables, notamment ceux
mentionnés à l’article L. 6161-2 ;
La programmation des travaux,
l’aménagement des locaux ou
l’acquisition d’équipements
susceptibles d’avoir un impact sur
la qualité et la sécurité des soins.
Article 1.3, la CME contribue
à l’élaboration de la politique
d’amélioration continue de la qualité
et de la sécurité des soins, notamment
en ce qui concerne :
La gestion globale et coordonnée
des risques visant à lutter contre les
infections associées aux soins et à
prévenir et traiter la iatrogénie et les
autres événements indésirables liés
aux activités de l’établissement ;
Les dispositifs de vigilances destinés
à garantir la sécurité sanitaire ;
42La politique du médicament et des patient hospitalisé survenu lors de la - L’identitovigilance
dispositifs médicaux stériles ; réalisation d’un acte de prévention, - La pharmacovigilance
La prise en charge de la douleur ; d’une investigation ou d’un - L’infectiovigilance (dans
Le plan de développement traitement) la CME et son président le cadre de l’EOH)
professionnel du personnel médical, sont consultés par le représentant - La politique qualité du médicament
odontologique et pharmaceutique légal de l’établissement pour : et des dispositifs médicaux sté-
salarié de l’établissement. Arrêter les mesures à mettre riles : COMEDIMS et la sous-com-
en œuvre dans le cadre d’un mission des fluides médicaux
Article 1.4, la CME contribue à programme d’actions La prise en charge de la
l’élaboration de projets relatifs aux Désignation d’un coordonnateur de douleur : le CLUD
conditions d’accueil et de prise en la gestion des risques associés aux
charge des usagers, notamment : La prise en charge de la nu-
soins (dont l’organisation des mis- trition : le CLAN
La réflexion éthique liée à l’accueil sions est définie par l’article R 6111-2 L’organisation de la perma-
et à la prise en charge médicale ; du décret du 12 novembre 2010. nence des soins : la COPS
L’évaluation de la prise en
Article 2.2, dans le cadre de ses autres …
charge des patients et le cas
échéant des urgences et des missions, la CME constituera à partir
Article 2.3 La CME propose un
admissions non programmées ; des instances existantes des sous-
programme d’actions et élabore le
L’évaluation de la mise en œuvre commissions (à préciser en fonction
rapport annuel d’activité prenant en
de la politique des soins palliatifs ; de la taille et de la spécificité de
compte :
l’établissement) :
Le fonctionnement de la Le bilan d’analyse des événe-
permanence des soins au sens Le Comité de Lutte contre les
ments indésirables ;
du 1° de l’article L 6112-1 ; Infections Nosocomiales (CLIN).
L’équipe opérationnelle d’hygiène Une réponse aux recommanda-
L’organisation des parcours de soins. tions de la certification ;
(EOH) composée d’un médecin et
Article 1.5, la CME d’un cadre infirmier est désignée La mise en œuvre des objectifs et
par le représentant légal de engagements fixés par le CPOM
Propose : un programme d’actions en matière de sécurité des soins
qui prend en compte les bilans l’établissement après concertation
avec la CME. Elle assiste la CME et d’amélioration de la qualité :
d’analyse des événements
dans la proposition des actions Les informations contenues dans
indésirables mentionnés à l’article
de lutte contre les infections le rapport annuel de la CDU.
R 6164-2. Il comprend les actions
nécessaires pour répondre aux nosocomiales et dans l’élaboration
ARTICLE 3, RÔLES DU PRÉSIDENT, DU
recommandations du rapport de des indicateurs de suivi de la mise
VICE-PRESIDENT, ET DU BUREAU DE
certification et de mettre en œuvre en œuvre de ces mesures. L’EOH
LA CME.
les objectifs et les engagements établit un bilan des activités de lutte
fixés dans le contrat pluriannuel contre les infections nosocomiales Article 3.1, Rôles du Président
d’objectifs et de moyens de selon un modèle défini arrêté du de la CME :
l’établissement en matière de ministre en charge de la santé.
La sous-commission évaluation des De façon pragmatique le PCME est
sécurité des soins et amélioration
pratiques professionnelles (EPP) : l’interface entre praticiens et direction.
de la qualité. Il prend également en Il a un lien direct avec le Directeur
compte les informations contenues - Elle recense les actions d’évaluation
Général et avec le directeur médical le
dans le rapport annuel de la réalisées ou en cours et formule
cas échéant.
commission des usagers (CDU). Il des recommandations en matière
est assorti d’indicateurs de suivi. de choix de thématiques. Le PCME à un rôle de représentativité
- Elle assure l’information en matière de son établissement, vis-à-
Élabore un rapport annuel d’activité
de dispositifs d’EPP à destination vis des tutelles (ARS, Conseil
présentant notamment l’évolution
des équipes médicales et met à Départemental…), sur le territoire
des indicateurs de suivi.
disposition des porteurs de projet de santé sur lequel est implanté
Le représentant légal de
un dispositif d’accompagnement, l’établissement, avec le GHT et
l’établissement tient le programme
de suivi et de formation. son président de la commission
d’actions et le rapport annuel à la
médicale de groupement, les
disposition du Directeur Général - Elle assure la validation individuelle
instances de démocratie sanitaire,
de l’Agence Régionale de Santé. des programmes ou actions d’EPP
les communautés professionnelles
réalisées par les praticiens.
ARTICLE 2, LES MISSIONS DE LA CME territoriales de santé …) cependant,
- Elle élabore un programme annuel lorsqu’une activité spécifique est
Les missions de la CME seront organisées d’actions et établit un bilan annuel. visée, un médecin responsable
comme suit : Les dispositifs de vigilance : afin de concerné peut accompagner
garantir la sécurité sanitaire (coordonnés le directeur en présence ou en
Article 2.1, dans le cadre de la lutte avec la cellule Qualité-Gestion des l’absence du président de CME.
contre les événements indésirables Risques), ils sont représentés par :
associés aux soins (constitue un Le PCME est invité à titre consultatif
événement indésirable associé aux - L’hémovigilance à la demande du Président du
soins tout incident préjudiciable à un - La matériovigilance conseil d’administration, au conseil
43Vous pouvez aussi lire