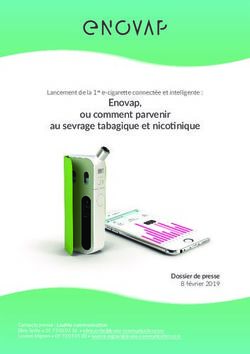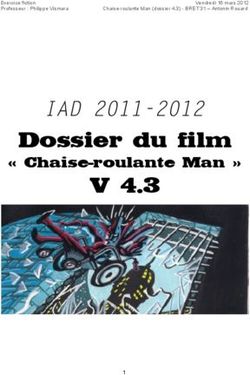Joséphine BAKER 1906-1975
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_423605
Joséphine BAKER 1906-1975
Par Sarah CLAVÉ,
professeure agrégée d’histoire-géographie au lycée l’Empéri (Salon de Provence)
Formatrice académique
« C’est la France qui m’a faite. Je suis prête à lui donner aujourd’hui ma vie. Vous
pouvez disposer de moi comme vous l’entendez. »
Après Sophie Berthelot, Marie Curie, Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle-
Anthonioz et Simone Veil, Joséphine Baker est la sixième femme à faire son entrée
au Panthéon le 30 novembre 2021.
« À travers ce destin, la France distingue une personnalité exceptionnelle, née américaine,
ayant choisi, au nom du combat qu’elle mena toute sa vie pour la liberté et l’émancipation, la
France éternelle des Lumières universelles.
Artiste de music-hall de renommée mondiale, engagée dans la Résistance, inlassable militante
antiraciste, elle fut de tous les combats qui rassemblent les citoyens de bonne volonté, en
France et de par le monde.
Pour toutes ces raisons, parce qu’elle est l’incarnation de l’esprit français, Joséphine Baker,
disparue en 1975, mérite aujourd’hui la reconnaissance de la patrie. »
Communiqué de l’Élysée du 23 août 2021.
1WOLS, La Danseuse noire, Aquarelle sur papier, 1940.
Hans Bellmer, Max Ernst, Ferdinand Springer, Wols au camp des Milles, catalogue de
l’exposition, Paris, Flammarion, 2013, p. 27.
Interné au camp des Milles en mai 1940, à l’âge de 27 ans, Alfred Otto Wolfgang
Schulze, davantage connu sous l’acronyme Wols, violoniste, photographe, artiste
prodigieux et tourmenté, livre cette aquarelle intitulée La Danseuse noire. Ce profil
hirsute, velu, difforme et ricaneur vient rappeler les images du cabaret Die Katakombe
créé au camp et le souvenir de Joséphine Baker, tant Wols a perçu la tuilerie des Milles
comme une grille de lecture, un résumé du monde et de la société.
2Ce souvenir, cette évasion artistique de Wols, peut être une entrée artistique
stimulante pour aborder l’histoire et la mémoire de Joséphine Baker, à l’occasion de
sa panthéonisation, en classe avec nos élèves dans l’académie d’Aix-Marseille.
Quelques éléments de réflexion
Frida Joséphine MacDonald, née le 3 juin 1906 dans le Missouri, est devenue
« Joséphine Baker » par son deuxième mariage avec William Howard Baker et
française par son troisième mariage avec Jean Lion en 1937.
@SarahClavé, Wordart 2021
Joséphine Baker : chanteuse et danseuse, une artiste
Chanteuse, danseuse, actrice et meneuse de revue, Joséphine Baker s’impose
comme une star éblouissante à la fin des années 1920 et au début des années 1930.
Sa carrière est fulgurante. Avec la Revue Nègre au Théâtre des Champs-Élysées à
partir de 1925, elle éblouit le Tout-Paris et la France par son talent et sa liberté.
La notoriété de Joséphine Baker, c’est d’abord à travers son corps qu’elle la conquiert.
Elle s’illustre au milieu de 25 artistes. Vêtue d’un simple pagne de fausses bananes,
elle surgit dans un tableau intitulé « La danse sauvage », agitant son corps sur un
rythme d’une musique totalement inconnue en Europe que l’on nomme bientôt le
charleston. Joséphine Baker attire les regards grâce à son corps dénudé mais aussi
grâce à son extraordinaire énergie et son sens de l’humour.
L’enjeu de la panthéonisation et du travail réflexif qui peut être mené avec des
élèves : Montrer la manière dont Joséphine Baker a su s’extirper de ce corps auquel
elle était assignée et des clichés qui y étaient attachés pour vivre d’autres vies.
3Joséphine Baker : une femme engagée dans la Résistance
Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, Joséphine Baker est au sommet de sa
gloire. Revenue d'une tournée en Amérique du Sud, elle a déjà en projet une revue
avec Maurice Chevalier au Casino de Paris. Pour elle, qui est devenue citoyenne
française par son mariage avec Jean Lion en 1937, il n'est pas question de trahir son
pays d'adoption et de se réfugier aux États-Unis. Elle est très rapidement sollicitée par
un jeune officier au service des renseignements, Jacques Abtey, et accepte
immédiatement. Sa première mission est de fréquenter les réceptions des
ambassades et des consulats où elle est invitée afin de recueillir les renseignements
les plus utiles. Mais elle offre également son temps aux réfugiés hollandais et belges
qui vivent alors leur exode.
L’affiche de la revue du Casino de Paris, intitulée « Paris London », cesse en mai 1940.
Joséphine Baker décide alors de partir pour la Dordogne, où elle loue un château, les
Milandes. Elle veut ensuite rallier Londres, tout comme Jacques Abtey, devenu «
Monsieur Sanders ». Ce dernier apprend que le service de renseignements s'est
réorganisé et se situe désormais à Marseille. Parvenue dans la cité phocéenne,
Joséphine couvre Abtey, nommé désormais « le secrétaire artistique monsieur
Hébert».
En janvier 1941, elle se rend en Afrique du Nord chez des amis membres de la famille
royale du Maroc, sympathisants de de Gaulle, pour briser la mainmise allemande dans
cette zone. Jacques Abtey a ensuite pour ordre de se rendre à Lisbonne afin de
recueillir des renseignements utiles à la France libre. C’est Joséphine qui réussit à
obtenir un visa et prend la place d'Abtey. Les informations que Joséphine doit
communiquer au bureau de renseignements du général de Gaulle à Londres sont
dissimulées à l'encre invisible sur les partitions musicales de ses chansons. Elle en a
épinglé d'autres dans son soutien-gorge. Belle, élégante et populaire, Joséphine Baker
attire le public et passe tous les barrages sans peine. Pendant son voyage, elle ne
rencontre aucun problème majeur lors des passages aux frontières. Mais, de retour
au Maroc, elle tombe malade et son état de santé l'oblige à subir de nombreuses
opérations chirurgicales et à rester à l'hôpital plus de dix-neuf mois. Très vite, des
Américains, tels que les vice-consuls Canfield, Read et Bartlett, lui rendent visite,
auxquels elle fournit les renseignements que Jacques Abtey lui fait parvenir. En avril
1942, Joséphine Baker est toujours hospitalisée mais la chambre de l'artiste continue
d'être un centre de renseignements improvisé.
En novembre 1942, c'est la bataille de Casablanca. Joséphine assiste aux combats
de la fenêtre de sa chambre d'hôpital. Elle se félicite de voir Casablanca libre grâce à
ses frères américains et fonde tous ses espoirs sur le général de Gaulle après sa visite
dans la ville. Elle participe au théâtre des armées alliées, dirigé par le colonel Meyers,
ami du général Eisenhower. C'est ainsi que Joséphine se produit à Casablanca, Oran,
Mostaganem, Beyrouth, Damas, Le Caire. Mais elle ne s'en tient pas à cette tâche :
elle est déterminée à mener la propagande pour le général de Gaulle lors de ses
spectacles. Il est très important, pour elle, que l'influence française soit maintenue au
Moyen-Orient. Jacques Abtey en réfère au chef d'état-major à Alger du général de
Gaulle, le colonel Billotte, qui accepte : une tournée officielle de propagande est
organisée, au bénéfice des groupes de résistance français en métropole, auxquels
seraient versées intégralement les recettes, et sous le patronage de De Gaulle. La
tournée Joséphine Baker est en route. Et dans chaque ville, à chaque gala, le drapeau
à croix de Lorraine se déploie : Sfax, Le Caire, Tripoli en Libye, Benghazi, Tobrouk,
4Alexandrie, Beyrouth. Puis elle traverse les villes de Jérusalem, Tel-Aviv, Haïfa. Enfin
a lieu le retour vers Alger.
Après ses très nombreuses missions en Afrique, Joséphine Baker est officiellement
engagée pour la durée de la guerre à Alger, le 23 mai 1944, dans l'armée de l'Air.
Elle devient alors sous-lieutenant, rédactrice première classe, échelon officier de
propagande. Elle est affectée à l'état-major général de l'Air et précisément à la
direction des formations féminines administrées par le quartier Hélène Boucher. Le 6
juillet 1944, le commandant Bortzmeyer détache le sous-lieutenant Baker à la sixième
sous-section administrative, service des « liaisons secours ». Le 11 juillet, le ministre
de l'Air confirme cette mutation et affecte Joséphine Baker au bataillon de l'air 117.
En octobre 1944, Joséphine Baker est de retour à Paris, pour peu de temps. Elle est
chargée par le général de Lattre de Tassigny de suivre la première armée française
au fur et à mesure de son avancement dans les pays libérés afin de chanter et de
recueillir de nouveaux fonds. Toujours aussi enflammée sitôt le nom du général de
Gaulle prononcé, elle réussit à convaincre tout un orchestre de la suivre. Les galas
ont d'abord lieu à Monte-Carlo, Nice, Cannes, Toulon. Le secours aux sinistrés
qu'elle récolte ainsi approche les deux millions de francs. Les spectacles se
poursuivent à Belfort, le jour même de l'entrée des troupes de De Lattre. Malgré la
neige et le froid, Joséphine et son orchestre se produisent pour les sinistrés. À
Strasbourg qui vient d'être repris, quand elle fait déployer le drapeau à croix de
Lorraine, on vient annoncer qu'un commando vient de passer le Rhin pour la première
fois. À Mulhouse, elle est la première artiste française à revenir sur la scène du
Municipal depuis 1940. Dans le triomphe qu'elle fait, on l'associe à la France, et elle
rayonne d'émotion. Sa dernière étape est Buchenwald où elle chante, assise sur un
lit de typhique, dans la salle des « intransportables ».
L’enjeu de la panthéonisation et du travail réflexif qui peut être mené avec des
élèves : Montrer la manière dont le parcours de Joséphine Baker s’inscrit dans
l’histoire de la Résistance et de la Déportation, faire le lien avec la question de
l’engagement et des valeurs de la Résistance présents dans les programmes
d’enseignement moral et civique du collège et du lycée.
Joséphine Baker : l’antiracisme
Sensibilisée par son mari Jean Lion, homme d’affaire juif, confronté à l’antisémitisme,
l’artiste s’engage notamment aux côtés de la LICRA (Ligue Internationale Contre le
Racisme) en 1938, se montrant très sensible au sort des Juifs pendant toute la période
de l’Occupation.
Plus tard, elle participe aux meetings du MRAP (Mouvement contre le Racisme et
l’Antisémitisme et pour la Paix) en relation avec l’Unesco afin de sensibiliser à la lutte
contre le racisme à l’échelle internationale.
Au temps des décolonisations, si l’artiste s’engage assez peu dans la lutte pour les
Indépendances malgré un soutien affirmé, elle milite contre l’apartheid en Afrique du
Sud et s’investit dans les mobilisations contre le racisme visant les Noirs aux États-
Unis. Elle est présente aux côtés de Martin Luther King le 28 août 1963 devant le
Lincoln Mémorial de Washington lorsque celui-ci prononce son discours historique « I
have a dream ». Dans cette période, elle apprécie aussi le Cuba de Fidel Castro où
5elle se rend pendant deux mois fin 1965, prenant le parti des non-alignés dans une
période de tensions au cœur de la Guerre froide.
Joséphine Baker et son quatrième mari Jo Bouillon avaient ce même idéal de fonder
un « Village du Monde, Capitale de la Fraternité universelle » afin de montrer au
monde entier que des enfants de nationalités et de religions différentes pouvaient vivre
ensemble dans la paix.
L’amour de Joséphine Baker pour les enfants en général était inébranlable, à tel point
qu’au retour de ses tournées, elle n’hésitait pas à ramener dans son château des
Milandes un enfant en manque d’amour ou dans le besoin. Tous ses enfants sont
adoptés à partir de 1955, 12 enfants de nationalités et de religions différentes. Tous
ses enfants formaient la « Tribu Arc en Ciel », unis pour le pire comme pour le
meilleur.
L’enjeu de la panthéonisation et du travail réflexif qui peut être mené avec des
élèves : Joséphine Baker enseigne un engagement antiraciste multiforme dénué de
toute « concurrence victimaire ». Sa lutte contre l’antisémitisme et le racisme, son
engagement pour les droits civiques aux États-Unis et sa constitution d’une famille
« arc-en-ciel » sont autant d’entrées possibles dans différentes périodes présentes
dans les programmes d’histoire au collège et au lycée et dans la lutte contre les
discriminations en EMC.
Quelques propositions pédagogiques
Approche interdisciplinaire
La vie et l’engagement de Joséphine Baker sont l’occasion de nourrir les parcours
citoyen et d’éducation artistique et culturelle.
Au collège, un travail interdisciplinaire peut être mené autour de la question de
l’engagement en lien avec les programmes de lettres et d’éducation musicale.
Les engagements de Joséphine Baker à travers différents temps forts du programme
d’histoire de troisième (Seconde Guerre mondiale, Guerre froide, Décolonisation) peut
contribuer à la construction du parcours citoyen de l’élève en lien avec le thème de
l’engagement en EMC et/ou de la lutte contre les discriminations (cycle 4).
La panthéonisation du 30 novembre et la réflexion sur la mémoire et l’histoire peuvent
être le point de départ d’un projet pédagogique. La semaine de lutte contre le racisme
et l’antisémitisme (mars) peut être l’occasion d’une mise en valeur des productions des
élèves.
Approche disciplinaire
Au lycée, en terminale générale tronc commun, la figure de Joséphine Baker peut
servir de point d’appui à l’étude du PPO « De Gaulle et la France libre », retraçant le
parcours de Joséphine Baker dans la France libre au service de De Gaulle et de la
liberté. Il est possible de mettre en parallèle l’engagement de Joséphine Baker dans
la Résistance et le parcours du général de Gaulle dans la France libre.
Dans le cadre du projet de l’année en EMC, l’engagement de Joséphine Baker peut
donner lieu à de stimulantes réalisations pour nos élèves et permettre le travail et
l’évaluation des compétences du LSL en EMC : Mobiliser les connaissances,
6méthodes et outils, Raisonner, argumenter, démontrer en exerçant un regard critique
et travailler en équipe.
Le groupe académique de formateurs Mnémosyté se tient à votre disposition pour
accompagner vos projets pédagogiques.
Ressources :
LABIAUSSE Kevin, « Joséphine Baker, au service de la France Libre », sur www.
Musiques-
regenerees.fr/GhettosCamps/Clandestinite/BakerJosephine/BakerJosephineAuServi
ceDeLaFranceLibre.html
« Joséphine Baker, une artiste au service de la France libre » sur
https://www.lumni.fr/video/josephine-baker-une-artiste-au-service-de-la-france-libre
« Joséphine Baker ou les chemins complexes de l’exemplarité », sur
https://theconversation.com/josephine-baker-ou-les-chemins-complexes-de-
lexemplarite-
167062?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1
630436266
Emission France culture, « Toute une vie : Joséphine Baker », mai 2021, rediffusion
de 2012, sur https://www.franceculture.fr/emissions/toute-une-vie/josephine-baker-
1906-1975-une-artiste-engagee
Joséphine Baker fait partie de ces médaillés célèbres qui font l’objet d’un panneau
dans l’exposition itinérante consacrée à la médaille de la Résistance française par la
Fondation de la Résistance, voir
https://www.fondationresistance.org/pages/accueil/medaille-resistance-
francaise_exposition19.htm?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre_dinform
ation_n15_-_4e_trimestre_2021&utm_medium=email
Parcours de vie, « Joséphine Baker », concours La flamme de l’égalité, sur
https://www.laflammedelegalite.org/doc/parcours/Joséphine%20Baker.pdf
SUMPF Alexandre, « Joséphine Baker et la revue Nègre », octobre 2006, sur
https://histoire-image.org/de/etudes/josephine-baker-revue-negre
7Vous pouvez aussi lire