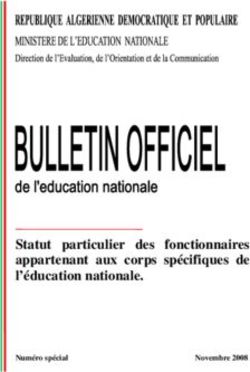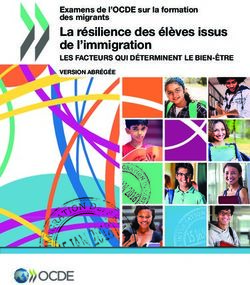L'ÉTAT de l'école 2018 - Epsilon (Insee)
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Cet ouvrage est édité par le Auteurs Nathalie Marchal
ministère de l’Éducation nationale DEPP Hélène Michaudon
etɸde la Jeunesse Sandra Andreu Olivier Monso
Direction de l’évaluation, Vanessa Bellamy Fabrice Murat
de la prospective Linda Ben Ali Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye
et de la performance (DEPP) Stéphane Berton Louis-Marie Ninnin
61-65, rue Dutot Nathalie Caron Jean-Marc Pastor
75732 Paris Cedex 15 Noémie Cavan Pascale Poulet-Coulibando
Léa Chabanon Patricia Prouchandy
Directrice de la publication Sandrine Chaumeron Danielle Prouteau
Fabienne Rosenwald Isabelle Cioldi Christelle Raffaelli
Marc Colmant Robert Rakocevic
Rédactrice en chef Elsa Conton Thierry Rocher
Sophie Saint-Philippe Sophie Cristofoli Julie Solard
Marion Defresne Alexia Stéfanou
Secrétaires de rédaction Mélanie Drégoir Anna Testas
Aurélie Bernardi Aurélie Demongeot Fanny Thomas
Bernard Javet Franck Évain Jean-Éric Thomas
Paul-Olivier Gasq Mustapha Touahir
Conception graphique Tamara Hubert Ronan Vourc’h
Frédéric Voiret Marie-Laurence Jaspar
Roselyne Kerjosse DGESIP-DGRI-SIES
Coordination cartographique Aline Landreau Aline Pauron ISSN 1152-5088
Cécile Duquet-Métayer Marion Le Cam Guillaume Rateau ISBN 978-2-11-152667-9
Sylvie Le Laidier Pour la version numérique,
Impression Stéphanie Lemerle Céreq e-ISSN 2431-5559
AMI Valérie Liogier Valentine Henrard e-ISBN 978-2-11-152668-6
Fabienne Lombard Alexie Robert Dépôt légal : novembre 2018Préface
Comme chaque année, la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance
(DEPP)ɸmet à disposition, deɸtous les acteurs de l’éducation, les 29 principaux indicateurs
deɸnotre système éducatif. Ils sont aussi attendus queɸprécieux, car ils permettent d’avoir
unɸaperçu trèsɸclair des forces et des faiblesses de notre école.
La diversité des indicateurs, à la fois quantitatifs et qualitatifs, leur précision et la qualité
@ Photo Philippe Devernay - desɸanalyses qui sont réalisées, constituent une boussole indispensable pour le pilotage
Ministère de l’Éducation nationale
et de la Jeunesse deɸlaɸpolitique d’éducation qui a pour Þnalité l’élévation générale du niveau et la justice sociale.
Ces indicateurs permettent d’objectiver le débat sur l’école, trop souvent pollué par des
représentations erronées ouɸidéologiques. Regarder les choses telles qu’elles sont, et agir
aÞnɸde dépasser les diƾcultés est essentiel pourɸqueɸtous les élèves puissent réussir.
Ce travail de statistique montre une fois encore la richesse de notre école, qui avec
sesɸ12,4ɸmillions d’élèves, sesɸ1,1ɸmillion de personnels présents sur tous les territoires,
estɸlaɸcolonne vertébrale de notre République etɸunɸformidable levier pour relever les déÞs
duɸXXIeɸsiècle.
Jean-Michel Blanquer
Ministre de l’Éducation nationale
et de la JeunessePrésentation
La publication L’état de l’École présente une synthèse d’indicateurs d’inclusion scolaire (ULIS). Cette baisse s’observe en préélémentaire
statistiques qui apparaissent essentiels pour analyser notre système (-ɸ 0,7ɸ %) et plus modérément en élémentaire (-ɸ 0,2ɸ %). Dans le
éducatif et pour apprécier les politiques publiques mises en œuvre. second degré, on constate la poursuite de la hausse des effectifs
Cette vingt-huitième édition évolueɸ ; la publication est rénovée tant (+ɸ 0,9ɸ %) avec près de 50ɸ 400 élèves supplémentaires (23ɸ 100
sur le fond que sur la forme. Grâce à l’enrichissement des systèmes lycéens et 27 300 collégiens de plus), sous l’impulsion notamment
d’information de la DEPP et aux réßexions menées sur les données, de des formations générales ou technologiques en lycée et des classes
nouveaux indicateurs plus pertinents prennent en compte l’évolution terminales en particulier (+ɸ2,0ɸ% d’augmentation à la rentrée 2017)
du contexte. Les choix éditoriaux visent à parfaire notre connaissance avec l’arrivée de la générationɸ 2000, et des formations en collège
du système éducatif en présentant une analyse globale fondée sur (+ɸ 0,8ɸ %), principalement les classes de sixième avec l’arrivée de
des indicateurs structurels et pérennes, en décrivant les principales laɸ génération 2006. En revanche, les formations professionnelles
évolutions et tendances et en apportant notamment l’éclairage des en lycée connaissent une diminution de leurs effectifs (- 1,2ɸ %).
comparaisons internationales et territoriales. Lesɸeffectifs dans l’enseignement supérieur continuent de progresser
L’objectif est d’alimenter le débat public autour de l’école, d’enrichir avec près de 71ɸ 000 étudiants de plus (+ɸ 2,7ɸ %). Il en va de même
l’aide au pilotage et de contribuer à l’évaluation du système éducatif pour ceux de l’apprentissage, +ɸ4,3ɸ% en 2017 du fait notamment des
français, avec des données de qualité et objectives, pour contribuer à apprentis de l’enseignement supérieur.
améliorer la réussite de tous les élèves. EnÞn plus de 390ɸ000 enfants handicapés sont maintenant scolarisés
soit en milieu ordinaire, en classe ordinaire ou dans un dispositif
AÞn de clariÞer la lecture, la structuration de la publication a été particulier, soit dans un établissement spécialisé.
modiÞée et les 29ɸindicateurs de cette édition 2018 ont été structurés
autour de quatre nouveaux thèmesɸ:
– Les élèves, cette partie permet de présenter les contextes de scola- Les investissements Þnanciers et en personnels consacrés
risation de l’ensemble des élèvesɸ; à l’éducation sont en constante progression
– L’investissement, cette partie présente les moyens Þnanciers, en
personnels et les conditions d’accueil des élèvesɸ; L’effort financier de la nation pour l’éducation est en constante
– Les acquis des élèves, cette partie présente les résultats et les progression. La dépense intérieure d’éducation (DIE) atteint 155ɸmilliards
acquis des élèves lors des évaluations nationales et internationalesɸ; d’euros en 2017, soit 6,7ɸ% du PIB. Avec 3,6 Md€ de plus qu’en 2016
– Les parcours, l’orientation et l’insertion, cette partie présente les (+ɸ2,4ɸ%), c’est la plus forte progression de la DIE depuis les an-
parcours des élèves, leur orientation et leur insertion professionnelle. néesɸ2010. Cette croissance est essentiellement portée par le bud-
get de l’État pour l’enseignement scolaire, en augmentation de 3,8ɸ% en
En 2017, la population scolaire continue de progresser. Les investisse- 2017 et notamment de la politique de «ɸpriorité au primaireɸ». Chaque
ments Þnanciers et en personnels consacrés à l’éducation sont en élève ou étudiant représente une dépense moyenne de 8ɸ690ɸeuros,
constante progression. L’effort de la nation est important et s’est traduit soit une augmentation moyenne de 1,7ɸ% par an en euros constants
par une forte élévation du niveau de qualiÞcation, sans toutefois depuis 1980. C’est dans le premier degré que la dépense par élève
parvenir à diminuer les inégalités, en particulier celles liées à l’origine a le plus augmenté sur les quarante dernières années en raison
sociale, ni à réduire les écarts au détriment des élèves en grande notamment d’une hausse du taux d’encadrement et de la création du
diƾculté scolaire. corps de professeurs des écoles. Dans le second degré, la dépense
par élève a augmenté de 1,4ɸ% par an depuis 1980, hausse due en
partie à la revalorisation du statut des enseignants. La dépense
La population scolaire croît, elle est portée par les effectifs moyenne par étudiant du supérieur n’a augmenté que de 0,9ɸ% par
du second degré et de l’enseignement supérieur an depuis 1980, la forte hausse des effectifs ayant absorbé la plus
grande part de l’augmentation des crédits consacrés à ce niveau
À la rentrée 2017, en France métropolitaine et dans les départements d’enseignement.
d’outre-Mer (DOM), l’ensemble du système éducatif public et privé Comparativement aux autres pays de l’OCDE, la France dépense
compte 15,7ɸmillions d’élèves, étudiants et apprentis, en progression moins par élève dans le premier degré (- 14ɸ%) et davantage dans
de +ɸ0,7ɸ% par rapport à la rentrée 2016 (+ɸ110ɸ900 élèves). le second degré (+ɸ 15ɸ %). En ce qui concerne l’enseignement
Les effectifs du premier degré diminuent en 2017 (-ɸ0,3ɸ%) pour des supérieur, la France se situe un peu au-dessus de la moyenne de
raisons démographiquesɸ; ils sont 6,8ɸmillions d’écoliers à la rentrée l’OCDE (+ 3 %), mais avec de très fortes disparités selon les filières
2017, dont 50ɸ 600 élèves scolarisés dans les unités localisées de formation.L’effort de l’État se traduit aussi dans le nombre d’enseignants recru- secondaires et supérieurs y étaient moins développés que dans les
tés. Depuis 2012, dans un contexte de départs en retraite moins nom- pays d’Europe du Nord ou qu’aux États-Unis. Aujourd’hui, la France
breux et d’une augmentation des postes ouverts aux concours ainsi a rattrapé son retard avec 86ɸ% des 25-34 ans, soit un point de plus
que d’un recrutement plus important de non-titulaires, les effectifs des que la moyenne des pourcentages des diplômés des pays de l’OCDE
personnels en mission d’enseignement repartent à la hausse (+ɸ6,2ɸ% (85ɸ%).
dans le premier degré sur les cinq dernières années et +ɸ3,5ɸ% dans
le second degré). Dans le secteur privé sous contrat, la progression
des effectifs des enseignants est plus dynamique que dans le public. Les résultats scolaires sont marqués par une persistance
L’effort se fait aussi en direction des établissements regroupant le d’élèves en diƾculté…
plus d’élèves rencontrant des diƾcultés en concentrant des moyens
Þnanciers, d’enseignement et d’accompagnement sur les établisse- En 2017, 80ɸ% des élèves de Þn de CE2 maîtrisent les connaissances
ments et les écoles en ayant le plus besoin. et compétences du socle commun. Les éléments nécessaires à
Le réseau d’éducation prioritaire reste stable avec 7ɸ 800 établisse- l’acquisition de la langue française sont correctement assimilés par
ments répartis en 2ɸ800 écoles et collèges publics du réseau d’édu- 80,3ɸ % des élèves. De moins bons résultats sont observés concer-
cation prioritaire renforcé (REP+) et 5ɸ000 en réseau d’éducation prio- nant les principaux éléments de mathématiques puisque seuls 78,3ɸ%
ritaire (REP). Ceci correspond respectivement à 7ɸ% des effectifs des des élèves maîtrisent ces connaissances et compétences. Les Þlles
écoles et collèges publics de France métropolitaine et des DOM pour dépassent de 5ɸpoints les garçons dans l’acquisition des éléments de
le réseau REP+, soit 181ɸ300 élèves, et 14ɸ% pour le réseau REP, soit la langue française. Cet écart n’apparaît pas en mathématiques.
366ɸ400 élèves. En début de sixième, en 2017, 85ɸ% des élèves ont acquis les attendus
Pour lutter contre les diƾcultés scolaires dès les premières années des connaissances et des compétences des programmes en français
des apprentissages fondamentaux, en 2017, ont été mis en place les et 73ɸ % en mathématiques. Les Þlles ont un taux de maîtrise en
CP dédoublés en REP+. Cette mesure a abouti à une forte baisse de la français plus élevé que les garçonsɸ: elles sont 88,4ɸ% contre 82,3ɸ%
taille des classesɸ: de 21,7 élèves par classe en 2016, la taille moyenne pour ces derniers. Que ce soit en français ou en mathématiques, la
des classes accueillant uniquement des élèves de CP en REP+ est proportion d’élèves qui maîtrisent les connaissances et compétences
passée à 13,4 en 2017. évaluées est nettement moins élevée parmi les élèves en retard
scolaire que parmi les élèves à «ɸl’heureɸ».
Les évaluations Cedre relatives aux compétences en histoire-géogra-
Le niveau de formation des élèves et étudiants continue phie à la Þn de l’école et à la Þn du collège apportent un éclairage sur
deɸs’élever le niveau des élèves qui se stabilise. En 2017, le score moyen atteint
252ɸpoints en Þn d’école, il était de 251 en 2012 et de 250 en 2006.
En 2017, l’État a délivré plus de 1,7ɸmillion de diplômes de niveauɸV et Une des évolutions les plus notables, depuis 2012, se caractérise par
de niveauɸIV, 25ɸ000 de plus que l’année précédente. une baisse des proportions d’élèves parmi les niveaux les plus faibles.
La rénovation de la voie professionnelle, mise en œuvre en 2009 en Moins satisfaisante, l’enquête internationale PIRLS 2016 sur les per-
supprimant le cycle BEP et en instaurant une scolarité en trois ans formances des élèves en compréhension de l’écrit en CM1 situe la
conduisant au baccalauréat, a permis une augmentation considérable France avec un score moyen de 511, juste au-dessus de la moyenne
du nombre de lycéens se présentant à l’examen. Le proÞl des bache- internationale (500) mais en dessous de la moyenne de l’Union euro-
liers a fortement évolué. Ainsi, à la session 2018, sur 100 bacheliers, péenne (540).
53 étaient issus des séries générales, 21 des séries technologiques et
26 des séries professionnelles contre respectivement 66, 32 et 2 en En 2017, 77ɸ % des jeunes Français âgés d’environ 17 ans sont des
1988. La part des bacheliers des sériesɸgénérales etɸtechnologiques lecteurs eƾcaces. L’évaluation de la Journée défense et citoyenneté
s’est réduite au proÞt des séries professionnelles. (JDC) donne également une mesure Þneɸde la proportion de ceux qui
À la sessionɸ2018 du baccalauréat, 79,9ɸ% des jeunes d’une génération éprouvent des diƾcultés de lectureɸ: ils sont 11,5ɸ%, dont la moitié de
obtiennent un baccalauréat alors qu’en 1980 seulement 26ɸ % d’une ces jeunes peuvent être considérés en situation d’illettrisme. Les per-
génération y parvenait. formances en lecture progressent avec le niveau d’études. Elles sont
Un diplôme d’études secondaires longues est, pour l’OCDE et l’Union globalement plus élevées chez les Þlles que chez les garçons.
européenne, un bagage minimum pour une économie et une société de Sortir sans diplôme de formation initiale rend plus diƾcile l’entrée
la connaissance. La France a longtemps partagé avec les pays latins un dans la vie active. A contrario, être diplômé et continuer à se former
niveau d’études modéré de sa population adulte. Les enseignements permettent une meilleure insertion professionnelle. Àɸ cet égard, lesjeunes Français sortent mieux armés du système éducatif initial mathématiques, en culture scientiÞque et technologiqueɸ; en français,
aujourd’hui qu’hier. En effet, la proportion de «ɸ sortants précocesɸ » les Þlles présentent de meilleurs acquis.
(c’est-à-dire de jeunes âgés de 18 à 24ɸ ans qui ne poursuivent pas Les Þlles sont plus représentées parmi les titulaires de diplômes gé-
d’études ou de formation et ne détiennent aucun diplôme ou unique- néraux alors que les garçons sont plus présents parmi les titulaires
ment le diplôme national du brevet) estɸpassée de 40ɸ% à la Þn des de diplômes professionnels. 84ɸ% des Þlles et 74ɸ% des garçons ont
années 1970 àɸ moins de 9ɸ % en 2017. Elle atteint 8,9ɸ % en 2017. obtenu le baccalauréat. En termes d’accès aux diplômes, les écarts
Laɸ France apparaît ainsi parmi les pays européens qui ont le plus se sont également creusés entre les Þlles et les garçons puisque,
réussi à lutter contre les sorties sans diplôme. dans les années 1990, 33ɸ% des Þlles et 32ɸ% des garçons obtenaient
un diplôme de l’enseignement supérieurɸ; dans les années 2010, elles
sont 49ɸ% des Þlles contre 40ɸ% pour les garçons. Or si les femmes
… avec des inégalités qui perdurent réussissent mieux dans le système scolaire et universitaire, leur rému-
nération, à diplôme équivalent, est inférieure à celle des hommes, et
Malgré cesɸprogrès, notre système éducatif ne parvient pas à réduire la différence s’accroît nettement avec l’âge.
les inégalités.
Celles-ci se manifestent dans les conditions d’accueil des élèves dans
les différents établissements. À la rentrée 2017, 10ɸ% des collèges ont L’insertion est très sensible au niveau du diplôme
moins de 14,5ɸ% d’élèves qui sont enfants d’ouvriers ou d’inactifs, et
10ɸ% en ont plus de 63ɸ%. Les collèges publics accueillent des élèves L’obtention du diplôme demeure déterminante dans l’insertion des
en moyenne plus défavorisés que les collèges privés et l’écart entre jeunes. Elle dépend du niveau et de la voie de formation, mais est aus-
les deux secteurs a progressivement augmenté ces dernières années. si marquée par la conjoncture économique dans laquelle ces jeunes
L’origine sociale et le sexe continuent de peser sur l’accès aux di- arrivent sur le marché du travail. Quel que soit le niveau de formation,
plômes. Ainsi, parmi les 25-34ɸans, 77ɸ% des enfants de cadres ou obtenir le diplôme demeure déterminant dans l’insertion des jeunes.
professions intellectuelles supérieures sont diplômés du supérieur, Le taux d’emploi des sortants de lycée est de 48ɸ% pour les diplômés,
contre 26ɸ % des enfants d’ouvriers. La proportion de jeunes ayant contre 35ɸ% pour les lycéens qui n’ont pas obtenu le diplôme préparé.
pour plus haut diplôme un baccalauréat général ou technologique Ces proportions sont nettement plus élevées pour les sortants d’ap-
diffère peu selon l’origine sociale. En revanche, seuls 11ɸ% des enfants prentissageɸ de niveauɸ V à IIIɸ : 71ɸ % des diplômés travaillent contre
de cadres ou professions intellectuelles supérieures ont pour plus 54ɸ% des non diplômés. Les apprentis s’insèrent plus que les lycéens
haut diplôme un diplôme du second degré professionnel (bacca- et plus souvent dans l’entreprise formatrice.
lauréat professionnel, CAP ou équivalent), contre 46ɸ % des enfants On observe une amélioration modérée de l’accès à l’emploi pour
d’ouvriers. En outre, 3ɸ% des enfants de cadres ou professions intel- l’ensemble de la génération des sortants du système éducatif en 2013,
lectuelles supérieures sont peu ou pas diplômés, contre 20ɸ % des malgré une élévation sensible du niveau de diplôme et un contexte
enfants d’ouvriers. conjoncturel plus favorable.
Parmi les bacheliers, le type de baccalauréat obtenu diffère également Une fois leurs études initiales achevées, les jeunes se portent
selon la catégorie socioprofessionnelle des parents. Siɸ77ɸ% des lau- massivement sur le marché du travail. En 2017, parmi les jeunes sortis
réats enfants de cadres obtiennent un baccalauréat général, 14ɸ% un de formation initiale depuis un à quatre ans, 68,6ɸ % sont en emploi,
baccalauréat technologique et 9ɸ% un baccalauréat professionnel, la 14,8ɸ% au chômage et 16,6ɸ% sont inactifs. Les situations de chômage
répartition est respectivement de 36ɸ%, 22ɸ% et 42ɸ% pour les enfants ou d’inactivité sont d’autant plus fréquentes que le niveau d’études
d’ouvriers. atteint est faible. Les jeunes femmes, qui ont atteint un niveau
d’études en moyenne plus élevé que celui des jeunes hommes, sont
La scolarisation des Þlles et des garçons diffère selon le niveau d’en- aussi souvent en emploi que ces derniers. Elles sont un peu moins
seignement et les Þlières. À l’école et au collège, les Þlles représentent nombreuses à être au chômage (13,2ɸ% contre 16,5ɸ% pour les jeunes
49ɸ% de la population scolaire alors que, dans les formations en lycée hommes), mais plus souvent inactives (18,3ɸ% contre 14,9ɸ%).
général et technologique, elles sont 54ɸ % dont 79ɸ % en terminale
littéraire et 88ɸ% en terminale technologique de la santé et du social.
Dans la voie professionnelle, elles sont moins représentées, 42ɸ %
en formation en lycée professionnel et 33ɸ % en tant qu’apprenties.
Auɸterme des évaluations sur les compétences du socle à l’école et
au collège, les Þlles et les garçons ont des résultats identiques enSommaire Les élèves Ŵ1 La scolarisation dans le premier degré. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 10 Ŵ2 La scolarisation au collège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 12 Ŵ3 La scolarisation au lycée général et technologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 14 Ŵ4 La voie professionnelle : voie scolaire et apprentissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 16 Ŵ5 La scolarisation des élèves en situation de handicap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 18 Ŵ6 L’éducation prioritaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 20 Ŵ7 Le climat scolaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 22 L’investissement Ŵ8 La dépense pour l’Éducation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 24 Ŵ9 La dépense d’éducation pour le premier degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 26 10 La dépense d’éducation pour le second degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 28 11 La dépense d’éducation pour l’enseignement supérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 30 12 Les personnels de l’Éducation nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 32 13 Les personnels des corps enseignants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 34 14 Les moyens humains alloués à l’enseignement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 36 15 Les conditions d’accueil dans le premier degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 38 16 Les conditions d’accueil dans le second degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 40 Les acquis des élèves 17 L’évaluation des compétences du socle en Þn de CE2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 42 18 Les connaissances et les compétences en français et en mathématiques en début de sixième . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 44 19 Les compétences en histoire-géographie et enseignement moral et civique en Þn d’école . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 46 20 Les compétences en histoire-géographie et enseignement moral et civique en Þn de collège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 48 21 Les compétences en lecture des jeunes (JDC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 50 22 Les performances des élèves de CM1 en compréhension de l’écrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 52 23 Les performances des élèves de CM1 en mathématiques et en sciences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 54 Les Parcours, l’orientation et l’insertion 24 Les parcours des élèves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 56 25 La réussite aux examens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 58 26 Les sorties de formation aux faibles niveaux d’études . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 60 27 Le niveau d’études de la population . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 62 28 L’insertion professionnelle des jeunes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 64 29 Le diplôme et l’entrée dans la vie active . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 66 méthodologie et définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 68
1 La scolarisation dans le premier degré
Les effectifs d’élèves dans le premier degré diminuent La scolarisation des enfants de moins de trois ans
en 2017 seɸstabilise
À la rentrée 2017, les écoles des secteurs public et privé (sous et hors 11,7 % des enfants de deux ans sont scolarisés à la rentréeɸ2017 f 1.3.
contrat) du premier degré scolarisent 6 783 300 élèves en France Le taux de scolarisation des enfants de deux ans diminue ainsi de
métropolitaine et dans les DOM, soit une baisse par rapport à 2016 0,2ɸpoint. Il avait fortement augmenté dans lesɸannées 1970 jusqu’à
(- 23 100 élèves) f 1.1. Cette baisse s’observe en préélémentaire atteindre 35ɸ % au début des années 1980. Entre 1999 et 2012, ce
(- 0,7 %) avec la baisse des naissances et plus modérément en taux a été divisé par trois, l’enseignement préélémentaire s’étant
élémentaire (-ɸ0,2ɸ%). Les unités localisées pour l’inclusion scolaire progressivement recentré sur les enfants de trois àɸcinq ans. Le taux
(ULIS), qui accueillent des élèves enɸsituation de handicap, comptent de scolarisation à deux ans s’est ensuite stabilisé et oscille autour de
1ɸ200 élèves de plus qu’à la rentrée 2016 (+ɸ2,4ɸ%). Ils sont scolarisés 12ɸ% depuis 2012.
soit en préélémentaire soit en élémentaire selon leur niveau.
Le nombre d’élèves scolarisés dans le secteur public recule (-ɸ30ɸ100
élèves) alors que le secteur privé enregistre une hausse de ses Les écoles de deux classes ou moins sont situées
effectifs (+ɸ7ɸ000 élèves). La scolarisation dans le secteur privé est dansɸuneɸlarge diagonale de la France
plus fréquente dans l’enseignement élémentaire (14,5ɸ% des élèves
scolarisés dans le privé contre 12,9ɸ% dans le préélémentaire). Pour La taille des écoles est très variableɸ : 26 % des écoles comptent huit
autant, entre ces deux dernières rentrées, la part de l’enseignement classes ou plus et scolarisent 3ɸ 425ɸ 000 élèves, soit près de la moi-
privé a progressé davantage dans le préélémentaire. tié d’entre eux. À l’opposé, 20ɸ% des écoles comprennent deux classes
Les Þlles représentent près de 49ɸ % des élèves dans les classes ou moins et accueillent 5ɸ% des élèves du premier degré, soit 335ɸ800
préélémentaires et élémentaires des secteurs public et privé. Cette élèves.
part légèrement moindre de Þlles s’explique par la répartition des Plus des trois quarts de ces «ɸpetitesɸ» écoles appartiennent à des
naissances (105 garçons pour 100 Þlles). Cependant, les Þlles sont communes de moins de 1 000 habitants. Seules 6ɸ % d’entre elles
plus nombreuses à bénéÞcier de la scolarisation précoceɸ : environ sont situées dans des communes de plus de 10ɸ000 habitants. Les
51ɸ% des élèves de deux ans sont des Þlles. Inversement, les Þlles bassins de vie des académies d’Île-de-France, des DOM, de l’ouest
sont très largement minoritaires dans les ULIS (36,3ɸ%). de la France, du pourtour méditerranéen ainsi que ceux d’une grande
partie de l’académie de Lyon comptent peu d’écoles de deux classes
ou moins f 1.4. À l’inverse, dans les académies de Dijon, Clermont-
Au cours des dernières décennies, les évolutions ont été Ferrand, Limoges, Corse et Toulouse, la part de ces «ɸpetitesɸ» écoles
variables suivant les niveaux est supérieure à un tiers.
L’enseignement préélémentaire a vu ses effectifs presque doubler
entre 1960 et 1985, en raison de la progression de la scolarisation des
enfants de trois ans ou plus et, dans une moindre mesure, des enfants
de deux ans f 1.2. La baisse du nombre de naissances cause un
léger recul des effectifs sur la périodeɸ1985-1998. Ensuite, l’entrée à
l’école de générations plus nombreuses a entraîné une faible augmen-
tation du nombre d’élèves en préélémentaire jusqu’en 2012. Depuis,
les effectifs diminuent légèrement.
L’enseignement élémentaire a perdu 18,1ɸ% de ses effectifs entre 1960 POUR EN SAVOIR PLUS
et 1985, période marquée par les effets de la baisse démographique Ư ROBIN J., 2018, «ɸLes élèves du premier degré à la rentréeɸ2018ɸ: le dédoublement
et de la réduction des retards scolaires. Par la suite, la diminution des des classes de CP et de CE1 dans l’éducation prioritaire s’ampliÞeɸ»,
Note d’information, n°ɸ18.27, MENJ-MESRI-DEPP.
effectifs s’est poursuivie à un rythme moins élevé puis s’est inversée
Ư MEN-MESRI-DEPP, 2018, Repères et références statistiques sur les enseignements,
avec l’arrivée à l’école élémentaire des générations nombreuses laɸformation et la recherche, Paris, chapitre 3 et Þches 2.1 et 2.2.
d’enfants nés en 2000 et après. Ư MENESR-DEPP, 2017, Géographie de l’École, Paris, indicateurs 7 et 15.
Méthodologie et DéÞnitionsŵp. 68
10 L’état de l’École 2018ŴŴLes élèves1
1.1 Effectifs des élèves du premier degré (en milliers) 1.2 Évolution des effectifs des élèves dans l’enseignement
préélémentaire et élémentaire (en milliers)
Évolution
Rentrée 2016 Rentrée 2017
2016-2017 (en %) 5 500
Part de Part de
Public Privé Total Public Privé Total Public Privé Total 5 000
filles (%) filles (%)
Préélémentaire 2 216,8 322,6 2 539,5 49,0 2 197,4 324,9 2 522,3 49,0 - 0,9 0,7 - 0,7 4 500 4 210,4
2 ans 76,2 20,4 96,6 51,3 73,5 19,4 92,9 50,9 - 3,5 - 5,1 - 3,8 Élémentaire
3 ans 690,4 97,9 788,3 49,1 689,0 99,1 788,1 49,1 - 0,2 1,2 0,0 4 000
4 ans 718,5 101,3 819,8 48,9 707,2 101,9 809,1 49,0 - 1,6 0,5 - 1,3 3 500
5 ans et plus 731,8 103,0 834,8 48,8 727,7 104,6 832,3 48,7 - 0,6 1,5 - 0,3
3 000
Élémentaire 3 609,8 607,7 4 217,5 49,0 3 598,1 612,3 4 210,4 49,1 - 0,3 0,7 - 0,2 2 522,3
CP 735,0 117,0 852,0 49,0 720,7 117,5 838,2 49,0 - 1,9 0,4 - 1,6 2 500
CE1 725,4 118,8 844,1 49,0 727,6 119,6 847,3 49,2 0,3 0,7 0,4 Préélémentaire
2 000
CE2 726,8 121,7 848,5 49,0 720,6 122,3 842,9 49,0 - 0,9 0,5 - 0,7
CM1 711,6 123,2 834,8 49,1 720,3 125,6 845,8 49,1 1,2 1,9 1,3 1 500
L’état de l’École 2018 © DEPP
L’état de l’École 2018 © DEPP
CM2 711,0 127,1 838,1 49,2 708,9 127,3 836,2 49,1 - 0,3 0,2 - 0,2
1 000
ULIS 46,2 3,2 49,4 36,5 47,3 3,4 50,6 36,3 2,3 4,0 2,4
1960 1970 1980 1990 2000 2010 2017
Total 5 872,8 933,6 6 806,4 48,9 5 842,7 940,6 6 783,3 48,9 - 0,5 0,7 - 0,3
Lecture : à la rentrée 2017, 2 522 300 élèves sont scolarisés en préélémentaire dont 2 197 400 dans le secteur public. Lecture : à la rentrée 2017, 4 210 400 élèves sont scolarisés dans l’enseignement élémentaire.
Parmi les élèves en préélémentaire, 49,0 % sont des Þlles. Champ : France métropolitaine avant 1999 ; France métropolitaine + DOM y compris Mayotte
Champ : France métropolitaine + DOM, public et privé (sous et hors contrat). à partir de 2011, public et privé.
Source : MENJ-MESRI-DEPP. Source : MENJ-MESRI-DEPP.
1.3 Évolution du taux de scolarisation des enfants de 2 ans (en %) 1.4 Part des écoles de deux classes et moins par bassin
de vie en 2017
40
35
30
25
20
15
11,7
10
5
L’état de l’École 2018 © DEPP
L’état de l’École 2018 © DEPP
en %
0
10 20 40
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2017 France métro. + DOM : 20,0 %
Lecture : à la rentrée 2017, 11,7 % des enfants de deux ans sont scolarisés. Lecture : à la rentrée 2017, 20 % des écoles ne comptent qu’une ou deux classes.
Champ : France métropolitaine avant 1999 ; France métropolitaine + DOM y compris Mayotte à partir de 2011, public et privé. Champ : France métropolitaine + DOM, public et privé.
Sources : MENJ-MESRI-DEPP ; Insee, estimations démographiques, traitements DEPP. Source : MENJ-MESRI-DEPP.
Les élèves ŴL’état de l’École 2018 112 La scolarisation au collège
Augmentation des effectifs, principalement en sixième Plus d’élèves d’origine défavorisée en ULIS et Segpa
etɸmoins dans les établissements privés
À la rentréeɸ 2017, les collèges des secteurs public et privé (sous et
hors contrat) scolarisent 3ɸ342ɸ000 élèves en France métropolitaine et Parmi l’ensemble des élèves qui suivent une formation au collège,
dans les DOM, soit une hausse de 0,8 % par rapport à 2016 (+ 27ɸ300 37ɸ% viennent d’une catégorie sociale défavorisée et 37ɸ% viennent
élèves) f 2.1. d’une catégorie sociale favorisée (y compris très favorisée) f 2.3.
L’augmentation des élèves de sixième est la plus importante (+ɸ19ɸ600) Lesɸ établissements privés scolarisent davantage d’élèves d’origine
et explique 72 % de la hausse globale des effectifs des collèges. sociale favoriséeɸ: 53 %, dont 38 % d’origine sociale très favorisée.
Le nombre d’élèves augmente aussi en cinquième et en quatrième Les élèves d’origine sociale défavorisée y sont sous-représentés
(+ɸ0,8ɸ%) mais diminue en troisième (-ɸ0,4ɸ%) par rapport à 2016. (19ɸ%).
On compte 85 300 élèves en sections d’enseignement général et Au sein des collèges, les élèves des ULIS (structures qui accueillent
professionnel adapté (Segpa), dispositifs d’initiations aux métiers en des élèves en situation de handicap) et ceux qui sont scolarisés
alternance (DIMA) et dispositifs relais à la rentréeɸ2017, soit 1ɸ900 de dans des dispositifs adaptés (Segpa, DIMA et dispositifs relais) sont,
moins qu’à la rentréeɸ2016 (-ɸ2,2ɸ%). bien plus largement que la moyenne, d’origine sociale défavoriséeɸ:
La hausse importante des effectifs en sixième en 2017 est largement 61 % en ULIS et 72ɸ% des élèves en Segpa, DIMA et dispositif relais.
due à l’entrée en sixième de la génération 2006. Cette génération
(829ɸ 400 naissances) est bien plus nombreuse que celle de 2005
(+ɸ22ɸ500). Cet effet démographique est bien le plus important pour Latin et grec ancien au collège
expliquer les évolutions des effectifs puisque les taux de redouble-
ment stagnent en 2017 et se stabilisent pour tous les niveaux. À la rentréeɸ 2017, 17,6 % des collégiens apprennent le latin, 0,7 %
apprennent le grec ancien et 0,3 % suivent une «ɸ initiation latin et
Cette progression globale des effectifs du collège se retrouve dans les grecɸ» f 2.4.
secteurs public et privé. Ce dernier compte 9ɸ900 élèves de plus qu’à La proportion d’élèves suivant l’apprentissage du latin décroît entre
laɸrentréeɸ2016 (+ɸ1,4ɸ%). Le public enregistre 17ɸ400 élèves supplé- laɸcinquième et la troisièmeɸ: 19,8 % des élèves de cinquième ont choisi
mentaires, soit 0,7ɸ% de plus qu’en 2016 f 2.1. l’option latin, mais ils ne sont plus que 14,9 % de latinistes en classe
Pour les seuls élèves de sixième, l’évolution est de + 2,3 % dansɸ le de troisième L’apprentissage de cette langue ancienne reste plus
public et +ɸ 2,8 % dans le privé. Les effectifs augmentent en cin- fréquent dans les collèges privés (20,7 %) que dans ceux du secteur
quième et quatrième pour les deux secteurs, mais plus fortement public (16,7 %).
dans le privé que dans le public. Les effectifs de troisième diminuent L’option de grec ancien, qui peut être étudiée dès la cinquième, reste
en revanche de 0,6 % (-ɸ3ɸ600) dans le public mais augmentent de faiblement suivie en collège (0,7 % des élèves). En revanche, la part
0,3ɸ% dans le privé (+ɸ600). d’hellénistes croît entre la cinquième et la troisièmeɸ: près de 2ɸ% des
élèves de troisième suivent l’option de grec ancien.
Depuis 20 ans, les évolutions sont contrastées
entreɸacadémies
Depuis 1997, les effectifs de collégiens ont diminué de 2,9ɸ% sur l’en-
semble de la France. Les évolutions académiques sont très contras-
tées depuis 20 ans f 2.2.
En métropole, les académies de Reims, Nancy-Metz, Rouen, Lille, POUR EN SAVOIR PLUS
Dijon et Caen ont connu des baisses de plus de 16 % de leurs effectifs. Ư BELLAMY V., BLANCH É., GASQ P.-O., GEORGE E., 2018, «ɸLes élèves du second degré
À l’inverse, Toulouse et Montpellier en particulier (plus de 9 % de hausse), à la rentréeɸ2018ɸ: plus de collégiens et moins de lycéensɸ», Note d’information, n°ɸ18.28,
MENJ-MESRI-DEPP.
mais aussi Bordeaux ou Nantes ont vu croître leur population de
Ư MEN-MESRI-DEPP, 2018, Repères et références statistiques sur les enseignements,
collégiens. Dans le même temps, les collégiens sont 12,2ɸ% de plus laɸformation et la recherche, Paris, chapitre 4.
dans les DOM en 2017 qu’en 1997. Cette hausse est portée par Ư MENESR-DEPP, 2017, Géographique de l’École, Paris, indicateur 8.
Mayotte et la Guyane.
Méthodologie et DéÞnitionsŵp. 68
12 L’état de l’École 2018ŴŴLes élèves2
2.1 Effectifs des élèves des formations en collège 2.2 Évolution des effectifs des formations en collège
entre 1997 et 2017 (en %)
Rentrée 2016 Rentrée 2017 Évolution
Nbre Nbre effectifs
Nombre % Nombre %
d'élèves d'élèves 2016-2017
d'élèves de filles d'élèves de filles
par classe par classe (en %)
Public Sixième 637 856 25 49,1 652 463 25 49,1 2,3
Cinquième 630 308 25 49,2 634 234 25 49,2 0,6
Quatrième 622 517 25 49,4 626 933 25 49,3 0,7
Troisième1 631 983 25 49,4 628 344 25 49,3 - 0,6
Total sixième à troisième 2 522 664 25 49,2 2 541 974 25 49,2 0,8
Segpa, DIMA et dispositifs relais 82 584 13 38,4 80 732 13 38,4 - 2,2
Total public 2 605 248 24 48,9 2 622 706 24 48,9 0,7 Effectifs d’élèves
dont ULIS 28 353 – 36,9 30 648 – 36,6 8,1 300 000
Privé Sixième 180 284 27 48,4 185 308 27 48,5 2,8
Cinquième 177 125 27 48,4 179 547 27 48,6 1,4 150 000
Quatrième 172 705 26 48,8 174 619 26 49,1 1,1
Troisième1 175 030 26 49,1 175 636 26 48,9 0,3 50 000
Total sixième à troisième 705 144 26 48,7 715 110 27 48,8 1,4
Segpa, DIMA et dispositifs relais 4 615 11 36,9 4 530 11 37,2 - 1,8
Total privé 709 759 26 48,6 719 640 26 48,7 1,4
dont ULIS 3 139 – 38,8 3 316 – 38,8 5,6
Public Sixième 818 140 25 48,9 837 771 25 49,0 2,4
et privé Cinquième 807 433 25 49,0 813 781 26 49,1 0,8
Quatrième 795 222 25 49,3 801 552 25 49,2 0,8
L’état de l’École 2018 © DEPP
L’état de l’École 2018 © DEPP
Troisième1 807 013 25 49,3 803 980 25 49,3 - 0,4 en %
Total sixième à troisième 3 227 808 25 49,1 3 257 084 25 49,1 0,9
Segpa, DIMA et dispositifs relais 87 199 13 38,3 85 262 13 38,3 - 2,2 - 30 - 20 - 10 0 12,5 70 et +
Total public + privé 3 315 007 25 48,8 3 342 346 25 48,8 0,8 France métro. + DOM : - 2,9 % et 3 442 346 élèves
dont ULIS 31 492 – 37,1 33 964 – 36,8 7,8
1. Y compris les troisième prépa-pro en lycées professionnels. Champ : France métropolitaine + DOM, public et privé, établissements sous tutelle du MENJ
Champ : France métropolitaine + DOM, public et privé, établissements sous tutelle du MENJ (y compris EREA). (yɸcomprisɸEREA).
Source : MENJ-MESRI-DEPP. Source : MENJ-MESRI-DEPP.
2.3 Répartition des collégiens selon leur origine sociale 2.4 Proportion des élèves étudiant le latin et le grec ancien
à la rentrée 2017 (en %) au collège à la rentrée 2017, hors ULIS (en %)
100 2 2
5 7 9 5 8
90 Initiation
20 7 23 24 8 Grec
10 Latin latin
80 20 38 20 ancien
et grec
12 22 23
70 13 13 Public Cinquième 18,6 0,0 0,4
30
60 Quatrième 17,4 0,1 0,3
26 15
50 29 27 Troisième 14,1 2,0 0,4
40 Total cinquième à troisième 16,7 0,7 0,3
73 72
30 64 28 61 Privé Cinquième 23,9 0,1 0,3
52 Quatrième 20,7 0,4 0,3
20 42 37
35
Troisième 17,6 1,6 0,4
10 19
Total cinquième à troisième 20,7 0,7 0,3
0
Public dt dt ULIS Privé dt dt ULIS Public dt dt ULIS Public Cinquième 19,8 0,0 0,4
L’état de l’École 2018 © DEPP
L’état de l’École 2018 © DEPP
Segpa1 Segpa1 et privé Segpa1 et privé Quatrième 18,1 0,1 0,3
Défavorisée Moyenne Favorisée Très favorisée Troisième 14,9 1,9 0,4
1. Segpa, DIMA et dispositifs relais. Total cinquième à troisième 17,6 0,7 0,3
Lecture : parmi les élèves suivant une formation en collège dans le secteur public, 42 % sont d’orgine sociale défavorisée
etɸ20ɸ% d’origine sociale très favorisée. Champ : France métropolitaine + DOM, public et privé, établissements sous tutelle du MENJ
Champ : France métropolitaine + DOM, public et privé, établissements sous tutelle du MENJ (y compris EREA). (y compris EREA, hors ULIS).
Source : MENJ-MESRI-DEPP. Source : MENJ-MESRI-DEPP.
Les élèves ŴL’état de l’École 2018 133 La scolarisation au lycée général et technologique
La hausse des effectifs en lycée général et technologique Dans la voie technologique, les spécialités de production sont large-
est portée par les terminales ment masculinesɸ: seuls 17,8ɸ% des élèves sont des Þlles. Cette part a
toutefois progressé depuis 10 ans, puisqu’elle était de 15,9ɸ% en 2007.
L’ensemble des élèves en formation (hors post-bac) en lycées géné- Les séries des services, toujours majoritairement féminines (59,8ɸ %
raux et technologiques (GT) est en progressionɸpar rapport à 2016ɸ: de Þlles à la rentréeɸ 2017), le sont un peu moins qu’il y a 10ɸ ans.
+ɸ31ɸ300 (2,0ɸ%) et atteint 1,63ɸmillion d’élèves f 3.1. La rentréeɸ2017 Enɸ2007, la part des Þlles était de 65,5ɸ% dans ces sériesɸ: en 10 ans,
fait suite à une rentréeɸ 2016 déjà en hausse de 48ɸ 300 élèves par elle a perdu 5,7 points.
rapport à 2015.
La progression globale des élèves en lycéeɸGT est portée par les élèves
de classes de terminaleɸ : entreɸ 2016 etɸ 2017, les effectifs ont pro- Plus d’élèves d’origine sociale défavorisée dans les séries
gressé de 35ɸ 900 élèves, soit une progression de 7,1ɸ %. Cette aug- technologiques que dans les séries généralesɸ
mentation correspond à l’arrivée en terminale de la générationɸ2000,
particulièrement nombreuse comparée aux générations précédentesɸ: Parmi l’ensemble des élèves qui suivent une formation au lycée,
807ɸ400 enfants sont nés en 2000 contre 775ɸ800 en 1999 (+ɸ31ɸ600). 26,4ɸ % viennent d’une catégorie sociale défavorisée et 47,1ɸ % d’une
Les évolutions des effectifs de terminale résultent massivement de catégorie sociale favorisée (y compris très favorisée) f 3.4. Dans
cet effet démographique. les séries générales, la série scientiÞque comprend 58,0ɸ % d’élèves
Les effectifs de seconde et de premièreɸGT ont, eux, diminué de res- de classes favorisées soit 11 points de plus que pour l’ensemble des
pectivement 0,6ɸ% et 0,2ɸ% entreɸ2016 etɸ2017. formations en lycéeɸGT, moins d’un élève de sérieɸS sur 5 est d’origine
sociale défavorisée. Les élèves de série économique et sociale sont
moins souvent d’origine favorisée (48,2ɸ %) et les élèves de la Þlière
Une hausse de 6ɸ% en 20 ans inégalement répartie littéraire encore un peu moins (43,4ɸ%).
Les élèves des séries technologiques sont bien plus souvent d’ori-
Depuis 1997, les effectifs de lycéens ont progressé de 6,0ɸ % sur gine défavorisée que ceux des séries générales. Dans les séries des
l’ensemble de la France. En métropole, les académies de Montpellier services, 39,1ɸ% sont d’origine défavorisée et ils sont 32,5ɸ% dans les
et de Nice ont connu des hausses de plus de 20ɸ% de leurs effectifs séries de production, contre 18,7ɸ % pour les séries scientiÞques en
entreɸ1997 etɸ2017 f 3.2. Dans les académies de Créteil, Toulouse, formations générales.
Versailles et de Bordeaux, le nombre de lycéens a progressé de
15ɸ % àɸ 19ɸ %. À l’inverse, Lille, Nancy-Metz et Reims ont enregistré
des baisses importantes de leurs effectifs en lycée (respectivement
-ɸ13,9ɸ%, -ɸ12,8ɸ% et -ɸ12,6ɸ%).
Sur cette même période, le nombre de lycéens a largement augmenté
dans les académies des DOMɸ(+ɸ36,7ɸ% soit 17ɸ600 élèves supplémen-
taires). Cette hausse est portée par Mayotte, la Guyane et La Réunion,
alors que les effectifs restent relativement stables en Guadeloupe et
diminuent en Martinique (-ɸ7,6ɸ%).
La part des Þlles reste très inégale selon les séries POUR EN SAVOIR PLUS
Ư BELLAMY V., BLANCH É., GASQ P.-O., GEORGE E., 2018, «ɸLes élèves du second degré
à la rentréeɸ2018ɸ: plus de collégiens et moins de lycéensɸ», Note d’information, n°ɸ18.28,
Dans la voie générale, les Þlles sont largement majoritaires en lettresɸ:
MENJ-MESRI-DEPP.
près de 4ɸ élèves sur 5 sont des Þlles dans cette Þlière et cette part
n’a guère varié depuis 10 ans f 3.3. Elles sont aussi majoritaires, mais
–ɸMEN-MESRI-DEPP, 2018, Repères et références statistiques sur les enseignements,
laɸformation et la recherche, Paris, chapitre 4.
moins fortement, en série économique et sociale (60,4ɸ%). Elles sont –ɸFilles et garçons sur le chemin de l’égalité de l’école à l’enseignement supérieur,
MEN-MESRI-DEPP, 2018.
en revanche minoritaires en série scientiÞque (47,2ɸ %). On notera
–ɸMENESR-DEPP, 2017, Géographie de l’École, Paris, indicateur 9.
quelques évolutions sur les 10ɸdernières années concernant ces deux
sériesɸ: la part des Þlles en série scientiÞque a progressé de 1,5 point
alors qu’elle a diminué de 1,9 point en Þlière économique et sociale. Méthodologie et DéÞnitionsŵp. 68
14 L’état de l’École 2018ŴŴLes élèvesVous pouvez aussi lire