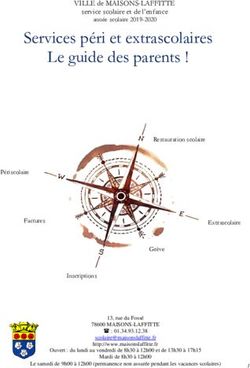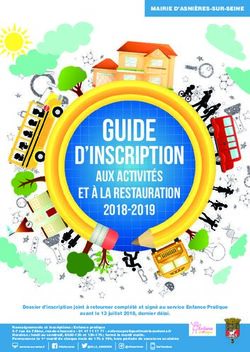La filière de la plongée sous marine dans les Pyrénées Orientales 2019
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Edito Méthodologie
Les spots de plongée sous‐marine dans le Dès le mois d’octobre 2018, la CCI des PO a travaillé
département des Pyrénées‐Orientales sont de avec des représentants de l’association GS3PO
véritables atouts pour le développement de cette (groupement associatif des professionnels de la
activité sportive : Parc National Marin du Golfe du Lion, plongée dans les Pyrénées‐Orientales) dans le but de
Réserve Naturelle Marine de Cerbère‐Banyuls, sentier mieux appréhender le fonctionnement et
sous‐marin. La plongée est une activité touristique qui l’organisation de cette activité dans le département.
a son importance dans un département touristique qui Ces entretiens ont conduit à la réalisation d’un
attire 8 millions de visiteurs par an. questionnaire en ligne auprès des acteurs
professionnels de la plongée. L’ensemble de ces
données a permis d’avoir un état des connaissances
De la côte sablonneuse aux fonds rocheux de la Côte
des activités de plongée : structuration,
Vermeille, du Nord au Sud, tout invite à d’inoubliables
fonctionnement, activités, clientèle… Par ailleurs, ce
plongées. Et, les lacs de montagne (Balcère et
travail de collecte des données a également été
Matemale) permettent également de plonger sous la
l’occasion de recueillir des éléments sur les enjeux
glace.
(besoins et attentes) pour les acteurs, qui pourront
ensuite être valorisés lors de l’élaboration d’un plan
Fort de ces nombreux atouts naturels, des
d’actions.
professionnels accompagnent les plongeurs français et
étrangers à la découverte de la richesse sous‐ marine
de notre département. Cette étude porte uniquement sur l’analyse des
structures commerciales. Les clubs associatifs qui
La CCI des Pyrénées‐Orientales dans son rôle de sont également des acteurs de la filière n’ont pas été
représentant des entreprises, souhaite assurer le pris en compte.
développement de cette filière.
Un questionnaire a donc été diffusé par mail auprès
Ce document est une première étape permettant de des 17 professionnels basés dans le département
dresser un état des lieux de la filière afin de des Pyrénées‐Orientales courant décembre 2018. Ils
comprendre sa diversité et son poids dans l’économie ont tous répondu à cette enquête ce qui nous
locale. permet d’avoir une vision globale et exhaustive. Afin
de respecter la confidentialité des données
communiquées, celles‐ci sont traitées de façon
collective et anonyme et ne feront pas l’objet d’une
Bernard FOURCADE utilisation à des fins commerciales.
Président de la CCI
des Pyrénées‐Orientales
2Rappel historique de la plongée en France
« La plongée sous‐marine consiste à descendre sous la surface de l’eau, munie d’appareils divers, soit à titre sportif,
soit à des fins scientifiques ou militaire ». (Définition Dictionnaire Larousse). Elle se pratique selon deux grandes
disciplines fondamentalement différentes : la plongée en apnée, ou plongée libre, et la plongée en scaphandre
autonome, qui est la plus pratiquée.
La plongée libre autorise en apnée les plongées les plus extrêmes. La descente se fait à l'aide d'une gueuse le long
d'un câble et la remontée grâce à un ballon.
En plongée en scaphandre autonome, trois types d'appareils peuvent être utilisés : à circuit ouvert, fonctionnant
avec de l'air ; à circuit fermé, fonctionnant avec de l'oxygène ; à circuit demi‐fermé, fonctionnant avec des mélanges
divers. Les deux derniers types d'appareils sont surtout utilisés par les nageurs de combat.
Au début du XXème siècle, la plongée sous‐marine était essentiellement pratiquée par les militaires et les
scientifiques.
La Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous‐Marin (FFESSM) a été créé en 1948. Elle regroupe les clubs de
chasseurs sous‐marins et les études sous‐marines. La plongée de loisir avec scaphandre n’existe pas encore.
C’est dans les années 1950 que la plongée sous‐marine s’est démocratisée avec le développement de nouveaux
matériels de plongée, permettant ainsi de pratiquer une activité sportive. Jean‐Yves Cousteau, explorateur
océanographique, a perfectionné le principe du scaphandre autonome et inventé le détendeur, pièce essentielle à la
plongée sous‐marine. D’autre part, en réalisant des films et documentaires télévisés de ces explorations sous‐marine
(Le Monde du Silence /1956, Histoire d’un poisson rouge / 1958, Voyage au bout du monde/1976), il a également fait
partager sa passion à de nombreux français. A cette époque, la plongée est pratiquée essentiellement dans le cadre
associatif. Et, face au développement de cette pratique de loisir, de nouveaux métiers d’encadrants sont apparus :
les moniteurs de plongée.
Dans les années 1960‐1970, deux organismes regroupant ces professionnels sont créés : le Syndicat National des
Moniteurs de Plongée (SNMP) et l’Association Nationale des Moniteurs de Plongée (ANMP). A ce moment‐là, les
structures commerciales agréées (SCA) ont commencé à voir le jour et les moniteurs de plongée sont devenus des
acteurs professionnels indépendants.
En 1987, la FFESSM comptait environ 100 000 licenciés. Après la sortie du film « Le Grand Bleu » en 1988, par Luc
Besson, le nombre de licenciés a atteint les 150 000 licenciés en quelques mois. En 1998, un pic historique est
enregistré avec 156 700 licenciés. Le rôle et les missions de la FFESSM sont de promouvoir les différentes activités de
la plongée sous‐marine : plongée bouteille, randosub (snorkeling), l’archéologie, la biologie, l’environnement, les
disciplines sportives…. Comme toutes les fédérations françaises, elle se décline en comités régionaux et
départementaux.
En 2018, la FFESSM recenserait 140 700 licenciés (toutes disciplines confondues). Cette baisse de licenciés (qui touche
également les autres fédérations sportives) s’expliquerait par un contexte économique difficile et une baisse du
pouvoir d’achat de la population.
Cependant, il n’est pas obligatoire d’être licencié dans un club (associatif ou commercial) pour pratiquer la plongée
de découverte, ce qui rend difficile le recensement des plongeurs. On dénombrait toutefois 300 000 plongeurs actifs
en France en 2019. L’intérêt d’une licence est de participer à des activités au sein des clubs mais également de suivre
des formations.
3Les activités de plongée sous‐marine en France
La pratique de la plongée en France au sein d’un club associatif ou d’une structure professionnelle est soumise aux
règles de sécurité définies par l’art A322‐78 du Code du Sport et légiférées par l’arrêté du 5 janvier 2012. Car, elle
n’est pas sans risque pour le corps humain si des protocoles stricts ne sont pas respectés : accidents de décompression,
barotraumatismes ….
D’autre part, l’arrêté du Préfet maritime de la Méditerranée n°125/2013 complète cette règlementation au vu des
règles de navigation et des sites de plongée.
Les activités de plongée sous‐marine nécessitent un équipement de base du plongeur permettant ainsi de respirer de
l’air dans un environnement présuré.
Source : forum‐MDP.com
A partir de cet équipement, le plongeur peut pratiquer diverses activités qui permettent d’observer les fonds marins
et la faune. Mais, la plongée peut également être pratiqué dans des rivières, des lacs ou des piscines.
Dans les Pyrénées‐Orientales, nous retrouvons l’ensemble de ces lieux de pratique : plongée en eau douce dans les
lacs de montagne (Balcère et Matemale), plongée dans des complexes aquatiques (Vernet‐les Bains, Perpignan…),
plongée dans la Mer Méditerranée.
Les activités sont bien évidemment différentes en fonction des sites de pratique. On s’intéressa donc plus
particulièrement aux activités de plongée dans la Mer Méditerranée car c’est la plus développée dans le
département. D’autre part, la plongée dans les complexes aquatiques est souvent pratiquée par des clubs associatifs
(hors de notre contexte d’étude).
• La randonnée palmée ou le snorkeling : La randonnée palmée peut être une première étape avant le baptême de
plongée afin de s’habituer aux fonds marins. C’est une activité facile, accessible à tous et qui nécessite peu
d’équipements : palmes, masque, tuba.
• Le baptême de plongée : Le baptême de plongée permet la découverte de la faune et de la flore sur des sites de
plongée. L’instructeur fournit l'équipement nécessaire pour plonger (combinaison, masque, palmes, gilet stabilisateur,
etc.…). L’immersion en baptême se déroule entre 0 et 6 mètres. Il n’est pas nécessaire d’avoir une formation pour
faire un baptême de plongée.
• Les sorties en mer ou plongée d’exploration : La plongée d’exploration est une balade subaquatique afin d’observer
le milieu aquatique marin. Ces plongées peuvent s’effectuer en groupe et nécessitent un niveau de formation
minimum en fonction de la profondeur d’exploration. Elles sont plutôt réservées à des plongeurs formés. Elles
permettent de découvrir des épaves ainsi que des sites naturels : Réserve Marine de Cerbère/Banyuls, Réserve
Naturelle du Cap Creus….
4Zoom sur les activités de plongée dans le département
La totalité des clubs de plongée du département dispensent des baptêmes de plongée et des formations.
Viennent ensuite les sorties en mer (plongée simple, plongée avec encadrement) et les randonnées palmées
(découverte snorkeling). 94% des professionnels proposent ces activités.
La location de matériel est une prestation très souvent proposée par les professionnels alors que la vente
de matériel est moins développée car cela nécessite des capacités de stockage plus importantes pour
proposer différents produits. Les professionnels semblent laisser ce pan d’activités aux magasins spécialisés.
D’autres prestations plus spécifiques sont également offertes par quelques clubs de plongée tels que la plongée sous
glace, des stages photos ou encore des stages pour enfants, des stages d’apnée. Ces activités demandent toutefois
des compétences bien spécifiques de la part des encadrants générant parfois des coûts supplémentaires pour les
structures commerciales.
Types de prestations proposées par le club de plongée
Type de prestation Nombre %
de club
Baptême de plongée 17 100%
Formations 17 100%
Plongée simple (sans encadrement) 16 94%
Plongée avec encadrement 16 94%
Rando palmée 16 94%
Station de gonflage 13 77%
Location de matériel 11 65%
Vente de matériel 8 47%
Plongée sous glace 4 24%
Stage photo 4 24%
Autre (stage apnée, bio, handi…) 3 18%
Source : CCI des PO – enquête professionnels de la filière – données 2018
5Les formations de plongée sous‐marine en France
En France, la plongée à l’air est limitée à – 66 mètres.
Cette pratique demande de disposer de notions de sécurité en fonction des paliers de profondeur. Il existe donc de
multiples formations pour les plongeurs permettant ainsi de pratiquer la plongée sous‐marine et de gagner en
autonomie.
Tableau des conditions de pratique de la plongée en milieu naturel
Profondeur Activité Formations requises
0à6m Snorkeling / Baptême de Aucun
plongée
6 à 12 m Plongée d’exploration Niveau I (PA112)
12 à 20 m Plongée d’exploration Niveau II (PA20 – PE220)
20 à 40 m Plongée d’exploration Niveau II (PA40 – PE40)
40 à 60 m Plongée d’exploration Niveau III (PA60 – PE60)
Source : forum‐MDP.com
Les trois premiers niveaux (N I, N II et N III) sont des diplômes permettant de faire des plongées d’exploration.
Le niveau I représente 64% des qualifications délivrées en 2006 et 2015 sur la façade méditerranéenne 3.
Le niveau III permet d'aller à 60 mètres sans moniteur et d'organiser des plongées entre plongeurs de même niveau.
Le niveau IV permet d’encadrer un groupe de plongeurs ayant les mêmes paramètres de plongée (en durée et en
profondeur). On parle ainsi de guide de palanquée.
Enfin, la plongée au trimix ou nitrox (mélange remplaçant l’air dans les bouteilles) requiert une qualification
particulière. Ce type de plongée est bien développée sur la façade méditerranéenne en raison de la facilité d’accès aux
formations et au développement de la gratuité du nitrox mais également car cette pratique permet une fatigue moins
importante des plongeurs avec des plongées successives plus longues et sans palier. Elle s’adresse plutôt à des
plongeurs habitués, experts.
L’enseignement de la plongée sous‐marine est dispensé en France par des moniteurs professionnels ou associatifs
avec quatre niveaux d’encadrement.
Les niveaux d’encadrement des moniteurs de plongée
Profondeur Niveau d’encadrement
0à6m E1 : initiateur
6 à 20 m E2 : initiateur + guide de palanquée
20 à 40 m MF1 ou E 3 : Moniteur
40 à 60 m Mf2 ou E 4 : Moniteur de moniteur
1
PA= Plongeur en autonomie
2
PE = Plongeur encadré
3
Source : Etude BRL – Etat des connaissances des activités de plongée subaquatiques sur la façade méditerranéenne et appui à l’élaboration d’une stratégie de
gestion durable des sites de plongée
6Zoom sur les formations délivrées dans le département
Les différentes formations proposées par les structures professionnelles
Formation découverte 94%
Formation Initiation 94%
Formation Niveau I 94%
Formation Niveau III 88%
Formation Niveau II 82%
Formation Niveau IV 77%
Formation Nitrox 77%
Formation Scuba 59%
Formation Encadrement 59%
Permis bateau 12%
Autre 6%
Source : CCI des PO – enquête professionnels de la filière – données 2018
Les trois types de formation généralement proposées dans les 17 clubs de plongée sont :
• la formation découverte, dispensée par 94% des professionnels
• la formation initiation,
• et la formation Niveau I.
94% des professionnels dispensent ces formations.
Ainsi, les clubs de plongée du département travaillent principalement avec des plongeurs débutants. Ce public ne
cherche pas obligatoirement une grande autonomie mais plutôt un encadrement et un appui pour chaque plongée.
L’intérêt est donc la découverte du milieu sous‐marin. Il s’agit d’une activité sportive de loisir.
On note toutefois que 88% des clubs de plongée dispensent également des formations pour des plongeurs
confirmés (formation niveau III) et 77% des formations de Niveau IV. Toutefois, selon les professionnels, les deux
formations les plus commercialisées sont celles de Niveau I et la formation découverte.
Le public des clubs de plongée est composé majoritairement d’adultes. Parmi eux, on retrouve des plongeurs
habitués mais également des moniteurs qui souhaitent se former.
7Les structures de plongée en France
En France, les structures de plongée sont soit associatives, soit commerciales. Toutes ces structures sont affiliées à
minima à l’un des principaux systèmes français de plongée : FFESSM, ANMP (Association Nationale des Moniteurs de
Plongée) ou FSGT (Fédération Omnisport).
En 2019, la France regrouperait 2 200 clubs associatifs et 420 structures professionnelles. 61,5% des structures
commerciales de métropole sont situées dans les départements littoraux méditerranéens.
Sur le pourtour méditerranéen, 67% des structures sont des clubs associatifs contre 33% des structures
commerciales.
Carte extraite de l’étude BRL – Etat des connaissances des activités de plongée subaquatiques sur la façade
méditerranéenne et appui à l’élaboration d’une stratégie de gestion durable des sites de plongée
8Zoom sur les structures commerciales dans le département
Au niveau du département des Pyrénées‐Orientales, la FFESSM dénombre 19 clubs associatifs et 17 structures
commerciales en 2019, soit au total 36 centres de plongée. Il y a globalement le même nombre de clubs associatifs
que de structures commerciales.
58% des structures de plongée sont situées sur le littoral roussillonnais. La totalité des structures commerciales sont
présentes le long du littoral ainsi quelques clubs associatifs (sur les communes de Banyuls sur Mer, Port‐Vendres,
Saint‐Cyprien, Canet‐en‐Roussillon, Sainte‐Marie et Le Barcarès).
Les clubs associatifs sont localisés à l’intérieur du territoire dont 11 clubs sur la commune de Perpignan, ce qui reste
toutefois proche du littoral méditerranéen et facile d’accès.
Localisation des structures commerciales sur le département
Le territoire de concentration des structures commerciales des centres de
plongée est la Côte Rocheuse. Elles sont localisées à proximité des
principaux sites de plongée du département : sentier sous‐marin, sites
d’épaves, réserve naturelle marine…
Ainsi, 10 structures commerciales sont présentes sur les 4 communes de
cette partie littorale du département : Cerbère, Banyuls sur Mer, Port‐
Vendres et Collioure.
La commune d’Argelès‐sur‐Mer (littoral sableux mais à proximité immédiate
de la côte rocheuse) compte 4 centres de plongée.
Depuis ces dernières années, le nombre de structures commerciales est
resté relativement stable dans le département, ce qui n’est pas le cas au
niveau de la façade méditerranéenne qui a connu une augmentation des
structures commerciales, notamment en Provence Alpes Côte d’Azur4. Cette
évolution en région PACA s’explique en partie par la mutation des clubs
associatifs vers le système commercial.
Source : CCI des PO – enquête professionnels de la filière – données 2018
En revanche, du fait d’une forte proportion des structures commerciales dans le département des Pyrénées‐Orientales
(47% des centres de plongées), ce phénomène ne s’est pas fait ressenti sur le territoire (quasi‐égalité du nombre de
clubs associatifs et de structures commerciales).
Selon les données recueillies auprès des professionnels, la plus ancienne structure commerciale existe depuis 1954.
Depuis ces trois dernières années, on note un certain dynamisme puisque trois centres de plongée ont été créée sur
la commune de Port‐Vendres.
4
Source : Etude BRL – Etat des connaissances des activités de plongée subaquatiques sur la façade méditerranéenne et appui à l’élaboration d’une stratégie de
gestion durable des sites de plongée
9Les principales caractéristiques des structures commerciales
Les centres de plongée professionnels exercent généralement leur activité sur 8 mois de l’année même si certains
travaillent toute l’année sur réservation. Le début de la saison commence au mois d’avril pour se clôturer au mois de
décembre. Il y a peu de variation d’une année sur l’autre. Par contre, les conditions météorologiques conditionnent
fortement leur niveau d’activité.
Selon les informations recueillies auprès des professionnels, 65% d’entre eux n’exercent pas d’autres activités en
dehors de l’encadrement de plongée sous‐marine.
Les équipements des structures commerciales
Les navires
Afin de se rendre sur les sites de plongées, les structures commerciales disposent à minima d’un bateau.
44% des structures commerciales du département possèdent deux navires. Au total, cela représente une flotte de
25 navires.
Deux types de bateaux sont utilisés par les professionnels : des vedettes et des semi‐rigides, avec une légère
prédominance des bateaux semi‐rigide.
Les navires semi‐rigides assurent un accès rapide aux zones de plongée ce qui permet de rotations plus rapides et plus
nombreuses. Par contre, les vedettes permettent de transporter un plus grand nombre de plongeurs et proposent un
meilleur confort aux pratiquants (ex : toilettes, possibilité de se changer…).
Exemple de vedette Exemple de semi‐rigide
Les navires de professionnels de la plongée sont amarrés dans les ports de plaisance des communes où sont situés
les centres de plongée. Dans l’ensemble, les professionnels louent des emplacements annuels dans les ports. Le coût
annuel de location d’un emplacement dans un des ports du littoral roussillonnais s’élève à 2 200 € TTC. Ce coût peut
être multiplié par dix en fonction des caractéristiques du port : de 400 € à 4 000 €.
Les locaux professionnels
Même si leur principale activité se déroule à l’extérieur et en milieu marin, les structures commerciales disposent
d’un local professionnel afin de renseigner leur clientèle, de permettre aux plongeurs de s’équiper avant leur sortie
en mer ou encore d’assurer des formations.
82 % des professionnels sont locataires de leur local professionnel. La surface moyenne du local est de 83 m². Plus
de la moitié des clubs de plongée utilise également une surface extérieure. La surface moyenne extérieure occupée
est de 90 m², ce qui double la surface moyenne utilisée. Dans quelques cas, la surface extérieure est même
supérieure à la surface intérieure.
10Les contraintes rencontrées par les professionnels
Problème lié à l’utilisation du domaine public 41%
Manque de visibilité 35%
Exiguïté des locaux 35%
Problème de mises aux normes (accessibilité,
sanitaires, douches..)
29%
Vétusté des locaux 29%
Conflit de voisinage 12%
Aucune contrainte 12%
Loyer excessif 6%
Source : CCI des PO – enquête professionnels de la filière – données 2018
Selon les professionnels, la principale contrainte à laquelle ils doivent faire face est liée à l’utilisation du domaine
public. En effet, au sein des ports de plaisance on retrouve plusieurs activités et un public varié en période estivale
: pêcheurs, plaisanciers, centres de plongée, touristes, commerçants… Et, parfois, cette cohabitation génère des
conflits d’usage.
Les deux autres contraintes concernent directement le local professionnel puisqu’il s’agit de problème de visibilité
et d’exiguïté et manque de confort des locaux. Ce manque de lisibilité est généralement dû à une absence de
signalétique directionnelle.
Les services proposés à la clientèle au sein de leur local
Douches 88%
Vestiaire 88%
Local pour le matériel 81%
Sanitaires 81%
Salle de cours 69%
Source : CCI des PO – enquête professionnels de la filière – données 2018
La majorité des clubs de plongée du département proposent à leurs clients des vestiaires pour se changer ainsi que
des douches. Un professionnel a indiqué disposer également de bacs de rinçage pour les combinaisons.
Dans la plupart des cas, les structures commerciales sont également équipées de sanitaires et de local pour stocker le
matériel.
Enfin, certaines structures disposent de salles de cours afin de dispenser des formations.
Il s’agit de services « minimum » proposés à la clientèle. L’un des enjeux consistera à développer les services à
destination des plongeurs qui recherchent davantage de confort et de services (exemple : ascenseur bateau, système
de séchage des combinaisons, espace pique‐nique …).
11Le poids économique des structures commerciales des
Pyrénées‐Orientales
Les emplois
En termes d’emploi, la saisonnalité est très marquée dans les structures commerciales et les emplois permanents sont
peu nombreux. Il s’agit principalement du dirigeant de la structure. Les contrats saisonniers sont signés
essentiellement d’avril à octobre avec un pic entre juillet et août. Les mois de juin et septembre comptent également
une part importante de saisonniers dans les centres de plongée.
Selon les données de la FFESSM, en France, les effectifs sur l’ensemble de la filière plongée (clubs associatifs et
structures commerciales) sont estimés à 2 000 emplois permanents et saisonniers. 56% de ces emplois sont localisés
sur le pourtour méditerranéen et parmi eux, 24% dans les départements de la région Occitanie (Pyrénées‐Orientales,
Aude, Hérault et Gard), soit environ 270 emplois.
Dans le département des Pyrénées‐Orientales, en 2018, les 17 structures commerciales ont généré près de 80 emplois
dont 70% sont des emplois saisonniers. Le ratio permet d’indiquer une moyenne de 5 emplois par structure
commerciale sur le département pour un ration moyen de 4 emplois par structure commerciale au niveau national5.
Le chiffre d’affaires
Les structures commerciales de plongée sont des activités saisonnières qui doivent faire leur chiffre d’affaires sur 6 à
7 mois de l’année avec un pic d’activité durant 2 mois.
Selon les données communiquées par les professionnels, le chiffre d’affaires annuel pour une structure commerciale
dans le département des Pyrénées‐Orientales s’élèverait en moyenne à 121 300 €, soit au total un chiffre d’affaires
global de près de 2 millions d’€. Ce chiffre d’affaires par structure commerciale est variable en fonction de la taille du
club et de la période d’ouverture. Il peut osciller entre 15 000 € et 250 000 € par an.
Selon les données FFESSM sur les structures commerciales du pourtour méditerranéen en 2016, l’estimation du chiffre
d’affaires généré par ces centres professionnels s’élèverait à près de 24 millions d’€., avec un chiffre d’affaire moyen
de 90 000 €/ an pour les structures commerciales.
Environ 57% du chiffre d’affaires est généré par les structures commerciales de la région PACA et 19% par celles de la
région Occitanie. La Corse contribuerait à 24% du CA global des structures commerciales du pourtour méditerranéen.
La FFESSM indique que le chiffre d’affaires global généré par la plongée sous‐marine en France s’élèverait à 71 millions
d’€ en 2016 (structures commerciales et clubs associatifs confondus). Ainsi, la filière plongée dans le département
représenterait 3% du chiffre d’affaires global national.
Depuis ces trois dernières années, on note une amélioration de la situation financière des structures commerciales
dans le département puisque 59% des professionnels ont enregistré une hausse de leur chiffre d’affaires.
Evolution du CA Depuis ces 3 dernières années, comment a évolué votre chiffre
depuis 3 ans
59% 24% 18%
Source : CCI PO / enquête professionnels
5
Source : Etude BRL – Etat des connaissances des activités de plongée subaquatiques sur la façade méditerranéenne et appui à l’élaboration d’une stratégie de
gestion durable des sites de plongée
12Les professionnels de ce secteur doivent s’adapter aux nouveaux modes de consommation des touristes et faire face
à la concurrence d’autres pays et destinations de plongées. Pour cela, les professionnels ont été amenés à diversifier
leur activité.
Répartition du chiffre d’affaires par poste d’activité
Baptême de plongée Sorties en mer Formations Snorkeling ou Vente accessoires Location matériel
rando palmée
29% 36% 24% 5% 3% 3%
Source : CCI des PO – enquête professionnels de la filière – données 2018
Les sorties en mer (plongée d’exploration) restent les principales recettes financières pour les clubs de plongée. En
moyenne, cela représente 36% du montant du chiffre d’affaire annuel.
Viennent ensuite les baptêmes de plongée qui représentent 29% de part du CA, suivi des formations (24%).
Les activités de snorkeling (rando palmée) et la vente et location de matériel et accessoires sont des activités
secondaires dans l’activité et le poids économique des structures commerciales de plongée.
Les plongeurs
Sur le marché européen, on totaliserait 3 millions de plongeurs actifs, dont 75% choisissent la Méditerranée comme
destination de plongée. La France compterait 300 000 plongeurs et 70 000 plongeurs dans les départements littoraux
méditerranéens dont 64% en région PACA.
97% des plongeurs sont licenciés à la FFESSM et 3% à la FSGT.
Dans le département des Pyrénées‐Orientales, selon les données de la FFESSM, on dénombrerait près de 1 000
plongeurs licenciés (clubs associatifs ou structures commerciales).
D’après les données des professionnels de la filière, 61 000 plongées sont effectuées par an, soit une moyenne de
3 800 plongées / structures commerciales. Ce chiffre englobe la pratique de la plongée par des licenciés dans le
département mais également une clientèle de plongeurs venant de l’extérieur du département.
Depuis ces trois dernières années, 56% des professionnels connaissent une hausse du nombre de plongées dans leur
structure contre 12% qui voient une diminution.
Evolution du Depuis ces 3 dernières années, le nombre de plongée dans votre club est :
nombre de plongée
56% 31% 12%
Source : CCI PO / enquête professionnels ‐ 2018
13Les relations commerciales des structures commerciales
du département
Les fournisseurs
Les professionnels travaillent avec d’autres professionnels du
département, spécialisés dans la vente, réparation et
maintenance des bateaux. Ces fournisseurs sont généralement
implantés au sein des communes du littoral catalan.
Source : CCI des PO – enquête professionnels de la filière – données 2018
Par contre, ils travaillent avec des fournisseurs situés à l’extérieur du département pour l’acquisition et la
réparation du matériel de plongée. Ainsi, ils se dirigent vers le département des Alpes Maritimes pour les
fournitures et matériel de plongée car on y retrouve les entreprises leader de ce marché et vers la région
toulousaine pour les travaux de réparation de ce même matériel.
La clientèle
La clientèle des centres de plongée est composée majoritairement de touristes. Cette clientèle est cependant une
clientèle de proximité puisque les plongeurs proviennent essentiellement de la région Occitanie et plus
particulièrement sur les ailes de saison (avril/mai/septembre). Cette proximité permet de souligner que cette
clientèle touristique est présente durant toute la saison. Durant l’été, des plongeurs provenant d’autres régions
françaises (Ile de France, PACA) complètent cette clientèle touristique de proximité.
Par leur faible nombre (1 000 licenciés), les plongeurs du département demeurent minoritaires dans la clientèle
des structures commerciales. Les plongeurs des clubs associatifs du département plongent essentiellement du bord,
sauf pour les plongées sur épaves. Ils utilisent les structures commerciales pour des destinations dont ils ne
connaissent pas la topographie des fonds sous‐marins (exemple : région PACA, Iles Mèdes, Egypte)
Les structures commerciales travaillent aussi avec des groupes de plongeurs. Il s’agit principalement de clubs de
plongée associatifs hors département. Selon le ressenti des professionnels de la filière, ce type de clientèle est plus
présenté sur la période d’avril à juin (avant saison).
Depuis ces trois dernières années, 53% des professionnels connaissent une hausse de la fréquentation de leur
clientèle contre seulement 6% qui enregistre une baisse.
Evolution de la clientèle Depuis ces 3 dernières années, votre clientèle est :
depuis 3 ans
53% 41% 6%
Source : CCI PO / enquête professionnels ‐ 2018
14Les attentes des professionnels des centres de plongée
professionnels du département
Les efforts d’investissements
Une large majorité de professionnels ont réalisé des investissements depuis ces deux dernières années.
Le montant moyen annuel de réinvestissement s’élèverait à 33 000€. Cela portait sur l’acquisition ou le
renouvellement d’équipements (bateaux, compresseurs), mais également sur des achats de matériels de plongée
destinés à la location. En raison d’un règlement strict en matière de sécurité, ces investissements semblent
quasiment indispensables afin de garantir la pérennité et le sérieux de l’entreprise.
Certains professionnels ont également effectué des travaux de rénovation de leur local.
82% des professionnels envisagent d’investir à nouveau dans les 3 ans à venir.
L’achat et le renouvellement du matériel de location demeurent une priorité en raison de contraintes réglementaires
et sécuritaires exigées par la pratique de cette activité sportive.
Les travaux de rénovation des locaux sont également d’actualité.
Enfin, sept professionnels envisagent de diversifier leur activité sûrement afin d’apporter de nouveaux services à leur
clientèle en raison de la volatilité des touristes et d’une compétitivité accrue entre les différentes destinations de
plongée.
Les principaux freins au développement
Concurrence d'autres destinations de 77%
plongée
Recrutement / formation du personnel 71%
Déficit de communication de la filière 59%
Manque de bouées d'amarrage 53%
Source : CCI des PO – enquête professionnels de la filière – données 2018
La concurrence avec d’autres destinations de plongée est un frein au développement des structures commerciales
du département (77% des professionnels semblent impactés par cette concurrence). Même si la Côte Rocheuse est
une destination très attractive le long du littoral languedocien, elle reste toutefois moins fréquentée que les sites
de la Côte d’Azur et des sites espagnols (Iles Medès).
Le recrutement et la formation du personnel est également une réelle difficulté pour les professionnels car
l’encadrement de la plongée demande des compétences techniques et réglementaires très précises (71% des
professionnels sont concernés). En règle générale, les moniteurs restent entre 3 et 5 ans dans la profession6.
Enfin, 59% des professionnels déplorent un déficit de communication sur la filière « plongée » dans le
département ce qui est un obstacle pour son développement.
6
Source : Chiffres clés de la plongée
15 Les pistes d’amélioration
59% des professionnels n’ont pas de labellisation.
Créer une destination PO
pour la plongée
Développer des Par contre, 88% des professionnels sont intéressés pour
partenariats avec les créer un label « Plongée dans les PO ».
collectivités Animations autour
de la plongée L’ensemble des professionnels sont adhérents à la FFESSM et
une large majorité sont membres de l’association
départementale GS3 PO.
A travers cette interrogation sur les points à améliorer pour favoriser l’attractivité des centres de plongée dans le
département, nous ressentons bien une volonté commune de travailler à la structuration et la promotion de la
plongée dans le département autour de trois axes :
‐ La création d’une destination PO pour la plongée (88% des professionnels)
‐ Le développement de partenariats avec les collectivités (71% des professionnels)
‐ La mise en place d’animations autour de la plongée (53% des professionnels).
16Ce qu’il faut retenir
17 structures 2 millions d’€ de
professionnelles 80 emplois chiffres d’affaires 61 000
et 19 clubs dont 70% de plongées par an
générés par les
associatifs saisonniers
structures
commerciales
Points forts Points de vigilance
Une forte représentativité des structures La pérennité des structures commerciales
commerciales parmi l’ensemble des clubs de remise en cause avec l’utilisation d’occupation
plongée du département du domaine public
Un niveau d’activité en progression pour une Un manque de visibilité et de signalétique des
majorité de professionnels et qui réinvestissent professionnels au sein des ports de plaisance
régulièrement dans le renouvellement de leur
équipement (navires, matériel de plongée
Des professionnels ayant un impact sur le Une exiguïté et un manque de confort des
comportement de leur clientèle qui est de plus en locaux avec 82% des professionnels locataires
plus sensible à la protection de l’environnement d’où un risque de déménagement
naturel
Un taux de fréquentation des centres de plongée à Un manque de personnel lié à l’absence de
la hausse dans le département formation dans le département
La concurrence d’autres destinations de plongée
Les enjeux
• Développer des aménagements de qualité pour l’accueil des plongeurs
• Proposer une offre produit touristique « Destination plongée PO »
• Créer un label ou une marque « Plongée dans les PO » et en assurer la promotion
• Organiser des évènements autour de la plongée ou des activités de pleine nature
17Pour en savoir plus à la CCI des PO :
Pôle Tourisme : 04 68 35 98 77
Pôle Etudes et Territoires : 04 68 35 98 88
www.pyrenees‐orientales.cci.fr
18Vous pouvez aussi lire