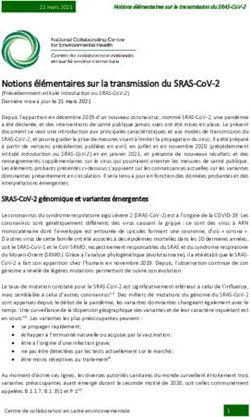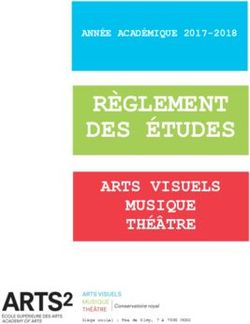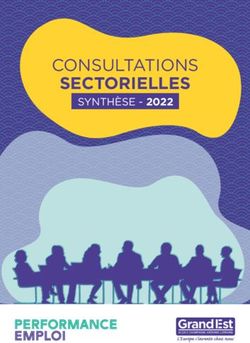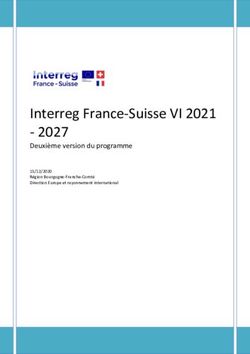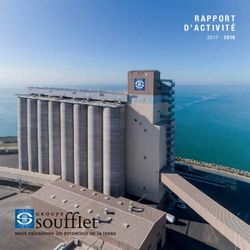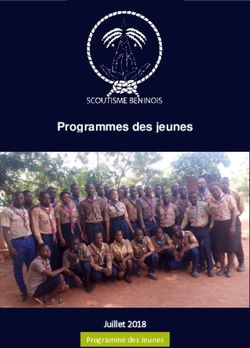Le rôle des symptômes dépressifs et de la sensibilité des pères dans le développement de problèmes intériorisés et extériorisés à la petite ...
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Le rôle des symptômes dépressifs et de la sensibilité
des pères dans le développement de problèmes
intériorisés et extériorisés à la petite enfance
Mémoire doctoral
Andréanne Beaupré
Doctorat en psychologie
Docteure en psychologie (D. Psy.)
Québec, Canada
© Andréanne Beaupré, 2021Le rôle des symptômes dépressifs et de la
sensibilité des pères dans le développement
de problèmes intériorisés et extériorisés à la
petite enfance
Mémoire doctoral
Andréanne Beaupré
Sous la direction de :
Célia Matte-Gagné (Ph.D.), directrice de recherche, Université LavalRésumé
Un nombre restreint, mais croissant d’études suggèrent que les comportements paternels
jouent un rôle dans le développement socioaffectif de l’enfant et que les problèmes de santé
mentale peuvent se transmettre du père à l’enfant. Par contre, rares sont les études qui ont été
réalisées durant la petite enfance et qui se sont intéressées au rôle des pratiques paternelles
dans la transmission intergénérationnelle de la psychopathologie. Ce mémoire a pour objectif
d’examiner le rôle de la sensibilité paternelle et des symptômes dépressifs du père dans le
développement de problèmes intériorisés et extériorisés à la petite enfance. L’échantillon de
l’étude réalisée comprend 91 familles (père, mère, enfant) qui ont été rencontrées à leur
domicile lorsque les enfants étaient âgés de 12 mois. Les symptômes dépressifs des pères et
des mères ont été mesurés à l’aide du Beck Depression Inventory. La sensibilité des deux
parents a été mesurée de manière observationnelle à l’aide d’un système de codification basé
sur l’analyse des interactions parent-enfant lors d’une rencontre à domicile d’une durée de
90 minutes. Les problèmes intériorisés et extériorisés de l’enfant ont été mesurés à l’aide du
Brief Infant Toddler Social Emotional Assessment, un questionnaire complété par les deux
parents séparément. Des analyses corrélationnelles et de régression ont été effectuées. Les
résultats suggèrent que les symptômes dépressifs et la sensibilité du père contribuent de façon
unique à la prédiction des problèmes intériorisés et extériorisés de l’enfant, et ce, au-delà des
facteurs propres à la mère. Les résultats de ce mémoire soulignent le rôle que joue le père
dans le développement socioaffectif de l’enfant et la transmission intergénérationnelle de la
psychopathologie.
iiTable des matières
Résumé .................................................................................................................................... ii
Table des matières................................................................................................................... iii
Liste des tableaux .................................................................................................................... iv
Remerciements ........................................................................................................................ v
Introduction ............................................................................................................................. 1
Les premières années de vie et l’environnement familial précoce ................................................. 2
Le rôle des pères .............................................................................................................................. 3
La sensibilité parentale ................................................................................................................... 4
La sensibilité parentale et les problèmes intériorisés et extériorisés de l’enfant ........................... 6
Transmission intergénérationnelle des problèmes de santé mentale ............................................. 8
La dépression parentale et les problèmes socioaffectifs chez l’enfant ........................................... 9
Les mécanismes de transmission intergénérationnelle de la psychopathologie ........................... 12
Récapitulatif .................................................................................................................................. 17
Chapitre 1 : Objectif ................................................................................................................ 19
Chapitre 2 : Méthode .............................................................................................................. 20
I. Participants ................................................................................................................................ 20
II. Mesures..................................................................................................................................... 20
III. Procédure ................................................................................................................................ 23
IV. Plan des analyses ..................................................................................................................... 23
Chapitre 3 : Résultats .............................................................................................................. 25
I. Analyses descriptives ................................................................................................................. 25
II. Analyses corrélationnelles préliminaires ................................................................................. 25
III. Analyses de régression ............................................................................................................ 27
Chapitre 4 : Discussion ............................................................................................................ 29
I. Contribution de la dépression paternelle .................................................................................. 29
II. Contribution de la sensibilité paternelle .................................................................................. 30
III. Contribution des variables maternelles.................................................................................. 34
IV. Limites de l’étude .................................................................................................................... 38
V. Forces de l’étude ....................................................................................................................... 41
Conclusion.............................................................................................................................. 44
Références ............................................................................................................................. 45
iiiListe des tableaux
Tableau 1 : Statistiques descriptives ................................................................................. 58
Tableau 2 : Corrélations entre les symptômes dépressifs et la sensibilité des parents et
les problèmes intériorisés et extériorisés de l’enfant ....................................................... 59
Tableau 3 : Analyses de régression permettant de prédire les problèmes intériorisés et
extériorisés de l’enfant à 12 mois ...................................................................................... 60
ivRemerciements
Le dépôt de ce mémoire doctoral marque la fin de mon parcours académique et mes débuts
dans le monde professionnel. Ce fut un parcours rempli de rencontres, d’expériences et
d’émotions. Je profite de la conclusion de cette étape pour offrir mes remerciements à ceux
qui ont été présents, de près ou de loin, tout au long de cette longue et belle aventure qu’est
le doctorat en psychologie.
Je tiens d’abord à remercier ma directrice de recherche, madame Célia Matte-Gagné, sans
qui rien de tout cela n’aurait été possible. Je te remercie de m’avoir accueilli dans ton équipe
et de m’avoir accompagné tout au long de mon doctorat. Je te remercie de l’immense
confiance avec laquelle tu m’as guidé, du respect dont tu as toujours fait preuve lors de nos
échanges, ainsi que du temps et de la passion que tu as investis dans la supervision de mon
projet. Je suis très reconnaissante de toutes les opportunités dont tu m’as fait profiter et
entame ma vie professionnelle avec une passion pour le développement de l’enfant plus
grande grâce à toi.
Je remercie également monsieur George Tarabulsy d’avoir encadré mon projet de mémoire
doctoral. Je suis reconnaissante du temps que vous avez investi à me lire et à assister à mes
séminaires. Votre expertise et vos conseils ont grandement influencé mes réflexions, et par
le fait même, ce document.
Merci à ma famille et mes amis pour leur soutien lors des beaux moments, ainsi que des
moments plus difficiles qui ont marqué mon cheminement. Un merci tout particulier à mes
parents, Michel et Marie-Claude, qui m’ont inculqué la curiosité, l’ambition et la
persévérance qui m’ont permis de relever ce défi qu’est le doctorat.
Je tiens à remercier toutes les familles qui ont accepté de participer à cette étude et qui nous
ont accueillis dans la beauté de leur quotidien. Sans eux, ce projet n’existerait pas.
Je remercie finalement le Centre de recherche universitaire sur les jeunes et les familles
(CRUJeF) pour son soutien financier dans la réalisation de mon mémoire doctoral.
vIntroduction
Le Système Canadien de Surveillance des Maladies Chroniques (2015) définit la
maladie mentale comme une altération de la pensée, de l’humeur ou du comportement de
l’individu qui est associée à un état de détresse et un dysfonctionnement marqué. La maladie
mentale peut avoir de sérieuses conséquences sur les apprentissages précoces, le
développement des compétences sociales et affectives et sur la santé en général, et ce, tout
au long de la vie (National Scientific Council on the Developing Child, 2012). Au Canada,
une personne sur cinq souffrirait d’une maladie mentale au cours de sa vie (Santé Canada,
2002). La maladie mentale peut frapper à tout âge, mais les premiers symptômes se
manifesteraient fréquemment dès l’enfance (Commission de la Santé Mentale du Canada,
2016; Gouvernement du Canada, 2006; Organisation mondiale de la Santé OMS, 2014).
D’ailleurs, selon les résultats d’une vaste étude longitudinale québécoise (Riberdy et al.,
2013), 50% des enfants québécois vont présenter un nombre élevé de symptômes intériorisés
ou extériorisés à un moment ou un autre de leur enfance. Les symptômes intériorisés sont
caractérisés par du retrait social, de l’anxiété, des sentiments dépressifs ou des manifestations
psychosomatiques. Les symptômes extériorisés englobent les comportements agressifs et les
manifestations comportementales du trouble des conduites, du trouble déficitaire de
l’attention avec ou sans hyperactivité et du trouble oppositionnel avec provocation
(Achenbach & Edelbrock, 1978). Les enfants présentant un niveau élevé de symptômes vont
être considérés comme ayant des problèmes intériorisés ou extériorisés. Ces problèmes sont
donc définis comme des manifestations comportementales intériorisées ou extériorisées
ayant une fréquence ou un nombre plus élevé que la normale (Comeau et al., 2013). Chez les
enfants québécois qui fréquentent la maternelle, les problèmes intériorisés et extériorisés
seraient les problèmes les plus fréquemment rapportés par les enseignants, parmi différentes
problématiques au niveau du développement global de l’enfant (p.ex., langage, cognition,
santé physique; Simard et al., 2018). Étant donné la prévalence élevée des problèmes
intériorisés et extériorisés, leur persistance dans le temps (Forbes et al., 2017) et leurs
conséquences sur l’adaptation sociale et scolaire ultérieures de l’enfant (Bor et al., 2004), il
est crucial de mieux comprendre les facteurs qui mènent à leur développement. Ce mémoire
se penche sur le rôle des symptômes dépressifs du père et des comportements de sensibilité
1paternelle dans la prédiction des problèmes intériorisés et extériorisés chez l’enfant durant la
petite enfance.
Les premières années de vie et l’environnement familial précoce
Selon l’OMS (2004), la petite enfance (0-2 ans) est une période durant laquelle les
fondements de la santé mentale s’établissent. La santé mentale chez l’enfant réfère à la
capacité de : 1) former des relations étroites et sécurisantes avec des adultes et des pairs, 2)
vivre, gérer et exprimer une gamme complète d’émotions, et 3) explorer l’environnement et
apprendre dans le contexte de la famille, de la collectivité et de la culture (Cohen et al., 2012).
Le terme développement socioaffectif est souvent utilisé pour référer à la santé mentale des
enfants et aux éléments qui la sous-tendent. Les premières années de vie sont considérées
comme une période critique dans le développement socioaffectif de l’enfant, mais aussi sur
le plan cérébral (Gale et al., 2004). Selon plusieurs experts, le développement précoce d’une
maladie mentale peut d’ailleurs nuire aux processus développementaux typiques du cerveau
et ainsi perturber de façon durable les capacités émotionnelles, relationnelles,
comportementales et intellectuelles émergentes (National Research Council and Institute of
Medicine, 2000; National Scientific Council on the Developing Child, 2012).
La petite enfance est une période de grande plasticité cérébrale caractérisée par la
formation, le maintien, le renforcement et la sélection des connexions neuronales (Nelson et
al., 2006). Ce processus est sans contredit biologique, mais dépend grandement des
expériences vécues dans l’environnement (Fox et al., 2010). Alors que le cerveau est en plein
développement, les expériences environnementales précoces peuvent altérer de façon
marquée et durable la structure cérébrale du jeune enfant (Bukatko & Daehler, 2011; Fox et
al., 2010) et, par le fait même, son développement socioaffectif et sa santé mentale (Cicchetti,
2015; Essex et al., 2001). Durant la petite enfance, les expériences environnementales sont
majoritairement vécues à l’intérieur du milieu familial, puisque l’enfant y passe la plus
grande partie de son temps. La recherche empirique démontre d’ailleurs que la qualité de
l’environnement familial est un prédicteur important de la santé mentale de l’enfant (Bøe et
al., 2014; Yap & Jorm, 2015). Cet environnement dans lequel l’enfant grandit et évolue est
essentiellement façonné par les parents (Bradley et al., 2001; National Research Council and
2Institute of Medicine, 2000; Lansford, 2017). Ceux-ci, par le biais de leur influence sur les
expériences environnementales de l’enfant durant une période de grande plasticité cérébrale,
joueraient un rôle important dans le développement des compétences sociales et affectives
qui sous-tendent la santé mentale de l’enfant (Bøe et al., 2014; Bradley et al., 2001; Clark et
al., 2016; Morris et al., 2007).
En tant qu’acteurs majeurs dans la vie de l’enfant, les parents influenceraient le
développement de ce dernier via leurs pratiques parentales (Bornstein, 2002; Cox & Harter,
2003; Lansford et al., 2014; Malmberg et al., 2016; Potapova et al., 2014). Plusieurs études
démontrent que des comportements parentaux inadéquats ou négatifs sont associés à plus de
problèmes de santé mentale chez l’enfant, notamment à plus de problèmes intériorisés et
extériorisés (Lansford et al., 2014; Zvara et al., 2018). Toutefois, la majorité des travaux sur
les pratiques parentales et le développement de l’enfant se sont concentrés sur les
comportements maternels (Cabrera et al., 2018; Wilson & Durbin, 2010). Des travaux plus
récents suggèrent que les comportements paternels joueraient un rôle unique et indépendant
dans la prédiction des problèmes intériorisés et extériorisés chez l’enfant (Jeynes, 2016;
Lansford et al., 2014). Étant donné le peu d’études réalisées chez les pères, le rôle que jouent
leurs pratiques parentales dans la trajectoire de santé mentale de l’enfant et le développement
social et affectif de ce dernier demeure toutefois méconnu.
Le rôle des pères
Pendant longtemps, l’étude du rôle joué par le milieu familial dans la santé mentale
et le développement socioaffectif de l’enfant était axée sur l’influence maternelle, sans réelle
considération pour l’influence des pères (Lamb, 2010). La mère a longtemps été considérée
comme la principale figure parentale (Cabrera et al., 2000). Le XXIe siècle a été marqué par
plusieurs changements sociaux qui ont toutefois amené les sociétés occidentales à considérer
davantage le père comme une figure parentale importante. L’investissement de plus en plus
important des femmes sur le marché du travail et la création de congés parentaux dédiés aux
pères ont notamment amené les pères à s’impliquer davantage auprès de leurs enfants. Le
rôle du père est alors passé de principal pourvoyeur à donneur de soins, ce qui lui a conféré
3une place plus importante dans le développement de l’enfant (Cabrera et al., 2000; Cabrera
et al., 2018; Lamb, 1995). Alors qu’ils ont longtemps été négligés dans la littérature
scientifique (Cabrera et al., 2018; Tamis-LeMonda et al., 2013), les pères ont fait l’objet d’un
intérêt plus marqué dans les dernières années.
Bien que plus récentes et moins nombreuses que les études portant sur les mères, les
études réalisées auprès des pères suggèrent que ceux-ci joueraient un rôle important dans le
développement socioaffectif (Cabrera et al., 2007; Davidov & Grusec, 2006; Lindsey et al.,
2010; Shannon et al., 2006; Stevenson & Crnic, 2013; Webster et al., 2013) et cognitif
(Cabrera et al., 2007; Kim & Hill, 2015; Malmberg et al., 2016; Tamis-LeMonda et al., 2013)
de l’enfant. Une méta-analyse récente propose même que les facteurs propres aux pères
contribueraient de façon unique, au-delà de l’influence maternelle, au développement de
l’enfant (Jeynes, 2016). Beaucoup de travail reste toutefois à faire pour bien comprendre le
rôle que le père joue dans la santé mentale de l’enfant. Même si un nombre croissant d’études
démontrent que les pères jouent un rôle dans le développement des problèmes intériorisés et
extériorisés chez l’enfant (Amato & Rivera, 1999; Barker et al., 2017; Lansford et al., 2014;
Miner & Clarke-Stewart, 2008; Ramchandani et al., 2013; Sarkadi et al., 2008; Trautmann-
Villalba et al., 2006; Wilson & Prior, 2011; Zvara et al., 2018), peu d’études se sont penchées
sur le rôle des comportements paternels de sensibilité (Bakermans-Kranenburg et al., 2003;
Elgar et al., 2007).
La sensibilité parentale
La sensibilité parentale fait partie des comportements parentaux qui joueraient un rôle
particulièrement important dans le développement social et affectif de l’enfant. Selon
Ainsworth et ses collègues (1978), la sensibilité fait référence à la capacité du parent à
percevoir les signaux de son enfant, à les interpréter avec précision et à y répondre
efficacement, et ce, de façon chaleureuse, cohérente et rapide. Selon la théorie de
l’attachement et plusieurs experts en psychologie développementale, ce comportement
parental serait essentiel au développement optimal de l’enfant (Ainsworth et al., 1978; Belsky
& Nezworski, 1988; Braungart-Rieker et al., 2001; DeKlyen & Greenberg, 2008; Kok et al.,
42015; Landry et al., 2001; Malmberg et al., 2016; Matestic, 2009; Towe-Goodman et al.,
2014). Grâce aux interactions parent-enfant caractérisées par de la sensibilité, l’enfant
apprendrait à entrer adéquatement en relation et à développer de bonnes aptitudes sociales
(Landry et al., 2001). Il apprendrait aussi à faire confiance à ses figures d’attachement et à
son environnement (Ainsworth et al., 1978). La sensibilité favoriserait également la
régulation des émotions (Cox & Harter, 2003; Davidov & Grusec, 2006), permettant à
l’enfant de faire face à d’éventuels stresseurs avec des sentiments de sécurité et de
compétence plus grands (Gilissen et al., 2007; Potapova et al., 2014).
Selon la théorie de l’attachement, la sensibilité parentale est essentielle au
développement d’une relation d’attachement sécurisante entre l’enfant et le parent. Un parent
qui interagit avec son enfant de manière prévisible, cohérente et chaleureuse, en répondant
de façon appropriée à ses signaux et à ses tentatives d’interaction, crée chez l’enfant un
sentiment de sécurité accrue qui l’aide à se sentir à l’aise d’explorer son environnement et
entrer en relation avec les personnes qui l’entourent (Ainsworth et al., 1978; Belsky &
Nezworski, 1988; Bowlby, 1969; De Wolff & van Ijzendoorn, 1997; Gilissen et al., 2007;
Pederson & Moran, 1995; Sroufe, 1996). La relation entre la sensibilité maternelle et la
sécurité d’attachement mère-enfant est bien documentée (Ainsworth et al., 1978; De Wolff
& van Ijzendoorn, 1997; Moran et al., 2008; Pederson & Moran, 1995). Des données méta-
analytiques appuient également la présence d’une association entre la sensibilité paternelle
et la sécurité d’attachement père-enfant (Lucassen et al., 2011). Des recensions et des études
longitudinales s’étendant sur plus de 30 ans soulignent les effets positifs d’une relation
d’attachement parent-enfant sécurisante sur la santé mentale des individus, et ce, tout au long
de leur vie (Bretherton, 2010; Grossmann et al., 2005; Main et al., 2005; Sroufe, 2005). En
contrepartie, des données méta-analytiques soulignent le risque qu’une relation
d’attachement parent-enfant insécurisante représente pour le développement de troubles de
santé mentale, tels que les troubles intériorisés (Groh et al., 2012; Madigan et al., 2013) et
extériorisés (Fearon et al., 2010) durant l’enfance, mais aussi à l’adolescence et à l’âge adulte
(van IJzendoorn et al., 1999). Peu d’études se sont toutefois penchées sur le rôle de la
sensibilité paternelle dans le développement des problèmes intériorisés et extériorisés chez
l’enfant. Ces études seront recensées et détaillées ci-dessous.
5La sensibilité parentale et les problèmes intériorisés et extériorisés de l’enfant
La sensibilité parentale est reconnue dans la littérature comme un facteur qui favorise
le développement de l’enfant dans plusieurs sphères. Les études dans ce domaine se sont
toutefois essentiellement concentrées sur la sensibilité de la mère, alors que le père est
aujourd’hui beaucoup plus engagé auprès de ses enfants. Un nombre restreint, mais croissant
d’études suggère que la sensibilité paternelle serait impliquée dans le développement des
problèmes intériorisés et extériorisés chez l’enfant. Une étude réalisée auprès de 710 familles
biparentales a examiné les relations entre la sensibilité maternelle et paternelle et les
comportements extériorisés de l’enfant mesurés de façon répétée entre la maternelle et la
cinquième année (Scott et al., 2018). Les chercheurs ont mesuré de façon observationnelle la
sensibilité des deux parents à quatre reprises dans le temps à l’aide de l’analyse d’interactions
parent-enfant filmées à la maison. Aux mêmes temps de mesure, les deux parents ont rempli
le CBCL afin de documenter les problèmes extériorisés de l’enfant. Un score combinant la
perception de la mère et du père a ensuite été créé. Les résultats de cette étude démontrent
une association entre la sensibilité du père et les problèmes extériorisés de l’enfant à 54 mois
(r = -.09, p < .05), en troisième année (r = -.18, p < .001) et en cinquième année (r = -.20, p
< .001). Cette association était petite, mais plus marquée que celle observée entre la
sensibilité de la mère et les problèmes extériorisés de l’enfant, cette dernière était seulement
marginalement significative à 54 mois (r = -.08, p = .06), significative, mais petite en
première année (r = -.15, p < .001) et non significative par la suite.
Une autre étude s’est penchée sur la relation entre la sensibilité des deux parents et la
présence de problèmes intériorisés et extériorisés chez l’enfant entre l’âge de 6 et 15 ans (N
= 578) à l’aide d’un devis longitudinal à mesures répétées (Zvara et al., 2018). Les problèmes
intériorisés et extériorisés ont été mesurés à l’aide du Child Behavioral Checklist (CBCL)
administré à la mère en première, troisième et cinquième année, ainsi qu’à l’âge de 15 ans.
La sensibilité des deux parents a été mesurée aux mêmes moments de façon observationnelle
à l’aide d’un système de codification basé sur l’analyse d’interactions parent-enfant filmées
à la maison. Les résultats de cette étude montrent qu’une sensibilité moindre de la part du
père est associée à plus de difficultés extériorisées (r < -.19) et intériorisées (r < -.13) chez
l’enfant, et ce, au-delà de la sensibilité maternelle. Cette relation était toutefois petite (r <
6-.19), mais persistante, prospective et concomitante. Les résultats de cette étude suggèrent
que la sensibilité maternelle est associée aux problèmes extériorisés (r < -.19) de l’enfant,
mais moins fortement que la sensibilité paternelle.
D’autre part, Hazen et ses collègues (2014) ont aussi mené une étude auprès de 125
familles afin d’examiner le rôle de la sensibilité paternelle dans les difficultés de régulation
émotionnelle à 24 mois, ainsi que dans les problèmes intériorisés et attentionnels d’enfants
âgés de 7 ans. Les chercheurs ont mesuré de façon observationnelle les capacités de
régulation de l’enfant à l’aide de la Children’s Emotion Regulation Scales à 24 mois. La
sensibilité des deux parents a également été mesurée de manière observationnelle durant des
interactions parent-enfant filmées à la maison lorsque l’enfant était âgé de 8 mois. Les
problèmes intériorisés et attentionnels de l’enfant ont été mesurés à l’aide du CBCL,
complété par l’enseignant quand l’enfant était âgé de 7 ans. Les résultats de cette étude
indiquent que les enfants de pères insensibles présentent plus de problèmes attentionnels à
l’âge de 7 ans (β = .34, p < .05). Les enfants de pères moins sensibles présentent également
plus de difficultés de gestion des émotions à 24 mois (β = -.22, p < .05). Aucune association
n’a toutefois été détectée avec les problèmes intériorisés. Les relations entre la sensibilité
maternelle et les différents construits étaient comparables à celles détectées chez les pères.
Enfin, le National Institute of Child Health and Human Development (NICHD, 2004)
a mené une étude auprès de 648 familles afin d’examiner l’association entre la sensibilité
parentale et les problèmes intériorisés et extériorisés de l’enfant. Les chercheurs ont mesuré
de façon observationnelle la sensibilité des deux parents durant des interactions parent-enfant
filmées lorsque l’enfant était âgé de 54 mois, ainsi qu’en première année. Les problèmes
intériorisés et extériorisés de l’enfant ont été mesurés à l’aide du CBCL, complété par
l’enseignant lorsque l’enfant était âgé de 54 mois, puis en maternelle, première et deuxième
année. Les résultats de cette étude démontrent qu’une sensibilité moindre de la part du père
est associée à plus de difficultés extériorisées chez l’enfant, et ce, au-delà de la sensibilité
maternelle. Cette relation était toutefois petite (r < -.15), mais persistante, prospective et
concomitante. Les résultats de cette étude suggèrent également que la sensibilité maternelle
est associée aux problèmes extériorisés de l’enfant (raux problèmes intériorisés tandis que la sensibilité du père est associée aux problèmes
intériorisés en première année (r = -.13), mais pas aux autres temps de mesure. Ainsi, la
relation entre la sensibilité parentale et les problèmes extériorisés semble plus marquée et
persistante.
Les études recensées ci-dessus suggèrent que la sensibilité paternelle et maternelle
pourrait diminuer les risques que les enfants développent des problèmes extériorisés et
intériorisés. Celles-ci ont toutefois été réalisées uniquement durant l’âge scolaire, ainsi, le
rôle de la sensibilité parentale lors des premières années de vie demeure méconnu. Ce rôle
pourrait être particulièrement important considérant que la petite enfance est caractérisée par
une grande plasticité cérébrale et que l’enfant passe la majorité de son temps en présence de
ses donneurs de soins principaux. D’autre part, rares sont les études qui se sont intéressées
au rôle de la sensibilité paternelle au-delà de la sensibilité maternelle de même qu’au rôle
que cette sensibilité pourrait jouer dans la transmission intergénérationnelle de la
psychopathologie.
Transmission intergénérationnelle des problèmes de santé mentale
En plus de promouvoir la santé mentale de l’enfant, les comportements paternels de
sensibilité pourraient jouer un rôle dans la transmission intergénérationnelle des problèmes
de santé mentale. Plusieurs études rapportent d’ailleurs une association entre les problèmes
mentaux des pères et les problèmes socioaffectifs de l’enfant (Beardslee et al., 1996, 1998;
Bradley & Slade, 2011; Kvalevaag et al., 2013; Lieb, 2002; Potapova et al., 2014;
Ramchandani & Psychogiou, 2009; Smith et al., 2013). Ces études démontrent
essentiellement que les enfants de pères qui présentent des problèmes de santé mentale sont
plus à risque d’avoir un tempérament difficile (Bradley & Slade, 2011; Potapova et al., 2014),
des difficultés de régulation émotionnelle (Potapova et al., 2014) et d’attachement (Beardslee
et al., 1998), des problèmes interpersonnels (Beardslee et al., 1998), des troubles affectifs ou
psychiatriques (Beardslee et al., 1996; Lieb, 2002), ainsi que des troubles de comportement
(Carro et al., 1993; Dave et al., 2008; Kvalevaag et al., 2013; Ramchandani & Psychogiou,
2009; Ramchandani et al., 2005, 2008; Smith et al., 2013; Sweeney & MacBeth, 2016; van
8den Berg et al., 2009). Ainsi, les problèmes mentaux pourraient se transmettre du père à
l’enfant.
Bien que les parents puissent présenter différents problèmes de santé mentale, la
littérature dans le domaine de la transmission intergénérationnelle des problèmes de santé
mentale s’est essentiellement penchée sur la dépression parentale (Barker et al., 2017;
Sweeney & MacBeth, 2016). La dépression est d’ailleurs le trouble mental le plus souvent
rapporté chez les Québécois (Statistique Canada, 2012) : 12% des Québécois âgés de 15 ans
et plus rapporteraient avoir vécu un épisode dépressif au cours de leur vie. Les femmes (15%)
seraient plus touchées que les hommes (9%) (Statistique Canada, 2012). Toutefois, des
données méta-analytiques suggèrent que la prévalence de la dépression serait plus importante
chez les hommes durant la première année suivant la naissance d’un enfant. Les travaux nord-
américains rapportent notamment des taux de dépression allant jusqu’à 13% durant cette
période (Cameron et al., 2016). Une méta-analyse identifie également la période de trois à
six mois post-partum comme étant la plus importante en termes de prévalence de la maladie
(25.6%; Paulson & Bazemore, 2010). Selon une revue de la littérature, le tiers des nouveaux
pères rapporteraient souffrir de symptômes dépressifs (Bradley & Slade, 2011). Étant donné
l’implication plus grande des pères auprès de leurs enfants (Cabrera et al., 2000), la
prévalence de la dépression chez les hommes (Statistique Canada, 2012) et la vulnérabilité
plus grande des nouveaux pères à cette maladie mentale (Cameron et al., 2016), l’étude du
rôle de la dépression paternelle dans le développement de l’enfant revêt une importance
particulière. Une meilleure compréhension de cette transmission intergénérationnelle
favoriserait notamment l’implantation de services de prévention ou d’intervention auprès des
nouveaux pères.
La dépression parentale et les problèmes socioaffectifs chez l’enfant
L’association entre la dépression maternelle et le développement social et affectif de
l’enfant est bien documentée. Des données méta-analytiques (Goodman et al., 2011)
démontrent que la dépression maternelle est significativement associée à la présence de
problèmes intériorisés (r = .23, p < .001) et extériorisés (r = .21, p < .001) chez l’enfant. Les
auteurs de cette méta-analyse soulignent toutefois le peu d’études qui considèrent aussi la
9dépression paternelle. Ces auteurs mettent de l’avant la nécessité de considérer les deux
parents dans les études futures afin de mieux comprendre les mécanismes par lesquels cette
maladie mentale peut se transmettre des parents à l’enfant.
Bien que moins nombreuses que les études réalisées chez les mères, de plus en plus
d’études suggèrent que la dépression paternelle jouerait un rôle négatif et comparable à celui
de la dépression maternelle sur le développement social et affectif de l’enfant (Sweeney et
MacBeth, 2016). Le taux de prévalence de troubles psychiatriques chez les enfants de pères
déprimés se situeraient entre 41 et 77% (Beardsleeet al., 1998), ce qui est deux à sept fois
plus élevé que dans la population en générale (Institut Canadien d’Information sur la Santé,
2018). Une revue de la littérature suggère notamment que les enfants de pères dépressifs sont
plus à risque de souffrir de différents troubles intériorisés et extériorisés au cours de leur vie,
la dépression étant le trouble le plus prévalent chez ces enfants (Spector, 2006). Dans le
même ordre d'idées, des données méta-analytiques regroupant 17 études mettent de l'avant
des associations modérées entre la dépression paternelle et les problèmes intériorisés (r = .24,
p < .05) et extériorisés (r = .19, p < .05) chez l’enfant (Kane & Garber, 2004).
Plus récemment, Sweeney et MacBeth (2016) ont recensé 21 études (N = 21 970)
appuyant l’existence d’une association entre la dépression paternelle et un risque accru de
problèmes intériorisés et extériorisés chez l’enfant. Cette association, de taille faible à
modérée, a été observée dans des échantillons d’enfants âgés de 2 mois à 21 ans. Dans les
études recensées, les problèmes intériorisés et extériorisés des enfants étaient mesurés à l’aide
de questionnaires complétés par les parents ou par les enseignants tandis que les symptômes
dépressifs des pères étaient mesurés à l’aide de questionnaires ou d’entrevues complétés par
les pères. Les auteurs de la recension soulignent que l’association entre la dépression
paternelle et les problèmes de santé mentale de l’enfant persiste même en contrôlant pour la
dépression maternelle, ce qui suggère que la dépression paternelle contribuerait de façon
unique à l’explication des différences individuelles dans la santé mentale de l’enfant. Les
auteurs de la recension soulignent également la présence d’une période sensible chez les
enfants de pères dépressifs, période où l’enfant serait plus vulnérable aux effets de la
dépression parentale. Plus l’exposition aux symptômes dépressifs du père serait précoce, plus
10l’enfant serait à risque de présenter des difficultés sur le plan socioaffectif (Ramchandani et
al., 2005). Cela est cohérent avec ce que l’on retrouve également dans les études réalisées sur
la dépression maternelle (Essex et al., 2001; Goodman et al., 2011; Hay et al., 2001).
Bien qu’elles permettent de mettre en lumière le rôle de la dépression des pères dans
le développement de l’enfant, les études réalisées dans le domaine possèdent tout de même
quelques limites. Tout d’abord, la majorité d’entre elles ont été réalisées chez des enfants
d’âge scolaire (Kane & Garber, 2008; Ramchandani et al., 2005). La dépression serait
toutefois plus prévalente chez les pères durant la première année de vie de l’enfant (Cameron
et al., 2016). Cette période étant caractérisée par une plus grande plasticité cérébrale chez
l’enfant (Nelson et al., 2006), l’effet de la dépression paternelle pourrait être plus grand et
donc important à examiner. De plus, plusieurs études ont mesuré les variables auprès du
même répondant, soit le père, malgré le risque de biais subjectifs susceptibles de gonfler les
relations observées (Treutler & Epkins, 2003). Les pères dépressifs peuvent surestimer les
difficultés de l’enfant en raison de leur propre humeur dépressive (Briggs-Gowan et al., 1996).
Par ailleurs, la plupart des études recensées ont considéré la dépression paternelle de manière
dichotomique, en formant deux groupes de père sur la base de l’atteinte d’un critère ou d’un
seuil clinique : les pères dépressifs et les pères non dépressifs. Cette séparation ne tient
toutefois pas compte de l’impact possible des symptômes dépressifs sous-cliniques et de la
détresse que les pères peuvent tout de même éprouver (sur le continuum), sans pour autant
satisfaire le critère ou franchir le seuil clinique (Elgar et al., 2007; Sweeney & MacBeth,
2016). Cette dichotomie peut nuire à l’obtention de résultats significatifs surtout dans des
échantillons d’enfants et de parents issus de la communauté en raison de la plus faible
prévalence de diagnostics cliniques (Eiden et al., 2007). Enfin, la majorité des études se sont
intéressées à la relation entre la dépression paternelle et le développement des problèmes
intériorisés et extériorisés de l’enfant sans tenter de mettre en lumière les mécanismes
explicatifs sous-jacents. Il est toutefois crucial de mieux comprendre les mécanismes par
lesquels la maladie mentale du parent peut se transmettre à l’enfant. Cette compréhension est
nécessaire à l’élaboration d’interventions visant à prévenir les difficultés socioaffectives chez
les enfants de pères ayant des problèmes mentaux.
11Les mécanismes de transmission intergénérationnelle de la psychopathologie
De plus en plus d’études suggèrent que les comportements parentaux joueraient un
rôle dans la transmission intergénérationnelle de la psychopathologie (Eiden et al., 2007;
Elgar et al., 2007; Giallo et al., 2014; Ramchandani et al., 2010). La maladie mentale pourrait
avoir un impact délétère sur la manière dont le parent interagit avec son enfant et celle-ci
pourrait altérer à son tour la manière dont l’enfant se développe et interagit avec le monde
qui l’entoure (Bradley & Slade, 2011). Dans la littérature scientifique, il est généralement
reconnu que la maladie mentale interfère avec la capacité des parents à prendre adéquatement
soin de leurs enfants. Des données méta-analytiques démontrent notamment que la
dépression chez les mères est associée à davantage de comportements négatifs (p.ex., hostilité,
intrusion, négligence ou désengagement), et à moins de comportements positifs (p.ex., jouer
avec l’enfant, être affectueux ; Lovejoy et al., 2000). Plus récemment, une méta-analyse
réalisée sur 28 études (N = 4788) s’est penchée sur la relation entre la dépression et les
comportements des pères (Wilson & Durbin, 2010). Les résultats de cette méta-analyse
démontrent que la dépression paternelle est significativement associée à moins de
comportements positifs (r = -.19, p < .001) et plus de comportements négatifs (r = .16, p
< .001). Les comportements étudiés étaient variés, incluant l’expression d’émotions
positives/négatives, la chaleur, la sensibilité, la propension à répondre aux besoins de l’enfant,
l’hostilité, l’intrusion et le désengagement. La majorité des études recensées dans la méta-
analyse de Wilson et Durbin (2010) et portant sur la relation entre la dépression et les
comportements paternels proposaient une vision dichotomique de la dépression. Les parents
qui présentent des niveaux sous-cliniques de détresse peuvent toutefois aussi éprouver des
difficultés à prendre soin de leurs enfants ou manifester des comportements plus négatifs
(Elgar et al., 2007; Kane & Garber, 2004; Lovejoy et al., 2000). Il est donc important
d’examiner cette relation sur l’ensemble du continuum. De plus, la majorité de ces études ont
utilisé des questionnaires autorapportés pour mesurer les pratiques parentales et ceux-ci sont
sujets à des biais de perception et de désirabilité sociale (Cox & Harter, 2003). L’humeur
dépressive du père peut entraîner une vision plus négative de ses propres comportements
parentaux qui peut résulter en un gonflement artificiel de la relation entre la dépression et les
comportements paternels (tous deux autorapportés).
12Par ailleurs, une seule étude recensée s’est penchée sur la dépression du père et la
sensibilité paternelle. Dans cette étude longitudinale réalisée sur un échantillon de 227
enfants, la dépression paternelle a été mesurée à deux reprises à l’aide du CES-D lorsque
l’enfant était âgé de 12 et 18 mois. À deux ans, les enfants et leur père ont été filmés en
interaction à la maison, afin de mesurer de façon observationnelle la chaleur, la sensibilité et
les affects négatifs du père. Un score composite regroupant les trois comportements a ensuite
été créé. Cette étude ne rapporte pas d’association significative entre la dépression et le score
composite (Eiden et al., 2007). Ainsi, la seule étude s’étant penchée sur la sensibilité
paternelle suggère une absence de relation entre elle et la dépression. La sensibilité était
toutefois combinée avec d’autres comportements paternels. En s’appuyant sur les études
réalisées chez les mères, une relation est attendue entre la dépression et la sensibilité parentale
(Campbell et al., 1995, 2007; Mills-Koonce et al., 2008). Ainsi, il faut poursuivre les études
sur la sensibilité paternelle pour mieux comprendre le lien entre elle et la dépression, mais
aussi les rôles respectifs de la sensibilité et de la dépression maternelles et paternelles dans
la prédiction des problèmes socioaffectifs de l’enfant.
Il n’en demeure pas moins que l’existence d’une relation entre les pratiques
paternelles et la dépression telle que démontré par la méta-analyse de Wilson et Durbin (2010)
appui l’hypothèse d’une transmission intergénérationnelle de la maladie mentale par le biais
des comportements parentaux. Très peu d’études se sont toutefois penchées sur le rôle
médiateur des pratiques paternelles dans la relation entre la dépression paternelle et la santé
mentale de l’enfant. Ces études sont recensées ci-dessous.
Une première étude réalisée par Ramchandani et ses collègues (2010) s’est penchée
sur le rôle de l’implication paternelle (N = 5064). Lorsque l’enfant était âgé de 8 mois, les
pères ont rempli l’Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), un questionnaire mesurant
les symptômes dépressifs. À 18 mois, l’implication paternelle a été rapportée par les mères à
l’aide d’une entrevue. Enfin, les problèmes comportementaux de l’enfant ont été mesurés à
6 ans à l’aide du Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ), complété par la mère. Les
résultats de cette étude indiquent que les enfants de pères déprimés présentent plus de
problèmes de comportement (r = .12, p < .01) de même que les enfants de pères qui
13s’impliquent moins (r = -.13, p < .01). Les résultats suggèrent également l’existence d’une
association significative entre la dépression paternelle et l’implication du père (r = -.07, p
< .01). Ainsi, la relation entre la dépression paternelle et les problèmes de comportement de
l’enfant pourrait, de façon plausible, passer par l’implication paternelle, mais les auteurs de
cette étude n’ont pas effectué d’analyses de médiation.
Le rôle médiateur de l’implication paternelle dans la relation entre la dépression
paternelle et les problèmes comportementaux de l’enfant a fait l’objet d’une autre étude
réalisée sur 8401 dyades père-enfant. La dépression a été mesurée à l’aide de l’EPDS huit
semaines et huit mois après la naissance de l’enfant. L’implication des pères a été mesurée à
l’âge de 18 mois auprès des mères à l’aide d’une entrevue. Les problèmes comportementaux
de l’enfant ont été mesurés à l’aide des questionnaires Rutter revised preschool scale (3 ans
1/2) et SDQ (3 ans 1/2 et 7 ans), complétés par les mères. Les analyses de médiation effectuées
révèlent que la relation entre la dépression paternelle et les problèmes de comportement de
l’enfant à 3 ½ et 7 ans s’expliquent en partie par le degré d’implication du père (Gutierrez-
Galve et al., 2015). Les symptômes dépressifs du père étaient associés à une plus faible
implication paternelle qui était à son tour associée à plus de problèmes comportementaux
chez l’enfant. Ces résultats soutiennent le rôle des comportements paternels dans la
transmission intergénérationnelle de la maladie mentale.
Pour leur part, Velders et ses collaborateurs (2011) se sont intéressés aux
comportements d’hostilité des parents et à leur rôle dans la relation entre la dépression
parentale et les problèmes internalisés et externalisés de l’enfant (N = 2698). Les symptômes
dépressifs et l’hostilité des parents ont été mesurés à l’aide du Brief Symptom Inventory à 20
semaines de grossesse, puis à nouveau lorsque l’enfant était âgé de 3 ans. Le CBCL a été
administré aux deux parents à 3 ans, puis une moyenne des scores obtenus a été créée. Les
résultats de cette étude démontrent que la relation entre la dépression parentale et les
problèmes internalisés et externalisés chez l’enfant disparaît lorsque l’hostilité des parents
est prise en compte. Ce phénomène se retrouve à la fois chez les pères et les mères et souligne
le rôle de l’hostilité parentale dans la transmission intergénérationnelle du risque
psychopathologique. L’hostilité parentale était toutefois mesurée par le biais du même
14Vous pouvez aussi lire