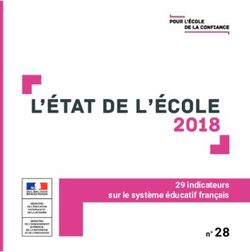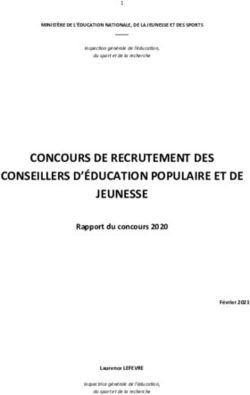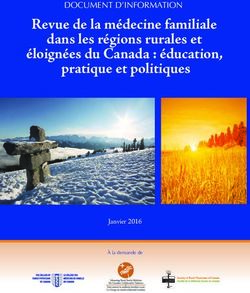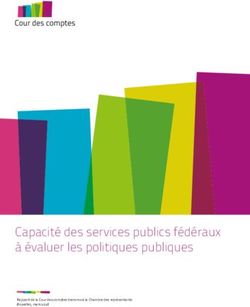Les déterminants de la demande sociale d'éducation islamique en Côte d'Ivoire
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Les déterminants de la demande sociale d’éducation islamique en Côte d’Ivoire Résultats de l'étude SCORE menée dans les localités d'Abobo, Bondoukou, Man, Minignan et Soubré Une étude réalisée grâce à l’appui du Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, de l’UNICEF et de l’Union européenne
Les déterminants de la demande sociale d’éducation islamique en Côte d’Ivoire Résultats de l'étude SCORE menée dans les localités d'Abobo, Bondoukou, Man, Minignan et Soubré Une étude réalisée grâce à l’appui du Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, de l’UNICEF et de l’Union européenne
Ce document est le rapport d’une étude quantitative menée en 2020 en Côte d’Ivoire dans les localités d’Abobo, Bondoukou, Man, Minignan et Soubré, par Indigo Côte d’Ivoire, Interpeace et SeeD. Les consultations ont été conduites auprès de 1000 citoyens sur les les déterminants et autres logiques sociales qui orientent et favorisent les choix d’éducation des parents, ainsi que le niveau d’acceptation sociale du processus d’intégration des structures islamiques d’éducation (SIE) actuellement conduit par l’Etat ivoirien. Cette étude a été réalisée grâce à l’appui du Ministère de l’Education nationale, de l’enseignement technique et de la Formation professionnelle (MENET-FP) de la République de Côte d’Ivoire, avec le soutien financier du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) en Côte d’Ivoire et de l’Union européenne (UE). Le contenu de ce rapport ne reflète pas l’opinion officielle du MENET-FP, d’UNICEF ou encore de l’UE. La responsabilité des informations et points de vue exprimés dans ce dernier incombe entièrement aux personnes consultées et aux auteurs. Crédit des photos dans ce rapport : Copyright Indigo Côte d’Ivoire Tous droits réservés. Copyright : Indigo Côte d’Ivoire et Interpeace 2021. Tous droits réservés. Publié en mai 2021. Les polices typographiques utilisées dans ce rapport sont Suisse International, Suisse Works et Suisse Neue, par Swiss Typefaces qui sponsorise généreusement Interpeace. www.swisstypefaces.com Quai Perdonnet 19 1800 Vevey Switzerland La reproduction de courts extraits de ce rapport est autorisée sans autorisation écrite formelle, à condition que la source originale soit correctement référencée, incluant le titre du rapport, l’auteur et l’année de publication. L’autorisation d’utiliser des parties de ce rapport, en entier ou en partie, peut être accordée par écrit. En aucun cas le contenu ne peut être altéré ou modifié, incluant les légendes et citations. Ceci est une publication d’Interpeace et ses partenaires dans le programme mis en œuvre en Côte d’Ivoire. Les publications de ces dernières ne reflètent pas spécifiquement un intérêt national, régional ou politique. Les opinions exprimées dans cette publication ne représentent pas nécessairement les vues de d’Interpeace et ses partenaires. Pour des autorisations ou information complémentaires, merci de contacter wao@interpeace.org. La responsabilité des informations et points de vue exprimés dans ce dernier incombe entièrement aux personnes consultées et aux auteurs.
Les déterminants de la demande sociale d’éducation islamique en Côte d’Ivoire Résultats de l'étude SCORE menée dans les localités d'Abobo, Bondoukou, Man, Minignan et Soubré
Ce rapport a été préparé par les organisations suivantes (dans l’ordre alphabétique) :
Indigo Côte d’Ivoire
Cocody 2 Plateaux les Perles
Cité les Versants 2, rue du Lac
Villa N°283
22 BP 288 Abidjan 22
27 22 42 96 72
indigoci@gmail.com
http://indigoci.org
Interpeace (Bureau d’Abidjan)
Cité Les Lauriers 5 - Villa n.43
Carrefour Duncan, Route du Zoo
Deux Plateaux, Cocody
06 BP 2100
Abidjan 06, Côte d’Ivoire
(+225) 27 22 42 33 41
www.interpeace.org
The Centre for Sustainable Peace and
Democratic Development (SeeD)
14 rue Michalakopoulou
1075 Nicosie
Chypre
+357 97 86 86 73
info@seedsofpeace.eu
https://www.seedsofpeace.eu/
Les efforts d’Interpeace pour la
construction de la paix dans le
monde sont rendus possibles par nos
partenariats stratégiques du Pays-Bas,
de la Suède et de la Suisse.Equipe de recherche et publication
Indigo Côte d’Ivoire
Coordinateur Dr. KOUAME Yao Séverin
Chercheur principal Dr. BINATÉ Yssouf
Chercheurs KOUASSI KOUAMÉ Georges
(chefs d’équipe) SANOGO Aïcha
Dr. KONAN Michel
Dr. KOFFI Alexis
Chercheurs associés ZIRIHI Yéréhonon Jean
KOUASSI Aya Angeline
DONEGUE Malloh Wilfried
KONATÉ Fona
BAMBA Madjata
TAMELA Yaya
TUO Sibéhon
MARA Laye Louis Silas
Dr. KONAN KOUAMÉ Jacques
KONAN Kouassi
KONDO N’Da N’Goran Didier
KONATÉ Alexandra
Interpeace
Directrice régionale Afrique de l’Ouest POLIDORO Alessia
Responsable du programme Côte d’Ivoire BODDAERT Mathilde
PIMOND Margaux
Chargée d’appui au Programme Côte d’Ivoire BERGER Marie
Graphiste CHOC Estuardo
The Centre for Sustainable Peace and Democratic Development
(SeeD)
Chercheurs BALDET Bertrand
KOKO Abdon Dominique
Analyste GUEST Alexander
MACHLOUZARIDES MarianTable des matières
Pour parcourir ce document, cliquez sur n'importe quel titre de la table des matières.
Pour revenir ici, cliquez sur un numéro de page
5 Equipe de recherche et publication
9 Sigles et acronymes
10 Lexique
11 Résumé exécutif
17 Introduction
17 1. Contexte et objectifs de l’étude
19 2. Méthodologie de l’étude
19 2.1 L’étape qualitative
20 2.2 L’étape quantitative
22 2.3 La méthode SCORE
23 3. Les questions de recherche, leurs résultats et l’organisation du rapport
27 I. Caractéristiques socio-démographiques des ménages enquêtés
27 I.1. Des ménages au faible niveau d’instruction
29 I.2. Des parents d’élèves exerçant davantage dans le secteur informel
30 I.3. Des ménages en situation de vulnérabilité socioéconomique relative
31 I.4. Des familles composites avec de nombreux enfants
32 I.5. Un niveau de religiosité et d’“entre-soi” ethnoculturel important
33 I.6. Un accès différencié, mais globalement limité, aux services de l’Etat
37 II. La structure de la demande d’éducation islamique : les
déterminants des choix de scolarisation, des préférences et des
attitudes vis-à-vis de l’intégration des SIE
38 II.1 Le niveau de revenu comme déterminant du choix éducatif
Les déterminants de la demande sociale d’éducation islamique en Côte d’Ivoire 739 Famille à faibles revenus : contraints de choisir leurs enfants à scolariser dans
le formel
40 II.2 Les attentes en termes d’avenir socioprofessionnel souhaité
pour l’enfant
40 II.2.1 Ambitions duales
42 II.2.2 Ambitions citoyennes et sociales du cursus informel
43 II.3 La trajectoire éducative personnelle des parents
44 II.5 La disponibilité de l’offre éducative
45 II.6 Les attentes sociales d’autorité dans la relation pédagogique
49 III. Les sources de résistance à la démarche d’intégration et à la
scolarité formelle
49 III.1 Pourquoi ne pas opter pour une école confessionnelle ? La question de la
religion à l’école
51 III.1.1 Demande sociale et nature attendue d’un curriculum de type religieux
52 III.1.2 Attentes sociales de « religiosité » à l’école
53 III.1.3 Aspiration à des débouchés « religieux » pour les enfants
54 III.1.4 Engagement des acteurs communautaires dans le leadership de l’école
55 III.2 Pourquoi ne pas adhérer à la démarche d’intégration ? La mixité
sociale et l’environnement communautaire
57 III.2.1 Résistance à la mixité confessionnelle et à la contraction/dilution
supposée du temps et du contenu de l’enseignement religieux
59 III.2.2. Le « communautarisme » religieux comme contrainte à l’adhésion au
processus
65 Conclusion et pistes d’action
66 Recommandations
71 Bibliographie
72 Annexes
8 Les déterminants de la demande sociale d’éducation islamique en Côte d’IvoireSigles et acronymes
Commission nationale d’accompagnement des structures
CNAESI
islamiques d’éducation dans le système éducatif formel
CNI Conseil national islamique
Comité de gestion des établissements scolaires
COGES
Conseil des imams sunnites
CODIS
Conseil supérieur des imams
COSIM
Maladie à coronavirus
COVID-19
Ecole confessionnelle
EC
Ecole confessionnelle Islamique
ECI
Ecole privée confessionnelle
EPC
Ecole primaire publique
EPP
Franco-arabe
FA
Ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement
MENET-FP technique et de la formation professionnelle
PSO Politique de scolarisation obligatoire
Fonds des Nations Unies pour l’enfance
UNICEF
Centre pour la paix et le développement démocratique
SEED durables
SIE Structure islamique d’éducation
Stratégie nationale d’intégration des enfants des
SNIESIE structures islamiques d’éducation dans le système
éducatif formel
Les déterminants de la demande sociale d’éducation islamique en Côte d’Ivoire 9Lexique
Littéralement « apprentissage par terre » (en langue malinké)
Dougouma kalan
et désignant l’école coranique traditionnelle
L’apprentissage des blancs ou l’école occidentale (en langue
Toubabou/ malinké)
Nanzaran kalan
Faso La terre des ancêtres (en langue malinké)
Karamoko Désigne un maître coranique, une personne qui a la
connaissance et l’enseigne.
Le clan (en langue malinké)
Kabla
Kafri Expression dérivée de Kafr en arabe (signifiant littéralement
« non croyant » en langue malinké)
10 Les déterminants de la demande sociale d’éducation islamique en Côte d’IvoireRésumé exécutif
L a question de l’intégration des enfants fréquentant les structures islamiques d’éducation
(SIE) dans le système formel d’éducation-formation demeure aujourd’hui un défi
important pour les pouvoirs publics ivoiriens. Dans le cadre de la Politique de scolarisa-
tion obligatoire (PSO) de l’Etat de Côte d’Ivoire, qui vise à scolariser tous les enfants de
6 à 16 ans d'ici 2025, le Ministère de l’Education nationale, de l’enseignement technique et
de la formation professionnelle (MENET-FP) a élaboré en 2019 une Stratégie nationale
d’intégration des enfants des SIE dans le système éducatif formel (SNIESIE). La SNIE-
SIE a pour objectif de faire bénéficier les enfants des SIE du socle commun de connais-
sances, de compétences et de culture tout en préservant l’apprentissage de la religion.
Pour mieux comprendre et consolider le niveau d’adhésion communautaire à cette ré-
forme, la présente étude sur la demande sociale d’éducation islamique cherche à docu-
menter les déterminants et autres logiques sociales qui orientent et favorisent les choix
d’éducation des parents vers les structures d’éducation formelles et non-formelles, ainsi
que le niveau d’acceptation sociale du processus d’intégration en cours.
L’étude, conduite en 2020 par Indigo Côte d’Ivoire, Interpeace et SeeD dans les localités
d’Abobo, Bondoukou, Man, Minignan et Soubré en suivant la méthodologie statistique
participative de l’Indice SCORE, établit que :
1. Les attentes éducatives orientant les parents musulmans vers les structures isla-
miques d’éducation formelles ou non-formelles sont en général plurielles. Les pa-
rents souhaitent que leurs enfants puissent avoir parallèlement accès à une éducation
religieuse et formelle de manière à faciliter leur intégration communautaire et profes-
sionnelle. Néanmoins, moins leurs attentes ont de fondement religieux (en termes de
socialisation à l’Islam, débouchés religieux post-formation, etc.), plus ils ont tendance
à opter pour une scolarité formelle et à adhérer à la démarche d’intégration.
2. Le modèle éducatif basé sur l’autorité des précepteurs est un moteur important de
la demande sociale d’éducation islamique, qui tend à décourager les parents à sous-
crire à une scolarisation formelle où ils perçoivent que leurs enfants seront moins
encadrés et respectueux des valeurs attendues par la communauté. En effet, plus les
parents sont attachés à une éducation centrée sur la discipline et le respect des valeurs
qui font « un bon musulman », (i) moins ils ont d’enfants scolarisés dans le système for-
mel, (ii) moins ils se sentent convaincus par un changement de scolarité vers une école
privée confessionnelle (EPC) et (iii) moins ils soutiennent le processus d’intégration.
3. L’accessibilité (géographique et économique) des écoles est une donnée importante
dans leurs rapports à l’offre de scolarisation formelle. Il a été constaté que plus les
parents ont des facilités d’accès aux écoles publiques par la proximité géographique
et la capacité à assurer les coûts de scolarité, moins ils font le choix de la scolarisation
non formelle. De fait, le niveau de revenu est un facteur fondamental structurant la
demande sociale d’éducation islamique non formelle. Qu’il soit question du niveau
Les déterminants de la demande sociale d’éducation islamique en Côte d’Ivoire 11de scolarité formelle au sein du ménage, de la propension à changer de trajectoire de scolarisation (vers les EPC) ou encore de soutien à la réforme, invariablement des re- venus élevés encouragent les parents à se montrer plus enthousiastes envers la dyna- mique d’intégration. 4. Une tendance à la reproduction des parcours scolaires. Les parents ayant suivi une formation formelle ont davantage tendance à reproduire ce modèle pour leurs enfants. 5. Lorsque les parents font confiance au personnel de l’école publique, ils ont da- vantage tendance à scolariser leurs enfants dans le système formel. A l’inverse, la confiance envers le personnel des structures islamiques d’éducation réduit la tendance des parents à orienter leurs enfants vers le système formel. 6. En somme, la propension à préférer l’offre islamique informelle d’éducation pour la scolarisation de tout ou partie des enfants dans ces ménages est renforcée : (1) lorsque ces parents semblent avoir de ces structures une assez bonne connaissance pour les avoir eux-mêmes fréquentées (ils reproduisent ainsi à travers leurs enfants leur propre trajectoire éducative), (2) lorsque l’offre formelle d’éducation n’existe pas dans leur environnement ou, (3) lorsqu’elle y existe, ces parents ne semblent pas y re- trouver le modèle d’autorité qu’il souhaitent dans la relation pédagogique entre pré- cepteurs et élèves. Par ailleurs, (4) plus le capital confiance qu’ils ont dans le per- sonnel d’encadrement ayant en charge l’éducation des enfants dans ces structures islamiques d’éducation est important, plus ils ont tendance à s’y orienter. 7. Si globalement le processus d’intégration n’est pas rejeté, des formes de résistance susceptibles d’affecter l’adhésion au processus sont néanmoins observées et nourries par une demande forte de « religion à l’école et dans l’école », un communautarisme prononcé et un refus de la mixité socioreligieuse dans les structures islamiques d’éducation. Certains parents craignent une dilution du poids et de la place du religieux à l’école pour leurs enfants, notamment au niveau du curriculum, des débouchés religieux à l’issue de leur formation, ou du niveau d’implication du leadership religieux dans la gouvernance scolaire. En lien avec ce qui précède, l’étude recommande en appui à la stratégie et campagne de communication en cours autour de la SNISIE : 1. Mettre en place une politique volontariste de discrimination positive à destination des parents d’élèves vulnérables économiquement (par la participation aux frais de scolarité, don de kits scolaires, etc.) afin de les aider à s’orienter vers les SIE intégrées pour la scolarisation de leurs enfants. 2. Saisir l’opportunité de la politique d’intégration pour générer une offre éducative for- melle dans les « déserts éducatifs », zones de prédilection d’ouverture des SIE non formelles qui représentent souvent les seules options de scolarisation pour de nom- breux enfants. Il est donc important d’opérer une cartographie fine des déserts éduca- tifs dans lesquels prospèrent les SIE non formelles et accompagner ces dernières dans le processus d’intégration. 12 Les déterminants de la demande sociale d’éducation islamique en Côte d’Ivoire
3. Appuyer les structures éducatives formelles pour rendre leur offre éducative plus
adaptée aux attentes sociales et projets éducatifs des parents ciblés par la politique
d’intégration, en instaurant un dialogue avec ces derniers et en renforçant leur partici-
pation à la gouvernance de la vie scolaire.
4. Favoriser la transition des maîtres et enfants des écoles coraniques vers le pro-
gramme officiel, à travers des mesures d’accompagnement répondant aux préoccu-
pations et aux besoins spécifiques (formations techniques, AGR, programmes passe-
relles, etc.) exprimés dans le cadre d’un dialogue inclusif.
5. Axer la communication et le dialogue communautaire autour de la SNIESIE sur la
déconstruction des risques perçus, en s’appuyant sur des messages et des relais pou-
vant rassurer les parents, les promoteurs et les maitres coraniques attachés à l’éduca-
tion islamique sur le fait que l’éducation formelle ne vise pas à faire disparaître leurs
valeurs, mais à créer plus d’opportunités dans la vie de leurs enfants.
Les déterminants de la demande sociale d’éducation islamique en Côte d’Ivoire 13Introduction Les déterminants de la demande sociale d’éducation islamique en Côte d’Ivoire 15
Introduction
1. Contexte et objectifs de l’étude
L a Côte d’Ivoire a renoué avec la stabilité sociale et rouvert ses activités économiques
sur l’extérieur depuis la fin de sa décennie de conflit politique et militaire. Son écono-
mie s’en est trouvée positivement influencée avec une croissance annuelle oscillant entre
7 et 8% entre 2012 et 2018.
Le secteur de l’éducation et de la formation, qui avait souffert de la destruction et la réduc-
tion des capacités d’accueil des infrastructures socio-éducatives pendant la crise, occupe
aujourd’hui une place de choix dans la politique de reconstruction du pays. Institution pu-
blique au 2e budget le plus important1, le Ministère de l’Éducation nationale a entrepris
d’importants chantiers et réformes, allant de la réhabilitation à la reconstruction d’éta-
blissements scolaires au lancement d’une Politique de Scolarisation Obligatoire (PSO) des
enfants de 6 à 16 ans en 2015.2
Dotée pour sa mise en œuvre d’un budget de 700 milliards de FCFA, cette politique rend
l’école publique gratuite et obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans, en vue de « don-
ner à toutes les filles et à tous les fils » de Côte d’Ivoire « le droit à l’éducation et à une for-
mation de qualité ».3 Elle cible ainsi tous les enfants et adolescents encore absents de l’es-
pace scolaire, qui étaient encore 2.067.020 d’après une étude statistique de 2016 – 2017.4
Parmi eux, et selon un rapport du MENET-FP de 2018, 237.004 enfants étaient ins-
crits dans des Structures Islamiques d’Éducation (SIE) évoluant en marge du contrôle de
l’État.5 Relevant de l’autorité d’un groupement associatif, d’une famille ou d’un individu,
ces structures - qui vont des écoles coraniques traditionnelles (ou dougouma kalan, litté-
ralement « apprentissage par terre » en langue malinké) aux établissements confession-
nels islamiques - forment une composante importante de la cartographie scolaire du pays
(cf. encadré 1)
De par sa caractéristique d’institution d’éducation aux valeurs islamiques et à la vie en
communauté, l’ordre d’enseignement islamique a acquis de la notoriété au fil du temps
au point d’en faire un vecteur de pérennisation de normes sociales.6 Longtemps resté en
marge du système éducatif officiel, l’enseignement coranique a fait sa mue à l’avènement
des médersas – à la fin des années 1940 – avant d’être en partie et progressivement intégré
dans le système éducatif national par l’entremise des écoles confessionnelles islamiques.
1 Le budget de ce ministère pour 2020 était de 955.931.905.381 FCFA, soit 12% du budget
gouvernemental total. URL : http://budget.gouv.ci/doc/loi/LOI%20DE%20FINANCES%20
INITIALE%202020.pdf (consulté le 07 janvier 2021).
2 Sur la période 2011 – 2018, on note la construction 30 621 salles de classes et le recrutement 54 318
enseignants.
3 Loi N° 2015-635 du 17 septembre 2015 portant modification de la loi n°95-696 du 7 septembre 1995.
4 Annuaire statistique du MENET-FP de 2016 à 2017.
5 MENET-FP, 2018, p.16.
6 Hamadou 1990 ; Meunier 1995 ; Cissé 1998 ; Brenner 2000 ; Hoechner 2012 ; Binaté 2016, Hugon 2016.
Les déterminants de la demande sociale d’éducation islamique en Côte d’Ivoire 17Encadré 1. Les quatre types de structures islamiques d’éducation (SIE)
en Côte d’Ivoire
Quatre types de structures islamiques d’éducation sont distinguées en Côte d’Ivoire, selon une gradation
allant des non-formelles aux SIE intégrées dans le système éducatif formel.
1. Les écoles coraniques, ou écoles coraniques traditionnelles, également connues aujourd’hui sous le
nom de dougouma kalan. L’enseignement y est dispensé sous la férule d’un maître coranique, le ka-
ramogofa, dans un espace domestique, généralement son domicile, sous un arbre ou un hangar. La
transmission du savoir est essentiellement fondée sur une relation personnelle presque exclusive entre
le maître unique et son/ses disciple(s), les talibés, et consiste en la mémorisation, l’étude du Coran et
l’apprentissage des pratiques religieuses par des groupes d’enfants, des adultes ou groupes d’adultes
de sexes, d’âges et de niveaux différents.
2. Les madrassa, également appelées medersa ou sanfèkalan, est une forme évoluée de l’école cora-
nique. Il a fait son apparition dans l’espace public ivoirien dans un contexte de réformes religieuses
initiées par la tendance sunnite, conduite par des diplômés des instituts de formation du monde
arable, de retour au pays dans les années 1940 (Binaté, 2016). La medersa présente un visage différent
de l’école coranique en termes de gestion du temps d’apprentissage, de construction et d’équipement
des salles de classe – équipée en bancs, tableaux et bureaux. En outre, le contenu enseigné est à la fois
varié et dense, ce qui facilite une meilleure lecture des sourates par les apprenants. En revanche, ces
élèves connaissent moins le contenu ésotérique du Coran que les talibés.
3. Les écoles dites franco-arabes, qui combinent les principes de l’enseignement de l’Islam et de la
langue arabe d’une part, et ceux de l’école laïque de type occidental (caractérisé par l’enseignement
du français et des matières qui y sont rattachées) d’autre part. Dans ce type d’école, l’apprentissage se
fait dans une relation « multi-acteurs », en ce sens que chaque matière est souvent prise en charge par
un enseignant différent. De ce point de vue, les écoles franco-arabes diffèrent de l’école coranique et
de la medersa dans lesquelles existe entre le maître et l’élève un rapport de type binaire.
4. Les établissements confessionnels islamiques, qui ont vu le jour à l’initiative de deux structures mu-
sulmanes – le Conseil National Islamique (CNI) et le Conseil Supérieur des Imams (COSIM) – et la mise
en place de l’Organisation des Etablissements d’Enseignement Confessionnel Islamique (OEECI). A
l’instar des écoles catholiques et protestantes, les établissements confessionnels islamiques sont des
écoles privées qui font partie intégrante du système éducatif national formel, et dispensent donc un
programme d’enseignement commun.
Cette initiative, intervenue à l’issue de la signature tion des écoles islamiques, la création de la CNAE-
d’une convention en 1993 entre le Ministère de l’Édu- SI (Commission Nationale d’Accompagnement des
cation nationale et le Conseil National Islamique Structures Islamiques d’Éducation), un cadre insti-
(CNI), alors organisation fédérative des associations tutionnel dédié à ce programme en 2011, et l’adop-
musulmanes, a initié le suivi et l’intégration pro- tion de mesures d’accompagnement telles l’accord
gressive des SIE par l’État ivoirien. Avec des résul- de subvention annuelle aux écoles islamiques inté-
tats mitigés au départ – moins de 15 établissements grées. Cette nouvelle donne a eu un effet sur la dé-
intégrés au programme éducatif formel en 2005. cision de nombreux promoteurs7 de SIE et en 2014,
Cette implication de l’État s’accentue à partir de on comptait plus de 330 d’entre elles ayant adhéré au
2008, avec le lancement d’un projet pilote d’intégra- programme éducatif national.8.
7 Ici, on entend par promoteurs les acteurs du système éducatif ayant créé leur(s) SIE.
8 Binaté, 2016, p. 139.
18 Les déterminants de la demande sociale d’éducation islamique en Côte d’IvoireBien que ce chiffre témoigne d’une mutation des stra- de scolarisation et préférences éducatives des pa-
tégies éducatives de plusieurs promoteurs d’écoles rents musulmans ayant inscrit leurs enfants dans
et parents d’élèves musulmans, de nombreux en- les écoles formelles et informelles, et les conditions
fants et établissements demeurent néanmoins au- auxquelles ils seraient susceptibles de soutenir et
jourd’hui en dehors de cette marche vers l’intégra- d’adhérer à la demande d’intégration portée par la
tion au système éducatif formel. Dans une étude du SNIESIE (Stratégie Nationale d’Intégration des En-
Ministère menée en 2018, cinq localités se sont il- fants des Structures Islamiques d’Éducation dans le
lustrées comme des espaces de forte présence de ces Système Éducatif formel). Ce rapport présente ain-
institutions éducatives informelles : Abobo, Bon- si les perceptions des parents d’élèves sur les écoles
doukou, Man, Minignan et Soubré. Hormis Abobo, islamiques et publiques, leurs attentes socio-éduca-
une commune d’Abidjan, ces villes ont la particula- tives, religieuses et laïques, et des recommandations
rité d’être des chefs-lieux administratifs de régions pour faciliter leur adhésion au processus d’intégra-
du pays et totalisent 812 des 2 402 écoles islamiques tion des écoles islamiques au système éducatif for-
répertoriées (dont 278 à Soubré, 241 à Bondoukou, mel. En faisant ressortir les contraintes et opportu-
63 à Man, 195 Abobo et 35 à Minignan) (MENET-FP, nités posées par les choix des parents au processus
2018, p.16). d’intégration, ces résultats permettent d’informer
et d’adapter la stratégie nationale pour favoriser un
Face au maintien de ces institutions éducatives in- accès élargi et harmonieux de tous les enfants à un
formelles, la présente étude a cherché à identifier, socle éducatif commun et de qualité.
dans ces cinq zones, les déterminants des choix
2. Méthodologie de l’étude
Les données recueillies de ce travail ont fait l’ob- Dans le cadre de cette étude, l’élaboration et le dé-
jet d’analyses conformément à la méthodologie ploiement de cette approche a reposé sur des en-
SCORE. L’indice SCORE est un instrument d'éva- quêtes de terrain menées en deux phases – l’une qua-
luation et d’aide à la décision développé par SeeD.9 litative et l’autre quantitative – par quatre équipes de
Cet outil statistique participatif vise à quantifier des chercheurs.es d’Indigo Côte d’Ivoire appuyés par In-
phénomènes psychologiques et sociaux, en vue de terpeace et SeeD.
contribuer à l’amélioration de la cohésion sociale,
de la réconciliation et de la consolidation de la paix.
2.1 L’étape qualitative
Dans la méthodologie SCORE, la conception des parents d’élèves et des acteurs du système éducatif
questionnaires d’enquête est précédée par une phase (professeurs, directeurs, …) sur leurs choix éduca-
de recherche documentaire et d’entretiens qualitatifs tifs, leurs modèles de réussite sociale et les facteurs
permettant de contextualiser les questions et d’assu- qui pourraient motiver leur adhésion au processus
rer que les options proposées résonnent avec la réa- d’intégration.10 Les données collectées ont été or-
lité des personnes enquêtées. Conduite du 21 au 30 ganisées entre « idées fortes » – découlant des per-
janvier 2020, cette première phase s’est effectuée ceptions sociales des écoles islamiques – et « condi-
dans quatre localités (excluant la ville de Man, qui tions d’adhésion à l’offre formelle d’éducation »,
a été ajoutée ultérieurement) et a mobilisé 297 per- construites à partir des comptes rendus des propos
sonnes. A travers des groupes de discussion et des bruts des participants consultés.
entretiens individuels, les équipes de recherche ont
interrogé des promoteurs des écoles islamiques, des
9 SCORE Index (scoreforpeace.org)
10 Composition et guide d’entretien des groupes de discussion en annexe 4.
Les déterminants de la demande sociale d’éducation islamique en Côte d’Ivoire 19Tableau 1 : Synthèse du nombre des enquêtés par catégories sociales et par localité
Acteurs
éducatifs
(directeurs,
Fondateurs/ professeur,
directeurs/ …) et parents
Pères Mères professeurs d’élèves
Pères Pères d’élèves d’élèves (avis en tant scolarisés
Type d’élèves d’élèves des FA des SIE/ que parents dans autres
Localités d’entretien SIE/EPP des EC et méd. EPP d’élèves) types d’écoles Total
Groupe de
12 10 12 15 11 0 60
Abobo discussion
Ent. Indiv. 1 1 1 1 1 1 6
Groupe de
15 13 16 15 17 0 77
Bondoukou discussion
Ent. Indiv. 1 1 1 1 1 1 6
Groupe de
10 12 14 14 9 10 69
Minignan discussion
Ent. Indiv. 1 1 1 1 1 1 6
Groupe de
13 10 15 15 14 0 67
Soubré discussion
Ent. Indiv. 1 1 1 1 1 1 6
54 49 61 63 55 14 297
Total 297
Source : Étude demande sociale d’éducation islamique en CI, 2020.
De ce travail de restitution en atelier, des hypothèses l’offre éducative formelle (QR3). Pour une meilleure
organisées autour des trois variables sont à retenir : appréciation des corrélations entre ces variables et
les déterminants des choix des parents pour les types ces hypothèses, un recours a été fait au Mental Mo-
d’écoles (QR1), les perceptions et déterminants de la deler, un outil d’analyse de données d’études quanti-
perception des parents (ayant fait uniquement le choix tatives, qui a été d’un apport considérable dans l’éla-
des SIE non intégrées) envers les EPC/écoles formelles boration du questionnaire de la seconde phase du
(QR2) et les conditions d’adhésion à l’intégration à terrain.
2.2 L’étape quantitative
Les données qualitatives collectées ont ensuite servi lecte de données (ou Kobo Collect), reliée à un ser-
de base à l’élaboration du questionnaire quantitatif. veur central tenu par SeeD.
Le questionnaire conçu comptait 60 questions fer-
mées (Q60), déclinées dans certains cas en plusieurs L’échantillon des enquêtés a été fixé à 200 parents
sous-questions. Les grands axes du questionnaire d’élèves par localité, soit 1000 personnes au total.
sont les suivants : (i) Données démographiques, (ii) Ce quota a été choisi pour disposer d’un échantillon
Parcours éducatif, (iii) Capacité de lire et écrire, (iv) total significatif permettant de s’assurer de la fia-
Connaissance des types d'écoles, (v) Confiance et bilité statistique de l’analyse. L’étude ne couvrant
proximité des autorités, (vi) Ambition pour l'enfant, que quelques localités et n’ayant pas une ambition
(vii) Ouverture à la reforme et (viii) Modelés sco- de représentativité sur l’ensemble du pays, l’équipe
laires. Une tablette numérique a servi d’outil de col- a privilégié un équilibre entre chacune des 5 régions
20 Les déterminants de la demande sociale d’éducation islamique en Côte d’Ivoireétudiées de manière à pouvoir comparer leurs ré- nistère de l'Education Nationale. Sur cette base, le
sultats. La stratégie d’échantillonnage a été calibrée choix des écoles a été opéré de manière aléatoire,
sous forme « d’entonnoir », à travers une méthode par type d'école, dans chaque localité. Ensuite, dans
aléatoire et plusieurs étapes de sélection pour iden- chaque école sélectionnée, les choix des classes, du
tifier les personnes responsables des choix éduca- genre et de l'enfant ont été faits suivant la même dé-
tifs des enfants scolarisés dans les localités d’inter- marche aléatoire. Il en résulte que les individus in-
vention. La première étape a consisté à identifier la terrogés ont eu les mêmes chances d’être choisis que
distribution des types d’écoles (coranique, meder- ceux n’ayant pas été sélectionnés.11 Cette mission
sa, franco-arabe, EPC, publique) par localité, à par- d’administration de questionnaire s’est déroulée du
tir de l'opération d'identification réalisée par le mi- 8 au 30 juin 2020.
Tableau 2 : Échantillon des enquêtés par types d’écoles et par localité
Abobo Bondoukou Minignan Soubré Man Total
EPC 45 45 0 45 45 180
Franco-arabe & Médersa 90 55 55 55 55 310
Ecole coranique 30 65 65 65 65 290
Ecole publique 35 35 80 35 35 220
Total 200 200 200 200 200 1000
L’enquête ciblait les individus responsables des toutes les décisions concernant l’enfant. Dans ces
choix éducatifs des enfants scolarisés dans les lo- quelques cas, les maîtres ont été interrogés en quali-
calités d’intervention. Cela a eu une incidence sur té de « tuteurs », dans la mesure où l’intégration des
la part de femmes interrogées dans l’échantillon, enfants dont ils ont la charge dans le système for-
les pères étant à grande majorité désignés lors des mel dépend d’eux et non des parents « biologiques ».
enquêtes comme chargés des choix sur la scolarité Cela peut constituer un biais méthodologique sur les
des enfants au sein du ménage. Dans de rares cas, résultats, néanmoins limité par le nombre marginal
pour certains enfants scolarisés dans des écoles co- de cas concernés.
raniques, cela a également signifié interroger le tu-
teur/maître coranique à qui l’enfant a été confié plu- La population visée par cette étude étant musul-
tôt que le parent de cet enfant. En effet, l’inscription mane, connue pour être plus dioulaphone que fran-
d’un élève dans une école coranique est assimilable cophone, il s’est également posé la difficulté de la
à une sorte de don de ce dernier à l’enseignant pour langue comme moyen de communication. Pour pa-
faire de lui un homme ou une femme instruit.e des rer au défi de la communication, l’équipe des cher-
valeurs religieuses et utile à sa communauté. Il s’agit cheurs.es a su trouver des mécanismes de contour-
d’un système où l’on confie entièrement les choix nement par la traduction des questions en dioula et
éducatifs concernant les enfants aux maîtres, qui de- l’appui de points focaux recrutés sur le terrain. Dans
viennent pour eux à la fois le parent de substitution certaines zones, une contrainte a également découlé
et le vecteur de transmission de savoirs. A l’issue de du manque de disponibilité des parents pour partici-
l’opération de la procédure aléatoire, certains élèves per aux entretiens. Dans ces cas, l’équipe a dû procé-
se sont ainsi retrouvés confiés aux mêmes per- der au remplacement des personnes absentes ou in-
sonnes. Pour ces élèves, les enquêteurs ont contac-
12
disponibles en utilisant une liste attente constituée
té les parents mais ces derniers les ont souvent ren- dans chaque classe pour pallier aux cas d'indisponi-
voyés vers le maître coranique, qu’ils ont chargé de bilité ou de refus d'être interviewé des parents, se-
11 La sélection aléatoire des parents a néanmoins tenu compte du genre de l’enfant. En ce sens, la sélection a veillé à
assurer un équilibre entre parents de garçons et parents de filles.
12 Ces répondants ont alors été interrogés en qualité de “tuteurs”.
Les déterminants de la demande sociale d’éducation islamique en Côte d’Ivoire 21lon l'approche aléatoire. Enfin, la taille du question- sonne enquêtée oscillait entre 45mn et 1 heure, ce
naire est restée un souci relevé par la majorité des que de nombreux enquêtés ont décrit comme trop
enquêtés. La durée de son administration par per- long.
2.3 La méthode SCORE
Les données recueillies de ce travail ont fait l’ob- disent positivement ou négativement les autres indi-
jet d’analyses conformément à la méthodologie cateurs auxquels ils sont liés. Ici par exemple l’indi-
SCORE. L’indice SCORE est un instrument d'éva- cateur “degré d’éducation religieuse des parents” est
luation développé par SeeD. L’idée du SCORE est mesuré à travers une série de questions :
de quantifier des phénomènes psychologiques et so-
ciaux. Cette approche repose sur des méthodologies → Durée de la scolarité dans une SIE
fondées sur des preuves statistiques dont l’objectif
est de contribuer à l’amélioration de la cohésion so- → Niveau de connaissance du Coran
ciale, de la réconciliation et de la consolidation de
la paix. → Accès à une éducation religieuse hors école (e.g.
enseignement du Coran par les parents, par la fa-
L’indice SCORE quantifie des niveaux de mani- mille, par la communauté…)
festation d’un phénomène social et renseigne ain-
si avec précision des attitudes et comportements
(ex : « engagement religieux »), des perceptions (ex : Heatmap 1 : Degré d’éducation religieuse
« confiance dans le personnel des écoles publiques ») des parents
ou encore des opinions (ex : « rapport à l’autorité »).
Les indicateurs reposent sur une agrégation de plu-
sieurs questions (entre 3 et 10 en général).
Minignan
La combinaison de celles-ci permet de mesurer les
différentes perspectives d’un même phénomène. 2.0
Evaluer « l’engagement religieux » d’un individu re-
Bondoukou
vient par exemple à mesurer la fréquence des prières
quotidiennes, le respect des phases de jeûne, la to-
lérance des mariages inter-religieux, le rapport au
Man
2.6
hijab… 3.0
L’indice SCORE suggère ainsi une mesure standar- Soubre
disée des phénomènes sociaux (scores de 0 à 10) : un Abobo
score de 0 correspond à l’absence totale d’un phé- 3.4
nomène au niveau individuel, régional ou sur l’en-
semble de l’échantillon tandis qu’un score de 10 si-
3.5
gnifie une présence totale du phénomène mesuré.
Les “heatmaps”, ou cartes de chaleur, illustrent le
niveau de manifestation des phénomènes dans les La carte doit donc être interprétée comme suit : de
différentes zones géographiques étudiées. L’ana- manière générale le degré d’éducation religieuse des
lyse causale (à l’aide de modèles d’équations struc- parents est assez faible. Pour que le score approche
turelles) permet de représenter les relations exis- 10 il faudrait que tous les parents de la localité cu-
tantes entre les différents indicateurs. Les modèles mulent une longue scolarité dans une SIE (1), dé-
révèlent les corrélations existantes entre les phéno- clarent un niveau de connaissance du Coran avancé
mènes et montrent les influences réciproques. Les (2) et aient eu accès à une éducation religieuse hors
indicateurs peuvent être des « moteurs » car ils pré- école auprès de tous les acteurs non-scolaires men-
22 Les déterminants de la demande sociale d’éducation islamique en Côte d’Ivoiretionnés (parents, famille, communauté, etc.) (3). A tion religieuse moyenne plutôt faible des parents in-
l’inverse un score de 0 signifierait une absence to- terrogés. En termes de distribution géographique du
tale de connaissance religieuse (due à l’absence de phénomène, les parents résidant dans la commune
scolarisation dans une SIE, un niveau de connais- d’Abobo ont en général un niveau d’éducation reli-
sance du Coran déclaré nul et l’absence de toute édu- gieuse plus élevé que dans les autres régions. C’est
cation religieuse hors école). Par conséquent, ici, des par contre à Minignan que les parents ont reçu le ni-
scores oscillants entre 2 et 3.5 signifient une éduca- veau d'éducation religieuse le plus faible.
3. Les questions de recherche, leurs résultats et
l’organisation du rapport
Comme indiqué plus haut, trois modélisations ont La lecture des résultats de ces modèles permet d’ob-
été opérées (une par question de recherche). La pre- server des similarités entre les déterminants impor-
mière modélisation (QR1) vise à identifier les dé- tants. Le niveau de scolarité formelle des enfants
terminants qui influencent le niveau de scolarité du ménage, la tendance à accepter un changement
formelle dans les ménages de notre échantillon. 13
de scolarité vers une EPC ou encore le soutien à la
Autrement dit, il s’agit d’évaluer le niveau de scola- démarche d’intégration sont renforcés ou affaiblis
rité formelle dans ces ménages et de se demander par sensiblement les mêmes indicateurs14.
pourquoi certains scolarisent leurs enfants dans le
système formel et d’autres dans le système infor- L’organisation du rapport se présente comme suit :
mel. Ici en observant la diversité de situations des
ménages (i.e. certains ont tous leurs enfants dans le → La première partie vise à dresser un profil géné-
système formel, d’autres n’en ont scolarisé que cer- ral de la population visée par l’enquête : descrip-
tains, d’autres encore ont tous leurs enfants scola- tion des caractéristiques sociodémographiques
risés dans le système informel…), il a été possible de l’échantillon.
d’identifier statistiquement les facteurs accen- → La deuxième partie dresse la liste des indicateurs
tuant ou inhibant l'accroissement de la scolarité importants qui structurent la demande sociale
formelle dans les ménages. Ensuite, il était ques- d’éducation islamique15. Ces déterminants sont
tion de se demander sous quelles conditions certains identifiés en fonction du rôle qu’ils jouent dans la
parents pourraient se laisser convaincre par une sco- relation des parents à la scolarité formelle et au
larisation dans le système formel (QR2). A ce niveau, processus d’intégration.
en raison de l’importance particulière accordée à la → La troisième partie revient sur les dynamiques
religion, notre modèle s'est concentré sur les EPC, générales qui tendent à constituer des sources de
en excluant l'école publique qui apparaitrait comme résistance à la politique d’intégration. Il s’agira
un changement trop drastique pour eux. Nous nous ici de décrire ce qui constitue un frein à la scolari-
sommes donc focalisés sur le potentiel de transfor- sation dans une EPC et à l’adhésion au processus
mation de l'informel vers formel. Enfin, la troisième institutionnel. Finalement, il s’agit de revenir sur
modélisation (QR3) cherche à comprendre quels sont des tendances globales qui restreignent les choix
les déterminants qui tendent à renforcer le niveau d’éducation de scolarisation formelle et nuisent à
d’adhésion au processus institutionnel. Ici, il s’agit la réussite de la politique d’intégration16.
de cibler les facteurs qui rendent certains parents → Enfin la dernière partie reviendra sur les recom-
plus ouverts à la démarche d’intégration. mandations et messages clés.
13 Le niveau de scolarisation formelle au sein du ménage est calculé à partir du nombre d’enfants du ménage scolarisés
dans le système formel ainsi que la durée de ce type de scolarisation.
14 Ceux-ci seront principalement décrits individuellement dans la deuxième partie.
15 Ces indicateurs influencent alors le niveau de scolarité formelle (RQ1), la tendance à changer vers une scolarité dans une
EPC (2) et le niveau d’adhésion à la réforme (RQ3).
16 Nous reviendrons ici sur les déterminants négatifs évoqués dans la deuxième partie mais dans une perspective
davantage macro. Autrement dit, ces indicateurs ne seront plus discutés individuellement mais mis en relation avec
d’autres indicateurs et intégrés à des dynamiques descriptives générales.
Les déterminants de la demande sociale d’éducation islamique en Côte d’Ivoire 23Vous pouvez aussi lire