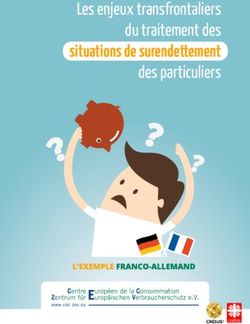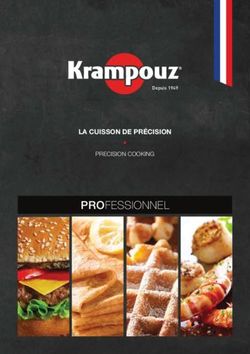Les représentations du travail dans les manuels en usage à l'école primaire marocaine 1923-1989
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Central European Management Journal ISSN:2336-2693 | E-ISSN:2336-4890
Vol. 31 Iss. 1 (2023)
Les représentations du travail dans les manuels en usage à l’école
primaire marocaine 1923-1989
Dyaa Elhak ENNAJI
Université Mohammed V Faculté des Sciences de l’Education Rabat, Maroc.
ABSTRACT
This article deals with the study of representations of the self and the other through the theme of
work developed in the textual and iconographic discourse of twelve school textbooks. First, I define the
role of the textbook in the construction of the young schoolboy and the image he has of himself and of
the other. Secondly, I propose an analysis of some textual and iconographic examples, divided into three
economic sectors: primary, secondary and tertiary, in order to highlight the nature of the economic
activities privileged by each textbook, the characters who carry them out and the age group that is
concerned. Finally, I discuss the data and findings from a synchronic and diachronic point of view to see
if we are dealing with evolving or fixed representations. The results obtained show us that there is a
significant predominance of the tertiary sector, which explains the failure of the integration of
schoolchildren into the labor market later on.
Keywords: Work, economic sectors, representations, social psychology, textbooks, school, discourse
analysis.
1 Introduction
Les manuels scolaires constituent l’un des vecteurs importants de la socialisation des individus. Outre
leur rôle éducatif, ils permettent « d’observer les mentalités et leurs changements » (Choppin 1992, 19), à
travers un certain nombre de représentations sociales, culturelles, identitaires et économiques qui façonnent
l’esprit du jeune écolier et du futur citoyen.
L’analyse de ces manuels, notamment ceux en usage à l’école primaire marocaine entre 1923 et 1989,
nous conduit ainsi à interroger la place, les formes et les représentations de la thématique du travail dans cet
outil didactique. Nous essayons de reconstruire l’image du travail inculquée aux apprenants à travers le discours
textuels et iconographique des manuels d’arabe et de français. Des questions se posent alors : Quelle forme de
travail favorise-t-on dans ces manuels ? privilégie-t-on des métiers manuels ou plutôt intellectuels ? Est-ce que
ces représentations sont figées ou évolutives ? Y a-t-il des convergences ou des divergences quant à la
représentation du travail dans les manuels arabes et français ?
Il convient de souligner ici que notre corpus concerne les manuels de lecture du cycle primaire car c’est
la phase pendant laquelle se forge l’identité du futur citoyen et pour éviter toute dispersion méthodologique qui
pourrait survenir lors de l’introduction des manuels d’autres disciplines. Ce corpus est constitué alors de douze
manuels de lecture étalés sur soixante-six ans, à raison de deux manuels par décennie :
Le livre unique de Français (1923), Au point du jour (1930), Bonjour, Ali ! Bonjour, Fatima ! (1949),
Nos Lectures 1 (1954), Bien Lire et comprendre 1(1961), i q ra’ tome 1(1964), i q ra’ tome 5 (1972), Jawad et
Leila (1972), Bien Lire et Comprendre2 (1979), ’al ’asalib ’aljadida fitarqib ’aljumal (1979), Qitab ’al qira’a
ltilm īd 1 (1988), Mes activités en lecture (1989)
2 La méthodologie adoptée
La présente étude a un caractère exploratoire puisqu’elle se base sur un corpus et non sur un échantillon.
Les conclusions auxquelles nous aboutirons ne sont nullement généralisables sur les autres manuels. Nous y
proposons d’approcher le thème du travail non dans sa dimension philosophique mais plus dans son acception
économique. Nous effectuerons une catégorisation et une périodisation des activités économiques présentes dans
chaque manuel. Nous tâcherons ensuite de préciser l’âge, le genre et l’environnement des personnes qui
effectuent ces tâches.
L’analyse du corpus s’appuiera sur des éléments textuels et iconographiques choisis en fonction de leurs
récurrences dans chaque manuel. Pour ce faire, nous recourrons à une démarche analytique et comparative qui
10.57030/23364890.cemj.31.1.53 496 | P a g eCentral European Management Journal ISSN:2336-2693 | E-ISSN:2336-4890
Vol. 31 Iss. 1 (2023)
réunit la méthode quantitative et qualitative. De surcroit, nous traiterons les données recueillies d’un point de
vue synchronique et diachronique afin de suivre l’évolution, les changements ou les métamorphoses que
pourrait subir le discours des livres scolaires par rapport au développement socio-économique de la société
marocaine.
3 La thématique du travail dans les manuels scolaires
3.1. Qu’est-ce que le travail ?
Le travail est un fait social et culturel permettant d’approcher la façon d’être, de penser et d’agir de
chaque société. Il nous apporte une idée d’ensemble sur la division des rôles et des classes dans les sociétés.
Aussi constitue-t-il un outil privilégié dans le processus de la reproduction sociale. Selon Emile DURKHEIM,
l’institution scolaire aurait un double objectif. Elle vise à la fois l’intégration des « jeunes générations en leur
inculquant des valeurs communes » (Duru-Bellat 2020) tout en organisant « l’aiguillage vers les places inégales
qu’agence la division du travail » . Le discours des manuels scolaires devient donc l’outil adéquat qui façonne
l’esprit de l’élève en lui suggérant ce qu’il faut aimer et respecter et ce qu’il faut haïr et mépriser. Il construit
son système de valeur, lui transmet des modèles d’identification et trace les idéaux de sa vie à venir.
3.2. Les manuels scolaires et les secteurs économiques
Pour étudier en détail les activités présentes dans ces douze manuels, nous avons recouru à la notion de
secteurs économiques (Colin 1960, 38) introduite, en 1947, par l’économiste britannique Colin Clark. Ce
dernier a défini trois secteurs économiques, selon la nature de l’industrie. Le premier secteur dit primaire
comporte l’agriculture, la pêche, l’exploitation minière et l’exploitation forestière. Il concerne la collecte et
l’exploitation directe de ressources naturelles (énergie, matériaux et certains aliments). Le deuxième secteur
nommé secondaire regroupe les activités liées à la transformation des matières premières issues du secteur
primaire. Nous y trouvons des activités aussi variées que l’aéronautique, l’industrie du bois et l’électronique, le
bâtiment et les travaux publics etc. Ce secteur est considéré par Clark comme stratégique parce qu’il fournit du
travail de recherche et développement à des entreprises du secteur tertiaire et fournit des emplois d’ingénieur.
Le troisième secteur, appelé tertiaire, consiste à produire des services. Il rassemble les activités économiques qui
ne font pas partie des autres secteurs comme l’enseignement, l’assurance, le tourisme, les associations, la
formation, l’intermédiation, l’administration, les services à la personne, le nettoyage, etc.
Nous avons choisi d'appréhender les représentations de Soi dans son rapport à l’Autre à travers les
activités exercées par les personnages dans les textes et les illustrations. Par « activité », nous entendons les
activités économiques qu'elles soient formelles ou informelles. Ces trois activités économiques expliquent les
prédispositions du jeune écolier à un type de métiers spécifiques lors de son âge adulte.
Nous avons analysé les images et des textes sur lesquelles figureraient un ou plusieurs personnages
effectuant des activités liées aux secteurs précédemment présentés. Sans oublier que 10% des images des douze
manuels, mettent en scène des animaux comme personnages. Nous avons répertorié, classé et regroupé ces
données dans le diagramme et le tableau suivants :
Figure 1
10.57030/23364890.cemj.31.1.53 497 | P a g eCentral European Management Journal ISSN:2336-2693 | E-ISSN:2336-4890
Vol. 31 Iss. 1 (2023)
Manuels Dates Activités liées au travail
1923 Instituteur/ Ménagère/ Vendangeur/ Laboureur/
maçon/ Tailleur/ Drôle de médecin-docteur /
Le livre unique Cordonnier/ Terrassier/ Maçon/ Charpentier/
de Français Plâtrier/ Vitrier/ Cireur/ Berger/ Libraire/
Boutiquier/ Paysans/ petits métiers/ Fleuriste/
menuisier/ forgeron/ Faucheur/ Soldat/ Boulanger
1930 Vendeur/ Chasseur / Ménagère/ Médecin/
Au point du
Chirurgien (1ère fois)/Bergère/ Marin/ Jardinier/
jour
Faucheur
1949 Brodeuse Fatima (2)/ couturière/Maçon/ /
Jardinier/ Semeur/ Marchand/ Commissions/
Bonjour, Ali !
Instituteur/Enfant jouant au docteur/ Agriculteur/
Bonjour,
Jardinière/ Berger/ Fermière/ Ménagère/
Fatima !
Couturière/ Boutiquier/ Cavalier/ Chauffeur/
Infirmier/ Gendarme/ Potier
1954 Instituteur/ Ménagère/ Fqih/ Berger/ Chasseur/
Serveur/ Bûcheron/ Couturière/ Cireur/ Faucheur/
Vendangeur/ Moissonneur/ Paysan/ Brodeuse/
Nos Lectures 1
Médecin/ Marchand/ Facteur/ Aviateur/ Conteur/
Berger/ Bijoutier/ Epicier/ Cueilleur de dattes/
Laboureur/ Footballeur/ Chauffeur
1961 Ménagère/ Passeur/ Jardinier/ Instituteur/
Bien Lire et Menuisier/ Cueilleur de champignons/ Bûcheron/
comprendre 1 Chasseur/ Marchand/ Médecin/ Pêcheur/
Vendeur/ Policier/ Teinturier/ Moissonneur
1964 Instituteur/ Chat docteur/ Moissonneur/ Brodeuse/
Secrétaire/ Sculpteur/ Agriculteur/
Iqraa, Vol. 1
Berger/Ménagère/ Epicier/ Vendeur du lait/
Institutrice/ Boxeur
1972 Fqih/ Instituteur/ Prof d’histoire géo/
Iqraa, Vol. 5 Chasseur/Brodeuse/ Guerrier/ Potier/ Fermière/
Cueilleur/ Savants/ Jardinier/ Pêcheur/ Peintre
10.57030/23364890.cemj.31.1.53 498 | P a g eCentral European Management Journal ISSN:2336-2693 | E-ISSN:2336-4890
Vol. 31 Iss. 1 (2023)
Ménagère/ Soldat/ Fermier/ Boulanger/ Musicien/
Poète (1ère fois)/ Fantassin / Marchand/ Pâtissier/
Vendeur / Charmeur de serpents/ Moissonneur
1972 Ménagère/ Marchand/ Chauffeur/ Vendeur/
Garagiste/ Epicier/ Contrôleur/ Conducteur de
train/ Cosmonaute/ Speaker/ Directeur/ Ouvrier/
Instituteur/ Boulanger/ Commerçant/ Cordonnier/
Jawad et Leila Mécanicien/ Employé/ Maçon/
Pâtissier/Marchand/ Musicien monitrice/ Médecin
Alaoui (2fois)/ Cuisiniers/ Fermier/ Berger/
Chauffeur/ Coiffeur/ Porteur d’eau/ Côcher/
Boucher/ Policier/ Petit laveur de voiture
1979 Ménagère/ Facteur/ Institutrice/Nettoyeur/
Fermier/ Terrassier/ Médecin/ Jardinier/
Bien Lire et
Pêcheur/Bricoleur/ Fonctionnaire des chemins de
Comprendre2
fer/ /Chasseur/Facteur/ Bûcheron/ Jardinier/
Cueilleuse de cerises/ Paysan/ Policier
Assalib al 1979 Instituteur/ Directeur/ Paysan/ Chasseur/ Pêcheur/
jadida fi tarkib Ménagère/ Médecin/ Facteur/ Policier/ Berger/
al jomal Jardinier/ Marchand/ Boucher/ Epicier/ Pompier
1988 Instituteur/ Ménagère/ Fermière/ Boxeur/ Maçon/
Fonctionnaire de poste/ Epicier/ Prêcheur/
Directrice/Tailleur/ Menuisier/ Soldat
Paysan/ Paysanne/Peintre/ Boucher/ Boulanger/
Maraîcher/ Vendeur de poissons/ Ouvrier/ Porteur
Kitab Al Qiraa
/ Infirmière/ Médecin/ Eboueur
Litilmid 1
Policier/ Pompier/ Scaphandrier/ Pilote/ Infirmier/
Sauveteur/ Pêcheur/ Barbier/ Boucher/
Boulanger/ Présentateur d’émissions/
Teinturier/Tanneur/ Médecin/ Marchand/ Berger/
Boulanger
Mes activités 1989 Commission (maman au souk)
en lecture Ménagère
Le graphique ci-dessus (Cf. à la figure 1) laisse voir un net écart entre le secteur tertiaire et les autres secteurs
dans tous les livres d’arabe et de français, hormis Au point du jour : premier livre de lecture courante. Il est clair
que dans la quasi-totalité des manuels publiés entre 1923 et 1989, les auteurs accordent une grande importance
aux métiers issus du secteur tertiaire tels que l’instituteur, le directeur, le marchand, l’épicier, le chauffeur, le
policier, le cordonnier (Cf. au tableau 1) etc. Un grand nombre de ces métiers concerne des services donnés à la
personne, d’une manière directe ou indirecte. Les quelques extraits textuels et iconographiques ci-dessous
confirment ce constat :
Images :
Image1 : Le livre unique de Français
10.57030/23364890.cemj.31.1.53 499 | P a g eCentral European Management Journal ISSN:2336-2693 | E-ISSN:2336-4890
Vol. 31 Iss. 1 (2023)
Image 2 : Bonjour Ali ! Bonjour Fatima !
Image 3 : Bonjour Ali ! Bonjour Fatima !
Image 4 : Nos lectures 1
Image 5 : Kitab Al Qiraa Litilmid 1
Textes :
Texte 1 : Bonjour, Ali ! Bonjour, Fatima !
10.57030/23364890.cemj.31.1.53 500 | P a g eCentral European Management Journal ISSN:2336-2693 | E-ISSN:2336-4890
Vol. 31 Iss. 1 (2023)
Texte 2 : Nos Lectures 1
Texte 3 : Iqraa vol. 5
Texte 4 : Iqraa vol.5
Dans le corpus d’illustrations présenté ci-dessous, la majorité de ces images mettent en relief des
métiers consistant à donner des services à la personne. Dans la deuxième et la troisième images nous avons deux
activités économiques : l’achat et la vente. Dans la deuxième illustration monochrome nous voyons un père et
son fils dans une boutique d’habits parlant avec un marchand qui semble leur exposer sa marchandise. Cette
image est aussi un tableau opposant modernité et tradition. Le père, portant une bourse et s’habillant d’une
djellaba comme son fils, est censé représenter la tradition. Alors que le marchand, habillé en costume,
représenterait plutôt la modernité. A travers les vêtements que le boutiquier expose au petit garçon, l’image
laisse entendre que le père adhère au fait que son fils s’habille à l’européenne, sans oublier que ce manuel a été
destiné aux élèves marocains de 1949, c'est-à-dire dans une société qui était ancrée fortement dans la tradition.,
Sans oublier que l’achat du prêt-à-porter n’était pas d’usage à cette époque car le Maroc n’avait conclu des
10.57030/23364890.cemj.31.1.53 501 | P a g eCentral European Management Journal ISSN:2336-2693 | E-ISSN:2336-4890
Vol. 31 Iss. 1 (2023)
accords de libre-échange qu’à partir des années 1980, alors la majorité des Marocains se faisait des vêtements
chez des tailleurs. Parmi les services donnés à la personne, nous retrouvons une autre scène, cette fois un peu
fantaisiste. La quatrième image laisse voir un jeune cireur en train de polir les babouches d’une femme vêtue en
haïk et qui se trouvent dans un jardin public. La scène ressemble de près à un tableau orientaliste vu que ce sont
des marocains « recréés » par l’imaginaire européen. C’est une représentation qui « maintient la région et ses
habitants dans des concepts qui les châtient, les réduit à des "attitudes", à des "tendances", bref, les déshumanise
» (SAID 2005, 325). Cela créerait, comme le soulignerait Edouard SAID, un modèle réduit du Maroc et du
Marocain « adapté à la culture (…) dominante » et qui est porté par le discours des manuels scolaires.
Les autres scènes réfèrent à un autre type d’activité liées à la réparation et au bricolage. Ces métiers
sont souvent l’apanage des hommes et des garçons. Elle atteint 28% dans les manuels arabes. C’est souvent un
père qui fait le bricolage assisté par son fils. C’est à partir de 1966 qu'apparaissent d’autres métiers comme le
facteur, le pompier, le scaphandrier et l’infirmier (image 5). Les seules images qui mettent la lumière sur des
activités nécessitant une spécialisation et un certain degré d’intellectualisme restent l’image 1. Elle montre, de
gauche à droite une école, une classe de cours et un élève qui écrit sur un tableau. Les cartes se trouvant à la
gauche du professeur suggèrent un cours de géographie. D’ailleurs, l’enseignement et la médecine sont deux
activités omniprésentes, dans tous les manuels du corpus, avec une augmentation de 43% après 1956
(Indépendance du Maroc). Cette intérêt croissant pour ces deux fonctions, dans les manuels publiés après 1956,
peut-être dû à la nécessité d’une reconstruction du pays et une volonté de revaloriser le capital humain,
exprimée par le premier gouvernement marocain. C’est pour cela que ces deux secteurs sont surreprésentés dans
les manuels conçus par des auteurs marocains tels que Boukmakh. Nous avons aussi remarqué l’émergence des
fonctions liées à la police, surtout dans les manuels d’arabe. Nous y constatons des images dans lesquelles des
enfants jouent aux policiers ou tout simplement un policier organisant la circulation. Dans les manuels d’arabe
publiés après 1956, on commence de s’intéresser aux métiers nécessitant des connaissances spécialisées
(image5). Il s’agit d'un pilote d’hélicoptère de secours. Mais la dimension de l’illustration dans la page ne
valorise pas ce métier.
Ces mêmes constats apparaissent dans le discours textuel. Le premier texte annonce indirectement
l’activité de professeur. L’énoncé est dit par un père qui demande au professeur d’apprendre à son fils à lire, à
écrire et à parler français. Cette interrogation, qui place l’action sur trois phases de l’apprentissage à savoir la
lecture, l’écriture et la parole, omet un autre niveau qu’est la compréhension. Nous verrons ce niveau
d’apprentissage après 1956 lorsque la compréhension de l’écrit et de l’oral était placée au centre de
l’apprentissage des langues.
Le texte 3 nous montre le rôle très important du professeur comme individu qui guide les peuples et qui
est à l’origine de tout progrès dans le monde. Il commence par la phrase suivante : « j’étais en train de lire, ces
derniers temps, la biographie d’un grand homme et je m’étais aperçu qu’il exerçait, pendant son jeune âge,
l’enseignement. » (Iqraa Vol. 5). Après 1956, le Maroc était en manque accru d’enseignants pour « appliquer
dès le début de l’année 1957-1958 et de façon progressive les programmes élaborés par la Commission
(Commission Supérieure de Réforme de l’Enseignement) » (B.I.E 1958, 96). Ce besoin s’explique aussi par une
volonté de mettre à l’essai ces nouveaux programmes en envisageant de créer des classes pilotes ou classes
expérimentales. Donc, l’Etat marocain a dû engager des enseignants venus d’autres pays arabes. Du moins c’est
ce qui a été avancé par le Ministère de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts, qui précise que « le
fonctionnement de ces écoles (les écoles expérimentales) ne pourra cependant être assuré que si le Ministère de
l’Education Nationale dispose d’un nombre suffisant de maîtres dûment qualifiés ; à cet effet, le Ministère a
adressé une demande aux gouvernements syrien et libanais » . Pour donner suite à cette demande, le Ministère
marocain n’a pas seulement embauché des professeurs Syrien et Libanais ; mais a programmé des manuels dont
les concepteurs étaient de ces deux pays.
Passons maintenant aux autres textes du corpus. Nous y relevons différents métiers liés au secteur
tertiaire. D’abord, le deuxième texte illustre le métier du cireur. C’est un service donné à la personne qu’on a
relevé aussi dans les images précédemment analysées. Or, ce texte se veut un peu particulier puisqu’il nous
présente ce métier à travers une bagarre entre cireurs. Ce sont des « indigents qui exercent de petits métiers qui
leur permettent d’assurer leur subsistance quotidienne » et qui se bagarrent sous les regards curieux et distraits
des gens. Ces jeunes cireurs sont peints comme des « animaux » marquant leurs territoires. Outre les
10.57030/23364890.cemj.31.1.53 502 | P a g eCentral European Management Journal ISSN:2336-2693 | E-ISSN:2336-4890
Vol. 31 Iss. 1 (2023)
informations fournies par ce texte sur la situation économique de ces cireurs, on communique aussi des
informations sur leurs âges, en utilisant les termes galopins et jeunes. L’écolier entend par là qu’il y a des
métiers pour les riches et d’autres pour les pauvres. Le discours scolaire contribuerait ainsi à l’enracinement de
l’idéologie de classe. Ce texte est exposé sous forme d’un encadré informatif qui vise souvent, dans Nos
lectures, à présenter le Marocain, son environnement et son comportement. De là, nous remarquons clairement
que les activités intellectuelles et spécialisées sont sous-représentées plus dans les manuels conçus par des
auteurs français que dans ceux élaborés par des Marocains.
3.2.1. Le secteur primaire
Le secteur primaire vient au second lieu dans vingt-six manuels d’arabe et de français publiés entre
1923 et 1989. Nous voyons dans ces manuels des activités consistant à extraire des ressources naturelles, à
travailler la terre ou au simple fait de cueillir des récoltes. Nous y relevons des agriculteurs, des fermiers, des
jardiniers et des vendangeurs. Sachant qu’il y a des activités réservées aux manuels français telles que les
vendanges et la cueillette des champignons. Ces activités sont remplacées, dans les manuels d’arabe, par le
moissonnage. De plus, 53% des activités figurant dans ces manuels sont partagées à part égale entre les hommes
et les femmes, les garçons et les filles, surtout lorsqu’il s’agit du travail de la terre ou de la cueillette. La seule
activité qui est totalement accomplie par les femmes et les petites filles, dans les textes et les illustrations, est la
corvée d’eau. A travers les métiers issus de ce secteur, le Marocain est représenté en tant que cultivateur acharné
sur sa terre ou en tant que moissonneur. La thématique de la terre est d’ailleurs omniprésente dans les dix
manuels d’arabe composant notre corpus. La terre désignerait l’image-mère, symbole si puissant en
psychanalyse. Renvoyant à l'essentiel et au concret, elle nous nourrit et nous la nourrirons après notre mort. Du
coup son travail est béni de Dieu avant tout. Or, ce qui attire l’attention dans les deux discours, c’est le fait
qu’ils placent toujours l’enfant dans le champ à côté de son père. Ces représentations dessineront les traits de la
société dans la mesure où elles influeront négativement la scolarité de l’enfant en le poussant à quitter l’école à
un très bas âge.
Illustrations :
Image 1 : Le livre unique de Français
Image 2 Bonjour, Ali ! Bonjour, Fatima !
10.57030/23364890.cemj.31.1.53 503 | P a g eCentral European Management Journal ISSN:2336-2693 | E-ISSN:2336-4890
Vol. 31 Iss. 1 (2023)
Image 3 Nos Lectures 1
Image 4 Méthode de lecture : Bien Lire et comprendre 1
Image 5 Iqraa, Vol. 1
10.57030/23364890.cemj.31.1.53 504 | P a g eCentral European Management Journal ISSN:2336-2693 | E-ISSN:2336-4890
Vol. 31 Iss. 1 (2023)
Image 6 Assalib al jadida fi tarkib al jomal
Image 7 : Kitab Al Qiraa Litilmid 1
Textes :
Texte 1 : Au point du jour
Texte 2 : Bonjour, Ali ! Bonjour, Fatima !
Texte 3 : Assalib al jadida fi tarkib al jomal
10.57030/23364890.cemj.31.1.53 505 | P a g eCentral European Management Journal ISSN:2336-2693 | E-ISSN:2336-4890
Vol. 31 Iss. 1 (2023)
Les activités appartenant au secteur primaire se répartissent en deux catégories : les tâches relatives au
travail de la terre que nous retrouvons dans les images 1, 2, 5, 6 et d’un autre côté les images renvoyant à
l’extraction des ressources naturelles telles que le moissonnage, la cueillette, la chasse, l’abatage des arbres et la
pêche (images 4, 7). Dans le côté droit de la première illustration, nous voyons deux paysans qui labourent la
terre à l’aide d’une charrue tirée par un cheval. La deuxième image quant à elle met en scène deux personnages,
Moha et Driss, qui labourent une parcelle de terre cahoteuse avec deux chèvres. C’est une scène invraisemblable
vu que le labourage ne se fait nullement à l’aide des chèvres. Souvent dans Bonjour, Ali ! Bonjour, Fatima ! les
auteurs recourent aux personnages-enfants de sorte à accéder et modeler l’imaginaire du jeune écolier. La
cinquième image met en scène un garçon travaillant sa terre avec une sape, près de son bétail. Ses habits
indiquent son appartenance : un Marocain. Cependant, dans l’image 6, nous constatons l’introduction du tracteur
en tant qu’outil moderne de travail. Dans un article intitulé « Histoire et réalité de la modernisation du monde
rural au Maroc », (Marthelot 1961, 137) précise qu’à la veille de la deuxième guerre mondiale, le Maroc a
entrepris une politique de modernisation de l’agriculture. C’est une « amélioration technique et économique
d'une agriculture, et le démarrage d'une société vers des modèles plus modernes » . Parmi ces outils de
modernisation on avait le tracteur. Cet outil n’était pas nouveau pour l’agriculteur marocain « puisque d'assez
nombreux colons, notamment en zone céréalière, avaient l'habitude de faire du travail à façon dans les
exploitations marocaines voisines » (Marthelot 1961, 157). Or, vu les coûts élevés de ces outils de
modernisation, le premier gouvernement marocain d’après l’« Indépendance» a octroyé des prêts aux fellahs via
le Crédit Agricole du Maroc créé en 1961. Depuis cette date la politique économique du pays se focalisait
davantage sur le secteur agricole et sensibilise les fellahs en faveur de la modernisation des outils de production.
La présence du tracteur dans le discours scolaire traduit donc une politique économique qu’on voulait inculquer
au jeune écolier. La troisième image met en scène un chasseur occupant le premier plan. Le mouvement créé par
l’agitation du gibier autour de lui donne à la scène une certaine action. Cela illustre une activité issue du secteur
primaire car elle consiste à exploiter la richesse animale de la forêt. Quant à l’image 4, l’intérêt est porté sur le
secteur de la pêche. Il s’agit d’une photographie de marins qui s’apprêtent à prendre le large. Enfin, la dernière
illustration concerne l’activité de la cueillette.
A partir des extraits textuels, nous isolons l’isotopie du travail de la terre : terre, cultivateur, labours,
sillon, charrue, soc, creuser (Bonjour, Ali ! Bonjour, Fatima !,) . Les protagonistes sont deux petits garçons
(Driss et Moha) qui se sont emparés d’une charrue laissée par un cultivateur nommée (Raho). Ils veulent
ressembler à des fellahs. Driss annonce même à son ami qu’il voudrait se servir d’une charrue quand il sera
grand. Comme nous le lisons dans le texte, cette activité se fait d’une manière traditionnelle. En 1949, date
pendant laquelle ce manuel a été en usage au Maroc, les moyens de production modernes étaient monopolisés
par le colonisateur. Ce n’est qu’au début des années 1960 que le fellah marocain commence à utiliser le tracteur.
S’ajoute à cela le fait que le labourage est représenté dans ce texte d’une façon caricaturale : à travers des
chèvres. Cela accentue le côté invraisemblable de l’image. Il convient de rappeler ici que la majorité des
activités agricoles sont effectuées par les membres de la famille. Même les femmes et les enfants y contribuent,
ce qui expliquerait le nombre élevé d’enfants dans les familles rurales. Les enfants représentent un capital, un
investissement indirect et de la main-d’œuvre pour le travail de la terre. Quant au rôle de la femme, il se limite
souvent à semer les graines. Mais, avec le développement des enjeux économiques, l’agriculture est devenue
massive. Le travail de la terre n’étant plus limité à la sphère familiale, sera attribué à des fellahs journaliers.
Cela a débuté depuis les années 1960. Le premier texte quant à lui nous renvoie au secteur primaire avec
l’activité de la chasse. Nous y soulignons un vaste champ lexical décrivant cette activité. On parle de fusil, de
chien d’arrêt, de cartouches et de gibecière. Le fait que l’homme chasse ou pêche et que la femme ramasse ou
jardine ; reflète une certaine structure primitive de la vie en communauté dans laquelle l’homme sortait du foyer
pour nourrir sa famille par la chasse ou par la pêche ; alors que la femme veillait sur son foyer et sur son jardin.
Dans notre corpus, la femme se voit attribuée d’autres activités liées au travail du champ comme les semailles et
la cueillette. Cette dernière tâche concerne, dans 23% du discours textuel et iconographiques constituant notre
corpus, les vendanges. Nous notons là une divergence par rapport au discours des manuels d’arabes. De ce fait,
le manuel devient le support d’un double discours qui risquerait de créer des représentations antithétiques dans
l’esprit de l’apprenant. Tantôt on est devant un apprentissage qui ne prend pas en considération le référentiel
10.57030/23364890.cemj.31.1.53 506 | P a g eCentral European Management Journal ISSN:2336-2693 | E-ISSN:2336-4890
Vol. 31 Iss. 1 (2023)
socioculturel des élèves, tantôt nous nous trouvons face à un discours fortement ancré dans la culture et la
tradition marocaines.
3.2.2. Le secteur tertiaire
La prégnance du secteur tertiaire nous permet de dire que les manuels scolaires visent plus à
développer chez l’écolier marocain une vision périssable et usuelle du travail. L’élève se représenterait le travail
plus comme une activité pour subvenir aux besoins quotidiens de la vie qu’en tant qu’activité créatrice
nécessitant des facultés intellectuelles. A travers son identification dans les personnages du manuel, l’élève
apprendra à être passif et incapable de faire des choix. Les activités économiques qu’il fréquente lui sont
imposées à travers leur récurrence au cours des cinq années d’apprentissage élémentaire. De plus, ce sont des
activités inter et transgénérationnelles car les mêmes métiers sont effectués par les différentes tranches d’âge et
les mêmes sexes. C’est ce qui explique la présence des mères ménagères, paysannes ou fermières et des pères
marchands, boutiquiers, chauffeurs, bergers ou épiciers et qui ne sont que rarement ingénieurs, penseurs, pilotes,
comédiens, artistes ou écrivains. Les seuls métiers intellectuels qui reviennent dans presque la totalité des
manuels restent les activités liées à l’enseignement (instituteurs, institutrice, directeur, censeur) et ceux relatifs
au domaine de la médecine (médecin, infirmier, infirmière) . La priorité accordée à l’éducation à l’aube de
l’Indépendance s’est traduite par un investissement important dans le développement des ressources humaines.
Les quatre principes formulés par la Commission Royale de 1957 étaient les suivants : unification,
généralisation, marocanisation et arabisation. Quant aux métiers du secteur sanitaire, il y en a ceux qui sont juste
évoqués par la simple présence de l’objet (laboratoire, hôpital …) ou apparaissent sous forme d’un jeu de rôle
(enfant jouant au médecin et fillette jouant à l’infirmière). Le seul manuel qui donne de l’importance aux
métiers spécialisés est Nos lectures 1 (1954). Les auteurs y introduisent les métiers d’écrivain, de spéléologue,
d’explorateur et de savant (Marie Curie). Les autres métiers intellectuels et spécialisés, bien que sous
représentés, figurent dans les manuels publiés après 1956. Nous retrouvons le domaine de la télécommunication,
de la banque, des finances, des services juridiques, de la création littéraire et de l’aviation. Ils apparaissent
surtout dans Iqraa Vol.1 (1964-1972) et Kitab Al Qiraa Litilmid 1(1988). Nous pouvons déduire de cela que les
métiers qui nécessitent des connaissances théoriques et un certain degré avancé de technicité paraissent de plus
en plus dans les livres arabes en usage au Maroc depuis 1956, surtout dans les manuels Iqraa. Nous y
enregistrons une volonté de détachement des métiers restés longtemps l’apanage des manuels français vers des
activités favorisant plutôt la créativité. C’est dans Iqraa que l’écolier marocain découvre, pour la première fois
dans le corpus, le métier de poète, de pianiste, de comédien, de cinéaste etc. Ce genre de métiers marque
essentiellement les trois derniers manuels d’Iqraa correspondant aux trois dernières années de l’enseignement
élémentaire. La même méthode est revisitée plus tard par d’autres manuels arabes et français conçus par des
pédagogues marocains, au cours des années 1970 et 1980. Outre cela, les prédominances des appellations « le
petit médecin », « le petit berger », « la petite cuisinière » ou « petite ménagère », dans les titres des leçons de
lecture et dans les illustrations qui les accompagnent, transmettent une vision assez limitée et défigurée du
travail de génération en génération. Cette transmission du métier des grands aux petits rend l’école un lieu de
reproduction sociale. Ainsi, on peut stipuler que l'école participe à la reproduction d’un modèle sociétal, au sens
où elle ne prépare pas les nouvelles générations à exercer des métiers en relation avec tous les secteurs
économiques, sans pour autant privilégier systématiquement la reproduction des mêmes fonctions et, par
conséquent, des mêmes inégalités sociales.
3.2.2.1. Le secteur tertiaire chez les Grecs
Les métiers quotidiens, qui sont surreprésentés dans notre corpus, avaient une connotation négative
chez les Grecs. Pour eux, le travail contenant des activités nécessaires à la survie physique de l’homme était
dénué de toute dignité sociale. Ce genre de travaux était réservé aux femmes et aux esclaves. Ils croyaient que la
vocation de l’homme n’est pas de se border à pourvoir aux besoins de la vie car ils deviendraient un obstacle à
l’épanouissement personnel de l’individu. Aristote exclut même l’artisan du droit à la citoyenneté car son corps
serait « déformé » par le contact avec les choses ayant une relation avec la satisfaction des besoins matériels de
l’homme. En ce qui nous concerne, nous ne voulons pas être aussi catégorique que cette conception grecque du
travail puisque les sociétés ont évolué et l’homme doit aussi changer au rythme de ses mutations. L’école est
avant tout le lieu où se forge le futur citoyen, c’est pourquoi elle doit réviser l’objet de son enseignement de
10.57030/23364890.cemj.31.1.53 507 | P a g eCentral European Management Journal ISSN:2336-2693 | E-ISSN:2336-4890
Vol. 31 Iss. 1 (2023)
sorte qu’il soit ancré dans « l’actualité » . Selon Pistrak, l’actualité est « tout ce qui dans la vie sociale de notre
époque est appelé à vivre et se développer, tout ce qui s’agglomère autour de la révolution sociale triomphante
et est destiné à servir l’organisation de la vie nouvelle » (Pistrak 1973, 21). Le contact de l’éducation avec
l’actualité créerait chez l’élève l’esprit d’initiative et l’esprit collectif. Nous devons opérer un lien entre les
activités quotidiennes, manuelles et celles liées à la réflexion. Or, la surreprésentation du secteur primaire et le
fait de se limiter à certains métiers du secteur tertiaire nous donnera un futur citoyen qui se représente le travail
du côté matériel seulement. Certes, le travail manuel et quotidien est très important pour le développement des
facultés motrices et de la dextérité de l’écolier, mais il doit être représenté à part égale avec les autres activités
économiques issues du secteur secondaire. Nous devrions penser, à l’instar de Ricardo, Hegel et Marx, que le
travail est comme « ce grâce à quoi l’homme se découvre, s’approfondit, se réalise » (Boissonnat s.d, 326).
Autrement dit, l’homme ne devrait pas se contenter d’exploiter et de transformer la matière. Le travail pourrait
lui permettre de se transformer lui-même.
3.2.3. Le secteur secondaire
Dans notre corpus, le secteur secondaire est sous-représenté par rapport au secteur primaire, à savoir
25% contre 75%. Cependant, il est quasiment absent dans les manuels français en usage à l’école après 1956.
Nous remarquons dans le graphique (figure 1) qu’il est de moins en moins présent 1961 jusqu’à 1978. Cela
témoigne d’un détachement vis-à-vis de la pensée socialiste des manuels publiés entre 1923 et 1956. L’école
était influencée par la pensée socialiste des années vingt et qui donnait la primauté à la production en tant que
facteur essentiel du développement économique des sociétés. C’est ce qui a amené Marx et Engels à contribuer
à la construction d’une pédagogie socialiste basée sur les relations école-travail-société (Lindenderg 1972).
Néanmoins, l’association de l’éducation et du travail productif génère non seulement une division de la société
en classe, mais aussi de l’homme lui-même ; d’où l’intérêt d’une unification des buts individuels et sociaux pour
conserver à l’homme son individualité. Parmi les métiers issus du secteur secondaire qui sont privilégiés par les
manuels du corpus, nous voyons des activités qui concernent le bâtiment, la construction, la menuiserie, le
textile, l’automobile etc. Nous ne trouvons que rarement des métiers spécialisés dans les domaines de
l’industrie. Ce qui est prédominant est surtout les activités mettant en relief des ouvriers dans une usine, des
maçons en œuvre, des menuisiers dans leurs ateliers de travail, des forgerons, des plâtriers, des tanneurs, des
boulangers, des sabotiers des tailleurs et bien d’autres petits métiers . Ces métiers représentent 92% des activités
issues du secteur secondaire, dans tous les manuels français et arabes. A part cela, il n’y a qu’une seule
évocation du métier d’artisan et de sculpteur, en tant que transformation artistique de la matière, dans Iqraa, Vol.
1(1964). Nous nous rendons compte de cela à travers les illustrations et les extraits suivants :
Images :
Image 1 Le livre unique de Français
10.57030/23364890.cemj.31.1.53 508 | P a g eCentral European Management Journal ISSN:2336-2693 | E-ISSN:2336-4890
Vol. 31 Iss. 1 (2023)
Image 2 Bonjour, Ali ! Bonjour, Fatima !
Image 3 Nos lectures 1
Image 4 Méthode de lecture : Bien Lire et comprendre 1
Image 5 Iqraa Vol. 5
Image 6 : Kitab al qiraa litilmid 1
10.57030/23364890.cemj.31.1.53 509 | P a g eCentral European Management Journal ISSN:2336-2693 | E-ISSN:2336-4890
Vol. 31 Iss. 1 (2023)
Textes :
Texte 1 : Le livre unique de Français
Texte 2 Bonjour, Ali ! Bonjour, Fatima !
Texte 3 Nos lectures 1
Bien que les métiers du secteur secondaire soient sous-représentés par rapport aux autres secteurs économiques,
ils demeurent diversifiés d’un manuel à un autre. Les manuels arabes privilégient les petits métiers liés à
l’industrie légère et artisanale ; alors que les manuels français ne passent pas sous silence les activités en relation
avec les industries lourdes. Les manuels d’arabe, publiés entre 1959 et 1989, mettent en scène des petits métiers
de couturier, de forgeron, d’artisan, de tanneur etc. La troisième illustration nous montre une femme couturière
travaillant sur une ancienne machine près de l’âtre et veillant en même temps sur ses deux enfants, dont l’un est
dans le berceau. La couture est intégrée souvent dans les manuels en tant qu’activité féminine qui s’effectue au
sein du foyer. Pour l’image 5, nous percevons un artisan en train de sculpter le métal avec la pointe de son
marteau. Ses vêtements et le décor qui l’entoure nous renvoie aux quartiers des anciennes médinas marocaines
notamment celui de la ville de Fès où l’on trouve ce genre de métiers. Dans l’image 6 nous avons un tanneur en
train de travailler une peau d’animal. Ce sont des petits métiers à spectre économique réduit puisque ces
personnages n’évoluent pas dans une usine et ne travaillent pas une quantité élevée de produits. L’artisanat d’art
10.57030/23364890.cemj.31.1.53 510 | P a g eCentral European Management Journal ISSN:2336-2693 | E-ISSN:2336-4890
Vol. 31 Iss. 1 (2023)
dans les manuels d’arabe traduirait une volonté de consolider l’apport culturel chez l’écolier. C’est aussi une
volonté de développer chez l’apprenant un certain esprit artistique. Même si l’artisanat n’était pas valorisé par la
pensée philosophique grecque et était longtemps séparé de l’art puisque rémunéré, il contient un côté artistique
car son produit est inédit, beau et irrégulier. Il nécessite, autant que l’art, une connaissance esthétique des
couleurs, des formes et des lignes. Pour les manuels français, les métiers de l’artisanat sont sous-représentés par
rapport aux métiers d’industrialisation. La première image, nous transporte dans un atelier de menuiserie. Il y a
trois personnages dont un menuisier et deux garçons apprentis. Le texte en bas de l’image le confirme. Le bric-
à-brac d’objets montre qu’on est en pleine production et le sourire du meunier symboliserait sa satisfaction du
travail fait par ses petits ouvriers. Enfin, les images restantes désignent le secteur du bâtiment. Dans Bonjour,
Ali ! Bonjour, Fatima !, on est dans un petit chantier de construction composé de quatre ouvriers et un patron au
regard vigilant qui les surveille. La même activité apparaît dans l’image 4 où il y a deux maçons en train
construire un petit mur. Or là, nous ne voyons pas le lieu dans son ensemble. Le dessinateur privilégie l’activité
plus que sa vraisemblance ou le lieu dans lequel elle se déroule.
Le groupement de texte fait souvent écho aux métiers évoqués dans les images analysées. Le nombre
d’images et de textes recueillis dans ces deux derniers corpus sont cités à titre indicatif parce que leur récurrence
a été déjà précisée dans le graphique. Les textes extraits des manuels d’arabe, rappellent les métiers de
l’artisanat que nous avons relevés dans les illustrations. Néanmoins, dans les manuels de français, l’évocation du
secteur industriel est prédominante. Le premier et le deuxième textes (paragraphe 3) décrivent le métier du
menuisier. Dans le texte 1 le personnage principal est un petit garçon attiré par la menuiserie et devient
l’apprenti du menuisier. Il ressent un grand plaisir en se servant des outils de menuiserie qui lui permettent de
matérialiser son monde imaginaire. Dans le deuxième texte, cette activité est citée en tant qu’étape dans la
construction de la maison. Le deuxième paragraphe du texte 2 expose le métier du maçon dans des petits
chantiers. Il contient une isotopie du bâtiment : un manœuvre, la pelle, le sable, le mortier (texte 2) ; pierre, mur,
truelle, cordeau, aligner. L’évocation de ce métier nous réfère, dans le premier texte, aux méthodes de
construction en usage au cours des années 1940 et qui étaient inspirées des Français. Dans Bonjour, Ali !
Bonjour, Fatima ! (1949), le manœuvre prépare du mortier en y mélangeant du sable et de la chaux et dans Le
livre unique de Français, il vérifie la rectitude du mur en y collant sa joue. Ces méthodes, largement dépassées
aujourd’hui, essaient d’inculquer au jeune écolier un certain savoir-faire vérifié souvent via des questions telles
que « quelles sont les actions successives faites par Beaucaire (le maçon) pour placer la pierre ? ». Pour finir, le
dernier texte évoque l’activité du tissage. Le narrateur du texte 3 nous énumère les tâches effectuées par une
brodeuse. Elle coupe, pique, brode, tricote, repasse etc. C’est un travail artisanal que l’artisane suit de bout en
bout ; à l’encontre du travail de chaîne pratiqué dans les usines.
4 Conclusion
En somme, la conception du travail dans les manuels de français et d’arabe tend à favoriser tous les métiers
qui se rattachent aux compétences manuelles. Le Marocain ou l’Africain y apparaît tel un exécuteur de tâches
parce que les travaux qu’il effectue ne nécessitent pas beaucoup de réflexion. Ce sont des tâches répétitives qui
ont un but productif pour satisfaire les besoins journaliers. Or, selon Hanna Arendt, ce qui relevait de la seule
satisfaction des besoins était considéré comme animal. Aussi faut-il rappeler que chez les Grecs le travail
manuel était dévalorisé parce qu’il était regardé comme indigne de la condition d’un homme libre. Il était confié
aux esclaves. La même idée d’infériorité est véhiculée par les concepteurs des manuels français. Cependant,
nous n’entendons pas par-là l’exclusion du travail manuel du circuit scolaire, mais le programmer parallèlement
au travail intellectuel, comme l’explique Rousseau dans l’Emile : « Le grand secret de l'éducation est de faire
que les exercices du corps et ceux de l'esprit servent toujours de délassement les uns aux autres »
(Rousseau1817, 86). La complémentarité dont parle Rousseau favoriserait un enseignement efficace capable de
de garantir l’équilibre et la diversité dans le marché du travail et lutter contre l’idéologie des classes.
Références bibliographiques
Ouvrages
1. Boissonnat, Jean. Le travail en vingt ans : Commissariat Général du Plan. Odile Jacob.
2. Choppin, Alain. Les manuels scolaires : histoire et actualité. Hachette Éducation. France, 1992.
10.57030/23364890.cemj.31.1.53 511 | P a g eCentral European Management Journal ISSN:2336-2693 | E-ISSN:2336-4890
Vol. 31 Iss. 1 (2023)
3. Colin, Clark. Les conditions du progrès économique, traduit par Annie MORIN-RAMBERT. Paris :
Presses Universitaires de France, XVI-508,1960.
4. Cuche, Denys. La Notion De Culture Dans Les Sciences sociales. Paris : Repères, Edition de la
découverte, 2001.
5. Fabre, Daniel. L’Europe Entre Cultures et Nations. Paris : De la Maison des Sciences de l’Homme,
France, 1996.
6. Lindenderg, Daniel. L’internationale communiste et l’école de classe. Paris : Maspéro, 1972.
7. Pistrak, Moiseĭ Mikhaĭlovich. Les problèmes fondamentaux de l'école du travail : Desclée de Brouwer,
1973.
8. Rousseau, Jean-Jacques. Emile ou De L’Education. Edition Stéréotype, France, 1817.
9. Salmi, Jamil. Crise de l’Enseignement des Langues et Reproduction Sociale. Casablanca : Les Editions
Maghrébines, 1985.
Articles
1. Aboulfeth, Kenza. « Le manuel scolaire : Quelle utilisation ? ». El Moudni, Abdellatif (dir.). « Le
Manuel Scolaire et les Supports Pédagogiques ». Cahiers de l’Education et de la Formation no 3.
2. Barthes, Roland. « Histoire et sociologie du Vêtement ». Annales, Économies, Sociétés, Civilisations,
12e année, no.3. 1957.
3. Barthes, Roland. « Rhétorique de l’image ». Communication, no. 4. 1964
4. Belghiti, Imad. « Le Manuel comme Outil de l’Enseignement des Valeurs ». El Moudni, Abdellatif
(dir.). « Le Manuel Scolaire et les Supports Pédagogiques ». Cahiers de l’Education et de la Formation,
No.3. 2010.
5. Bourdieu, Pierre. « L’Identité et la Représentation ». Acte de la recherche en science sociales, Vol. 35.
1980.
6. Hardy, Georges et Brunot, Louis. « L’Enfant Marocain : Essai d’Ethnographie Scolaire ». Ed. du
Bulletin de l’Enseignement Public au Maroc, no. 63.1925.
7. Marthelot, Pierre. « Histoire et réalité de la modernisation du monde rural au Maroc ». Tiers-Monde
Tome 2, no. 6.1961 : 137-168.
Rapport
1. Bureau International de l’Education. Elaboration et promulgation des programmes de l’enseignement
primaire. Genève . 1958.
10.57030/23364890.cemj.31.1.53 512 | P a g eVous pouvez aussi lire