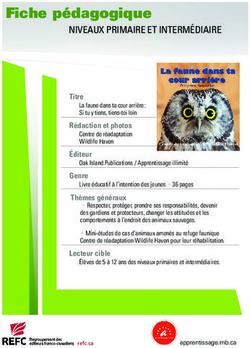Lignes directrices sur : le soin et l'utilisation des animaux
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Conseil canadien de protection des animaux
lignes directrices
sur :
le soin et
l’utilisation des
animaux
sauvagesLe présent document intitulé Lignes directrices du CCPA sur : le soin et l’utilisation des animaux sauvages a été
préparé par le sous-comité ad hoc sur les animaux sauvages du Comité de l’élaboration des lignes directrices
du Conseil canadien de protection des animaux (CCPA) :
M. Peter Austin-Smith, Acadia University (président)
Dre Sandie Black, Calgary Zoo
M. Daniel Bondy, Service canadien de la faune
Dr Nigel Caulkett, University of Saskatchewan
Dr Marco Festa-Bianchet, Université de Sherbrooke
Dr Robert Hudson, University of Alberta
Dr Donald McKay, University of Alberta
M. Michael O’Brien, Department of Natural Resources, N.-É.
Mme Joy Ripley, Fédération des sociétés canadiennes d’assistance aux animaux
Dre Helen Schwantje, Ministry of Water, Land and Air Protection, C.-B.
Dr Todd Shury, Parc national Banff / Calgary Zoo (représentant de l’ACVZF)
Dre Gilly Griffin, Conseil canadien de protection des animaux
De plus, le CCPA est reconnaissant envers le Dr Gerald Miller, University of Alberta et membre du Conseil
du CCPA de 1996 à 2001, qui a été le premier coprésident du sous-comité sur les animaux sauvages avec
le Dr McKay. Le CCPA remercie également les nombreuses personnes, organisations et associations qui
ont commenté les précédentes ébauches de ces lignes directrices, et en particulier les directeurs des services
de la faune des paliers fédéral, provincial et territorial, la Société canadienne de zoologie, l’Animal Behavior
Society / Association for the Study of Animal Behaviour, l’American Society of Ichthyologists and Herpe-
tologists, l’Ornithological Council et l’American Society of Mammalogists. Nous remercions aussi la fonda-
tion Max Bell pour son aide financière lors de l’élaboration de ces lignes directrices.
© Conseil canadien de protection des animaux, 2003
ISBN : 0–919087–40–X
Conseil canadien de protection des animaux
315–350 rue Albert
Ottawa (ON) CANADA
K1R 1B1
http://www.ccac.caLignes directrices du CCPA sur : le soin et l’utilisation des animaux sauvages, 2003
TABLE DES MATIÈRES
A. PRÉFACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. Capture d’animaux vivants . . . . . . . . . .27
2.1 Fréquence de la vérification
des pièges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
SOMMAIRE DES PRINCIPES
DIRECTEURS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
E. CONTENTION . . . . . . . . . . . . . . .29
1. Contention physique et manipulation .29
B. INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . .9
2. Contention chimique et anesthésie . . . .30
1. Animaux sauvages, définition . . . . . . . . .9 2.1 Formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
2. Objet des lignes directrices sur 2.2 Aspects pharmacologiques . . . . . .31
les animaux sauvages . . . . . . . . . . . . . . .10
2.3 Relaxants musculaires . . . . . . . . . .31
3. Éthique de l’utilisation des
animaux sauvages . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 2.4 Administration des médicaments .32
3.1 Responsabilités . . . . . . . . . . . . . . . .12 2.5 Anesthésie sur le terrain . . . . . . . .32
4. Réglementation sur la faune . . . . . . . . .17 2.6 Suivi et soins de soutien . . . . . . . .33
4.1 Réglementation internationale . . .17 2.7 Résidus de médicaments . . . . . . . .34
4.2 Réglementation fédérale . . . . . . . .18
4.3 Réglementation provinciale F. MARQUAGE . . . . . . . . . . . . . . . . .35
et territoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
4.4 Réglementation municipale . . . . . .19 1. Considérations générales . . . . . . . . . . . .35
4.5 Propriétés privées . . . . . . . . . . . . . .19 2. Baguage et étiquetage . . . . . . . . . . . . . . .35
4.6 Associations professionnelles . . . .20 3. Marquage des tissus
(techniques invasives) . . . . . . . . . . . . . . .36
4. Émetteurs radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
C. ÉTUDES SUR LE TERRAIN —
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 21
G. INTERVENTIONS MÉDICALES
1. Projets d’observation . . . . . . . . . . . . . . .22
ET CHIRURGICALES . . . . . . . . . .38
2. Projets impliquant la manipulation
d’animaux sauvages . . . . . . . . . . . . . . . .22 1. Emploi d’analgésiques . . . . . . . . . . . . . .38
2.1 Manipulation indirecte . . . . . . . . .23 2. Interventions mineures . . . . . . . . . . . . . .39
2.2 Projets exigeant la manipulation 2.1 Échantillons de tissu ou de sang . .39
directe d’animaux sauvages . . . . .23
2.2 Mesure des paramètres
3. Morbidité et mortalité sur le terrain . . .24 physiologiques . . . . . . . . . . . . . . . .39
2.3 Isotopes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
D. COLLECTE DE VERTÉBRÉS . . . .26 3. Interventions majeures . . . . . . . . . . . . . .40
1. Spécimens tués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 3.1 Techniques invasives . . . . . . . . . . .40H. TRANSPORT ET HÉBERGEMENT L. GLOSSAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . .57
D’ANIMAUX SAUVAGES . . . . . . .41
1. Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 M. ABRÉVIATIONS . . . . . . . . . . . . . .60
2. Soins des animaux . . . . . . . . . . . . . . . . .41
2.1 Hébergement . . . . . . . . . . . . . . . . .42
ANNEXE A
2.2 Nutrition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
LIGNES DIRECTRICES
2.3 Interactions sociales . . . . . . . . . . . .43
PERTINENTES . . . . . . . . . . . . . . .61
2.4 Hygiène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
3. Déplacement et remise en liberté . . . . . .44
3.1 Considérations d’ordre général . . .44 ANNEXE B
3.2 Considérations d’ordre médical . .45 MODÈLE DE FORMULAIRE DE
3.3 Considérations d’ordre PROTOCOLE POUR PROJET
environnemental . . . . . . . . . . . . . . .46 D’UTILISATION D’ANIMAUX
SAUVAGES EN RECHERCHE,
I. EUTHANASIE . . . . . . . . . . . . . . . .47 EN ENSEIGNEMENT OU DANS
1. Méthodes pharmaceutiques . . . . . . . . . .47 LES TESTS . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
2. Gaz à inhaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
3. Méthodes physiques . . . . . . . . . . . . . . . .48 ANNEXE C
4. Méthodes d’euthanasie inacceptables . .48 CONTACTS UTILES . . . . . . . . . . .67
5. Élimination des carcasses d’animaux
euthanasiés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
ANNEXE D
J. SÉCURITÉ DES PERSONNES . . .50 CATÉGORIES DE TECHNIQUES
INVASIVES DU CCPA POUR LES
1. Risques liés aux médicaments . . . . . . . .50
ÉTUDES SUR LES ANIMAUX
2. Risques physiques et
environnementaux . . . . . . . . . . . . . . . . .51 SAUVAGES . . . . . . . . . . . . . . . . .68
3. Risques liés à l’équipement . . . . . . . . . .51
4. Préparation aux situations d’urgence . .51 ANNEXE E
5. Risques biologiques . . . . . . . . . . . . . . . .51 LISTE DES ORGANISMES DE
RÉGLEMENTATION ET
K. RÉFÉRENCES . . . . . . . . . . . . . . .53 PRINCIPALES LÉGISLATIONS . .70
iile soin et
l’utilisation des
animaux sauvages
A. PRÉFACE
Le Conseil canadien de protection des animaux généraux concernant le soin et l’utilisation
(CCPA) a pour mandat de superviser l’utilisa- des animaux, le CCPA publie également des
tion des animaux en recherche, en enseignement lignes directrices sur des enjeux relatifs aux
et dans les tests, et les institutions universitaires dossiers actuels et à venir (http://www.ccac.
doivent obligatoirement participer à son pro- ca). Le document Lignes directrices du CCPA
gramme. Le non-respect des lignes directrices sur : le soin et l’utilisation des animaux sauvages
et des politiques du CCPA peut entraîner la sus- est le sixième de cette série. Ce document
pension du financement des programmes de remplace le Chapitre XXII — Les vertébrés
recherche et (ou) des institutions en question sauvages sous expérimentation en liberté ou
(CCPA, Manuel sur le soin et l’utilisation des ani- en captivité, Manuel sur le soin et l’utilisation
maux d’expérimentation, vol. 1, 2e éd., 1993; IRSC, des animaux d’expérimentation, vol. 2 (CCPA,
CRSNG et CRSH, Protocole d’entente sur les rôles 1984).
et responsabilités en matière de gestion des subven-
tions et des bourses fédérales, Annexe 3 : Évaluation Le raffinement des lignes directrices sur le soin
éthique de la recherche avec des animaux, 2000). et l’utilisation des animaux est un processus
continu. Le présent document s’inspire dans
Bien que le soin et l’utilisation des animaux une large mesure des travaux des organismes
sauvages soient régis par les législations énumérés à l’Annexe A; nous remercions ces
provinciales, territoriales et fédérale, certains organismes d’avoir généreusement permis au
organismes responsables de la faune ont adopté CCPA de se servir de certains passages des
des lignes directrices sur le soin des animaux, lignes directrices élaborées par leurs divers
y compris celles du CCPA, et ils ont constitué comités. Les renseignements pertinents qui ne
des comités internes chargés de superviser le figurent pas dans les présentes lignes directrices
soin et l’utilisation des animaux sauvages pour font l’objet de références distinctes.
la recherche, la gestion et les procédures opéra-
tionnelles. Beaucoup de ces organismes s’in- Ces lignes directrices ont été préparées par le
téressent de près au programme du CCPA ou sous-comité du CCPA sur les animaux sauvages.
y participent en vue de se montrer imputables En avril 2001, le sous-comité s’est entendu sur
de leur travail auprès du public. une ébauche préliminaire qui a été distribuée
à l’ensemble des directeurs de la faune des
Outre le Manuel sur le soin et l’utilisation des gouvernements fédéral et provinciaux; ceux-
animaux d’expérimentation, vol. 1, 2e éd. (1993) ci ont été invités à apporter leur contribution
et vol. 2 (1984), où sont définis les principes dès les premières étapes. En août 2001, la pre-mière ébauche a été transmise à 56 experts, dont des diverses procédures. Dans la mesure du
les représentants des organismes énumérés à possible, le texte suit une suite logique en allant
l’Annexe A. En janvier 2002, une deuxième des procédures les moins invasives aux plus
ébauche fut distribuée en vue d’obtenir les com- invasives; il décrit aussi tour à tour les diverses
mentaires d’un grand nombre de personnes. étapes de capture, contention, manipulation,
La rédaction de ces lignes directrices a été déplacement, remise en liberté, rétention ou
facilitée par des ateliers qui ont été tenus en avril euthanasie. On a également ajouté un chapitre
2001 à Halifax, N.-É., en collaboration avec le sur la sécurité des personnes étant donné que
Conseil des provinces atlantiques pour les
lignes directrices du CCPA
les comités de protection des animaux ont la
sciences, et en novembre 2001 à Edmonton, Alb., responsabilité de veiller à ce que l’emploi d’a-
conjointement avec la University of Alberta. gents infectieux, biologiques, chimiques, radio-
Les lignes directrices sont présentées sous un actifs ou représentant un danger pour les êtres
format qui devrait faciliter la préparation et vivants fasse l’objet d’une approbation insti-
l’examen des protocoles. Dans la plupart des tutionnelle (Politique du CCPA : Mandat des
cas, l’ordre des différentes sections est le sui- comités de protection des animaux, 2000) et étant
vant : élaboration des plans de recherche, exi- donné que les institutions connaissent les dan-
gences relatives aux permis, puis exécution gers auxquels leur personnel peut être exposé.
2SOMMAIRE DES PRINCIPES DIRECTEURS
B. INTRODUCTION paux de leur institution ou agence, que ces
études relèvent de leur juridiction ou de celle
Principe directeur nº 1 : d’un autre comité de protection des animaux.
le soin et l’utilisation des animaux sauvages, 2003
L’utilisation des animaux sauvages pour la Section 3.1.2 Responsabilités du comité de protection
recherche, la gestion, l’enseignement et les des animaux, p. 15.
tests n’est acceptable que si elle permet l’étude
de principes biologiques ou la recherche de Principe directeur nº 5 :
résultats qui devraient avoir des retombées
bénéfiques pour les humains, les animaux ou Les comités locaux de protection des animaux
les écosystèmes. Les propositions de projets doivent inclure des personnes ayant une
touchant les animaux sauvages doivent être expertise pertinente des animaux sauvages en
évaluées par des experts qui confirmeront leur liberté et (ou) en captivité, ou ils doivent con-
valeur potentielle. sulter des experts indépendants en mesure de
Section 3. Éthique de l’utilisation des animaux sauvages, les renseigner sur la nature de l’étude de terrain
p. 11. proposée et sur ses répercussions.
Section 3.1.2 Responsabilités du comité de protection
Principe directeur nº 2 : des animaux, p. 15.
Tous les projets prévoyant l’utilisation d’ani-
maux sauvages pour la recherche, la gestion, Principe directeur nº 6 :
l’enseignement et les tests doivent faire l’objet
Tous les employés impliqués dans l’utilisation
d’un protocole qui sera approuvé par un comité
des animaux sauvages pour la recherche, l’en-
de protection des animaux avant le début des
travaux (références définissant les exigences seignement et les tests doivent avoir reçu une
pertinentes : Lignes directrices du CCPA : révi- formation adéquate en éthique de l’utilisation
sion de protocoles d’utilisation d’animaux d’expéri- des animaux et avoir la formation et l’expé-
mentation, 1997; et Politique du CCPA : Mandat rience nécessaires à l’exécution des procédures
des comités de protection des animaux, 2000). définies dans le protocole.
Section 3.1.1 Responsabilités des chercheurs, paragraphe Section 3.1.2 Responsabilités du comité de protection
3.1.1.1 Protocoles prévoyant l’utilisation d’animaux des animaux, p. 16.
sauvages, p. 12.
Principe directeur nº 7 :
Principe directeur nº 3 :
On doit consulter des vétérinaires ayant l’expé-
Les chercheurs sont responsables de leurs
rience des animaux sauvages et (ou) demander
propres agissements et de ceux de l’ensemble
leur collaboration pour tout projet pouvant
du personnel participant à leurs études.
avoir des répercussions sur la santé des animaux
Section 3.1.1 Responsabilités des chercheurs, paragraphe
(p. ex., déplacement des animaux, interventions
3.1.1.1 Protocoles prévoyant l’utilisation d’animaux
sauvages, p. 14. médicales ou chirurgicales). On doit également
consulter des vétérinaires ayant l’expérience
Principe directeur nº 4 : des animaux sauvages ou des professionnels
Les comités de protection des animaux ont la expérimentés de la faune pour les activités
responsabilité d’examiner toutes les études nécessitant la contention d’animaux.
qui sont menées par les chercheurs princi- Section 3.1.3 Rôle du vétérinaire, p. 16.
3C. ÉTUDES SUR LE TERRAIN — Principe directeur nº 12 :
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES Sur le terrain, le chercheur doit être prêt à
euthanasier tout animal qui, à la suite de sa
Principe directeur nº 8 : capture, d’une manipulation ou d’une procé-
Les procédures susceptibles d’avoir des effets dure expérimentale, subit une douleur et (ou)
néfastes durables sur une population ou d’af- une détresse impossible à soulager.
fecter sa survie ne doivent être entreprises Section 2.2 Projets exigeant la manipulation directe
qu’exceptionnellement. Lorsque de tels effets d’animaux sauvages, p. 24.
lignes directrices du CCPA
sont probables, le chercheur doit démontrer
que des experts reconnus ont établi que la Principe directeur nº 13 :
procédure envisagée est nécessaire.
Lorsqu’on observe un cas de morbidité pendant
p. 21. ou après une manipulation, on doit prendre
les mesures nécessaires, puis documenter le
Principe directeur nº 9 :
cas et faire enquête. Toute mortalité doit s’ac-
Les activités d’observation doivent être menées compagner d’une nécropsie complète visant à
de façon à limiter le plus possible tout boule- déterminer la cause de la mort.
versement pouvant provoquer l’abandon des Section 3. Morbidité et mortalité sur le terrain, p. 24.
territoires, des domaines vitaux, ou pouvant
entraîner la préemption de l’alimentation, le D. COLLECTE DE VERTÉBRÉS
démantèlement des structures sociales ou l’alté-
ration des relations prédateur-proie. Principe directeur nº 14 :
Section 1. Projets d’observation, p. 22. Les méthodes de mise à mort pour la collecte
d’animaux sauvages doivent être éthique-
Principe directeur nº 10 :
ment acceptables et adaptées à l’espèce. Les
Lors des recherches de terrain prévoyant la chercheurs doivent avoir reçu une formation
manipulation d’animaux sauvages à des fins sur la méthode de collecte proposée pour pou-
expérimentales, les chercheurs doivent pren- voir effectuer une mise à mort éthiquement
dre en compte la biologie et le comportement acceptable.
de l’espèce à étudier et opter pour les procé- Section 1. Spécimens tués, p. 26.
dures les moins invasives et qui permettent
d’atteindre les objectifs de l’étude. Pour la Principe directeur nº 15 :
capture et la manipulation de l’espèce, on doit
s’efforcer de choisir la méthode la plus appro- Avant d’entreprendre un projet de capture sur
priée ou les méthodes les plus appropriées le terrain, le chercheur doit connaître l’espèce
permettant de réduire autant que possible la à l’étude et sa réponse au dérangement ainsi
détresse chez les animaux et d’assurer leur que sa sensibilité à la capture et à la contention.
survie après la manipulation. Le chercheur doit également connaître les
avantages et les désavantages des méthodes
Section 2. Projets impliquant la manipulation d’animaux
sauvages, p. 22. existantes de capture d’animaux vivants et
particulièrement celles qui ont déjà été em-
Principe directeur nº 11 : ployées chez l’espèce à l’étude.
Section 2. Capture d’animaux vivants, p. 27.
Les personnes qui effectuent des recherches
sur le terrain doivent prévoir toute la gamme
Principe directeur nº 16 :
de situations qui peuvent causer un stress
exagéré et (ou) une blessure à l’animal, et elles Le chercheur doit vérifier régulièrement les
doivent être prêtes à y faire face. pièges de capture et les filets pour éviter que
Section 2.2 Projets exigeant la manipulation directe les animaux capturés meurent ou se blessent.
d’animaux sauvages, p. 24. Section 2.1 Fréquence de la vérification des pièges, p. 28.
4E. CONTENTION Principe directeur nº 22 :
On doit s’efforcer de réduire les risques liés
Principe directeur nº 17 : à la contention chimique. On doit toujours
On doit choisir des méthodes efficaces de con- considérer le bien-être de l’animal comme
tention physique qui permettent de réduire le principale priorité tout en tenant compte de la
plus possible les risques de blessure physique sécurité des personnes.
et de stress physiologique et psychologique Section 2.5 Anesthésie sur le terrain, p. 32.
tout en assurant la sécurité des personnes. Le
le soin et l’utilisation des animaux sauvages, 2003
degré de contention et la durée des procé- Principe directeur nº 23 :
dures doivent être réduits au minimum. Le On doit assurer des soins de soutien et un
personnel qui manipule les animaux doit avoir suivi régulier pour réduire les risques de mor-
reçu une formation complète sur les procédures bidité et de mortalité.
prévues et sur les méthodes de contention de Section 2.6 Suivi et soins de soutien, p. 33.
rechange qu’il pourrait avoir à employer.
Section 1. Contention physique et manipulation, p. 29. Principe directeur nº 24 :
On doit prendre des mesures pour éviter que
Principe directeur nº 18 : les médicaments employés sur les animaux
Le personnel chargé de la mise en œuvre de la sauvages entrent dans la chaîne alimentaire.
contention chimique et de l’anesthésie des Section 2.7 Résidus de médicaments, p. 34.
animaux sauvages doit recevoir une forma-
tion reconnue et à jour, et il doit employer les F. MARQUAGE
techniques et les médicaments qui convien-
Principe directeur nº 25 :
nent à l’espèce visée.
Les chercheurs doivent s’efforcer de réduire
Section 2.1 Formation, p. 30.
autant que possible les effets néfastes des
procédures de marquage sur le comporte-
Principe directeur nº 19 :
ment, la physiologie ou le taux de survie des
Les médicaments employés pour la capture animaux à l’étude.
d’animaux sauvages doivent, autant que pos- Section 1. Considérations générales, p. 35.
sible, avoir les propriétés suivantes : pouvoir
anesthésiant; stabilité en solution; efficacité à Principe directeur nº 26 :
petit volume; toxicité et effets physiologiques Le chercheur doit évaluer les besoins de visibi-
néfastes minimaux; rapidité de mise en place lité et d’identification aux fins de la recherche
de l’anesthésie; réversibilité. et les comparer au risque de blessure qui
Section 2.2 Aspects pharmacologiques, p. 31. découle des techniques de marquage (p. ex.,
baguage, étiquetage), et il doit s’efforcer de
Principe directeur nº 20 : choisir la technique qui présente le moins de
Les relaxants musculaires dépolarisants (p. ex., risques à cet égard.
chlorure de succinylcholine) produisent une Section 2. Baguage et étiquetage, p. 35.
paralysie sans anesthésie et ne doivent pas
être employés sans agent anesthésiant. Principe directeur nº 27 :
Section 2.3 Relaxants musculaires, p. 31. On ne doit employer des techniques de mar-
quage qui endommagent les tissus de façon
Principe directeur nº 21 : significative (marquage au fer rouge, ablation
de phalanges, découpe d’oreille et de queue)
Les systèmes d’administration à distance d’a- que si l’on a soumis à un comité de protection
gents anesthésiants à des animaux sauvages des animaux des preuves montrant qu’aucune
en liberté doivent être choisis en fonction de la autre méthode ne permet d’obtenir les résultats
taille de l’animal et du volume de médicament recherchés.
à administrer. Section 3. Marquage des tissus (techniques invasives),
Section 2.4 Administration des médicaments, p. 32. p. 36.
5Principe directeur nº 28 : H. TRANSPORT ET HÉBERGEMENT
Les dispositifs de télémétrie doivent être aussi D’ANIMAUX SAUVAGES
légers que possible. L’émetteur doit peser moins
de 5 p. cent de la masse corporelle de l’animal. Principe directeur nº 33 :
Lorsque c’est possible, on optera pour des dis- Les chercheurs doivent s’assurer que les
positifs plus légers. Les chercheurs doivent soins, la mise en cage et le mode de transport
s’efforcer d’employer des appareils externes conviennent à l’espèce et que les animaux
qui se détachent à la fin de leur vie utile. sont transportés de façon à réduire le stress
lignes directrices du CCPA
Section 4. Émetteurs radio, p. 37. autant que possible et à éviter les blessures.
Section 1. Transport, p. 41.
G. INTERVENTIONS MÉDICALES
Principe directeur nº 34 :
ET CHIRURGICALES
Le chercheur doit obligatoirement étudier et
Principe directeur nº 29 : comprendre les habitudes et les comporte-
ments de toute espèce à garder en captivité.
On doit employer des analgésiques appro-
Cette information lui permettra peut-être de
priés lors de l’exécution de toute procédure
prévenir certains problèmes liés à la captivité.
pouvant produire une douleur significative
Section 2. Soins des animaux, p. 41.
pendant ou après l’intervention.
Section 1. Emploi d’analgésiques, p. 38.
Principe directeur nº 35 :
Principe directeur nº 30 : Les animaux gardés captifs pendant quelques
heures ou en vue d’un transport sur de courtes
Les prélèvements de sang et de tissus, inclu- distances doivent être placés dans des cages
ant les extractions de dents, ne doivent être de rétention adéquates contenant de la litière,
effectués que par des personnes ayant une de l’eau et de la nourriture en quantité suf-
formation appropriée et l’expérience voulue. fisante.
On doit opter pour des procédures et des pro- Section 2.1 Hébergement, p. 42.
tocoles qui permettent d’éviter ou de réduire
la douleur et la détresse. Principe directeur nº 36 :
Section 2.1 Échantillons de tissu ou de sang, p. 39.
L’environnement des animaux gardés en cap-
tivité pendant de longues périodes doit leur
Principe directeur nº 31 :
permettre de répondre à leurs besoins com-
Les chercheurs qui prévoient employer des portementaux, physiques et nutritionnels tout
radio-isotopes doivent avoir reçu une forma- en leur offrant des stimulations physiques et
tion sur l’utilisation de ce type de traceurs. Ils psychologiques au moyen d’occasions d’enri-
doivent obtenir tous les permis requis et s’as- chissement.
surer que les déchets sont éliminés conformé- Section 2.1 Hébergement, p. 42.
ment aux procédures stipulées sur le permis.
Section 2.3 Isotopes, p. 39. Principe directeur nº 37 :
La nourriture et l’horaire des repas doivent
Principe directeur nº 32 : refléter le régime habituel de l’animal et son
Les interventions chirurgicales, y compris les comportement alimentaire normal.
laparotomies, l’implantation de radioémetteurs, Section 2.2 Nutrition, p. 43.
la stérilisation chimique et les autres procé-
dures invasives exposant la cavité abdominale Principe directeur nº 38 :
ou les autres tissus profonds, ne doivent être On doit prendre en compte les relations
exécutées que par un vétérinaire ou sous la sociales et le comportement social des animaux
supervision d’un vétérinaire. sauvages gardés en captivité.
Section 3. Interventions majeures, p. 40. Section 2.3 Interactions sociales, p. 43.
6Principe directeur nº 39 : d’urgence pour l’euthanasie. À cette fin, les
On doit effectuer les opérations d’entretien connaissances sur les techniques appropriées
régulier de façon à déranger les animaux le d’euthanasie pour l’espèce concernée doivent
moins possible tout en leur assurant une être recherchées et le matériel et l’équipement
hygiène convenable. nécessaires doivent être obtenus et préparés.
On doit également tenter de choisir les tech-
Section 2.4 Hygiène, p. 43.
niques qui interfèrent le moins possible sur la
Principe directeur nº 40 : nécropsie ou sur l’analyse subséquente.
le soin et l’utilisation des animaux sauvages, 2003
p. 47.
Avant de déplacer un animal sauvage ou de
remettre en liberté un animal qui a été gardé
ou élevé en captivité, il faut envisager les réper- Principe directeur nº 44 :
cussions possibles de cette opération. Il faut
Lorsqu’un animal a été euthanasié sur le terrain
prendre en compte et réduire autant que pos-
et que sa carcasse peut contenir des résidus de
sible les répercussions sur l’animal en question,
l’écologie du site de remise en liberté et la substances chimiques toxiques employées
sécurité des personnes. L’animal ne doit pas pour l’euthanasie, elle doit être éliminée de
être relâché si la captivité a rendu sa survie façon à l’empêcher d’entrer dans la chaîne ali-
improbable ou si l’écologie du site de remise mentaire.
en liberté risque d’être altérée, y compris par Section 5. Élimination des carcasses d’animaux eutha-
l’introduction d’une maladie de la faune nasiés, p. 49.
jusque-là inexistante à cet endroit.
Section 3. Déplacement et remise en liberté, p. 44. J. SÉCURITÉ DES PERSONNES
Principe directeur nº 41 :
Principe directeur 45 :
À chacune des étapes d’un programme de
déplacement ou de remise en liberté, on doit De nombreuses espèces d’animaux sauvages
prendre toutes les précautions pour assurer la peuvent infliger des blessures graves ou
santé de l’animal. Avant la remise en liberté transmettre des maladies aux personnes qui
d’un animal sauvage, on doit procéder au les manipulent. On doit employer les tech-
dépistage des parasites, traits génétiques indé- niques appropriées de manipulation et de
sirables et agents infectieux connus. contention, et on doit offrir la formation
Section 3.2 Considérations d’ordre médical, p. 45. voulue sur la mise en œuvre de ces techniques
en vue d’éviter les blessures aux animaux et
Principe directeur nº 42 : aux personnes.
Le chercheur doit évaluer l’habitat du site p. 50.
proposé pour la remise en liberté, non seule-
ment pour vérifier que l’endroit répond aux Principe directeur nº 46 :
besoins liés à la survie et à la reproduction de
l’espèce, mais également pour s’assurer que la Les risques liés à l’emploi des médicaments
remise en liberté ne nuira pas à l’intégrité éco- pour la capture et la contention des animaux
logique du milieu. sauvages doivent être identifiés et commu-
Section 3.3 Considérations d’ordre environnemental, p. 46. niqués à l’ensemble du personnel travaillant
au projet. Au moins deux membres de l’équipe
I. EUTHANASIE doivent avoir reçu une formation en premiers
soins et en réanimation cardio-respiratoire, les
Principe directeur nº 43 : autorités médicales locales doivent être infor-
Les procédures de terrain concernant les ani- mées des dangers possibles et on doit avoir
maux sauvages doivent comprendre des plans convenu d’un plan d’évacuation vers un éta-
7blissement médical avant le début du travail proximité d’un aéronef, la plongée, l’escalade,
sur le terrain. le travail à haute altitude, en températures
Section 1. Risques liés aux médicaments, p. 50.
extrêmes et sur la glace.
Section 2. Risques physiques et environnementaux, p. 51.
Principe directeur nº 47 :
Principe directeur nº 50 :
Le personnel chargé d’administrer les médi-
caments aux animaux sauvages doit avoir reçu Le personnel chargé de la contention des ani-
une formation à jour et informer les autres maux sauvages doit avoir reçu une formation
lignes directrices du CCPA
à jour sur l’emploi de l’équipement connexe
membres de l’équipe des risques liés à l’expo-
(p. ex., véhicules tout terrain, embarcations
sition des personnes. Sur le terrain, on doit
nautiques, armes à feu, médicaments, fusils à
disposer de l’antidote à effet réversible en
fléchettes, pistolets et dispositifs d’injection).
quantité suffisante s’il existe.
Section 3. Risques liés à l’équipement, p. 51.
Section 1. Risques liés aux médicaments, p. 50.
Principe directeur nº 51 :
Principe directeur nº 48 :
Le chercheur a la responsabilité de veiller à la
On doit faire un effort raisonnable pour mise en place d’un plan d’urgence.
récupérer toutes les fléchettes qui ont raté
Section 4. Préparation aux situations d’urgence, p. 51.
l’animal et qui contiennent des substances
pharmaceutiques pouvant poser un risque Principe directeur nº 52 :
pour la santé publique.
Le chercheur doit veiller à ce que le personnel
Section 1. Risques liés aux médicaments, p. 51.
concerné soit informé, avant le début du travail
de terrain, de tous les agents biologiques dan-
Principe directeur nº 49 : gereux ou de zoonoses pouvant être rencon-
Le chercheur a la responsabilité de veiller à ce trés lors d’une étude sur le terrain et qui sont
que le personnel concerné soit informé des particuliers à l’espèce à l’étude, à ce que la for-
risques liés au travail de terrain. Certaines situa- mation soit dispensée et à ce que les mesures
tions exigent une expérience et (ou) une for- préventives d’ordre médical soient prises.
mation particulières, par exemple le travail à Section 5. Risques biologiques, p. 51.
8B. INTRODUCTION
Les présentes lignes directrices sont néces- Lorsqu’ils évaluent des protocoles d’études
sairement générales et limitées à des principes devant être mis en œuvre dans l’habitat naturel
fondamentaux qui seront utiles aux chercheurs, d’une espèce donnée, les CPA doivent consi-
aux gestionnaires de la faune et aux comités dérer que les conditions de travail peuvent
le soin et l’utilisation des animaux sauvages, 2003
de protection des animaux (CPA) qui seront rendre nécessaires des approches et procé-
amenés à rédiger et à examiner des protocoles dures autres que celles qui seraient employées
et des procédés normalisés de fonctionnement en laboratoire. Les CPA doivent également
(PNF). Conjointement à ces lignes directrices considérer que les protocoles de mise à l’essai
générales, d’autres recommandations visant de dispositifs ou de techniques peuvent com-
les divers groupes d’espèces sauvages ont été porter une part d’incertitude afin de permettre
rédigées et affichées sur le site Web du CCPA l’évaluation des méthodes les plus efficaces et
(http://www.ccac.ca). Ces lignes directrices et les plus acceptables éventuellement utilisées.
recommandations s’adressent aux chercheurs
et aux gestionnaires de ressources des univer- 1. Animaux sauvages, définition
sités, des collèges et des parcs zoologiques
ainsi qu’aux instituts de recherche, aux orga- Aux fins de ce document, les animaux
sauvages sont définis comme étant des
nismes et industries du domaine des ressources
vertébrés sauvages en liberté ou captifs, ce
naturelles, aux gouvernements et à leurs
qui comprend les amphibiens, les reptiles,
agences, aux organismes non gouvernementaux
les oiseaux et les mammifères (à l’exclusion
et aux consultants auxquels font appel les
des poissons). La définition inclut toutes les
institutions et les organismes publics. Les per-
espèces introduites et indigènes ainsi que
sonnes qui travaillent à des projets liés à la
les animaux domestiques qui sont devenus
gestion des populations, à la lutte contre les
féraux.
animaux nuisibles et à d’autres formes de ges-
tion de la faune susceptibles de se répercuter La définition d’animal sauvage peut se limiter
sur le bien-être des animaux visés sont invitées au gibier à plumes et à poil ou s’étendre à tous
à lire ces lignes directrices; elles leur seront utiles les organismes sauvages. Cependant, pour plus
lors de la rédaction de PNF ou pour l’étude de commodité, on a besoin d’une définition
des exigences réglementaires. qui englobe un nombre limité d’espèces et qui
est acceptable pour une large gamme de pro-
Les études fauniques réalisées sur le terrain fessionnels de la faune. Le document Lignes
ou en captivité peuvent comporter une vaste directrices du CCPA sur : l’utilisation des poissons
gamme de techniques plus ou moins invasives en recherche, en enseignement et dans les tests (en
et porter sur des espèces dont la réponse face préparation) est publié séparément. Les prin-
à la présence humaine est très variable. Pour cipes directeurs relatifs à la recherche sur la
trouver les méthodes de capture, de contention faune domestique commerciale (bison, cerf)
et de manipulation les plus efficaces, on doit sont inclus dans les Lignes directrices du
tenir compte de la vaste gamme de tailles, de CCPA sur : l’utilisation des animaux de ferme en
caractères physiologiques et de comportements recherche, en enseignement et dans les tests (en
des animaux. Le laboratoire, dont les para- préparation). On pourra consulter d’autres
mètres sont contrôlés tout au long de l’étude, organismes pour trouver des lignes directrices
ne constitue pas nécessairement un modèle sur les animaux gardés en captivité dans les
valable pour les conditions qui prévalent le institutions zoologiques (Association des zoos
plus souvent lors d’études sur le terrain; et aquariums du Canada [AZAC]; American
cependant, les règles qui régissent les bonnes Zoo and Aquarium Association [AZA]) ou sur
pratiques relatives au bien-être des animaux l’élevage des espèces sauvages (p. ex., Conseil
sont les mêmes sur le terrain qu’en laboratoire. de recherches agro-alimentaires du Canada
9[CRAC] http://www.carc-crac.ca/french/ L’utilisation d’animaux sauvages en recherche,
codes_de_pratique/index.htm). en enseignement et dans les tests soulève des
questions éthiques qui doivent être résolues
Les Lignes directrices du CCPA sur : le soin et avant le début de chaque projet. Il est essentiel
l’utilisation des animaux sauvages couvrent les de soumettre le protocole à un examen appro-
animaux sauvages en liberté ainsi que ceux
prié pour s’assurer que les procédures et les
capturés dans la nature et qui ne sont pas
techniques de recherche sur le terrain modi-
habitués à vivre en captivité. Pour les ani-
fient le moins possible l’habitat et le compor-
maux qui doivent être maintenus en captivité
tement des animaux, et qu’elles représentent
lignes directrices du CCPA
pendant de longues périodes, on devra con-
un risque minimal pour ceux-ci. Certaines
sulter les lignes directrices pertinentes (du
études peuvent nécessiter la mise à mort d’ani-
CCPA et autres).
maux pour le prélèvement de spécimens bio-
logiques aux fins d’un programme de gestion.
2. Objet des lignes directrices La rédaction du protocole conformément aux
sur les animaux sauvages présentes lignes directrices assurera que les
méthodes employées sont efficaces et éthique-
Les recherches sur les espèces animales sauvages
ment acceptables. Certaines études de gestion
et leurs habitats sont d’une importance capitale
de la faune peuvent avoir comme but la modi-
pour la compréhension de notre relation avec
fication de l’habitat ou du comportement, ou
l’environnement (ABS et ASAB, 1997). Les
elles peuvent consister en un suivi de la
connaissances découlant de ces travaux peuvent
réponse des animaux à des modifications de
s’avérer primordiales pour ce qui est du bien-
leur habitat. Ces études doivent également
être des sociétés humaines, et elles contribuent
tenir compte des risques encourus par les ani-
également à la protection et au traitement
éthique de tous les vertébrés, qu’ils vivent en maux. Pour assurer un traitement approprié
liberté ou en captivité. Bien que l’avancement aux animaux sauvages gardés en captivité,
de la connaissance scientifique puisse justifier on doit leur fournir tout ce qui leur permet de
les recherches sur la faune, il est souvent mener une existence normale; on doit égale-
impossible de prévoir les effets des procédures ment veiller à ce qu’ils puissent être remis en
de recherche sur le terrain sur les animaux liberté si cela est considéré comme approprié.
touchés et sur leur habitat. De nombreuses De façon générale, on doit traiter les animaux
études sur le terrain portant sur les vertébrés de façon à ne pas nuire à leur capacité de
sauvages se limitent à la simple observation reprendre leurs activités normales lorsqu’ils
des animaux. D’autres champs de recherche seront relâchés. Cependant, certaines modifi-
nécessitent une certaine manipulation de l’ani- cations pourraient être nécessaires dans cer-
mal, que ce soit sur le terrain ou en captivité tains cas; par exemple, la stérilisation ou la
(ABS et ASAB, 1997). Les études effectuées contraception peut s’inscrire dans une stratégie
risquent d’interrompre les activités normales spéciale de gestion des populations.
de l’espèce, notamment lorsqu’on effectue des
Les animaux sauvages touchés par les études
captures, du marquage ou d’autres procédures
doivent être traités de façon appropriée, non
plus invasives.
seulement pour des raisons éthiques et juri-
L’objet des présentes lignes directrices est de diques, mais également pour des raisons scien-
réduire le stress ainsi causé aux animaux. Les tifiques (ABS et ASAB, 1997). De façon générale,
animaux en état de détresse ont parfois un des procédures éthiquement acceptables
comportement anormal et peuvent être plus doivent nuire le moins possible à chacun des
exposés à la prédation ou aux blessures. Le animaux touchés par l’étude, aux populations
stress excessif peut également affecter leur état et à leur habitat, ce qui permet par ailleurs
de santé, leur performance et leurs fonctions d’obtenir des données expérimentales de plus
immunitaires et reproductives. grande valeur.
103. Éthique de l’utilisation des une espèce en danger ou menacée pour la
animaux sauvages protection de cette espèce ou de son habitat.
• On doit choisir les techniques les moins
Principe directeur nº 1 :
invasives et qui causeront le moins de souf-
L’utilisation des animaux sauvages pour la france; la réduction de la douleur et de la
recherche, la gestion, l’enseignement et les détresse doit constituer une priorité dans
tests n’est acceptable que si elle permet toutes les stratégies envisagées relatives au
soin et à l’utilisation des animaux sauvages.
le soin et l’utilisation des animaux sauvages, 2003
l’étude de principes biologiques ou la re-
Le bien-être physique et psychologique de
cherche de résultats qui devraient avoir l’animal doit toujours prévaloir sur les con-
des retombées bénéfiques pour les hu- sidérations de coûts et de commodité sans
mains, les animaux ou les écosystèmes. compromettre la sécurité des personnes.
Les propositions de projets touchant les En outre, l’objectif des mesures de raffine-
animaux sauvages doivent être évaluées ment devrait miser l’emploi des techniques
qui ont le moins de chance de se répercuter
par des experts qui confirmeront leur
sur le comportement normal de l’animal.
valeur potentielle.
• Les chercheurs doivent saisir les occasions
La Politique du CCPA : Principes régissant la de publier leurs techniques de raffinement
recherche sur les animaux (1989) couvre tant les afin d’améliorer le bien-être des animaux à
animaux sauvages utilisés à des fins de l’étude.
recherche, d’enseignement ou de tests que les
animaux de laboratoire. Les fondements éthi- • On doit opter pour l’utilisation du plus petit
ques des lignes directrices et des politiques du nombre d’animaux possible tout en permet-
CCPA reposent sur le respect des trois prin- tant d’obtenir des données valides et sta-
cipes relatifs aux techniques expérimentales tistiquement significatives. Dans les études
appropriées tels que définis par Russell et Burch sur le terrain tout comme dans les travaux
(1959), soit le remplacement, le raffinement et de laboratoire, une bonne méthodologie
la réduction. Selon le CCPA, le respect de ces constitue le principal outil permettant de
trois principes (Trois R) signifie que : réduire le nombre d’animaux nécessaire
pour arriver à un résultat donné. Cepen-
• Le chercheur ne peut utiliser des animaux dant, les études sur le terrain exigent sou-
que si tous les efforts qu’il a entrepris pour vent des échantillons plus larges que celles
trouver d’autres méthodes d’acquisition de menées en laboratoire parce qu’il faut tenir
l’information recherchée ont échoué. Du compte de la variation propre à l’environ-
point de vue de la conservation, il est préfé- nement et de la variabilité intrinsèque de
rable de remplacer une espèce menacée ou l’hôte, lesquelles sont impossibles à con-
rare par une espèce plus commune. Cepen- trôler. Une évaluation statistique préalable
dant, cette décision ne modifiera en rien de la taille de l’échantillon est nécessaire
les aspects relatifs au bien-être des animaux même lorsque seule une évaluation gros-
puisque l’espèce de remplacement sera sière des sources de variation est possible.
probablement une proche parente de l’espèce Il est également important de se familiariser
menacée ou rare et qu’elle aura ainsi un avec les ouvrages qui rapportent des études
degré de sensibilité comparable. Dans le cas de ce type portant sur la taille de l’échan-
des études de terrain portant sur l’écologie, tillon et la méthodologie. Il est aussi pos-
l’écophysiologie ou le comportement d’une sible de réduire le nombre d’animaux utili-
espèce donnée, on reconnaît qu’il sera sés si l’on facilite la diffusion des données
probablement impossible de remplacer et si l’on publie les résultats sous des formats
celle-ci par un modèle non animal ou même facilement accessibles.
par une autre espèce ayant un degré de
sensibilité moindre. De plus, il pourrait être • Dans la mesure du possible, les recherches
nécessaire d’effectuer des recherches sur doivent permettre d’employer des spécimens
11à plusieurs fins ou de les combiner avec d’aider les chercheurs et les membres des CPA
des échantillons provenant de d’autres à s’acquitter des leurs responsabilités, telles
saisons d’étude sur le terrain pour optimiser que définies ci-dessous :
leur utilisation. Cela concerne également
la collecte d’échantillons biologiques et 3.1.1 Responsabilités des
génétiques pour l’archivage, là où cela est chercheurs
possible.
• L’évaluation du mérite scientifique ou de 3.1.1.1 Protocoles prévoyant l’utilisation
lignes directrices du CCPA
la valeur potentielle de toute étude doit d’animaux sauvages
avoir été effectuée avant l’examen éthique
Principe directeur nº 2 :
par un CPA. Lorsque ces dispositions n’ont
pas été prises dans le cadre de la demande Tous les projets prévoyant l’utilisation d’ani-
de subventions de recherche, le CPA doit maux sauvages pour la recherche, la gestion,
faire cette démarche en vue d’un examen l’enseignement et les tests doivent faire
indépendant du mérite scientifique (Lignes
directrices du CCPA : révision de protocoles d’uti- l’objet d’un protocole qui sera approuvé
lisation d’animaux d’expérimentation, 1997). par un comité de protection des animaux
avant le début des travaux.
On doit encourager la publication des résultats
des études sur les animaux sauvages sous forme (références définissant les exigences perti-
de rapports en bonne et due forme (p. ex., article nentes : Lignes directrices du CCPA : révision de
scientifique, base de données accessible, rapport protocoles d’utilisation d’animaux d’expérimentation,
formel). Les relevés ou les inventaires visant à 1997; et Politique du CCPA : Mandat des comités
déterminer la présence de certaines espèces de protection des animaux, 2000)
dans une zone donnée, l’utilisation de l’habitat, Les chercheurs ont la responsabilité de faire
la taille de la population, etc., peuvent contribuer approuver leurs travaux de recherche par leur
à l’avancement de la science de la conservation. institution. Ils ont également la responsabilité
Les chercheurs doivent tenir compte des con- de transmettre le protocole approuvé au CPA
naissances traditionnelles ou locales et des local chargé de superviser les projets ayant
valeurs des communautés concernées et, le cas lieu dans le secteur de l’approbation.
échéant, ils doivent partager avec la commu- Un modèle de formulaire de protocole pour les
nauté locale leurs connaissances au sujet des projets impliquant l’utilisation d’animaux sau-
espèces en question. Le Conseil international vages est proposé à l’Annexe B. Étant donné
des unions scientifiques et l’Organisation des que les conditions de terrain peuvent être im-
Nations Unies pour l’éducation, la science et la prévisibles, le CPA doit savoir qu’il pourrait
culture (UNESCO) (ICSU, 2002) reconnaissent
être nécessaire d’adapter certaines des procé-
l’avantage des échanges réciproques d’infor-
dures décrites dans un protocole donné selon
mation entre les scientifiques et les détenteurs
les conditions du moment. Cependant, le for-
de connaissances traditionnelles. Les chercheurs
mulaire de protocole préparé par le CPA local
doivent savoir que les connaissances tradition-
doit être rempli de façon complète et exacte.
nelles peuvent faire l’objet de droits de pro-
priété intellectuelle, et ils doivent suivre les Lors de la préparation d’un protocole, les
lignes directrices pertinentes (CRM, CRSNG chercheurs doivent :
et CRSH, 1998). Byers (1999) traite du point de
vue des autochtones concernant la recherche • d’abord et avant tout, définir l’objectif de
sur la faune. l’étude du point de vue pratique ou péda-
gogique; situer les travaux dans une per-
3.1 Responsabilités spective plus large et expliquer en quoi
l’étude pourra contribuer à l’avancement
Des informations détaillées sont fournies tout général de la connaissance ou aux résultats
au long des présentes lignes directrices afin recherchés; et justifier l’importance des résul-
12Vous pouvez aussi lire