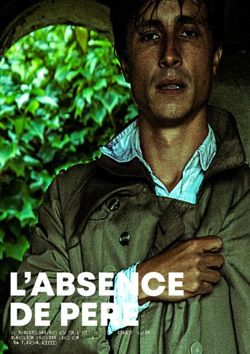Love&Collect La cuisine du peintre Dorothée Selz (née en 1946) - dorothee-selz.art
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Love&Collect
8, rue des Beaux-Arts
Fr-75006 Paris
Du lundi au samedi
de 10 h à 19 h
www.loeveandco.com
collect@loveandcollect.com
+33 1 42 01 05 70
La cuisine du peintre
Dorothée Selz (née en 1946)
11.03.2021
Dorothée Selz
Filtre improvisé
1993
Technique mixte sur bois
Titrée, signée et datée au dos
47 × 60 cm
1/25Si le sculpteur Nouveau Réaliste Daniel Spoerri est le «Pape du Eat Art», Dorothée Selz est sa première disciple. 3/20
Love&Collect
8, rue des Beaux-Arts
Fr-75006 Paris
Du lundi au samedi
de 10 h à 19 h
www.loeveandco.com
collect@loveandcollect.com
+33 1 42 01 05 70
La cuisine du peintre
Dorothée Selz (née en 1946)
11.03.2021 Si le sculpteur Nouveau Réaliste Daniel Spoerri est le Pape du
Eat Art, Dorothée Selz est sa première disciple. Compte tenu
de ses engagements constants, notamment féministe, et de son
rejet viscéral de toute autorité illégitime, l’expression semble
d’abord contre-nature. Invitée, en 2015 à participer à l’exposition
The World Goes Pop à la Tate Modern de Londres, elle apparaît
soulagée que l’époque soit venue de dépasser une certaine
image, parfois figée et superficielle, de l’art des années 1960,
dont elle a été pleinement partie prenante: Quelle vision avions-
nous à l’époque, nous les artistes, du pop art? Pas seulement
le pop art esthétisant, coloré et amusant, mais le pop art plus
politique, plus engagé sur, par exemple, le rôle social de
la femme?
Son irruption dans le Eat Art, par une œuvre collaborative,
réalisée avec son mari d’alors, le sculpteur catalan Antoni
Miralda, joue indéniablement sur la dimension sacrée qui,
traditionnellement, unit art et nourriture. Comme le rappelle
en effet l’historienne de l’art Camille Paulhan, spécialiste de
l’artiste, le grand début de la carrière artistique de Dorothée Selz,
c’est véritablement la constitution en 1967 d’un duo d’artistes
avec Antoni Miralda, les Traiteurs coloristes. Tout part d’une
fantaisie, pour Noël 1967, lorsque Selz et Miralda envoient à leurs
amis le Croque-Jésus, une carte de vœux en trois dimensions
fabriquée à partir de produits alimentaires fabriqués en série
et achetés dans le commerce: l’assemblage propose un petit
enfant Jésus meringué dans sa crèche, entouré d’une mâchoire
en sucre, le tout fixé à la colle vinylique dans une petite boîte
en rhodoïd circulaire à motifs floraux.
Ces dimensions spirituelles, rituelles, anthropologiques,
éphémères, critiques, chromatiques, décoratives… ne sont
naturellement pas totalement absentes du Eat Art version
Daniel Spoerri, mais elles n’en constituent pas le centre, alors
qu’elles infusent absolument tout l’art de Dorothée Selz depuis
l’origine. Spoerri est arrivé au Eat Art par l’extérieur, par l’objet,
en fixant ses reliefs de repas présentés à la verticale en
Tableaux-Pièges susceptibles de leurrer le regardeur, tandis
que Selz se place à l’intérieur même de la relation, ô combien
intime et mystérieuse, entre l’être et ce qui le nourrit. Dans ce
sens, le Croque-Jésus de 1967 est absolument programmatique:
il donne chair et forme à l’absorption du corps du Christ, la
sortant du registre symbolique où elle est traditionnellement
cantonnée, mais sous forme d’un ready made, s’emparant
d’une confiserie anodine réservée aux enfants. Dès lors,
le sucré est devenu le royaume de Dorothée Selz (elle a même
été la co-commissaire de l’exposition de référence sur le sujet,
Sucre d’art, au Musée des arts décoratifs à Paris en 1978,
regroupant des œuvres populaires en sucre du monde entier,
4/25 des pâtisseries, de l’Art Brut et du Eat Art issu de la collectionpersonnelle de Daniel Spoerri).
Réalisée en 1993, cette œuvre est la dernière disponible
d’une série importante, élaborée par Dorothée Selz à partir
des cent trente-sept gravures sur bois et dix planches
chromolithographiques réalisées par le dessinateur Étienne
Antoine Eugène Ronjat pour le célèbre Livre de Pâtisserie
de Jules Gouffé, paru chez Hachette en 1873. Naturellement,
cette entreprise porte la trace de l’attirance de Dorothée Selz
pour l’imagerie populaire (forgée dès l’enfance, son père,
Guy Selz, figure du monde des arts et grand collectionneur,
notamment d’art populaire et de chromos), mais aussi de son
travail au long cours sur les usages culinaires, de la conception
des plats à leur consommation. Élève du grand Antonin
Carême, Gouffé est un célèbre cuisinier et pâtissier, que ses
contemporains surnommaient précisément l’apôtre de la
cuisine décorative. Pourtant, l’illustration choisie par Dorothée
Selz comme base de cette œuvre n’est pas l’une de celles –
sublimes, exquises de symétrie et de détails décoratifs – d’un
plat dressé (comme le fait, à la même époque, Philippe Mayaux,
qui s’inspire du même livre pour certains de ses plus célèbres
tableaux d’aspics), mais d’un ingénieux ustensile improvisé
par système D...
En effet, l’image de Ronjat apparaît à la page 379 de l’ouvrage,
au chapitre XI Entremets de douceur, dans la partie Gélatine,
lorsqu’il s’agit de filtrer cette infusion de couenne indispensable
en pâtisserie. En effet, l’usage d’une chausse est alors
incontournable… À défaut de disposer de ce filtre conique en
feutre ou en tissu épais, de la forme approximative d’un soulier,
Gouffé préconise de tendre une serviette à œil de perdrix sur un
tabouret renversé, et de la fixer avec de la ficelle aux quatre pieds.
Apologie de la débrouille, l’image choisie par Dorothée Selz
paraît énigmatique et mystérieuse, son lien avec la nourriture
n’apparaissant pas immédiatement. Mais elle témoigne d’une
attirance certaine pour le renversement et le passage d’un
domaine vers un autre, caractéristique de tout son art, qui invite
à questionner ce que l’on voit, et à dépasser les apparences,
et les réactions premières qu’elles suscitent en nous.
Ce lien à la fois étroit et suspicieux à la vision est à la base même
du concept de mimétisme relatif emblématique de son œuvre,
par lequel, ainsi que le souligne Camille Paulhan, il n’est pas
uniquement question de dénoncer [les] images, mais comme
le titre l’indique, d’exprimer la fascination que celles-ci peuvent
exercer: le mimétisme peut être perçu comme une contrainte,
mais également comme une façon de [se les] approprier.
5/25Le grand début de la carrière artistique de Dorothée Selz, c’est véritablement la constitution en 1967 d’un duo d’artistes avec Antoni Miralda, les «Traiteurs coloristes». Camille Paulhan 6/25
7/20
L’inspiration se trouvait dans les rues, les affiches, les publicités, la mode. La pop était influencée par des tendances subversives, qui protestaient contre la rigidité des institutions, les traditions conservatrices et le rôle des femmes en tant que femmes au foyer. Dorothée Selz
Love&Collect
8, rue des Beaux-Arts
Fr-75006 Paris
Du lundi au samedi
de 10 h à 19 h
www.loeveandco.com
collect@loveandcollect.com
+33 1 42 01 05 70
La cuisine du peintre
Dorothée Selz (née en 1946)
Propos recueillis par l’équipe Le terme Pop Art était-il utilisé par vous-même ou par des
de la Tate Modern en juillet 2014 artistes autour de vous, ou existait-il une autre terminologie
dans le cadre de l’exposition faisant référence à un nouveau mouvement d’art figuratif dans
«The World Goes Pop», les années 1960 et au début des années 1970?
commissaires Jessica Morgan
et Flavia Frigeri Oui, je connaissais le terme Pop Art depuis le début des années
1960; il était utilisé par mes amis artistes. Plus tard, vers 1969,
j’ai découvert le Nouveau Réalisme et rencontré le critique et
commissaire d’exposition Pierre Restany.
Notes sur mes découvertes:
Je suis née à Paris en 1946 et j’ai grandi dans cette ville. Dès
mon plus jeune âge, j’ai été attirée par les arts visuels et j’ai visité
de nombreuses expositions, souvent avec mon père Guy Selz
(1901-1976), qui travaillait à l’époque comme journaliste pour
le magazine ELLE; il était Secrétaire Général (directeur
administratif) et responsable de la section culturelle du
magazine. Entre 1964 et 1967, je suis allée à l’école Camondo,
une école d’architecture intérieure. L’École des Beaux-Arts de
Paris en 1964 semblait ne jamais avoir entendu parler du Pop
Art, des performances, de l’art abstrait ou de l’Op Art et je ne
voulais pas étudier dans une institution aussi conservatrice.
Je suis une autodidacte.
En 1965 à Paris, le Pop Art britannique et le Pop Art nord-
américain n’étaient pas beaucoup exposés; je ne connaissais
que la galerie Alexandre Iolas, qui avait ouvert en 1964.
Le Centre Américain avait un excellent programme intégrant
les avant-gardes expérimentales américaines, françaises et
internationales comme le Festival Fluxus, John Giorno, John
Cage, le théâtre de Marc’O, Bernard Heidsieck, la poésie action
ou la poésie visuelle, le Living Theatre, Philip Glass. Cela a
constitué mon université marginale, où j’ai tout découvert et
appris. J’étais fascinée par ces nouveaux modes d’expression,
ces œuvres subversives, provocantes, poétiques et dérangeantes.
Vous êtes-vous déjà considérée (aujourd’hui ou par le passé)
comme une artiste pop?
Pas vraiment, mais la culture pop m’a influencée. Aujourd’hui
encore, je peux me définir comme influencée par le Pop art, le
Eat Art et la performance. Entre 1962 et 1972, je suis souvent allée
à Londres. J’étais fascinée par les Beatles, les Rolling Stones,
le rock britannique, les concerts au Roundhouse, l’Arts Lab
créé par Jim Haynes (1967), le design des pochettes de disques,
la mode chez Biba, le style de Twiggy, le style de The Shrimp
[Jean Shrimpton], les maquillages de Mary Quant, les artistes
pop que j’avais vus dans les galeries – Peter Blake (chez Kasmin),
Richard Hamilton – et les événements à l’ICA [Institute of
9/25 Contemporary Arts]. À Londres, ce sont surtout les changementsradicaux de la société, les changements socioculturels, qui
étaient les plus visibles et palpables. J’étais fascinée par une
partie de la jeunesse britannique. Je vivais et embrassais
pleinement la culture pop, je voulais être pop, que je le sois
ou non. L’inspiration se trouvait dans les rues, les affiches,
les publicités, l’industrialisation de la vie quotidienne, la mode.
La pop était influencée par des tendances subversives, qui
protestaient contre la rigidité des institutions, les traditions
conservatrices et le rôle des femmes en tant que femmes au foyer.
J’ai pensé que le statement de Harald Szeemann, When Attitudes
Become Form, titre de son exposition, pouvait être appliqué
à d’autres pratiques et recherches artistiques que le seul
minimalisme.
Votre travail était-il lié à l’actualité des années 1960 et du début
des années 1970?
Oui, mon travail était lié au contexte socioculturel des années
1960 à 1975. La société changeait ainsi que les comportements
et je ressentais la nécessité de développer de nouvelles attitudes
dans mon travail:
- de nouveaux sujets picturaux liés à des questions
sociopolitiques d’actualité
- de nouveaux modes d’action en dehors des galeries
(performances dans la rue pour désacraliser l’art)
- de nouvelles approches du public (avec sa participation active)
- l’utilisation de nouveaux matériaux (industriels ou inhabituels,
comme le comestible)
- des tentatives de destruction de quelques tabous (à l’instar
de nos prédécesseurs dadaïstes).
La société française était alors en pleine métamorphose. J’ai
vécu les événements de mai 1968 à Paris avec conscience, gravité
et euphorie: manifestations étudiantes et ouvrières, mouvements
féministes, libération sexuelle, prise de conscience de toute
une population. Révolution? plutôt Évolution.
L’actualité était aussi à l’origine de peurs ou d’interrogations:
- la guerre d’indépendance de l’Algérie contre la France
(1954-62)
- la dictature du Général Francisco Franco en Espagne
- les États-Unis et la guerre du Vietnam
- les dictatures en Amérique Latine
- le Black Power aux États-Unis
- la guerre froide et la course au nucléaire entre les États-Unis et
l’Union soviétique (cf. Docteur Folamour film de Kubrick)
10/25Mais l’actualité était aussi marquée par une certaine utopie
et poésie, avec la Beat Génération, le mouvement hippie, la
nouvelle littérature et le boom de la musique, avec Woodstock
en 1969 et le festival de l’île de Wight, auquel je suis allée. J’étais
une fan des Who et de Jimi Hendrix.
Les jeunes se sentaient soit en danger, à cause des guerres et de
la répression (selon les pays), soit dans un mouvement utopique,
aspirant à un nouveau mode de vie (comme les hippies, les
beatniks), avec la musique rock et ses immenses rituels collectifs.
Je me suis identifiée à cela.
En France, le boom économique a permis aux femmes d’être
indépendantes financièrement. Il y avait alors peu de chômage
et la vie quotidienne ne coûtait pas cher. L’évolution des
traditions, des lois et les changements socioculturels ont permis
enfin aux femmes d’avoir d’autres rôles dans cette société en
mutation. J’étais féministe et je le suis toujours, dans le sens des
droits à défendre, du nouveau rôle social des femmes, des
hommes, et des changements à construire dans la vie privée,
en parallèle avec les changements de la société. Cela impliquait
aussi de nouvelles relations sexuelles/érotiques, mais bien sûr
avec la complicité des hommes, dans la mesure où une nouvelle
femme implique aussi un nouvel homme, non?!
En septembre 1969 à Paris, j’ai réalisé ma première performance
collective avec mes amis artistes Antoni Miralda, Joan Rabascall
et Jaume Xifra au Centre américain – une installation-
performance rituelle visuelle et comestible qui recherchait la
participation directe du public, avec un esprit pop indirect. Nous
avons rencontré Pierre Restany en 1969 et Daniel Spoerri en 1971.
Depuis 1973, nous poursuivons nos propres carrières artistiques,
influencées - entre autres - par le pop art. Et nous restons des
amis très proches.
J’étais fascinée par le comestible en tant que nouveau matériau
expérimental (j’ai travaillé avec des boulangers et des pâtissiers),
et j’ai collaboré avec Miralda sous la bannière Miralda-Selz
Traiteurs Coloristes et créé de nombreuses œuvres comestibles.
Comment avez-vous choisi le sujet de votre œuvre incluse dans
The World Goes Pop?
De 1960 à 1975, la femme était représentée dans l’imagerie
populaire (calendriers) ou sophistiquée (magazine Playboy ou
œuvres d’Allen Jones) comme une séductrice, une femme fatale
ou une pseudo prostituée. Ou, à l’inverse, comme une femme
au foyer ou une mère de famille. Ces deux clichés étaient les
plus courants: mère ou femme fatale. Je pensais que les femmes
11/25 étaient dans une position ambiguë, entre le désir secret deressembler aux mannequins sexy et le rejet de ces modèles.
C’est dans cet esprit que j’ai conçu cette série où je me suis mise
en scène comme un mannequin, en soulignant avec humour
l’ambivalence de l’image féminine dans les photos sexy. En
posant comme un modèle – à imiter ou à rejeter? – je devenais
moi-même le modèle de ce sujet délicat. Quel genre de femme
vais-je devenir? A quelle femme voudrais-je ressembler? Quelle
femme suis-je? Je ne voulais pas me dépeindre, mais je ne voyais
personne d’autre que moi pour illustrer mon intention. En fait,
je dirais qu’en présentant le modèle et moi-même, le sujet
est double, c’est un duo complexe: le modèle et son imitation,
le modèle et son imitation ironique, le modèle anonyme et
moi-même.
Au fil des années, je me suis interrogée sur la vie de cette femme
anonyme - quelle était la vie réelle du modèle?
Notes sur les processus de création des diptyques:
1. Choisir une image parmi des centaines.
2. Je me fais photographier nue (ou pas) sur un fond blanc.
Je prends la même pose.
3. Imprimer les photos en noir et blanc.
4. Dessiner sur ces photos, à l’encre de Chine, les accessoires
du modèle féminin, ou son environnement (bottes en cuir,
lampe, etc.).
5. Imprimer une deuxième fois en noir et blanc la photographie
avec les dessins ajoutés.
6. Créer le diptyque avec les deux images des deux femmes
dans le même format.
7. Encadrer le duo comme une pâtisserie: la peinture et le ciment
sont appliqués avec la poche à douille d’un pâtissier, le modèle
et moi-même devenons maintenant comestibles, des femmes
offertes à l’œil et au goût.
Le cadre de type comestible est un cadre délibérément absurde,
avec des couleurs de pâtisserie pop: à partir de 1967, je me suis
beaucoup intéressée au comestible en tant que sujet, objet de
partage et matériau de la vie quotidienne.
J’ai réalisé de nombreuses œuvres comestibles accompagnées
des indications Touche-moi ou Mange-moi. Avec aussi cette idée
de partage. Le sexe est tabou mais le comestible l’est aussi s’il
est sorti de son contexte habituel et de sa fonction originelle,
qui est de nourrir. J’ai eu le désir de provoquer de nouveaux
comportements, depuis 1967 jusqu’à aujourd’hui.
Mimétisme relatif, avec son apparence faussement comestible,
posait la question suivante: comment parler avec humour des
femmes stéréotypées?
12/25Où avez-vous puisé votre imagerie (quelles sources avez-vous
utilisées, le cas échéant)?
De diverses sources industrielles et populaires produites en
grande quantité, comme des calendriers, des cartes postales,
des magazines tels que Lui ou Playboy. Elles provenaient toutes
de France, d’Espagne, d’Italie, de Turquie et des États-Unis.
Connaissiez-vous le Pop art dans d’autres parties du monde?
J’avais quelques informations sur le Pop Art en Angleterre et aux
États-Unis. Je connaissais les œuvres du groupe Equipo Crónica
en Espagne, j’ai rencontré le Brésilien Antonio Dias à Paris ainsi
que Lourdes Castro et René Bertholo, du Portugal, Erró, qui est
Islandais, et les Nouveaux Réalistes. Mais je ne savais rien du
Pop Art dans le reste du monde. L’information ne circulait que
par le bouche-à-oreille, qui était plus efficace que la presse.
L’art commercial a-t-il eu une influence sur votre travail ou sur
la manière dont il a été réalisé?
Oui, j’étais très intéressée par l’industrialisation de l’image,
à travers la publicité, les emballages, les photographies de
presse/mode/alimentation, les pochettes de disques, les
affiches de films, les vitrines de magasins, les grands étalages
alimentaires industriels, les nouvelles techniques architecturales,
les formes, les couleurs, les textures: tout dans l’environnement
urbain quotidien m’inspirait. Pour gagner ma vie, je travaillais
pour le quotidien France-Soir, où je retouchais des photos de
presse, et pour divers magazines de mode. J’essayais de
décrypter les messages des produits et de les déformer. J’ai
été très influencée et inspirée par les dessins de Saul Steinberg.
Aviez-vous le sentiment, à l’époque, de faire quelque chose
d’important et de nouveau, d’apporter un changement...?
Non, je n’en étais pas consciente, mais je pensais être dans
l’esprit de l’époque, et que le sujet était important. La société
française des années 1960 était très conservatrice et vivre un
autre mode de vie demandait beaucoup d’énergie. Ce qui était
important pour moi, c’était ce qui était vécu, et plus que d’opérer
un changement, c’était moi qui changeais. Je n’avais pas assez
de recul pour juger mon travail. Je pensais que les artistes
avaient un rôle à jouer dans la société et devaient s’exprimer
autant que possible. Mais je n’avais pas de plan de carrière et
je ne pensais même pas à photographier le travail que je faisais.
C’est pourquoi il existe très peu de documentation sur mes
œuvres de 1967 à 1975. J’étais motivée par le fait d’expérimenter,
de découvrir, de sentir et de réagir aux choses.
13/25Y avait-il un public pour votre travail à l’époque – et si oui, quelle
a été sa réaction?
Oui, il y avait un public intéressé par mon travail, positif et
surpris par son caractère humoristique. En 1975, Fernando
Amat m’a invité à la Sala Vinçon à Barcelone, une galerie
expérimentale située dans le premier magasin de vente d’objets
de design. Un endroit très visité. Puis en 1976 à la Galerie
Contrejour du photographe Claude Nori, un espace expérimental
exposant de la photographie. Les deux galeries avaient un public
plutôt jeune.
En regardant ces œuvres, que pensez-vous d’elles aujourd’hui?
Aujourd’hui, je pense que le concept et la réalisation de ces
œuvres sont bons, mais je remarque que leur sujet est toujours
d’actualité, et que je pourrais produire plus d’œuvres de cette
série aujourd’hui. En 1970, je pensais que l’imagerie des pin-up
allait disparaître, comme j’étais naïve! Le corps masculin est
aussi devenu une sorte de pin-up dans tous les médias visuels.
En 2014, à travers les publicités, les corps de femmes et d’hommes
sexy (entre autres) sont exposés, offerts à la consommation de
masse par l’imaginaire sexuel collectif. L’industrie, à coup
d’images et de slogans provocateurs, tente de vendre tout et
n’importe quoi. L’art a aussi ses codes provocateurs, comme
Allen Jones en 1970. Apprendre à décrypter les images
trompeuses devrait être enseigné dans les écoles.
La lutte contre les stéréotypes féminins et masculins est toujours
d’actualité. Je suis optimiste et je vois que la nature multiple de
l’identité érotique de l’individu est de mieux en mieux acceptée
dans certaines parties du monde. Le dialogue entre l’homme et
la femme a beaucoup changé, dans notre vie privée et dans la
société. Le monde devient pop? Je dirais, en tant que rêveuse
utopique, The World Goes Sexy.
14/25J’ai réalisé de nombreuses œuvres comestibles accompagnées des indications «Touche-moi» ou «Mange-moi». Le sexe est tabou mais le comestible l’est aussi s’il est sorti de son contexte habituel et de sa fonction originelle, qui est de nourrir. Dorothée Selz 15/25
Pour deux peintres, «parler cuisine» signifie s’échanger des recettes picturales, parler métier, en somme. Pour naturelle qu’elle paraisse, cette analogie entre peinture et cuisine est plus profonde qu’on pourrait le croire. 17/25
Daniel Spoerri réalisait des éditions d’œuvres d’artistes comestibles. Je me souviens qu’il avait fait un Pouce de César en bonbon. Cela nous a forcés à reconsidérer ce que nous appelions les arts visuels. Les œuvres d’art sont-elles vouées à vivre indéfiniment? Dorothée Selz 19/25
Love&Collect
8, rue des Beaux-Arts
Fr-75006 Paris
Du lundi au samedi
de 10 h à 19 h
www.loeveandco.com
collect@loveandcollect.com
+33 1 42 01 05 70
La cuisine du peintre
Quarante-huitième semaine
Quarante-huitième semaine Pour deux peintres, parler cuisine signifie s’échanger des
Chaque jour à 10 heures, recettes picturales, parler métier, en somme. Pour naturelle
du lundi au vendredi, qu’elle paraisse, cette analogie entre peinture et cuisine est
une œuvre à collectionner plus profonde qu’on pourrait le croire. Il y aurait tout à chapitre
à prix d’ami, disponible à ouvrir sur les liens entre art et cuisine – on y croiserait, pour
uniquement pendant l’époque contemporaine, le Nouveau Réaliste Daniel Spoerri,
24 heures. qui a tant œuvré dans et pour le Eat Art, parfois en invitant
l’artiste Dorothée Selz à officier. Celle-ci se remémore: À
l’époque, peu de revues ou de critiques d’art s’intéressaient aux
liens entre l’art et la nourriture, à part Pierre Restany qui fut
l’un des premiers à écrire sur le sujet. Daniel Spoerri réalisait
des éditions d’œuvres d’artistes comestibles. Je me souviens
qu’il avait fait un Pouce de César en bonbon. Cela nous a forcés
à reconsidérer ce que nous appelions les arts visuels. Les œuvres
d’art sont-elles vouées à vivre indéfiniment? Comme avec
le happening, l’avènement du Eat Art a bousculé cette idée
pour mettre en avant celle de l’éphémère et du geste quotidien.
C’est bien cette question du geste qui est au centre de cette
nouvelle semaine, et plus précisément l’analogie entre le geste
du peintre et celui du cuisinier, dans l’idée d’une transmission
exigeante, d’un champ créatif où l’apprentissage de la tradition
est indissociable de la transgression et de la novation.
Dans ses Mémoires, le peintre Giorgio De Chirico livre une
anecdote éclairante, sur laquelle ce tenant du métier
traditionnel est souvent revenu. Elle concerne ses débuts de
peintre, encore enfant, en Grèce, où il découvre cette fameuse
cuisine... J’avais décidé de peindre une nature morte, j’avais
choisi trois citrons, raconte-t-il. J’avais entendu parler de
peinture à l’huile et je pensais que cette peinture se faisait
avec de l’huile. Alors j’ai pris de l’huile d’olive qu’il y avait dans
la salle à manger. Mais l’huile d’olive a cette propriété: elle ne
sèche jamais. Au bout de trois mois, le jaune de ces citrons restait
sur les doigts quand on touchait la toile. Alors j’ai demandé à
un peintre, un vieux monsieur spécialiste de peinture de marine,
qui enseignait quelquefois, et qui m’a parlé de l’huile de lin.
La dimension alchimique de la peinture est consubstantielle
à sa naissance; en effet, les pigments ne sont pas applicables
directement sur un support (même si Yves Klein s’en est
approché). Aussi, pour assurer son adhérence, ils doivent au
préalable être dispersés dans une substance (le liant) afin
de maintenir en suspension les particules en évitant toute
agglomération. À l’ère paléolithique, les liants employés
pouvaient être de l’huile végétale, déjà, mais plus couramment
de la graisse animale, du sang, de l’urine, du crachat…
Le portrait du peintre en alchimiste parcourt toute l’histoire de
l’art. Ainsi, Giorgio Vasari écrit-il en 1550, à propos du créateur
20/25 de la peinture à l’huile Jan Van Eyck: Ce fut une belle inventionet une grande commodité pour l’art de la peinture d’avoir
découvert le coloris à l’huile. Le premier inventeur en fut Jean
de Bruges... Il chercha diverses sortes de couleurs, étant très
amateur d’alchimie et distillant continuellement des huiles
pour composer des vernis et différentes sortes de choses, comme
cela arrive fréquemment aux personnes imaginatives. Dans une
conversation avec le conservateur Didier Ottinger, spécialiste
du Surréalisme, et notamment de Chirico, Magritte et Picabia,
l’artiste Philippe Mayaux établit un parallèle direct entre les
trois disciplines: Un élément connu plus un élément connu égale
un élément inconnu, c’est la base de la cuisine, mais aussi une
métaphore de l’art.
Alchimie, cuisine et peinture sont intimement liées par une
notion centrale: la transmutation, ce changement spontané
ou provoqué d’une substance en une autre.
Quel cuisinier, ou quel peintre, ne se reconnaîtrait dans
l’axiome énoncé par Paul Valéry, en 1936 dans Variété: Ainsi,
des affections de l’âme, des loisirs et des rêves, l’esprit fait des
valeurs supérieures; il est une véritable pierre philosophale,
un agent de transmutation de toutes choses matérielles
ou mentales.
Comme le cuisinier, le peintre apprend à utiliser tous les outils,
avant de les détourner, d’en découvrir de nouveaux usages,
parfois grâce à l’intervention du hasard, voire est contraint
d’en inventer d’inédits, afin d’accompagner sa quête d’un art
réellement neuf: Max Ernst ou Jackson Pollock peignent
directement avec la pâte sortie du tube, ce dernier substitue
au pinceau une simple baguette de bois, ou laisse la peinture
couler d’un seau dont le fond est percé, Yves Klein peint au
lance-flammes, ou par anthropométrie, avec des femmes-
pinceaux, Brice Marden peint avec des branches d’arbre,
Jean Tinguely invente des machines à peindre, Niki de Saint
Phalle perce des poches de peinture à la carabine, Olivier Debré
détourne le balai en un gigantesque pinceau, et Hans Hartung
la sulfateuse…
L’atelier est une cuisine, les pinceaux des ustensiles, la peinture
un appareil… cette semaine nous visitons la cuisine du peintre,
pour en percer à jour les tours-de-mains!
21/25J’avais décidé de peindre une nature morte, j’avais choisi trois citrons. J’avais entendu parler de peinture à l’huile et je pensais que cette peinture se faisait avec de l’huile. Alors j’ai pris de l’huile d’olive qu’il y avait dans la salle à manger. Giorgio De Chirico 23/25
Love&Collect
8, rue des Beaux-Arts
Fr-75006 Paris
Du lundi au samedi
de 10 h à 19 h
www.loeveandco.com
collect@loveandcollect.com
+33 1 42 01 05 70
Actuellement
08.03 12.03.2021 En ligne
Love&Collect: La cuisine du peintre
Gérard Schlosser, Dorothée Selz, Roy Adzak, Philippe Mayaux
et Malcolm Morley. Inscription sur notre site et suivez ce projet
en temps réel sur Instagram et Twitter @loveandcollect
04.03 30.04.2021 À la galerie : 15, rue des Beaux-Arts
Milan Kunc & Philippe Mayaux
Pop & Surréalistes
Depuis qu’il était étudiant à la Villa Arson à Nice, à la fin des
années 1980, le peintre Philippe Mayaux (lauréat du Prix Marcel
Duchamp en 2006) ne cesse de clamer sa dette à l’égard de la
peinture de Milan Kunc. De 17 ans son aîné, celui-ci est né à
Prague, en République tchèque, où il a étudié dans les années
1960 à l’Académie des Beaux-Arts de Prague. Malgré une
carrière internationale bien remplie, Kunc demeure quasiment
inconnu en France, où il n’a exposé que sporadiquement.
Dans la lignée de nos relectures historiques, toujours effectuées
depuis un point de vue contemporain, nous avons décidé de
permettre à ces deux artistes que tout oppose, mais que tout
rapproche, d’enfin pouvoir partager les mêmes cimaises.
Depuis décembre 2020 Nouvel espace : 8, rue des Beaux-Arts
Ouverture de Love&Collect
Stéphane Corréard et Hervé Loevenbruck annoncent
l’ouverture de Love&Collect, « magasin d’histoires de l’art »,
en ligne et à Saint-Germain-des-Prés. Expérimenté depuis
huit mois, le projet en ligne Loeve&Co-llect a été plébiscité
quotidiennement par plusieurs milliers d’abonnés, et
a engendré la vente de près de cent-cinquante œuvres.
Ses initiateurs décident de le pérenniser et de le développer,
en le rendant autonome, et de lui consacrer un espace
physique, au 8 rue des Beaux-Arts à Paris.
25/25Robert Robert et SpMillot ont dessiné cette Fiche pour Love&Collect Écrans imprimables Format 21 × 29,7 cm 28.02.2021 Crédit photographique Fabrice Gousset
Vous pouvez aussi lire